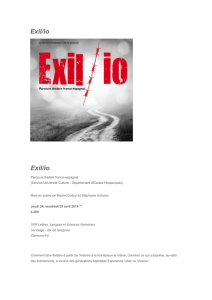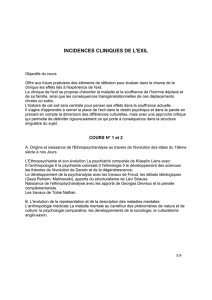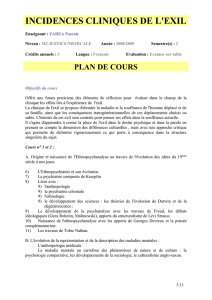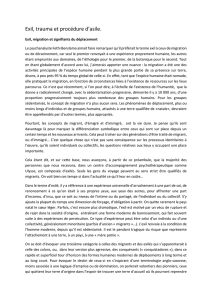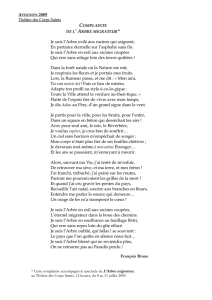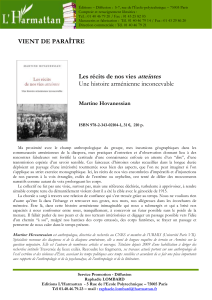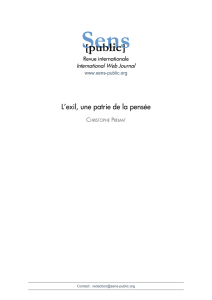dossier d`introduction - exil

www.ciph.org - mccaloz.tschopp@gmail.com
C O L L È G E I N T E R N A T I O N A L
de P
P H I L O S O P H I E
COLLÈGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE (CIPh), PARIS
Programme :
EXIL, CRÉATION PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE
PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ CONTEMPORAINE 2010 – 2016
Suisse - Amérique latine - Méditerranée - Paris
Prof. Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP
Direction du programme
mccaloz@gmail.ch
REPENSER L’EXIL
Premier cours-séminaire UOG 2011, Genève
DOSSIER D’INTRODUCTION
« Et la mer rugit et rugit, elle ne s’occupe pas des fatigues de l’homme, qui voudrait
rugir avec elle et qui perd patience, car elle n’a pas de limites et n’offre jamais de
récompense ».
Ludwig Hohl, Impression, Nante, Le passeur, 1996.
« Le châtiment – la mort mise à part – c’est la privation de liberté. Le reste
appartient aux barbares ».
Robert Antelme, Vengeance ? (1945) Lignes no. 21, 1994, p. 98.
«Penser n’est pas construire des cathédrales ou composer des symphonies. La
symphonie s’il y a, le lecteur doit la créer dans ses propres oreilles ».
Castoriadis Cornelius, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, p. 6.
« Ne suis pas les traces des anciens, cherche ce qu’ils ont cherché »,
Matsuo Bashoo, cité par le poète uruguyen Mario Benedetti.
Genève, février 2011

www.ciph.org - mccaloz.tschopp@gmail.com
Que suis-je sans exil ?
Etranger comme le fleuve au bord du fleuve… L’eau
M’attache à ton nom. Rien ne me ramène de mon
lointain
A mon palmier : Ni la paix ni la guerre. Rien
Ne m’incorpore aux Evangiles. Rien…
Rien ne scintille dans le sac
Et le ressac entre le Tigre et le Nil. Rien
Ne me débarque des vaisseaux de Pharaon. Rien
Ne me porte ou me fait porter une idée : Ni le désir
Ni la promesse. Que faire ? Que
Faire sans exil et sans une longue nuit
Qui scrute l’eau ?
L’eau
M’attache
Mahmoud Darwich, Anthologie (1992-2005),
éd. bilingue, Babel

www.ciph.org - mccaloz.tschopp@gmail.com
Partir
Issa Makhklouf
Nous partons pour nous éloigner du lieu qui nous a vu naître et voir l’autre versant du matin.
Nous partons à la recherche de nos naissances improbables. Pour compléter nos alphabets. Pour charger
l’adieu de promesses. Pour aller aussi loin que l’horizon, d’échirant nos destins, éparpillant leurs pages
avant de tomber, quelquefois, sur notre propre histoire dans d’autres livres.
Nous partons vers des destinées inconnues. Pour dire à ceux que nous avons croisés que nous
reviendrons et que nous referons connaissance. Nous partons pour apprendre la langue aux arbres qui,
eux, ne partent guère. Pour lustrer le tintement des cloches dans les vallées saintes. A la recherche de
dieux plus misécordieux. Pour retirer aux étranger le masque de l’exil. Pour confier aux passants que nous
sommes, nous aussi, des passants, et que notre séjour est éphémère dans la mémoire et dans l’oubli. Loin
des mères qui allument les cierges et réduisent la couche du temps qu’elles lèvenet les mains vers le ciel.
Nous partons pour ne pas voir vieillir nos parents et ne pas lire leur jours sur leur visage. Nous
partons dans la distraction de vies gaspillées d’avance. Nous partons pour annoncer à ceux que nous
aimons que nous aimons toujours, que notre émerveillement est plus fort que la distance et que les exils
sont aussi doux et frais que les patries. Nous partons pour que, de retour chez nous un jour, nous nous
rendions compte que nous sommes des exilés de nature, partout où nous sommes.
Nous partons pour abolir la nuance entre air et air, eau et eau, ciel et enfer. Riant du temps, nous
contemplons désormais l’immensité. Devant nous, comme des enfants dissipés, les vagues sautillent
pendant que la mer file entre deux bateaux. L’un en partance, l’autre en papier dans la main d’un petit.
Nous partons comme les clowns qui s’en vont de village en village, emmenant les animaux qui
donnent aux enfant leur première leçon d’ennu. Nous partons pour tromper la mort, la laissant nous
poursuivre de lieu en lieu. Et nous continuerons ainsi jusqu’à nous perdre, jusqu’à ne plus nous retrouver
nous-mêmes là où nous allons, afin que jamais personne ne nous retrouve.
In, Les Poètes de la Méditerranée. Anthologie, Poésie/Gallimard, 2010, p. 248-249.
“L’exil intérieur”
« L’exil n’est pas le départ, un départ parmi d’autres possibles, dont on saura seulement plus tard
qu’il est devenu la marque dans le temps individuel, d’une coupure, d’une cassure et le début d’un vide,
un cavité pâle où seule la porte est visible, parfois aveuglante, alors qu’autre chose peut-être a déjà
commencé.
L’exil n’est pas le voyage. Il peut être bref, le voyage, quelques heures d’avion ou de train
rapide, et n’équivaut pas à l’errance – les experts mondiaux en savent quelque chose, qui ne se meuvent
jamais sans garder les contacts activés avec leurs repères terrestres et on incorporé le jet Lag dans leur
horloge biologique, toujours nageurs, jamais perdus. Pourtant, le voyage peut devenir interminable, à
bord de camions chaotiques ou marchant dans le désert, parcours scandés par les arrêts intempestifs et les
attentes imprévues sous les cartons ou les carcasses de voitures lorsqu’arrivent les traques urbaines ou
aériennes des polices, leurs chiens et leur « chasseurs » aux frontières, ou leurs drones dans les aire. Alors
le voyage lui-même, qui ne trouve pas son lieu d’arrivée, devient le hors-lieu où commence l’exil.
L’hétérotopie angoissante aux yeux et au ventre de ceux qui ont une place quelque part (et qui se
rassurent en pensant « s’ils sont dans ce trou noir si proche, ils ne peuvent pas être pareils à nous »).
Agier Michel, Le couloir des exilés. Etre étranger dans un monde commun, Marseille, Le Croquant, 2011,
p. 21.

www.ciph.org - mccaloz.tschopp@gmail.com
Esclavage, pensée, liberté
« J’ai découvert que, pour rendre un esclave satisfait, il faut le rendre sans pensée. Il faut
obscurcir sa vision morale et mentale et, autant que possible, anéantir la force de la raison ».
Douglass F., 1980, 94.
Qu’est-ce qu’être esclave?
« Pourquoi suis-je esclave? Pourquoi certaines personnes sont-elles esclaves et d’autres maîtres? Y a-t-il
jamais eu une époque où il en était autrement? Une fois mon investigation commencée, il ne me fallut pas
longtemps pour trouver la vraie solution du problème. Ce n’était pas la couleur mais le crime, ce n’était pas Dieu
mais l’homme qui fournissait la véritable explication de l’existence de l’esclavage; je ne mis pas longtemps non
plus à découvrir une autre vérité importante : ce que l’homme peut faire, l’homme peut le défaire(...).
Je me souviens distinctement avoir été alors profondément impressionné à l’idée d’être un jour un homme libre.
Cette assurance réjouissante devint un rêve inné de ma nature - une menace constante contre l’esclavage -, un
rêve que tous les pouvoirs de l’esclavage ont été incapables de réduire au silence ou de détruire (Douglass, 1980,
8).
Le désir de la liberté en tant qu’équivalent général
« Tandis que je me débattais dans ces affres, il m’arrivait de penser qu’apprendre à lire avait été une
malédiction plutôt qu’une bénédiction. Cela m’avait fait voir ma misérable condition sans m’en donner le
remède. Cela m’ouvrait les yeux sur l’horrible gouffre, mais sur aucune échelle avec laquelle sortir. Dans mes
moments de souffrance, j’enviais la stupidité de mes compagnons d’esclavage. J’ai souvent souhaité être un
animal. Je préférais la condition du plus misérable reptile à la mienne. N’importe quoi, peu importe, pourvu que
je cesse de penser! C’était cette éternelle pensée de ma condition qui me torturait; il n’y avait aucun moyen de
m’en débarrasser. Elle s’imposait à moi à travers chaque chose que je pouvais voir ou entendre animée ou
inanimée. La trompette d’argent de la liberté avait suscité dans mon âme une vigilance éternelle. Désormais, la
liberté était apparue pour ne plus jamais disparaître. Je l’entendais dans chaque son et la voyais en chaque chose.
Elle était toujours présente pour me torturer par la conscience de ma condition misérable. Je ne voyais rien sans
la voir, n’entendais rien sans l’entendre, ne sentais rien sans la sentir. Elle regardait chaque étoile, souriait dans
tout ce qui était serein, respirait dans chaque brise et s’agitait dans chaque orage.
Je me surpris souvent à regretter ma propre existence et à souhaiter être mort, et, n’eût été l’espoir d’être libre, je
ne doute pas que je me serais tué ou que j’aurais fait une chose, pour laquelle j’aurais été tué » (Douglass, 1980,
48).
Le désir d’apprendre
« Ce que mon maître redoutait le plus était ce que je désirais le plus. Ce qu’il aimait le plus était ce que
je haïssais le plus. Ce qui pour lui, était un grand malheur à éviter prudemment, était, pour moi, un grand bien à
rechercher avec application; et l’argument qu’il fit valoir si vivement contre le fait que j’apprenne à lire ne servit
qu’à m’inspirer le désir et la résolution d’apprendre (Douglass, 1980, 8).
La victoire ne s’obtient que par la lutte (1849)
« Laissez-moi vous dire un mot à propos de la philosophie des réformes. Toute l’histoire du progrès des
libertés humaines montre que toutes les concessions faites à ses augustes revendications sont sorties de la lutte.
S’il n’y a pas de lutte, il n’y a pas de progrès. Ceux qui prétendent défendre la liberté et déprécient l’agitation
sont des hommes qui veulent des récoltes sans labourer le sol. Ils veulent la pluie sans le tonnerre et les éclairs.
Ils veulent l’océan sans les terribles rugissements de ses eaux profondes. La lutte peut être morale, ou elle peut
être physique, ou elle peut être à la fois morale et physique, mais ce soit être une lutte. Le pouvoir ne cède rien si
on ne l’exige pas. Il ne l’a jamais fait et ne le fera jamais ».
Deux principes de la lutte
« C’est essentiellement notre bataille; personne d’autre ne peut la mener pour nous (...). Nos rapports
avec le mouvement anti-esclavagiste doivent changer. Au lieu de dépendre de lui, nous devons le diriger ».
« Les esclaves émancipés ne seront pas vraiment libres s’ils oppriment eux-mêmes d’autres personnes :
leurs femmes », (Douglass, 1980, 13).
Douglass F., Mémoires d’un esclave américain, Paris, François Maspéro, 1980. Autobiographie d’un esclave
américain terminée en 1847, au moment où il s’enfuit et construit avec d’autres le mouvement abolutionniste.
Réédité en français en 2004 (existe en anglais).

www.ciph.org - mccaloz.tschopp@gmail.com
1. CITATIONS, EXTRAITS
« … la vie moderne commence avec l’esclavage (…). Du point de vue d’une femme, affrontant
les problèmes du positionnement actuel du monde, les femmes noires ont été confrontées à des problèmes
postmodernes dès le XIXe siècle et même auparavant. Ces questions ont été abordées par les Noirs il y a
bien longtemps : certains genres de dissolution, la perte de certains types de stabilité et le besoin de
reconstruire. Certains genres de folie, de folie volontaire pour, comme le dit l’un des personnages du
livres « que tu ne perdes pas la tête ». Ces stratégies de survie ont constitué l’individu vraiment moderne.
Ils représentent une réponse aux phénomènes prédateurs de l’Occident. Vous pouvez appeler ça de
l’idéologie ou de l’économie c’est en fait une pathologie. L’esclavage a coupé le monde en deux, il l’a
brisé sur tous les plans. Il a cassé l’Europe. Il a transformé les Européens, il en a fait des maîtres
d’esclaves, il les a rendus fous. Vous ne pouvez pas faire ça pendant des centaines d’années sans que rien
ne se passe. Ils ont dû se déshumaniser, et je ne parle pas seulement des esclaves eux-mêmes. Ils ont dû
tout reconstruire pour que ce système ait l’air vrai. C’est ce qui a rendu possible tout ce qui s’est passé
pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est ce qui a rendu la Première Guerre mondiale nécessaire. Le
racisme est le mot que nous employons pour recouvrir toutes ces expériences »,
Toni Morrison, Beloved, cité par Gilroy P., L’Atlantique noir. Modernité et double conscience
(l’esclavage et ses conséquences), Paris, Kargo, p, 289.
°°°
« … il n’y a pas de « question de l’immigration ». Qui grandit encore là où il est né ? Qui habite
là où il a grandi ? Qui travaille là où il habite ? Qui vit là où vivaient ses ancêtres ? Et de qui sont-ils, les
enfants de cette époque, de la télé ou de leurs parents ? La vérité, c’est que nous avons été arrachés en
masse à tout appartenance, que nous ne sommes plus de nulle part, et qu’il résulte de cela, en même
temps qu’une inédite disposition au tourisme, une indéniable souffrance. Notre histoire est celle des
colonisations, des migrations, des guerres, des exils, de la destruction de tous les enracinements. C’est
l’histoire de tout ce qui fait de nous des étrangers dans ce monde, des invités dans notre propre famille.
Nous avons été expropriés de notre langue par l’enseignement, de nos chansons par la variété, de nos
chairs par la pornographie de masse, de notre ville par la police, de nos amis par le salariat ».
Comité invisible, L’insurrection qui vient, Paris, éd. La Fabrique, 2007, p 19-20 (le salariat globalisé).
°°°
L’exilé.e un.e a-topos (hors-lieu)
“Avec Abdelmalek SAYAD (sociologue algérien), le sociologue se fait écrivain public. Il donne
la parole à ceux qui en sont le plus cruellement dépossédés, les aidant parfois, autant par ses silences que
par ses questions, à trouver leurs mots, à retrouver, pour dire une expérience qui la contredit en tout, les
dires et les dictons de la sagesse ancestrale, les “mots de la tribu” qui décrivent leur exil, alghorba,
comme un occident, une chute dans les ténèbres, un désastre obscur.
(…)
Les principes de l’épistémologie et les préceptes de la méthode sont de peu de secours, en ce cas
(pour témoigner de ce que nous avons vu et entendu), s’ils ne peuvent s’appuyer sur des dispositions plus
profondes, liées, pour une part, à une expérience et à une trajectoire sociale. (…) Dans un article paru
dans Actes de la recherche dès 1975, c’est-à-dire bien avant l’entrée de “l’immigration” dans le débat
public, Abdelmalek Sayad déchire le voile d’illusion qui dissimulait la condition des “immigrés”, et
révoque le mythe rassurant du travailleur importé qui, une fois nanti d’un pécule, repartirait au pays pour
laisser place à un autre. Mais surtout, en regardant de près les détails les plus infimes et les plus intimes
de la condition des “immigrés”, en nous introduisant par exemple au plus secret des souffrances liées à la
séparation à travers une description des moyens qu’ils emploient pour communiquer avec le pays, ou en
nous menant au cours de la contradiction constitutive d’une vie impossible et inévitable au travers une
évocation des mensonges innocents par qui se reproduisent les illusions à propos de la terre d’exil, il
dessine à petites touches un portrait saisissant de ces “personnes déplacées”, dépourvues de place
appropriée dans l’espace social et de lieu assigné dans les classements sociaux. Comme Socrate,
l’immigré est atopos sans lieu, déplacé, inclassable. Rapprochement qui n’est pas là seulement pour
ennoblir, par la vertu de la référence. Ni citoyen ni étranger, ni vraiment du côté du Même, ni totalement
du côté de l’Autre, “l’immigré” se situe en ce lieu “bâtard” dont parle aussi Platon, la frontière de l’être et
du non-être social. Déplacé au sens d’incongru et d’importun, il suscite l’embarras; et la difficulté que
l’on éprouve à le penser – jusque dans la science, qui reprend souvent, sans le savoir, les présupposés ou
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%