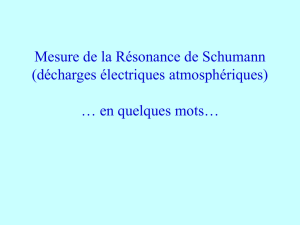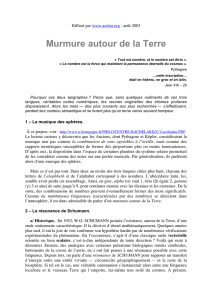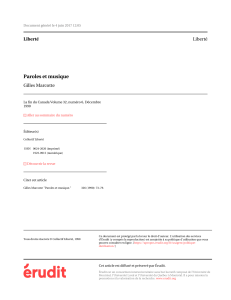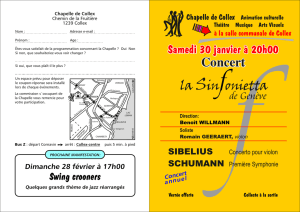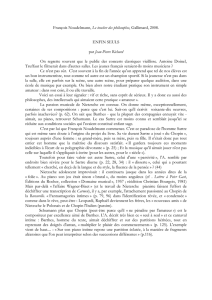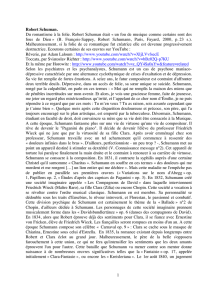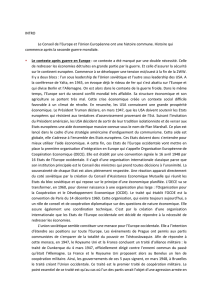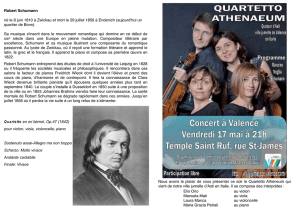le programme complet - Les Grands Interprètes

Programme ALEXEÏ VOLODIN
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
3 sonates pour piano
Serge Prokofiev (1891 – 1953)
Dix pièces opus 12
1°) Marche (allegro) – 2°) Gavotte (allegretto) – 3°) Rigaudon (vivace) – 4°) Mazurka (capriccioso) –
5°) Caprice (allegretto capricciosamente) – 6°) Légende (andantino) – 7°) Prélude (vivo e delicato) –
8°) Allemande (allegro risoluto) – 9°) Scherzo humoristique (allegro) – 10°) Scherzo (vivacissimo).
Troisième sonate en la mineur Opus 28 « d’après de vieux cahiers »
Allegro tempestoso – Moderato - Allegro tempestoso.
Nikolaï Medtner (1879 – 1951)
Sonate « Réminiscence » Op. 38 n°1
- Allegretto tranquillo
- - - - - - ENTRACTE - - - - - -
Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Troisième Ballade en la bémol majeur opus 47
Robert Schumann (1810 – 1856)
Carnaval Opus 9 (Scènes mignonnes sur quatre notes)
Préambule – Pierrot – Arlequin – Valse Noble – Eusebius – Florestan – Coquette – Réplique (sphinxes)
– Papillons – A.S.C.H. / S.C.H.A. (lettres dansantes) – Chiarina – Chopin – Estrella – Reconnaissance –
Pantalon et Colombine – Valse allemande – Paganini – Aveu – Promenade – Pause – Marche des
Davidsbündler contre les Philistins.

L’année 1685 fut une année particulièrement faste puisqu’elle a vu la naissance de Jean-Sébastien
Bach, Geörg Frieidrich Händel et de Domenico Scarlatti. Ces trois compositeurs vont illuminer
l’Europe musicale baroque de leur génie ; Bach en restant en Allemagne, Händel en Allemagne, puis
en Italie et en Angleterre et Scarlatti en Italie, puis au Portugal et en Espagne.
Domenico Scarlatti naît à Naples le 26 octobre 1685. Il est le sixième enfant d’Alessandro Scarlatti,
lui-même un célébrissime compositeur de musique religieuse (cantates et madrigaux) et d’opéras.
Baigné dès son plus jeune âge dans la musique, c’est tout naturellement que le jeune Domenico
deviendra musicien. Il se formera dans les plus grands centres culturels d’Italie que sont Naples,
Rome, Venise et Florence. Prodigieusement doué Domenico Scarlatti deviendra à seulement quinze
ans l’organiste et le compositeur attitré de la Chapelle Royale. Au cours de sa jeunesse Scarlatti
compose surtout de la musique d’orgue et des œuvres religieuses dont il ne reste malheureusement
que peu de traces aujourd’hui.
A Rome, il assistera Tommaso Bai alors Maître de Chapelle de Saint Pierre et rencontrera Händel. Ils
se prêteront à une joute musicale mémorable où Scarlatti sortira vainqueur au clavecin, mais sera
vaincu à l’orgue par le saxon. Alors qu’il a une vingtaine d’années, Scarlatti est engagé par la Maison
de Bragance étroitement liée à la famille Royale du Portugal. C’est par cette entremise que Scarlatti
sera nommé par Jean V le Magnifique professeur de musique du frère cadet du Roi et surtout de sa
fille l’Infante Maria Barbara. Scarlatti se rend à Lisbonne vers 1720 et s’acquitte parfaitement de son
rôle auprès de la famille royale. Scarlatti donnera aussi des cours à l’un des plus importants
compositeurs portugais du 18ème siècle Carlos Seixas. Des liens d’amitié indéfectibles se tissent entre
Scarlatti et la jeune Princesse qui s’avère être une élève prodigieusement douée. Cet attachement
fidèle durera jusqu’à la mort de Scarlatti en 1757. Mais entretemps ce dernier restera près de vingt-
huit ans au service de Maria Barbara. Lorsque celle-ci épouse en 1729 le futur roi d’Espagne
Ferdinand VI. Scarlatti la suivra à Madrid où elle se retrouve seule et éloignée des siens, à cette cour
d’Espagne triste et sévère. Autant pour divertir qu’instruire la Reine, Scarlatti lui composera de très
nombreuses sonates pour clavecin. Celles-ci perdront au fil du temps leur but purement didactique,
et de ces simples exercices techniques naîtront des sonates très élaborées et hautement inspirées.
Celles-ci sont à la fois d’une grande technicité mais aussi poétiques, elles véhiculent parfois cette si
vivifiante et bouillonnante musique populaire espagnole dont la couleur fait cruellement défaut à
l’austère Cour d’Espagne. Scarlatti composera la majorité de ses 555 sonates entre 1742 et 1757. Ces
courtes pièces de structure binaire qui traversent toutes les tonalités et utilisent tous les rythmes,
des plus lents (adagio, largo) aux plus rapides (allegrissimos, prestos) feront à elles seules la grande
popularité de Scarlatti. Ce soir Alexeï Volodin a choisi de nous en interpréter trois parmi les plus
belles.
Les dix pièces pour piano de Prokofiev ont été composées entre 1906 et 1913 et jouissent depuis
leur édition d’un succès jamais démenti. Fort prisées par leur auteur, certaines d’entre elles
figureront parmi les premiers enregistrements effectués vers 1920 par Prokofiev.
Ici on retrouve le Prokofiev brillant, percussif et volontairement iconoclaste qui impose son propre
style et qui tourne le dos à tout romantisme. Prokofiev opte ici pour un style essentiellement
néoclassique baignant dans une bonne humeur non dissimilée. Bien qu’il insère dans sa suite des
musiques dont le cadre a été défini au début du 19ème siècle comme les deux scherzos, il conçoit
plutôt son cycle à la manière d’une suite baroque en reprenant des danses anciennes comme la

Gavotte ou le Rigaudon. La comparaison s’arrête là tant l’expression et les buts sont différents. La
Marche initiale donne le ton en recelant des harmonies plutôt aigres alors que les trois pièces
suivantes (Gavotte – Rigaudon et Mazurka) ne sont que des hommages parodiques et ironiques aux
danses du passé. Pour les pièces suivantes Prokofiev adopte un style plus moderniste en faisant
preuve d’une grande recherche harmonique (Caprice) et créant des atmosphères très variées :
morose pour la Légende, raffinée et badine pour le Scherzo et enfin remplie de fantaisie pour les
trois derniers mouvements (Allemande, Scherzo humoristique et Scherzo) dont leur rigueur
rythmique et leur ingénieuse écriture terminent brillamment cette suite pour piano.
Prokofiev fera souvent référence dans ses œuvres aux danses anciennes, qu’il adaptera à son propre
style. C’est le cas par exemple dans son ballet de Cendrillon (Pavane – Gavotte) ou dans sa
Symphonie Classique qu’il composera dix ans après les dix pièces opus 12.
Si la troisième sonate pour piano n’a été éditée qu’en 1917 dans sa version définitive, elle reprend
une sonate de jeunesse largement remaniée contemporaine des dix pièces opus 12. Ce remaniement
d’une œuvre antérieure explique le titre « d’après des vieux cahiers », titre que porte aussi la
quatrième sonate écrite dans les mêmes conditions.
La troisième sonate évolue dans un climat dramatique beaucoup plus marqué que les pièces opus 12,
prouvant ainsi l’évolution stylistique de Prokofiev en l’espace d’une décennie. Cette sonate est dense
et repliée sur un unique mouvement divisé en trois parties. Les indications données par Prokofiev
dénotent le caractère extrêmement agité et sombre de l’œuvre : Allegro tempestoso – Moderato –
Allegro tempestoso. La sonate joue aussi dans son ambiguïté rythmique oscillant entre binaire et
ternaire.
Bien que la musique de Nikolaï Medtner soit plus fréquemment jouée que par le passé, ce
compositeur russe de grand talent est certainement moins connu que ses grands contemporains que
furent Rachmaninov et Prokofiev. Né le 24 décembre 1879 à Moscou, Medtner effectue de brillantes
études musicales au conservatoire de Moscou où il est l’un des élèves les plus doués du grand
pédagogue Vasili Safonov à l’instar d’Alexandre Scriabine et de Josef Lhévine. Il sort du conservatoire
en 1900 après avoir remporté la médaille d’or. Sur les conseils de son mentor Taneïev il renonce à
une carrière de concertiste qui s’avérait pourtant très prometteuse, pour se consacrer à la
composition. Il n’abandonnera cependant pas tout à fait la scène et donnera des récitals pour
promouvoir sa musique.
Ses premières compositions sont très appréciées et il reçoit deux fois le Prix Glinka : en 1909 pour
une série de lieder sur des textes de Goethe et en 1916 pour deux sonates pour piano (opus 25 n°2 et
opus 27). Malgré son grand talent Medtner est rapidement éclipsé par deux autres compositeurs
russes plus charismatiques Scriabine et Rachmaninov, ainsi sa musique ne sera pas reconnue au-delà
des frontières de la Russie. Lorsque la guerre et la révolution bolchévique interviennent, Medtner qui
ne supporte pas le nouveau régime décide d’émigrer en 1921 pour mener une vie de pianiste
compositeur errant, comme le feront aussi avec plus de succès Sergei Rachmaninov et Serge
Prokofiev à la même époque. Medtner sillonnera alors l’Europe (Berlin, Paris, Londres) et effectuera
deux tournées aux Etats Unis en 1924/25 et 1929/30 sans obtenir de succès retentissants. C’est en
Angleterre qu’il se fixera définitivement en 1935. Malgré cette vie difficile il ne cessera jamais de
composer.

La seconde guerre mondiale éclatant quelques mois après son installation à Londres le prive de toute
ressource (son éditeur était à Berlin, ses concerts sont déserts et les leçons de piano qu’il donne se
raréfient). Les bombardements de Londres l’incitent à trouver refuge dans le Warwickshire. Deux ans
plus tard sa santé se dégrade irrémédiablement suite à une première crise cardiaque lui laissant
d’importantes séquelles lui interdisant quasiment de donner des concerts. Fort heureusement, le
Maharadjah de Mysore devient son mécène et lui permet de réaliser une série d’enregistrements en
studio pour la firme His Master Voice (EMI) de la majorité de ses œuvres. Ces enregistrements,
malheureusement réalisés à la fin de l’ère du 78 tours furent vite obsolètes et indisponibles à la
vente. Il mourra à Londres le 13 novembre 1951 victime d’une nouvelle attaque cardiaque.
La musique de Medtner qui commence seulement à être reconnue et jouée, principalement en
Russie, en Angleterre, en Allemagne et aux USA, mais très peu en France, a été victime de son
époque et de l’attitude même de Medtner. Il avait la réputation d’être en musique un réactionnaire
raide et archaïque ne supportant pas la musique des compositeurs « modernes », pourtant ses
contemporains tels que Stravinsky ou Schöenberg (qu’ils qualifiaient d’hérétiques) et de puiser ses
références musicales dans les compositeurs des 18ème et 19ème siècles. Cette conception rigide de la
musique a certainement contribué à faire condamner ses propres compositions, jugées d’emblée
comme passéistes et sans originalité alors que bien entendu il n’en est rien. N’oublions pas que le
grand pianiste russe Emile Gilels a tout au long de sa carrière joué et défendu la musique de
Medtner. En 1921 Rachmaninov écrivait à Medtner « Je répète ce que je vous ai déjà dit en Russie :
Vous êtes, à mon sens le plus grand compositeur de notre temps ».
Par ses ascendances Medtner avait une double culture à la fois russe, mais aussi allemande. Aussi, il
n’est pas surprenant que sa musique ait des parentés avec Schumann et Brahms autant qu’avec
Tchaïkovski ou Rachmaninov, voire même avec les premières œuvres de Scriabine.
Tout comme la troisième sonate de Prokofiev, la Sonate-Reminiscenza est en un seul mouvement.
C’est la première pièce d’un recueil de huit, intitulé « Les Mélodies Oubliées ». Le cycle a été
composé entre juin 1919 et octobre 1920 à une époque où Medtner fuyait les tumultes de la guerre
et de la révolution dans la datcha d’un ami à Bugry dans une campagne reculée à plus de cent
kilomètres de Moscou.
Si l’on ignore ce qui a inspiré à Medtner cette œuvre mélancolique on peut imaginer que son titre
« Réminiscence » lui vient de sa propre réflexion portée sur les innombrables difficultés déjà
rencontrées au cours de son existence, ainsi que sur l’angoisse de quitter très prochainement sa
patrie. C’est l’évocation intime d’un monde qui n’existe déjà plus.
Après l’exposition des deux thèmes principaux de la sonate, le développement renforce le climat
angoissé et halluciné qui trouve son apogée dans deux arpèges semblables à des cris. Pendant un
bref passage un nouveau motif plus brillant permet à l’œuvre de trouver un peu d’apaisement et de
lumière avant que le thème initial (la réminiscence) ne vienne clore la sonate dans une atmosphère
sombre et méditative.
Chopin a composé ses quatre Ballades en une dizaine d’années, de 1831 à 1842. Il est d’ailleurs
délicat de déterminer avec précision la période de pure composition, entre le temps des premières
ébauches de la Première Ballade en 1831 de la publication de la Quatrième en 1843. Pendant cette
décade, Chopin est alors en pleine possession de ses moyens techniques, il maîtrise totalement son

propre langage et son inspiration est à son zénith. Ces quatre pièces tiendront une place importante
dans sa production pianistique, compte tenu de leur ampleur mais aussi de leur densité. Elles
évoluent dans un langage très lyrique, souvent dramatique, tout en conservant une grande liberté
formelle. Ces Ballades combinent subtilement des formes utilisées précédemment par Chopin
comme la variation, le Lied ou encore le Rondo.
La Troisième Ballade en la bémol majeur a été composée très rapidement comparativement aux
deux premières. Datant de 1841, elle est dédiée à Pauline de Noailles. Si elle reste dans le même
univers aquatique que la deuxième Ballade, son expression et sa forme sont totalement différentes.
Sans se référer à un texte particulier, Chopin s’inspire du personnage de l’Ondine au caractère
amoureux à la fois tendre et exalté, qui tente de punir son infidèle (et mortel) amant, en l’entraînant
à sa poursuite dans une quête amoureuse aussi désespérée qu’éternelle. On retrouve dans cette
Ballade deux groupes thématiques assez proches qui, par leur poésie et leur douceur, évoluent de
façon presque improvisée dans un langage d’une très grande expressivité. Cette troisième Ballade est
certainement la plus poétique et intime du groupe. Elle a été créée par Chopin lors de ce fameux
concert du 21 février 1842 dans les Salons de la Maison Pleyel.
Pour composer son Carnaval opus 9 Robert Schumann s’inspire des œuvres littéraires de ses
écrivains favoris : Jean-Paul Richter et d’ETA Hoffmann. Il crée ainsi son propre univers régi par ses
propres règles en mélangeant personnages réels et personnages de fiction.
Il aura fallu près de trois ans à Schumann pour composer cette œuvre exemplaire en bien des points,
qui est une mosaïque de vingt et une courtes pièces enchaînées très rapidement, basée sur le
Carnaval. Intitulé à l’origine « Carnaval : Facéties sur quatre notes pour pianoforte, de Florestan ».
L’œuvre est largement autobiographique et écrite dans un style très personnel. Partout on rencontre
des couples dont les caractères opposés attirent Schumann: Eusebius et Florestan – Pierrot et
Arlequin – Pantalon et Colombine et même Chiarina et Estrella représentant Ernestine et Clara les
deux femmes dont il est alors épris.
Schumann conçoit une fête où personnages fictifs et réels se côtoient. Certains se présentent
masqués en jouant des rôles et en endossant diverses personnalités. Au-delà de ce cadre formel
Schumann s’interroge sur le travestissement et la dualité du caractère, dont il se sent plus ou moins
consciemment atteint. Il s’inclut dans le Carnaval par l’intermédiaire des deux personnages
récurrents dans son œuvre que sont Eusebius et Florestan, dont les tempéraments sont
diamétralement opposés.
Schumann composera trois œuvres sur le thème du Carnaval : tout d’abord les Papillons opus 2, le
Papillon n’étant pas ici l’insecte, mais le masque du bal (1829 à 1831), puis le Carnaval opus 9 (1833 –
1835) que nous entendrons ce soir, et enfin le Carnaval de Vienne opus 26 (1839).
Au moment où Schumann compose le Carnaval opus 9, il est fiancé à Ernestine von Fricken. Clara
Wieck qui deviendra sa femme six ans plus tard n’a alors que quinze ans mais les sentiments
amoureux commencent à naître entre eux. Schumann la rencontre pour la première fois alors qu’elle
est âgée de huit ans. Elle est la fille de son professeur de piano Frieidrich Wieck. Au moment de la
composition du Carnaval Clara est déjà une musicienne extrêmement douée jouant de façon
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%