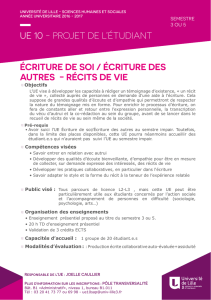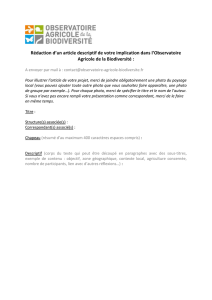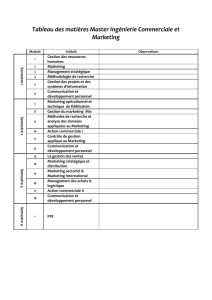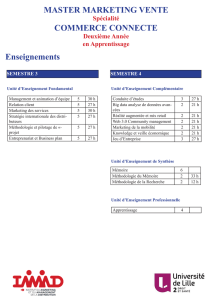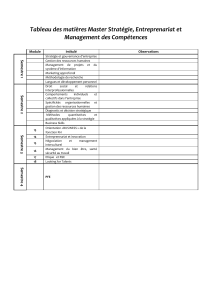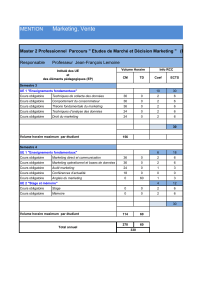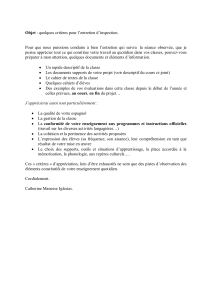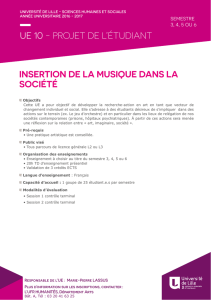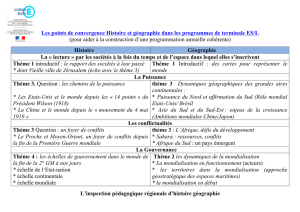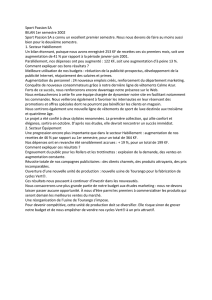IpWeb hist - Université d`Artois

UE Libres
201
6
-
201
7
Les UE libres _ UFR Histoire Géographie
Licence Histoire
Licence Géographie
SEMESTRES IMPAIRS
L1 L2 L3
L1 L2 L3
Histoire des Faits religieux
C. Leduc
O. Rota
X X X
X X X
Mondialisation (en anglais) MP. Chélini X X X
X X X
Histoire de l'Europe centrale Y. Carbonnier
X X X
X X X
Histoire ancienne / latin P. Schneider X X X
X X X
La culture antique et ses échos
dans le monde contemporain S. Lebreton
X
X
Les littoraux : espaces et sociétés
des côtes françaises
(métropole et outre-mer)
V. Morel
X X X
X X X
Géographie de l’Afrique L. Gagnol
X X X
X X X
Construction du projet
professionnel E. Sinniger
X
X

UE Libres
201
6
-
201
7

Unité d’Enseignement
Semestre impair
Histoire des Faits religieux
Descriptif
Ce cours d’initiation se propose de présenter l’émergence des monothéismes, d’en montrer les évolutions à travers
l’Histoire et, par une présentation comparative, d’en dégager les enjeux culturels et politiques.
Bibliographie
*Régine AZNIA, Le Judaïsme, P.U.F. (Que sais-je ?), 2010 (1
ère
éd. 2003).
*Yves BRULEY, Histoire du catholicisme, P.U.F. (Que sais-je ?), 2012.
*Olivier CHRISTIN, Les Réformes. Luther, Calvin et les protestants, Découvertes Gallimard, 1995.
*Roger DU PASQUIER, Découverte de l’Islam, Seuil (coll. Points-Sagesse), 1984.
*François LEBRUN (sous la dir. de), Histoire des catholiques en France, Privat (coll. Pluriel), 1980.
*Ẻmile G. LẺONARD, Histoire générale du protestantisme, P.U.F. (1961 ; réed. 1988).
*André LEMAIRE, Histoire du peuple hébreu, P.U.F. (Que sais-je ?), 2009
*Dominique SOURDEL, L’Islam, P.U.F. (Que sais-je ?), 2009.
Enseignant
Christophe Leduc – Olivier Rota
Unité d’Enseignement
Semestre impair
L’Europe dans la globalisation / Cours en ANGLAIS
Descriptif
L’objectif du cours proposé est de se familiariser avec l’évolution de l’économie européenne dans le cadre de la
globalisation.
La globalisation n’est pas apparue dans les années 1980. Sans aller à la recherche de ses origines (Antiquité,
Moyen-Âge, Renaissance), nous partirons du XIXe siècle qui marque une accélération de la globalisation. Avec
l’industrialisation, les actuels pays avancés distancent par leur croissance et leur niveau de vie, les Etats qui restent
majoritairement agricoles (cas de la Chine). Les guerres mondiales et la crise des années 1930 ralentissent le
mouvement de globalisation. La guerre froide coupe l’Europe en deux, avec une partie orientale prosoviétique. La
croissance est rapide jusqu’au milieu des années 1970, avant de se ralentir depuis. Les chocs pétroliers servent de
signal mais ne sont pas la cause essentielle de la crise, qui emporte les pays communistes et permet paradoxalement
la réunification de l’Europe à partir de 1989-90 dans le cadre du Traité de Maastricht (1992).
De nouveaux Etats, qualifiés de « pays émergents » dans les années 2000, apparaissent. Après la première vague
des quatre « Dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong, Singapour) pendant la période 1960-1990, les années
1980-90 voient l’accélération économique de Chine (1984), Inde (1991), Brésil, Afrique du Sud etc. Les principaux pays
émergents regrouperaient actuellement 40% de la population planétaire et assureraient 20% du PIB. Face à cette
croissance, le ralentissement économique européen nourrit l’euroscepticisme et diverses formes de repli pessimiste
(national, régional ou corporatiste).
La croissance des émergents ralentit-elle celle des pays avancés (comme veulent le croire les opinions publiques)
ou constitue-t-elle au contraire une opportunité saisie par certains pays avancés plus performants à l’exportation
(Allemagne, USA, Australie, Canada) ?
Bibliographie
Indications bibliographiques (textes en français)
. Adda, J, La mondialisation.
De la genèse à la crise
, Paris, La Découverte, 2012, 290 p
. Bairoch, P, Victoires et déboires, Paris, Folio, 2003, 3 vol. (depuis le 16
e
s). Chapitres spécifiques.
. Berger, Suzanne, Made in monde. Les nouvelles frontières de l’économie mondiale, Paris, Seuil, 2006, 357 p.
. Bitsch, Marie-Thérèse Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Bruxelles, Ed. Complexe. 2003, 356
p.
. Blancheton Bernard, « Mondialisation - histoire de la mondialisation », Encyclopædia Universalis (en ligne)
. Cohen, Daniel, La mondialisation et ses ennemis, Paris, Grasset, 2004, 264 p.
.
Crouzet, François, Histoire de l’économie européenne, 1000- 2000, Paris, Albin Michel / University Press of Virginia,
2000, 437 p
Enseignant Michel Pierre Chélini

!
Unité d’Enseignement
Semestre impair
Histoire de l’Europe centrale
Descriptif
L’objectif de cette UE est de brosser les grands traits de l’histoire de l’Europe Centrale de 1648 à 1948. Ces trois
siècles, entre la paix de Westphalie et le « coup de Prague », sont marqués par des transformations importantes à la
fois dans les institutions politiques, dans les tracés des frontières, dans la répartition démographique ou dans les
aspects culturels et religieux.
L’étude portera principalement sur la Pologne, la Bohême et la Hongrie, ce qui amènera à évoquer également la
Slovaquie, l’Autriche, l’Allemagne, l’Ukraine, la Roumanie ou les Balkans, du fait des liens territoriaux et politiques qui
ont existé avec les trois Etats principaux.
Bibliographie
Natalia Aleksiun, Daniel Beauvois, Marie-Elizabeth Ducreux, Jerzy Kłoczowki, Henryk Samsonowicz, Piotr Wandycz,
Histoire de l’Europe du Centre-Est, Paris, PUF, 2004 (coll. Nouvelle Clio).
Norman Davies, Histoire de la Pologne, Paris, Fayard, 1986.
Jörg K. Hoensch, Histoire de la Bohême, Paris, Payot, 1995.
Miklós Molnár, Histoire de la Hongrie, Paris, Perrin, 2004.
Paul Robert Magocsi, Historical atlas of Central Europe, Seattle, University of Washington Press, 2002 (ouvrage
malheureusement absent de la BU, mais dont les cartes serviront de points d’appui au cours).
Enseignant
Youri Carbonnier
Unité d’Enseignement
Semestre impair
Histoire ancienne / Enseignement du latin
Descriptif
Cet enseignement du latin est principalement destiné aux étudiants en histoire. Adaptés aux niveaux des étudiants
(débutant, intermédiaire ou confirmé), les cours visent à donner les bases de morphologie et de syntaxe latines. Au
terme du programme, les étudiants les plus avancés peuvent aborder des auteurs majeurs de l’histoire antique :
César, Cicéron, Tite-Live … Ils ont également les bases nécessaires du latin médiéval.
Bibliographie
Documents fournis en cours
Enseignant
P. Schneider
Unité d’Enseignement
Semestre impair
La culture antique et ses échos dans le monde contemporain
Descriptif
Cet enseignement vise à faire connaître quelques aspects de la culture antique à travers des thèmes qui ont pu
traverser l’histoire et nourrir notre culture contemporaine. Il s’agira par exemple de s’intéresser à des textes
fondateurs comme l’épopée de Gilgamesh, le mythe des races d’Hésiode, les origines légendaires de l’histoire de
Rome ou certains passages de la Bible. En amont, il sera aussi question de comprendre les origines de l’héritage
transmis par ces textes. Ainsi, certaines parties de l’Ancien Testament s’expliquent dans le contexte sumérien du 3
ème
millénaire.
Bibliographie
Des ouvrages seront conseillés lors de la progression du cours, mais deux livres peuvent d’ores et déjà donner le ton
de cette UE libre :
-W. Burkert, La tradition orientale dans la culture grecque, Paris, trad. 2001.
-S. N. Kramer, L’histoire commence à Sumer, Paris, réed. 2009.
Enseignant
Stéphane Lebreton

"
Unité d’Enseignement
Semestre impair
Les littoraux : espaces et sociétés des côtes françaises
(métropole et outre-mer)
Descriptif
Point de focalisation de l’imaginaire collectif, le littoral, et par extension ses habitants et les activités qui s’y
développent, en raison de sa localisation singulière entre terre et mer, fait l’objet d’une diversité de regards. Ils
constituent autant de constructions culturelles fluctuantes et qui évoluent dans l’espace et le temps.
Au XXI
e
siècle,
les littoraux constituent l'un des espaces géographiques les plus peuplés.
Ce cours se propose d’analyser la
construction des littoraux dans l’espace et le temps afin de rendre compte des processus de construction naturels et
anthropiques et ainsi comprendre la diversité des littoraux français et les enjeux qui les caractérisent.
Bibliographie
Des ouvrages seront conseillés lors de la progression du cours, mais deux livres peuvent d’ores et déjà donner le ton
de cette UE libre :
-Miossec A., 2004 (3
ème
édit.), Les littoraux entre nature et aménagement. Paris, Armand Colin, Coll. Campus, 192 p.
-Paskoff R., 2010 (3
ème
édit.), Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution. Paris, Armand Colin, 264 p.
Enseignant
Valérie Morel
Unité d’Enseignement
Semestre impair
Géographie de l’Afrique
Descriptif
Ce cours traite des dynamiques et des transformations d’un continent que l’on a trop tendance à figer et à
homogénéiser. Une approche géohistorique montre que l’Afrique ne forme pas un continent isolé, hors de l’histoire,
aux caractéristiques communes nettement identifiables. Une approche par l’histoire et l’épistémologie de la
géographie, montre que le continent a été « inventé » par un regard extérieur qui a construit une identité africaine,
légitimé notamment par « l’africanisme ». Après avoir abordé l’évolution du traitement de l’Afrique en géographie,
nous prendrons des études de cas de dynamiques territoriales actuelles, notamment au Maroc et au Niger, sur des
thèmes variés : agro-pastoralisme, croissance urbaine, tourisme, ressources extractives, conflits, trafics et
contrebande, etc.
Bibliographie
Enseignant
Laurent Gagnol
Unité d’Enseignement
Semestre impair :
Construction du Projet Professionnel
Descriptif
L’unité de Construction du Projet Professionnel a pour objectif d’apporter une méthodologie et des outils afin de
préparer les étudiants à leur insertion professionnelle. En fonction du choix de filière, des attentes personnelles et
de la motivation de chacun, il s’agit de définir un projet principal et un projet second puis de construire son parcours
de réussite : découvrir les secteurs d’activité, les métiers liés à la formation suivie et comprendre les attentes du
monde professionnel ; choisir les mentions et les parcours les mieux adaptés en fonction de ses choix et préparer ses
recherches de stage efficacement… L’étudiant consigne ses recherches dans un dossier et acquiert une méthodologie
qui lui permettra d’adapter et de faire évoluer son projet tout au long de son parcours de formation.
L’unité est assurée par des intervenants extérieurs conseillers en ressources humaines et des personnels du Service
d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SAOIP) de l’université.
Bibliographie
Les étudiants apprendront à se servir des ressources documentaires papier et numériques spécialisées pour
construire leur recherche.
Les étudiants utiliseront le Portefeuille d’Expériences et de Compétences (www.pec-univ.fr) pour consigner tout ou
partie de leur travail afin de valoriser leur formation et leur profil tout au long de leur parcours.
Enseignants
Intervenants extérieurs et personnel SAOIP
1
/
5
100%