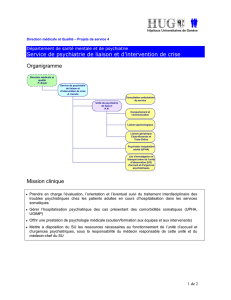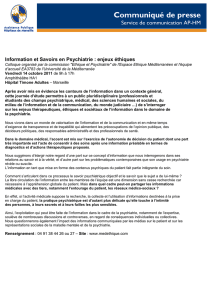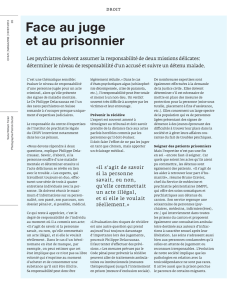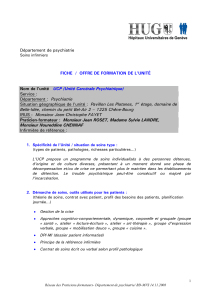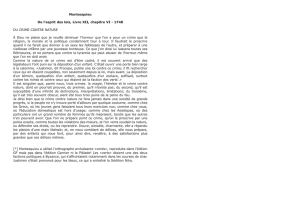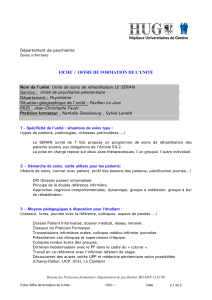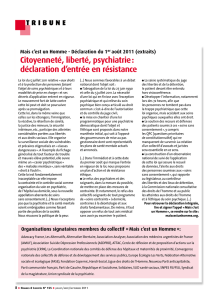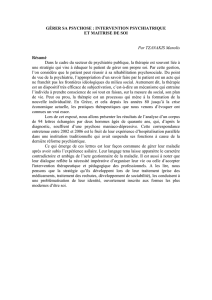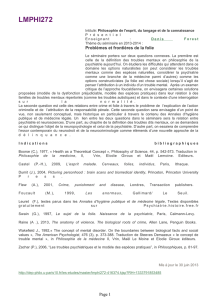Textes du séminaire d Utrecht 2003

1
C.E.D.E.P.
Comité Européen : Droit, Ethique et
Psychiatrie
XIIème SEMINAIRE,
La Peine du Fou, la Prison, le Soin
The Madman Sentence, Prison,
Treatment
Programme et Documents
7, 8 et 9 juin 2003, Utrecht (Pays-Bas)

2
ARGUMENT : LA PEINE DU FOU, LA PRISON, LE SOIN ............................... 3
THE MADMAN’S PUNISHMENT, PRISON, TREATMENT ................................ 5
PROGRAMME (FRANÇAIS) .............................................................................. 7
PROGRAMME (ENGLISH) .............................................................................. 12
ABSTRACTS - RÉSUMÉS ............................................................................... 17
LA PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES : UNE
QUESTION CLINIQUE. .................................................................................... 26
PUNIR ET SOIGNER, LA QUESTION DE LA DÉLINQUANCE RÉCIDIVANTE ET DE LA
PSYCHOPATHIE FACE AU DROIT PÉNAL ET À LA POLITIQUE PSYCHIATRIQUE DE
SECTEUR. ........................................................................................................ 32
COURT PROPOS SUR LA TÉMÉBILITÉ ET LA TÉMIBILITÉ (TÉMIBILITÀ EN ITALIEN),
AINSI QUE SUR LES TRAVAUX DE UEBERSCHLAG À LANNEMEZAN, .... 43
QUESTIONNAIRE : “ L’ÉTAT DES LÉGISLATIONS ” (FRANCE) ................. 46
QUESTIONNAIRE : « L’ÉTAT DES LÉGISLATIONS » ALLEMAGNE ........... 52
QUELQUES NORMES JURIDIQUES EN DROIT ALLEMAND ....................... 57
BIBLIOGRAPHIE « PRISON &PSYCHIATRIE » ............................................. 60
SCHIZOPHRÉNIE, PSYCHOSE ET PRISON .................................................. 64
VIOLENCE, FOLIE, ET POLITIQUE ................................................................ 78
LA DOUBLE FACE DU CRIME ........................................................................ 82
D'UNE TRIPLE À UNE MULTIPLE ENTENTE ................................................ 95
DU MÉSUSAGE DU CONCEPT DE "DANGEROSITÉ" AUJOURD'HUI, TENTATIVE
D'APPROCHE CRIMINOLOGIQUE ............................................................... 101

3
Argument : La Peine du Fou, la Prison, le Soin
« Les malades mentaux sont de plus en plus nombreux dans les prisons des Etats de droit »,
entend-t-on partout. Conséquence de la désinstitutionalisation, de la responsabilisation à
tout prix, de l’ouverture des hôpitaux, de l’exclusion croissante des malades mentaux des
circuits sociaux ou de la violence croissante de certaines pathologies ….. Les explications
sont nombreuses et sûrement plus complexes que ne veulent bien le dire ceux qui
stigmatisent certaines évolutions de la psychiatrie hors les murs, ou de l’expertise.
Ils n’en reste pas moins que les prisons sont inadaptées à la prise en charge des patients
souffrant de troubles psychiques et que ceux –ci y connaissent un sort peu enviable,
souvent mis à l’écart, stigmatisés en raison de leur pathologie et exclus pour les même
raisons des possibilités de libération conditionnelle ou d’assouplissement de régime.
Malgré ce constat maintenant partagé par bien des responsables politiques, la tendance
n’est pas près de s’inverser. Il faudra encore des rapports parlementaires ou des livres
pamphlets pour faire évoluer véritablement l’état des prisons et le sort de ceux qui s’y
trouvent. Le tout sécuritaire s’accommode assez bien de ces situations, sauf à posséder les
moyens de construire des établissements qui permettent une gestion spécifique de ces
patients inquiétants en prenant l’alibi psychiatrique pour priver ceux-ci de liberté de
manière indéterminée.
Nous sommes probablement à une croisée des chemins dans l’évolution de législations et
des structures. Le développement de la psychiatrie en prison a suscité certains espoirs qui
restent encore incertains faute, peut-être, d’avoir pu penser cette difficile articulation et de
donner les moyens d’y parvenir. A l’opposé de ce choix, certains pays ont considéré que
seuls un système spécifique, distinct pouvait prendre en charge ces patients Partout se
pose la question de l’exercice de la contrainte ou de l’obligation dès lors que la folie se
décompense ou que la pathologie inquiète. Nous sommes en crise de modèles.
Pour contribuer à cette réflexion le CEDEP propose d’organiser son séminaire annuel
autour de trois axes : éthique, en interrogeant le difficile rapport entre soignant et
instances de sécurité, juridique dans l’analyse des législations qui oscillent entre peines
incompressibles et mesures de sûreté indéterminées et enfin clinique en posant
l’interdisciplinarité et le partenariat comme possibilité d’une évolution des prises en
charge en milieu pénitentiaire.
Comme chaque année, le séminaire se construira à partir des contributions que les
membres du CEDEP enverront au secrétariat et qui nous permettront la constitution d’un
document préparatoire.
Cette année le séminaire se tiendra en Hollande, à l’invitation de Frans Koenraadt. Ceux
qui connaissent l’exemplarité du système de soin hollandais dans le champ de la
psychiatrie légale ne pourront que souscrire au thème que nous proposons cette année et à
la pertinence de le traiter à Utrecht.
Bruno Gravier, 20 février 2003
Comité d’organisation

4
Claude Louzoun (Paris), Paul Arteel (Gent), Franz Koenradt (Utrecht),
Bruno Gravier (Lausanne), Ulrich Kobbé (Lippstadt)

5
The madman’s punishment, Prison, Treatment
As the rumor goes:« In the prisons of democracies the number of mentally ill patients increases».
This can be explained by several factors: de-institutionalization, accountability at all costs,
the opening of hospitals, the increasing exclusion of such patients from social systems or
the increasing violence of certain pathologies….. Explanations are numerous and certainly
more complex than what is claimed by those who denounce certain evolutions of either
psychiatry beyond the walls or expertise.
Whatever the case, patients suffering from psychic disorders should not be treated in
prisons where they experience a rather unpleasant fate, often kept out of things,
stigmatized because of their pathology and, for the same reasons, excluded from possible
release on parole or relaxed regimes.
Although this situation is well understood by many political decision makers, the trend is
not about to be reversed. Many more parliamentary reports and pamphlets will be
needed to change effectively the conditions of the prisons and of the inmates. Those who
advocate a strong stance on law and order basically agree with such situations, unless they
are replaced by institutions that would enable these difficult patients to be managed, using
the psychiatric alibi to deprive them of freedom in an unclear manner.
We are probably at a crossroad of the evolution of law and structures. The development
of psychiatry in the prisons fuelled certain hopes which remain stained with uncertainty
due to a lack – possibly – of reflexion on this difficult articulation and of means needed to
achieve it. On the contrary, some countries consider that only a specific distinct system
could enable such patients to be managed. The issue of the application of constraint or of
obligation whenever madness collapses or the pathology worries is raised everywhere.
We face a model crisis.
In order to contribute to this reflexion, the CEDEP wishes to structure its annual seminar
with three issues: ethical – by pondering on the difficult relationship between health care
personnel and the prison authorities; legal – through the analysis of legislations which
range from sentences to be served in full and undetermined security measures; and finally
clinical – by looking at interdisciplinarity and partnership as a possibility of evolution for
the treatment in prisons.
As usual, the seminar will be based on the contributions that all members of the CEDEP
will send to the secretariat and which will enable us to elaborate a preliminary document.
This year the seminar will take place in the Netherlands, thanks to Frans Koenradt’s
invitation. Those who know of the exemplarity of the Dutch legal psychiatry care system
will undoubtedly agree with the theme proposed and with the choice of Utrecht as the
venue
So, let’s get to work and send us your contributions.
Bruno Gravier, 20 February 2003
Organizing Committee
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%