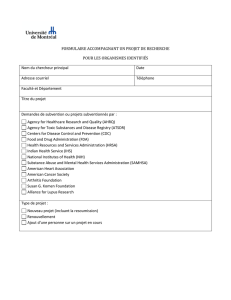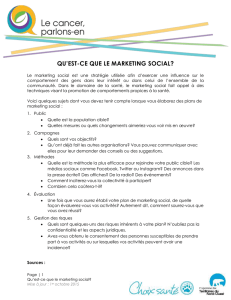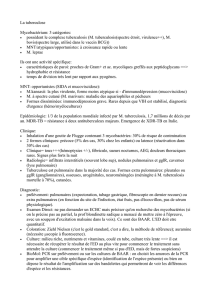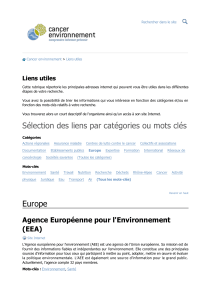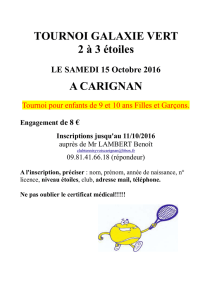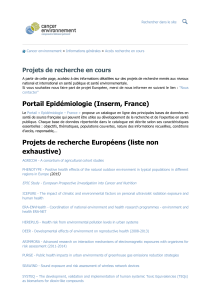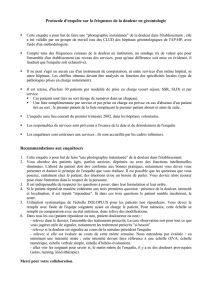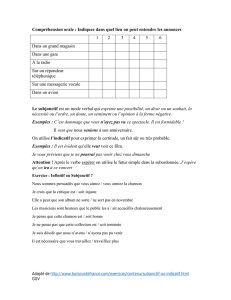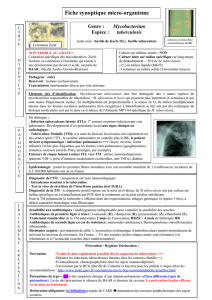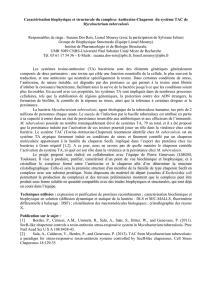Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic de la

INT J TUBERC LUNG DIS 14(2):171–180
© 2010 The Union
[Traduction de l’article : « Confusion, caring and tuberculosis diagnostic delay in Cape Town, South Africa » Int J Tuberc
Lung Dis 2010; 14(2): 171–180]
Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic
de la tuberculose à Cape Town, Afrique du Sud
J. Skordis-Worrall,*† K. Hanson,† A. Mills†
*
Centre for International Health and Development, University College London Institute for Child Health, London,
†
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, Royaume-Uni
Auteur pour correspondance : J Skordis-Worrall, Centre for International Health and Development, UCL Institute for
Child Health, 30 Guilford Street, London WC1N 1EH, Royaume-Uni. Tel : (+44) 207 242 9789. Fax : (+44) 207 404
2062. e-mail : [email protected]
OBJECTIF : Explorer les façons dont les comportements du pourvoyeur de soins et du patient interagissent pour ac-
centuer le retard au diagnostic à Cape Town, Afrique du Sud.
SCHÉMA : On a mené huit discussions focalisées de groupe dans quatre collectivités urbaines où la prévalence de la
tuberculose (TB) était élevée, y compris deux collectivités à co-prévalence élevée d’infection pour le virus de l’immu-
nodé cience humaine. On a strati é les groupes en fonction du sexe, de l’ethnie et du statut TB. On a fait apparaitre
les observations de manière inductive à partir de la base de données en utilisant la combinaison d’une théorie fondée
et d’une analyse thématique.
RÉSULTATS : Les causes du retard au diagnostic sont des retards dans le recours aux soins, le fait que le pourvoyeur
ne réussit pas à diagnostiquer la TB lors du premier contact, le recours au secteur privé qui ne traite pas la TB ainsi
que de multiples recours aux soins au sein des secteurs ou entre secteurs.
CONCLUSIONS : L’interaction entre le comportement du patient et les dispositions institutionnelles accentue maté-
riellement le retard au diagnostic de la TB. Il faut comprendre le recours aux soins dans des contextes pluralistes
comme un processus complexe qui implique une série de pourvoyeurs d’un secteur à l’autre. Les retards au diagnostic
seront raccourcis et tant l’ef cacité que l’ef cience du programme actuel de TB seront améliorées par des stratégies
visant à faciliter le mouvement des patients tant à l’intérieur des secteurs qu’entre eux, et à améliorer les perceptions
tant de la qualité des services que de leur degré de respect de la vie privée.
MOTS-CLÉS : retard au diagnostic ; recours aux soins ; tuberculose ; Afrique du Sud ; VIH
LA TUBERCULOSE (TB) tue approximativement 2
millions de personnes par an et 98% des décès par
TB surviennent dans les pays en développement.1
L’Afrique du Sud connaît un des taux mondiaux de
prévalence de la TB les plus élevés,2 et la Province de
Western Cape un des taux nationaux les plus élevés.3,4
Bien que le taux de guérison au Cap soit relativement
élevé,3 il reste néanmoins en deça des cibles natio-
nales et internationales.5
Comme ailleurs, le virus de l’immunodé cience
humaine (VIH) contribue à un faible succès de la
lutte antituberculeuse, car on s’attend à Cape Town à
ce que la prévalence du VIH atteigne un plateau de
25% à 30%. 6,7 Toutefois, certaines études suggèrent
que le VIH n’est pas le seul facteur qui mine la lutte
antituberculeuse et que des initiatives pour améliorer
le diagnostic précoce et l’adhésion au traitement peu-
vent avoir un impact positif sur les résultats.4,7–10 Bien
que la plupart des études sur le retard au diagnostic
(c’est-à-dire la durée qui sépare le début des symp-
tômes et le diagnostic, ou celle qui sépare la première
consultation et le diagnostic11) ont adopté une appro-
che quantitative du problème,8,10,12,13 certaines ont
commencé à explorer la façon dont les patients inte-
ragissent avec les systèmes de santé, en vue d’amélio-
rer l’adhésion et l’identi cation précoce des cas.14–18
Cette étude examine les liens entre le comporte-
ment du patient et le retard au diagnostic à Cape
Town, Afrique du Sud, en explorant comment les
comportements du pourvoyeur de soins et du patient
interagissent pour accentuer le retard aux niveaux in-
dividuel et institutionnel. L’étude débute par une re-
vue de la littérature sur le recours aux soins de ma-
nière générale et en particulier dans la TB, avant de
décrire les méthodes et les observations. L’article se
termine par une discussion des observations et par
des recommandations de politique.
CONTEXTE ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
Dans la ville de Cape Town, la plupart des traitements
de la TB consistent en des soins ambulatoires assurés
RÉSUMÉ

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
par les polycliniques primaires du secteur public. Ces
polycliniques adhérent à la stratégie DOTS, les fourni-
tures de médicaments sont signalées comme régulières
et les polycliniques ont accès à un réseau de soutien se-
condaire étendu qui comporte un grand laboratoire
TB et, à proximité, des hôpitaux tertiaires.7 Toute-
fois, le système médical d’Afrique du Sud est extrê-
mement pluraliste et les options de traitement vont
de la médecine occidentale assurée dans les secteurs
privés ou publics aux médecines traditionnelles et
aux guérisseurs spirituels. Depuis 1994, le système de
santé a également subi une restructuration complexe
visant à la décentralisation de la fourniture de soins
et à l’élimination des inégalités systémiques.19 Gibson
décrit la manière dont ce processus de transformation
n’a fréquemment pas réussi à coïncider avec la réalité
de l’utilisation des services.20 La confusion au sujet de
la nouvelle structure et du point d’entrée correct pour
le traitement ainsi qu’une désillusion croissante en ce
qui concerne la qualité des soins publics primaires
ont été les thèmes principaux émergeant des investi-
gations de Gibson. Ceci peut expliquer l’utilisation
de services privés par environ 30% des personnes dé-
pourvues d’assurance médicale en Afrique du Sud.21
Le recours aux guérisseurs traditionnels ou spirituels
est également répandu, quoiqu’ Abrahams et coll.
aient conclu qu’ils sont habituellement complémen-
taires à l’égard des services biomédicaux et que l’auto-
médication joue un rôle similaire.22
Les descriptions du système médical et les construc-
tions culturelles de la maladie s’avèrent, selon la litté-
rature empirique qualitative, avoir un impact matériel
sur le recours aux soins.14,23 Il existe une abondance
croissante de littérature qualitative qui investigue la
qualité interpersonnelle et la con ance entre patient
et pourvoyeur de soins. Cette littérature suggère que
la qualité interpersonnelle est un concept à facettes
multiples incorporant des notions de con ance et des
perceptions de con dentialité, empathie, gentillesse et
respect. Gibson décrit les soins ef cients comme une
activité relationnelle exigeant de la con ance et de la
« compréhension mutuelle » entre le patient et le pour-
voyeur de soins.24 Gilson et coll. expliquent comment
la con ance entre patient et pourvoyeur trouve ses
racines à la fois dans la con ance interpersonnelle et
la con ance dans l’institution.25 Ils concluent qu’un
traitement respectueux est la demande centrale des
utilisateurs des soins primaires. De la même manière,
Thiede décrit la façon dont les relations patient/pour-
voyeur de soins sont basées sur l’échange d’informa-
tions et observe que les sociétés à culture diverse telles
que celles d’Afrique du Sud constituent des environne-
ments à faible niveau de con ance.26 De plus, deux
études provenant de Tanzanie insistent sur quelques
uns des mécanismes par lesquels la relation patient/
pourvoyeur de soins peut avoir un impact matériel
sur le recours aux traitements. Tibandebage et Mack-
intosh ont démontré de quelle manière la rupture des
relations entre patient et pourvoyeur de soins affecte
l’accessibilité et insistent sur les types systémiques
d’exclusion et d’abus,27 alors que Gilson et coll. ont
illustré la façon dont la satisfaction du patient in-
uence l’adhésion et l’ef cience des soins.28
Les thèmes de la con ance et de la qualité inter-
personnelle décrivent la recherche de soins comme un
phénomène social nécessitant interaction et communi-
cation. La littérature qualitative décrit d’autres struc-
tures comme le soutien social, les réseaux sociaux,
l’évaluation sociale, le capital social, la cohésion so-
ciale, l’inclusion et l’exclusion sociales et (au sein du
domaine de la santé) les groupes de prise en charge
du traitement et la rationalité sociale pour intégrer le
comportement d’individus dans l’environnement so-
cial plus large et pour comprendre l’impact réciproque
de l’individu et la société, l’un sur l’autre.14,29 Dans
l’étude de la TB, ces interactions affectent matérielle-
ment le diagnostic et l’adhésion thérapeutique. Les
facteurs sociaux courants permettant une recherche
effective des soins incluent un soutien nancier, ma-
tériel et émotionnel aux niveaux du patient, de la
f amille, de la collectivité et des systèmes de santé,
avec dans beaucoup de contextes des différences si-
gni catives en fonction du sexe en matière des sou-
tiens accordés.30,31
Toutefois, les relations sociales peuvent avoir des
dimensions négatives dans le contexte de la TB. La
crainte de la stigmatisation peut entraîner des retards
dans la recherche de soins, réduire l’adhésion théra-
peutique et affecter défavorablement les résultats.14,32
Macq et coll. font la différence entre stigmatisation
dans les faits et celle perçue/internalisée et concluent
que des croyances culturelles au sujet de la transmis-
sion sont le déterminant essentiel de la stigmatisa-
tion.33 Ils notent également que la stigmatisation de
la TB va fréquemment de pair avec d’autres caracté-
ristiques « stigmatisées », telles que le sexe ou la pau-
vreté. Il est important de noter qu’une étude prove-
nant de Thaïlande a signalé que la sigmatisation du
syndrome d’immunodé cience acquise (SIDA) pour-
rait accroître le risque de transmission de la TB en
raison des retards qu’elle entraîne dans la recherche
du traitement de la TB et/ou dans la non-adhésion au
traitement.34
Les préoccupations du patient concernant la possi-
bilité de stigmatisation ont entraîné dans beaucoup
de contextes un plus grand souhait de con dentia-
lité.14 Ceci a un impact sur le comportement dans les
contextes pluralistes. Une étude au Viet Nam a ob-
servé que les patients préfèrent un traitement privé
(non-DOTS) plutôt que de recourir au DOTS gratuit
dans le système public en raison de la plus grande
con dentialité qu’assurent les pourvoyeurs privés.35
La recherche en Thaïlande nous avertit: « . . . Une
prise de conscience croissante et une stigmatisation
du SIDA ainsi qu’une connaissance inadéquate de la
TB peuvent entraîner des retards dans la recherche

Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic de la TB 3
des soins pour la TB et une non-adhésion thérapeu-
tique ».17 De plus, Long et coll. ont identi é au Viet
Nam les différences en matière de sexe en ce qui
concerne le besoin de con dentialité ; dans ce pays,
les hommes sont plus préoccupés au sujet des facteurs
économiques et les femmes au sujet des conséquences
sociales de la maladie tuberculeuse.36 Une étude en
Inde du Sud a identi é la perception persistante de la
stigmatisation de la TB même après traitement,37 alors
qu’en Afrique du Sud, Munro et coll. décrivent les
« barrières structurelles » à l’adhésion au traitement
de la TB et font appel à la fois à une accentuation des
interventions centrées sur le patient et à un accroisse-
ment de la recherche concernant l’adhésion dans une
perspective non-biomédicale.38
Dans de nombreux contextes, la recherche de soins
de la TB est retardée et caractérisée par un nombre
élevé de contacts avec les pourvoyeurs avant d’arriver
au diagnostic. Par exemple, Salaniponi et coll. ont
trouvé que dans les hôpitaux gouvernementaux du
Malawi, 79% des patients TB nécessitent des contacts
multiples avec le pourvoyeur avant le diagnostic.13
Needham et coll. concluent de la même manière que
le retard au diagnostic en Zambie est en association
avec le fait que plus de six rencontres à la recherche de
soins sont nécessaires avant le diagnostic.12 Certaines
études, notamment celles de Meintjes et coll.10 et
Pronyk et coll.39 en Afrique du Sud et celles de Need-
ham et coll.12 en Zambie attribuent ce retard aux dé -
ciences du pourvoyeur. Needham et coll. concluent
également que la centralisation des services publics et
l’absence d’intégration entre les pourvoyeurs de soins
publics et privés prolongent les retards.12 Une autre
étude en Afrique du Sud rurale a souligné la nécessité
d’une collaboration entre les travailleurs de santé tra-
ditionnels et occidentaux dans le traitement de la TB
a n de minimiser les retards.16 Aljunid insiste égale-
ment sur le fait que, alors que le secteur privé fournit
une proportion signi cative des soins de santé en Asie,
les informations publiées sont peu nombreuses au su-
jet des interactions entre les pourvoyeurs de soins pu-
blics et privés.40 Par ailleurs, il n’y a que peu d’infor-
mations publiées sur la façon dont les comportements
du patient et du pourvoyeur interagissent pour ac-
centuer le retard au diagnostic. C’est cette dé cience
de la littérature que cet article vise à combler. Cette
contribution est illustrée par le réseau conceptuel
présenté dans la Figure. Le réseau a été adapté à partir
des travaux de Gilson et coll.25 et a été étendu pour
illustrer la manière dont la littérature sur la con ance
et la recherche de soins sous forme d’interaction
h umaine sont en relation avec les perceptions du pa-
tient et les comportements de recherche de soins. Les
encarts gris à droite de la ligne « A » constituent
Figure Un réseau conceptuel de la manière dont les caractéristiques du patient et du pourvoyeur de soins interagissent pour
a ccentuer le retard. Adapté de Gilson et al.25

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
l’extension du réseau de Gilson ; les observations de
cet article renforcent leur contenu.
Dès lors, en bref, l’étude se situe au sein d’un
contexte urbain pluraliste où les patients peuvent avoir
de fréquents contacts avec les pourvoyeurs avant
d’arriver à un diagnostic de TB. Elle vise à étendre la
littérature existante sur la recherche de soins et le
diagnostic de la TB grâce à l’exploration de la façon
dont les comportements du pourvoyeur et du patient
interagissent pour accentuer le retard au diagnostic à
la fois au niveau du contact individuel et au niveau
des dispositions institutionnelles.
RECUEIL ET ANALYSE DES DONNÉES
On a mené, pendant l’année 2004, huit discussions
focalisées de groupe dans des collectivités où la fré-
quence de la TB était élevée. Les répondeurs atteints
de TB ont été recrutés au moyen d’un questionnaire
standardisé de recrutement et les répondeurs poten-
tiels ont été identi és par les in rmières dans les poly-
cliniques TB et par les contacts personnels des recru-
teurs au sein des collectivités, suivis d’ailleurs d’un
effet de boule de neige pour l’identi cation des pa-
tients aux différents stades du traitement de la TB,
c’est à dire traitement achevé, en cours ou échec.* Le
statut TB est établi à partir des déclarations des parti-
cipants qui sont classi és comme atteints par la TB
s’ils signalent qu’à un moment quelconque le dia-
gnostic de TB a été porté chez eux. Les participants
non atteints de la TB sont recrutés par les contacts
personnels des recruteurs au sein des mêmes collecti-
vités et par l’effet de boule de neige. Les patients dé -
nis comme non atteints par la TB ont déclaré que le
diagnostic de TB n’avait jamais été porté chez eux.
Chaque groupe a compris de 6 à 8 participants âgés
de 20 à 39 ans. Le Tableau montre la strati cation du
groupe en fonction du sexe, de l’ethnie† et du statut
de TB. Les discussions dans les groupes ont été me-
nées dans la langue maternelle des répondeurs et ont
respecté un guide détaillé de discussion. Les discus-
sions ont été enregistrées sur bande magnétique, tra-
duites et simultanément transcrites en anglais. Toutes
les discussions de groupe ont été observées par un
traducteur derrière un miroir sans tain. Les partici-
pants étaient au courant du fait que le groupe faisait
l’objet d’un enregistrement et d’une observation et
ont eu la possibilité de se retirer à n’importe quel
moment.
L’approbation éthique pour mener cette étude a
été obtenue au niveau de la London School of Hy-
giene & Tropical Medicine et du City of Cape Town’s
Health Directorate.
Les discussions visaient à extraire le langage utilisé
pour décrire les services de santé et les maladies cou-
rantes et la base sur laquelle ces services et ces mala-
dies étaient différenciés. On a testé les participants au
sujet des in uences agissant sur le comportement de
recherche de soins, y compris les barrières effectives
ou potentielles d’accessibilité aux soins. Comme la
recherche du traitement de la TB peut constituer un
sujet sensible, les discussions ont comporté également
un jeu de rôle où l’on demandait aux participants de
décrire un membre typique de leur collectivité. On a
ensuite dit au groupe que la personne décrite était at-
teint de TB et on leur a demandé pourquoi on pou-
vait suspecter ce diagnostic et ce que cette personne
ferait à ce propos en termes à la fois de recherche de
soins et de crainte de communication.
Les observations ont été mises en lumière de ma-
nière inductive à partir de l’ensemble des données en
utilisant à la fois une théorie bien fondée (menée en
utilisant ATLAS.ti version 4.0, Scienti c Software
Development, Berlin, Allemagne) et une analyse thé-
matique manuelle. Les observations provenant des
deux processus ont fait l’objet d’une triangulation
pour permettre de tirer les conclusions nales. Seules
* Les recruteurs sont des travailleurs de terrain, professionnels in-
dépendants employés par une agence locale.
† Les termes « ethnie » et « groupe de population » ont été utilisés
de façon interchangeable. On a demandé aux participants de se
classer eux-mêmes et on leur a laissé la possibilité de refuser ou
d’utiliser n’importe quelle autre description. Les termes « Noir/Afri-
cain », « métis », « blanc » et « Indien ou Asiatique » sont utilisés.
Tableau Une vue d’ensemble de la structure des groupes de discussion
Sexe Ethnicité (langage) Sous-district de Cape Town Atteints
de TB
Groupe 1 Féminin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Non
Groupe 2 Féminin Noir/Africain (Xhosa) Khayelis/Nyanga Non
Groupe 3 Masculin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Non
Groupe 4 Masculin Noir/Africain (Xhosa) Khayelis/Nyanga Non
Groupe 5 Féminin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Oui
Groupe 6 Féminin Noir/Africain (Xhosa) Khayelis/Nyanga Oui
Groupe 7 Masculin Métis (Afrikaan) Mitchells Plain/Oostenburg Oui
Groupe 8 Masculin Noir/Africain (Xhosa) Khayelisha/Nyanga Oui
TB = tuberculose.
Ils n’ont pas comme intention de conférer des stéréotypes raciaux ou
autres ou de déroger de n’importe quelle manière. Comme la ter-
minologie peut ne pas être agréable à certains lecteurs, on se réfère
aux participants en fonction de leur langage dominant, c’est-à-dire
un répondeur « Noir/Africain » sera désigné dorénavant comme un
« Xhosa » et un répondeur « métis » comme « Afrikaan ».

Confusion, recours aux soins et retard au diagnostic de la TB 5
les observations signi catives pour la compréhension
des retards au diagnostic de TB sont reprises ici.
RÉSULTATS
Connaissance et perception des pourvoyeurs de soins
Les participants étaient conscients de l’existence d’une
variété de pourvoyeurs. La discussion suivante utilise
le langage des participants, c’est-à-dire que « docteur »
se rapporte à un médecin privé (sauf spéci é autre-
ment) et que les polycliniques ou les hôpitaux de
jour* sont des services publics (sauf spéci é autre-
ment). Les hôpitaux tertiaires sont cités par leur nom
lorsque c’est possible a n de permettre la différentia-
tion entre les divers services.
En dépit du fait que la plupart des pourvoyeurs
étaient connus, il persiste une confusion concernant
les types de service fournis par chacun d’entre eux et
concernant la manière de se comporter à l’entrée dans
un service public. Par exemple, un certain nombre de
patients ont consulté des médecins privés lorsqu’ils
suspectaient être atteints de TB sans réaliser que les
pourvoyeurs privés ne sont pas autorisés à traiter la
TB. D’autres participants se sont plaints du fait que
lorsqu’ils se rendaient dans les services publics avec
des enfants malades, ils étaient renvoyés parce que la
polyclinique pour bébés était fermée à ce moment.
D’autres se sont plaints des les d’attente durant des
heures dans les polycliniques publiques, aboutissant
uniquement à la découverte qu’ils n’avaient pas pré-
senté leur carte de santé à l’arrivée et que pour cette
raison, ils ne seraient pas vus ce jour là par une in r-
mière ou un médecin. Ces problèmes ont été une
source signi cative de frustrations pour les utilisa-
teurs des services et ont constitué une barrière aux
soins pour les participants ; ceux-ci ont cité les expé-
riences négatives d’amis et de membres de la famille
pour justi er le fait qu’ils avaient recouru à un pour-
voyeur de soins privé plutôt qu’à un service public ou
même le fait qu’ils n’avaient recouru à aucun soin.
Utilisation des services de santé
On a demandé à tous les participants de décrire leur
comportement de recherche de soins pour leur der-
nière maladie. Les épisodes de maladie ont varié de-
puis les refroidissements saisonniers jusqu’à l’appen-
dicite aiguë et la TB. Les types de recours aux soins
signalés ont varié de simples rencontres à des chaînes
complexes comportant des visites multiples à de mul-
tiples pourvoyeurs. Parmi ceux qui ont recherché de
l’aide chez un pourvoyeur, la chaîne la plus courte
utilisée (c’est-à-dire la série de pourvoyeurs consultés
pour un seul épisode de maladie) a été la visite unique
à un pourvoyeur. Ce pourvoyeur était le plus souvent
un pharmacien, une polyclinique publique ou un mé-
decin privé, mais occasionnellement un hôpital pu-
blic tertiaire, un guérisseur spirituel ou un herboriste.
La chaîne la plus longue a comporté 10 visites à huit
pourvoyeurs différents, à la fois privés et publics,
avant d’aboutir à un diagnostic et avant que le traite-
ment approprié ne puisse être mis en route. Le récit
suivant a été assez habituel parmi les personnes re-
cherchant des soins et chez qui le diagnostic de TB a
été porté ensuite :
J’avais de la èvre. J’ai été à la polyclinique [pu-
blique]. On m’a donné des comprimés et on m’a
dit que si je ne me sentais pas mieux je devais re-
venir. Après une semaine. . . . j’ai été chez un mé-
decin [privé] . . . Il a dit que la polyclinique avait
raison et que j’avais un refroidissement . . . Je lui
ai également dit que j’avais une douleur aiguë
ainsi que des sueurs nocturnes. Il m’a donné un
médicament. Je n’ai pas été satisfait du traitement
car je continuais à tousser . . . Je perdais du poids
à une vitesse inquiétante. Mon oncle m’a envoyé
chez un autre docteur . . . La première fois, il n’y a
pas eu d’amélioration et je suis revenu. La seconde
fois, il m’a fait une injection. Après que j’aie été
d’un médecin à l’autre, Maman m’a conseillé
d’aller à une polyclinique . . . Ils m’ont examiné
pour la TB et quand je suis revenu pour les résul-
tats, ils m’ont dit qu’après tout j’avais la TB. Ils
ont tout mis en route pour moi et j’ai pu com-
mencer le traitement. (Répondeur, Groupe 6).
Les chaînes de recherche de soins ont paru plus
simples chez les participants non atteints de TB.
Parmi les participants atteints de TB, les chaînes
étaient généralement plus courtes pour les partici-
pants Afrikaans que Xhosa. Les répondeurs Afrikaans
ont rarement mentionné avoir consulté des médecins
privés, alors que les participants Xhosa semblaient
aussi susceptibles de consulter un médecin privé
qu’un médecin public.
Ces diverses chaînes utilisées démontrent à quel
point les services publics et privés sont fréquemment
utilisés de manière conjointe. Ils illustrent également
comment les patients court-circuitent fréquemment
leur pourvoyeur public local pour recourir à des
pourvoyeurs publics en dehors de leur collectivité, ce
qui implique des coûts de transport plus élevés et
occasionnellement des mensonges concernant leur
adresse réelle pour pouvoir béné cier de soins.
. . . vous ne pouvez pas aller à une quelconque cli-
nique que vous souhaitez si vous n’êtes pas établi
dans cette zone, vous ne serez pas accepté ou aidé
(Répondeur)
Si vous avez besoin d’aller à une polyclinique Wyn-
berg lorsque vous séjournez à Nyanga, [la seule
manière] pour qu’ils vous acceptent est de dire
que vous travaillez et que vous séjournez là. Vous
devez mentir et que pouvez-vous faire d’autre
puisque vous êtes malade et que vous avez besoin
d’aide à ce moment là. (Répondeur, Groupe 6)
*
C’est un service de soins primaires qui peut assurer des diagnos-
tics sur place, y compris des clichés radiographiques et donner des
soins chirurgicaux mineurs. Habituellement le personnel comprend
un médecin. Il n’y a pas de services de nuit.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%