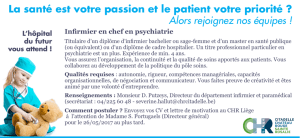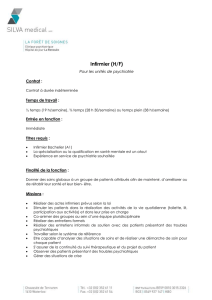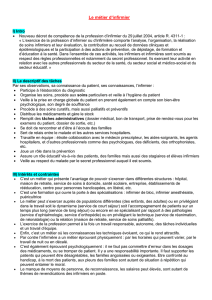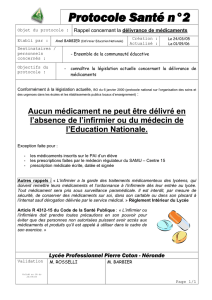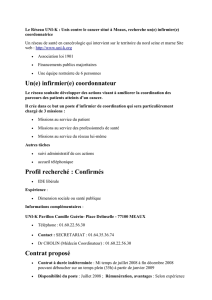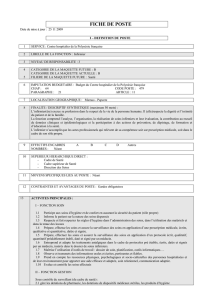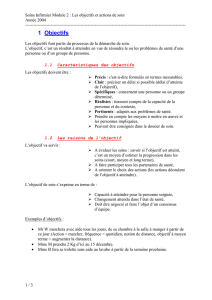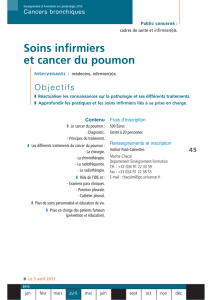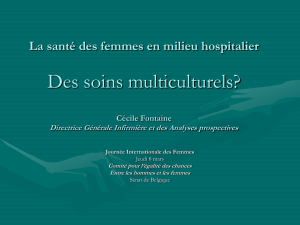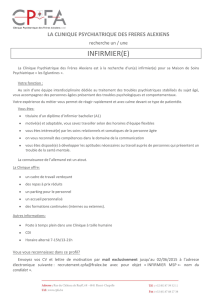Lire l`article complet

J
e suis cadre de proximité !
L’action, rien que l’action ! Être
cadre de proximité m’impose
d’être au plus proche de l’équipe
soignante, du soin, du patient, de la
logique, de la mission, du sens, mais
également des problèmes, des dysfonc-
tionnements, des difficultés, du quotidien,
de l’absence de sens...
Être proche et distant – une position de
déséquilibre –, je suis cadre de soin : le
soin, rien que le soin. Être cadre de soin
m’impose d’être au plus près du soin, du
patient, des moyens mis en œuvre, des
acteurs du soin, de cette difficulté à
soigner : observer, mettre en valeur,
reconnaître ce dont les soignants ont
besoin. Être également le porte-parole du
soin, porte-parole auprès des décideurs.
Ouf, ouf, ouf, je suis surveillant, la loi,
les lois, rien que la loi, je surveille qui, je
surveille quoi, je surveille comment ?
Surveillant...
Un mot à connotation policière qui
mérite qu’on s’y arrête.
•“sur” : préfixe qui marque la situation
de ce qui est plus haut, avec néanmoins
un contact, un mouvement. Une position
de recul, une vue du dessus, pour voir
autrement.
•“veillant” : mot soignant évoquant
l’attention. Veiller au respect de la loi,
celle pour protéger le patient, celle pour
protéger le soignant, celle pour me
protéger.
Cadre ?
L’institution, toute l’institution, le cadre
est une bordure entourant un tableau
pour marquer, orner, renforcer un
contenu. C’est également ce qui entoure
et délimite.
Renforcer le contenu, c’est parler du
soin, dire ce que l’on fait à nos inter-
locuteurs. Le cadre est le lien entre les
limites du service et celles de l’institution,
le lien entre l’extérieur et l’intérieur.
C’est aussi parler des contraintes, du
budget, de l’institution aux soignants, du
réel. Orner, c’est être le décor. Suis-je là
pour la frime, pour faire beau ?
Au-delà des commissions de toutes
sortes, des chefs, il est un fait que ceux
qui sont sur le terrain, “qui font tourner
les services”, qui sont au quotidien avec
les patients, dans une permanence à
toute épreuve, sont les infirmiers, les
aides soignants, les agents de service
hospitaliers.
La panoplie de termes pour évoquer une
même et unique fonction est sans doute
le signe de la difficulté, mais aussi de la
richesse, de cette fonction, de cette mission
ou de l’opportunité pour chacun de la
remplir différemment.
Se débrouiller au quotidien est le maître
mot pour tous.
La compétence du cadre est de concevoir
l’imprévisible au quotidien, de s’adapter
aux situations, de créer des solutions sur
mesure, comme la compétence des
soignants. C’est en cela que le soin est
un art. Dans la fonction de cadre, nous
sommes dans la même dynamique, celle
de l’art, de l’imprévisible, de l’inattendu,
du désordre, de l’imagination, de la
grogne, de l’angoisse parfois.
Comment créer des conditions d’organisation
optimales ? Celles-ci seraient-elles
garantes de la qualité ? Pour l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé, il semble que oui. Et pourtant,
le soin en psychiatrie échappe à toute
tentative de procédure. On ne peut pas,
et on ne doit pas, codifier les comportements
humains selon des critères. La qualité
n’est-elle pas la capacité des soignants à
répondre au mieux aux besoins ? Cette
capacité des soignants est parfois
supérieure à ce que l’on peut imaginer.
Cadres, nous sommes parfois dans
l’impossibilité de prévoir et de définir
les besoins de manière générale. C’est
aussi ces dysfonctionnements, “ces
couacs” qui ne manquent pas de
survenir, qui nous servent de fil, parfois
de projet, pour une prochaine fois, à
condition que la parole s’ensuive.
Parole, parole...
L’identité du cadre infirmier basée sur
le projet
Le cadre infirmier doit, dans son objet
organisationnel, adhérer à deux concepts
qui pourraient s’intituler “l’exemplarité”
et “l’intentionnalité”.
•L’ exemplarité du cadre infirmier se
définit par sa capacité à mettre en éveil et
en œuvre son expérience issue de la
pratique des soins, acquise au cours de
son exercice infirmier. C’est parce que
cet exercice infirmier doit être exercé
avec art que le cadre devra, dans sa
nouvelle fonction de responsabilité,
utiliser son exemple. Il est au cœur des
soins infirmiers, porte-parole éclairé de la
souffrance et des besoins exprimés,
recensés et métabolisés par l’équipe infir-
mière, dans la mise en place de projets.
Permettre à l’ensemble des acteurs de
soins de se familiariser avec sa pratique,
c’est consentir et souscrire à l’appropriation
et au devenir, devenant à son tour
22
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19) n° 1-2, janvier-février 2002
Je suis cadre !
D. Marquet*
* Cadre infirmier, service de psychiatrie
des adultes, CHU de Reims.
Vie professionnelle
Vie professionnelle
paramédicale

“exemple”.
• L’intentionnalité du cadre infirmier doit
être le moteur de toute approche de pro-
jet qui doit être alimentée par l’ex-
périence, définissant le sujet comme être
intentionnel qui cherche à donner “du
sens”, “de son sens” au soin ! Ce sens le
conduit à concevoir la finalité elle-même
comme propre objet de recherche à la
quête de l’individu.
Le cadre infirmier et le projet
De ce point de vue, le projet ne peut être
ni finalisé ni fonctionnalisé dans une
perspective d’activité, de charge, de rôle,
donc de mission à exercer. Des tâches à
accomplir, un service à rendre – modèles
qui répondraient alors à un contexte
d’obéissance où l’identité serait fondée
sur le projet – nourris de l’expérience et
de l’intention, n’auraient pas de sens.
Les projets ponctuels des cadres infirmiers
sont toujours des prétextes à situer
l’institution comme moteur des projets,
l’institution devenant alors source même
des projets, incitatrice. En fait, le projet
n’est que la mise en œuvre du désir
projectif du cadre qui l’initie, il n’a donc
pas forcément des options institution-
nelles mais il sert avant tout son créateur
en devenant une décision et l’énoncé de
ce qu’il a projeté pour lui-même. La
relation que le cadre infirmier a avec son
projet est comparable à la relation de
soins que l’infirmier a avec le patient.
Les cadres infirmiers initiateurs de pro-
jet démontrent malgré tout la relation
que “l’individu cadre” a avec le monde
qui l’entoure. Cette relation témoigne de
l’expérience qu’il a à ce monde.
L’écriture, dans la formulation de projets
et dans leur mise en œuvre, permet l’as-
similation à un processus de pensée qui
diffusée, devient un support à la mise en
actes des projets, créant ainsi une pro-
duction nouvelle au service d’un change-
ment escompté. L’écriture, de ce point de
vue, a plusieurs fonctions, notamment
une fonction de formation pour d’autres
projets. C’est aussi un mode de communi-
cation et de transmission allant vers une
forme d’explicitation et de compréhen-
sion qui pourrait tendre vers l’universel.
Les lecteurs du projet, notamment les
équipes soignantes, deviennent peu à peu
détentrices de ce nouveau savoir, essentiel
à la production et au changement.
La transmission du message
Dans toute expérience, l’exemple est au
cœur du processus de la formation, issue
d’un modèle inspiré de l’apprentissage.
La formation se transmet en premier
lieu, non pas par une accumulation de
connaissances et de savoirs, mais bien
par l’image que le professionnel renvoie
de sa fonction, elle-même renvoyant à
une représentation de son rôle et de son
mode d’exercice. Le cadre infirmier
n’échappe pas à cela, recherchant, dans
son expérience du passé, une image qu’il
veut soit recopier, soit, à l’inverse, modifier,
en considérant que l’exemple repéré
l’aidera à mieux agir.
Personnage, profession,
personne et institution
L’élaboration d’un modèle est remplie
d’options que se donne une société,
admettant et agréant des repères institu-
tionnels et légaux. Le projet personnel
ne peut que se diluer dans un leurre où
se noie un personnage repéré et identifié
comme “cadre”.
Notre exemplarité
Auteur de cet article, j’écris pour
m’exprimer et pour mettre en exergue un
point de vue. Mais cette rédaction sert
avant tout à réparer une image ou un
exemple que nous voulons faire et
défaire, l’écriture étant également un
outil de valorisation qui nous permet de
nous créer et de nous recréer sans cesse.
Ce mode d’expression est nécessaire
individuellement, et pourquoi pas collé-
gialement, pour recréer une image plus
digne, plus valorisante, plus respectable
que celle du cadre porteur de missions
souvent imaginaires, d’une représentation
collective, qui consisteraient à véhiculer
ce qui vient d’en haut, “de l’administration”,
à exécuter des tâches ingrates (les plannings)
et à remplir les injonctions des infirmières
générales.
Ne soyons pas dupes, même si chacun des
acteurs a son scénario, le rôle que nous
jouons, consciemment ou pas, est celui
que la société nous donne à remplir, en
étant nous-mêmes instrumentalisés et en
n’ayant que peu d’impact sur les décisions
que nous sommes appelés à prendre.
Interpréter le scénario en apportant
notre touche artistique
La distinction, entre scénario, texte et
acteur, est essentielle dans la fonction de
cadre. Même si les bases sont les
mêmes, chacun ou chacune d’entre nous
pourra apporter une touche issue de son
expérience, de son modèle, de sa sensi-
bilité. Ce pourra, selon le cas, être un
scénario où le vécu et le ressenti seront
diamétralement opposés. Les manifestations
caractéristiques pourraient se retrouver
dans les services de soins sous notre
responsabilité par des attitudes et des
comportements générant chez les pro-
fessionnels arrêt maladie ou non, moti-
vation ou non, mobilisation ou non.
Cadre infirmier,
à quoi ça sert ?
Distributeur de “PQ”, organisateur des
activités de soins, des plannings, des
congés, accusés d’être la courroie de
transmission de la direction, d’être aux
bottes du corps médical, d’être toujours
en réunion, d’être enfermés dans un
bureau, complotant toujours dans le dos
du personnel. Cadres, à quoi sert-on ? Le
fait d’exercer en psychiatrie majore
indubitablement ce questionnement.
S’il manque de monde aux portillons des
Instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI), peut-on en dire autant des Instituts
de formation des cadres de santé
(IFCS) ? La place ne serait-elle pas aussi
mauvaise que l’on a l’air de le dire ?
Être cadre,
une compétence à confirmer
Cette compétence, notamment en psy-
chiatrie, trouve sa force dans l’assise de
la connaissance que les professionnels
23
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19) n° 1-2, janvier-février 2002
Vie professionnelle
Vie professionnelle
paramédicale

ont de leur identité, leur permettant d’exercer
leur art avec conscience, compétence et
minutie. Cette assise renforce l’identité,
la satisfaction de cette identité et le
plaisir de remplir une mission utile, effi-
cace et agréable.
Le cadre garant d’une parole
et d’une expression
Une importante majorité du personnel
des équipes de soins souffre du manque
de considération, du manque de
dialogue, du manque de concertation qui
règnent dans les hôpitaux.
L’organisation maillon fort
permettant l’équilibre
La place et le rôle du cadre sont majeurs
pour permettre l’émergence de nouvelles
solidarités soignantes au service des
personnes soignées. Il faut pour cela que
chacun soit bien “à” et “dans” sa place,
notamment dans une fonction directe
auprès des patients, fonction qui serait à
redéfinir. Même si, d’un point de vue
théorique, le cadre n’a pas forcément
besoin de l’expertise en soins – car cette
expertise s’obtient en reconnaissant le
complément nécessaire à acquérir en
matière de formation, d’attitude et d’ap-
titude – il est absolument essentiel que la
reconnaissance de l’expertise infirmière
soit au cœur de la gestion de notre manage-
ment. Osons reconnaître que nous ne
savons pas tout en matière de soins. Lais-
sons place à la connaissance des autres,
qui, en retour, acceptent la place que
nous occupons parce que nous
n’usurpons pas la leur.
Équipe, décloisonnement,
concertation, échanges
L’esprit d’équipe, c’est cela qui est
important. Comme un entraîneur de foot,
n’hésitons pas à convoquer nos talents
d’animateur, de leader pour permettre la
potentialisation des compétences et des
connaissances. Celle-ci a toujours des
effets créatifs, dynamiques, vitalisants.
Nous ne sommes pas là pour faire, mais
pour faire faire, pour épauler, rassurer,
écouter, animer.
Le cadre infirmier en partenariat avec
l’ensemble des acteurs de soins devrait :
•
•participer à la définition des objectifs de
soins et du projet de l’unité en collaboration
avec le corps médical, sous la coordination
du cadre infirmier supérieur, en lien avec
l’infirmière générale ;
•
•gérer l’unité de soins en lien avec les
orientations définies par le corps médical
et organiser la prise en charge des
personnes hospitalisées ;
•
•assurer l’organisation des soins dans le
domaine de la compétence “propre” aux
soins infirmiers en obtenant l’ensemble
des moyens nécessaires au fonction-
nement ;
•
•coordonner la mise en place de ce dis-
positif dont il doit pouvoir évaluer les
effets ;
•
•associer dans un lien indiscutable et
indiscuté le corps médical, l’équipe
soignante, les personnes soignées et leur
entourage ;
•
•garantir la mise en place des outils et
des procédures, notamment dans le
domaine du dossier de soins infirmiers
et des protocoles de soins ;
•
•évaluer les impacts sur le degré de satis-
faction et de contentement des person-
nes hospitalisées ;
•
•signifier son engagement en prenant
suffisamment de distance, tout en étant
attentif et à l’écoute des besoins de
l’équipe.
À quand un texte régissant
la fonction des cadres
soignants dans la fonction
publique hospitalière ?
Les cadres infirmiers de la fonction
publique hospitalière ont besoin de
repères issus d’un texte réglementaire
définissant leurs missions, dans leur
relation aux malades et aux familles,
dans la gestion et le management des
moyens et des personnes. Il est également
essentiel de revoir notre place dans la
définition des processus de formation et
dans l’encadrement des stagiaires.
Dans le cadre de notre fonction, ne
devrions-nous pas être associés à la mise
en œuvre de la politique d’établissement
dans le respect des compétences et des
responsabilités de chacun pour en
préserver les valeurs professionnelles
infirmières qui sont les nôtres ? Il est
nécessaire d’apporter un éclairage
adapté aux situations complexes des
unités de soins par la mise en place d’un
réseau neutre, non hiérarchisé, de
l’encadrement, de façon à pouvoir évacuer
l’ensemble des situations anxiogènes
générées par la rencontre au quotidien de
la souffrance, de la maladie, voire de la
mort. L’expression et la prise en compte
des cadres dans les établissements de
soins auront des effets mobilisateurs et
des répercussions positives sur les
équipes soignantes et, de ce fait, sur les
personnes soignées.
Des avancées sont à espérer, notamment
dans les négociations futures sur la
réorganisation du temps travaillé et des
conditions de travail. Il est essentiel que
nous portions une parole simple, pleine
de convictions, sans attendre que tout
provienne des textes, du ministère, de la
hiérarchie.
Nous devons mobiliser nos énergies,
quelles qu’elles soient, afin que les
compétences soient reconnues, que nos
missions au sein des structures hospitalières
soient réalisées et que l’ensemble des
charges qui nous incombent soit recensé.
Nous voulons être reconnus, valorisés,
respectés. Et bien, respectons-nous,
valorisons-nous, produisons des réflexions
pertinentes ! Aussi, dégageons-nous des
tutelles pesantes en respectant et en
valorisant la place de l’autre. L’autre
pourra peut-être enfin nous reconnaître.
En augmentant nos délégations de
responsabilités, nous pourrons enrichir et
permettre notre épanouissement profes-
sionnel.
24
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19) n° 1-2, janvier-février 2002
Vie professionnelle
Vie professionnelle
paramédicale
1
/
3
100%