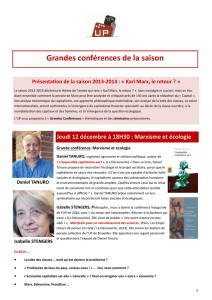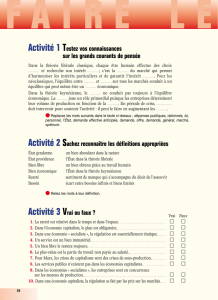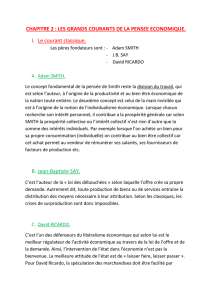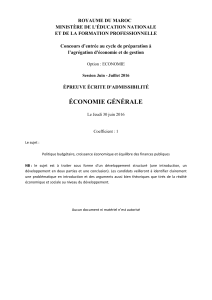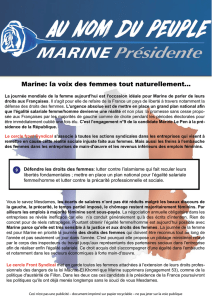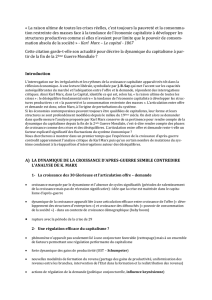Brève synthèse d`histoire de la pensée économique

Economie Générale Préparation à l’agrégation Marine Salès
Brève synthèse d’histoire de la pensée économique
L’apparition de théories nouvelles en économie n’entraine pas la disparition des anciennes. En
effet, les économistes ont soulevé des problèmes propres à leur période, à leur environnement et ont tenté
de trouver des solutions à ces problèmes. Toutes les théories en économie sont donc liées aux problèmes
d’une époque.
Certains problèmes sont évidemment récurrents, comme par exemple le problème de la définition de la
valeur, de la richesse, pour lesquels il est difficile d’apporter une réponse définitive.
Beaucoup d’économistes se définissent à l’origine comme des conseillers d’un prince ou du pouvoir en
place. Aucun économiste ne semble être insensible à ce qu’il l’entoure. Ils doivent par conséquent tenter
d’être les plus scientifiques possibles (se dégager des préjugés).
(Pour une synthèse sur l’épistémologie économique, lire page 2 à 9 d’Economie ; Alain Beitone, Emmanuel
Buisson et Christine Dollo).

Economie Générale Préparation à l’agrégation Marine Salès
La pensée économique avant les classiques
I. Contexte
A. La Renaissance (XVI siècle)
Progrès importants dans tous les domaines en Europe (technique, conception…)
o Déplacement du foyer des découvertes vers l’Ouest de l’Europe.
o Exemple : 1ière université créée à Padou en Italie par Galilée.
Démographie et climat
o Au 16ième siècle, on assiste à une explosion démographique, qui correspond en
Occident à la disparition des « Chevaliers de l’Apocalypse » (guerres, famines,
peste…) : augmentation de la demande, émigration vers le nouveau monde, affirmation
de l’hégémonie de l’Europe Occidentale.
o De plus, le climat a tendance à se radoucir, à devenir plus chaud (par rapport au Moyen
Age). Associé au progrès technique, cela a favorisé la croissance démographique.
Redéfinition des limites de l’Europe
o Découverte de l’Amérique ; prise de Grenade par les Espagnols en 1492…
Développement des échanges économiques, culturels… au sein et entre les pays,
développement des grandes villes, surtout en Italie.
L’Europe des Etats
o Création d’Etats au sens où on l’attend aujourd’hui. Exemple : François 1ier par
ordonnance crée la langue nationale, le Français, afin de rassembler la population.
o Création de cartes politiques, pour éviter que les intérêts s’imbriquent et se
chevauchent. Mise en place progressivement des frontières.
La religion : la Réforme (réforme de Luther, de Calvin, Anglicane…).
B. Les spécificités de la pensée économique
Apparition du courant des mercantilistes. Cela représente de nombreux auteurs, souvent proches
du pouvoir, assez pragmatiques. Développement anarchique (autant de mercantilistes que
d’auteurs !).
o Pour les mercantilistes, le paradis est sur terre (et non plus au ciel comme pour les
canonistes). Ainsi, la richesse doit être obtenue sur terre. Pour eux, cette richesse
correspond aux métaux précieux, qu’il convient d’accumuler ; mais souvent au détriment
d’une autre partie de l’économie comme l’agriculture.
o Pour les mercantilistes Français, la population est aussi une richesse. Par exemple, une
forte démographie permet une colonie de peuplement (dans le nouveau monde par
exemple), une armée plus importante, le prélèvement de plus d’impôt, une production plus
importante…
A l’opposé, les physiocrates défendent l’agriculture et la liberté de commercer.

Economie Générale Préparation à l’agrégation Marine Salès
II. Les doctrines mercantilistes (1450-1750 environ)
A. Mercantilismes Espagnol, « bullionisme »
1. Contexte
Obsession de l’or : comment le conserver au sein du pays ?
o On parle de chrysohedonisme (amour de la richesse). Les autorités favorisent la
thésaurisation et se détournent des autres sources de richesse.
Le volume d’or augmente dans les pays. Les prix augmentent sans que la production augmente :
pénurie, même pour les biens de base. Ils auraient pu décider d’importer mais cela aurait généré
des sorties d’or et d’argent… => interdiction d’exporter et d’importer, au risque d’avoir des
sorties de métaux précieux : balance commerciale nécessairement excédentaire.
o Mais perte progressivement de leurs métaux précieux sans avoir développé leur
activité économique.
2. Auteurs
Ecole de la Salamanque avec De Vitoria, Juan de Medina (ecclésiastiques)…
B. Mercantilisme Français
1. Harmonies Economiques
Jean Bodin (1529-1596) a été le conseiller d’Henri II. Il lui a écrit Six livres de la République (traité
politique pour le Roi).
Selon lui, la richesse est le profit laissé par les activités de fabrication et de commerce. Cette
richesse doit être accumulée. Ainsi, le royaume est riche et continu de s’enrichir (vision vraiment
différente du mercantilisme espagnol). Il faut un développement harmonieux de l’industrie, du
commerce et de la population.
« Il n’est de richesse ni de force que d’hommes »
2. Théorie quantitative de la monnaie
Développée lors d’une correspondance avec le seigneur de Malestroit (1568), Réponse aux
paradoxes de M. de Malestroit.
Jean Bodin considéra comme normal l’augmentation des prix observée en Espagne. Il y a une
relation étroite entre la masse monétaire et l’inflation selon lui. Plus la masse monétaire
augmente toutes choses égales par ailleurs (par l’augmentation du volume de métaux précieux),
plus la demande augmente sans que l’offre n’augmente. Ce qui entraine une augmentation des
prix (inflation) et des salaires. Il faudrait donc favoriser l’augmentation de l’offre et donc de la
production, pour permettre une augmentation de la richesse.
Le seigneur de Malestroit avait été chargé d’une enquête sur la forte inflation qui fit rage durant ce
siècle en Espagne. Il conclut de son côté, en 1565, que cette hausse n’avait rien de réel (c’est-à-
dire qu’elle ne tenait pas à la croissance de la richesse matérielle) mais qu’elle était purement

Economie Générale Préparation à l’agrégation Marine Salès
nominale (c’est-à-dire qu’elle correspondait à une augmentation des signes monétaires, celle qui
résulte par exemple d’une « valse des étiquettes » par les commerçants).
3. Jean Baptiste Colbert (1619-1683)
Jean Baptiste Colbert fut surintendant des finances sous Louis XIV.
Il développa l’industrie. Vision de concurrence entre les pays « Nul de gagne plus qu’un autre ne
perd » : création de droits de douane prohibitifs pour assurer une balance commerciale
excédentaire. Il faut favoriser l’enrichissement de la population et du Roi, en évitant notamment les
importations, en produisant soi-même.
Exemple : les fameuses manufactures royales…
4. Barthélémy Laffemas (1583-1657)
Homme de terrain, autodidacte, protestant.
Pour aider les manufactures du Royaume, il faut éviter les importations. La production nationale est
à favoriser, en développant l’industrie. Même si on ne peut pas produire quelque chose, on lui
trouve un substitut.
Il proposa d’étendre les corporations à tous les métiers (suppression des corporations en 1791 par
la loi Le Chapelier). Pour lui, les corporations garantissent la qualité des produits ; chaque artisan
est formé et contrôlé en permanence.
C. Mercantilisme fiduciaire de John Law (1671-1729)
La richesse peut venir du système bancaire, en facilitant la circulation de la monnaie par les billets
dont la valeur est fondée sur la confiance des agents. Il s’agit de remplacer les métaux précieux
par des billets.
Il créa une banque royale sous Louis XV. Celle-ci émettait des billets contre des métaux précieux.
Ces billets étaient une créance sur la banque, qui remboursait en or si les agents le demandaient.
Une fois la confiance des agents acquise, la banque a émis plus de billets qu’elle ne disposait
d’or afin de favoriser le développement des affaires commerciales.
Cependant, une coalition de propriétaires fonciers et de l’église a entrainé la faillite de cette
banque. Ceux-ci ont en effet réalisé des dépôts massifs d’or, entrainant une augmentation du
nombre de billets en circulation, avant de retirer massivement cet or.
La monnaie ne valait plus rien : fuite devant la monnaie.
D. Mercantilisme libéral, surtout anglais
William Petty (1623-1687)
o Le fondateur de l’économie politique pour Karl Marx.
o Tenta de mesurer la richesse d’un pays ; la valeur de la vie humaine d’un point de vue
économique.
o Pour le libre échange en Irlande : Anatomie politique de l’Irlande.

Economie Générale Préparation à l’agrégation Marine Salès
David Hume (1711-1776)
o Idées plus libérales que les mercantilistes.
o Mouvement pendulaire de l’or.
III. Les physiocrates (aux alentours de 1750)
Ils prônent le gouvernement de la nature. C’est une vraie école de pensée avec un « chef »,
François Quesnay (1694-1774) et des disciples (Mirabeau, Dupont de Nemours…),
essentiellement apparue en France, concernant surtout des propriétaires fonciers.
Ils s’opposent à l’idée de J. B. Colbert : il faut mettre en valeur la terre, et pas l’industrie !
François Quesnay était médecin, fils d’un agriculteur aisé. Il sera anoblit par Louis XV (médecin
ordinaire du roi). Il est donc venu tard à l’économie (C’est en fait en obtenant un domaine agricole
suite à son anoblissement qu’il s’y intéressera). On lui doit Le tableau économique (1758), où il
introduit vraiment la notion de cycle et de circuit économique. Il montre comment la richesse
circule, se forme, se consomme (se basa sur le circuit sanguin pour représenter cela). C’est en
quelque sorte l’ancêtre du modèle économique et des tentatives de schématisation.
o Son idée est la suivante : l’agriculture permet l’apparition d’un produit net. Ce revenu circule
alors dans l’économie : versement de rentes aux propriétaires fonciers qui achètent des
marchandises aux agriculteurs et à la classe des artisans (considérée comme
« improductive »). Ceux-ci achètent en retour des produits aux agriculteurs.
Ils se positionnent contre l’impôt sur la production, vu comme injuste : plus on produit, plus on
paye d’impôt. Ce qui en plus favorise l’augmentation du prix des biens. Ce sont les propriétaires
fonciers qu’il faut imposer, soit ceux qui contribuent peu à la production de richesse : ils ne
travaillent pas. Une exception est autorisée s’ils utilisent leur revenu pour « améliorer » leur terre.
Ce sont les dépenses qui doivent être taxées mais pas le gain ou le revenu d’après eux.
Ils sont favorables à la liberté individuelle et à la libre circulation des marchandises : « Laissez-
faire les hommes, laissez-passer les marchandises » Vincent de Gournay.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%