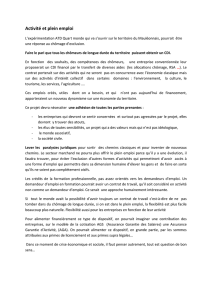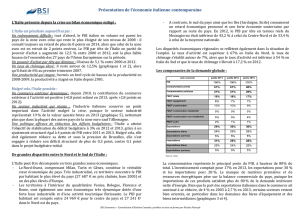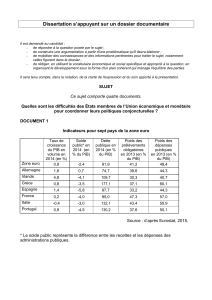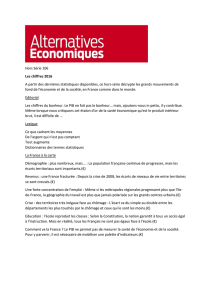EMPLOI - Le Monde

François Fillon veut secouer
le service public de l’emploi
bPour la première fois, la Commission
européenne a fait de la lutte contre le travail
au noir l’une de ses priorités. L’économie
souterraine représenterait entre 3 %
et 15 % du PIB des Etats membres p. VII
bLes cabinets de recrutement tentent
de lutter contre les discriminations p. VIII
FOCUS EMPLOI
T
andis que Jean-Pierre
Raffarin annonce la
création d’un « chè-
que-emploi » destiné
aux PME, avec
500 000 jobs à la clé,
François Fillon durcit le ton. Au
départ, la fin annoncée du mono-
pole de l’ANPE devait permettre
de « fluidifier » le marché du tra-
vail. Mais depuis quelques semai-
nes, le ministre des affaires socia-
les, du travail et de la solidarité
entonne, à son tour, le refrain des
«chômeurs qui ne souhaitent pas
reprendre un emploi ». Conforté
par un récent sondage CSA dans
lequel 67 % des personnes interro-
gées estiment qu’il faut « réduire
les indemnisations après une longue
période de chômage pour contrain-
dre les demandeurs d’emploi à
retrouver du travail », le ministre
évoque une modification éventuel-
le des règles, que l’on imagine plus
coercitives.
Le locataire de la rue de Grenel-
le s’imagine déjà en chef d’or-
chestre d’un débat majeur : la lut-
te contre le chômage, dont le
taux s’approche très dangereuse-
ment du seuil des 10 % . Le thème
est électoralement très sensible
et le gouvernement Raffarin ne
manquera pas d’être interpellé
sur une bonne ou une mauvaise
performance. François Fillon a
d’ores et déjà annoncé ses ambi-
tions en lançant, avec assurance,
le 4 novembre, que « 2004 serait
pour la France une année de
retour à la création d’emplois,
au-delà même des besoins de son
marché ». Une confiance qui
apparaît en décalage avec les pré-
visions de l’Unedic : selon les sta-
tisticiens de l’assurance-chôma-
ge, 135 000 emplois devraient
être créés en 2004, mais cette
reprise ne se répercuterait que
très faiblement et tardivement
sur le taux de chômage.
Si le ministre réussit à faire dimi-
nuer le nombre des demandeurs
d’emploi après avoir bouclé en 2003
la réforme des retraites, il s’ouvrira
un peu plus la route vers Matignon.
Mais, à l’inverse, s’il échoue, il pour-
rait en payer le prix fort.
Au-delà de sa volonté d’occuper
la scène politique en 2004, sa déci-
sion de reporter à l’année prochai-
ne la réforme de l’Association
nationale pour l’emploi (ANPE), ini-
tialement prévue dans le cadre du
projet de loi sur la formation tout
au long de la vie et le dialogue
social, traduit aussi la prudence. Le
gouvernement a préféré attendre
janvier 2004 et la remise des rap-
ports de Jean Marimbert, conseiller
d’Etat – sur les conditions d’un rap-
prochement des services publics de
l’emploi, notamment de l’ANPE et
de l’Unedic - et de Michel de Vir-
ville – secrétaire général de
Renault –, sur une simplification
du code du travail. Quant au rap-
port de Dominique Balmary,
conseiller d’Etat et ancien délégué
àl’emploi, sur les pratiques de
recours à des opérateurs externes
pour la mise en œuvre des politi-
ques actives de l’emploi, il devrait
être rendu d’ici à la fin 2003.
La réalité économique et sociale
est, en effet, difficile à manier.
L’argument principal de François
Fillon pour justifier la fin du mono-
pole de l’ANPE, ce sont ces
«300 000 » offres d’emploi non
pourvues, alors que l’on compte
plus de 2,5 millions de chômeurs.
Un « paradoxe inacceptable »,
juge le ministre, contredit par
beaucoup d’experts qui estiment
que cette situation n’a « rien
d’anormal ». Certains de ces pos-
tes dont la part est « marginale »
selon Pierre Cahuc, professeur à
l’université Paris-I, relèvent de sec-
teurs peu attractifs, en raison de
mauvaises conditions de travail et
de salaires peu élevés, comme le
BTP ou la restauration.
Quant aux autres emplois
vacants, ils sont le pendant du
«chômage frictionnel », provoqué
par les considérables mouvements
de main-d’œuvre. « Chaque jour
ouvrable, précise-t-il, 30 000 sala-
riés quittent leur emploi (retraite, fin
de contrat à durée déterminée
(CDD), licenciement, démission…),
soit plus de 6 millions par an. Il y a
ainsi en permanence des personnes
entre deux emplois, et en face des
postes en attente. Il faut le temps
que la rencontre se fasse. »
Dans la foulée, François Fillon
souhaite mettre en œuvre un rap-
prochement entre l’Unedic et
l’ANPE, mais comment aller plus
loin après l’intensification de la col-
laboration entre les deux institu-
tions introduite par le plan d’aide
au retour à l’emploi (PARE) en
2001 ? Il s’attaque aussi à un autre
chantier, la décentralisation de la
formation qualifiante pour les chô-
meurs, qui risque de porter un
coup à l’Association pour la forma-
tion professionnelle des adultes
(AFPA), bras armé de l’Etat dans
ce domaine. Dès 2005, le donneur
d’ordre sera la région, à laquelle il
n’est pas fait obligation de recou-
rir à l’AFPA. Celle-ci risquerait,
donc, de perdre des parts de mar-
ché et de subir des restructura-
tions. Certes, « l’Etat peut toujours
essayer de mettre en question les ins-
titutions, et cela est légitime, estime
Denis Fougère, directeur de recher-
che au CNRS, mais sur quels outils
scientifiques s’appuie-t-on pour
juger de l’efficacité de notre service
public de l’emploi ? »
L’arrivée promise de bureaux
privés de placement va accentuer
la concurrence déjà existante
entre les prestataires de l’ANPE,
au risque de déstabiliser les
acteurs du marché de l’emploi. Et
en particulier, parmi les plus fragi-
les d’entre eux, les associations,
qui depuis des années, via des
conventions avec l’ANPE et
d’autres financeurs publics, aident
les personnes en difficultés à s’in-
sérer. Même si quelques expérien-
ces européennes d’agences pri-
vées sont lancées, tout comme le
rapprochement entre services d’in-
demnisation et de placement, le
gouvernement sait qu’il devra
jouer tout en finesse. Le sujet est
éminemment explosif. Déjà, pres-
que tous les syndicats et associa-
tions de chômeurs contestent ces
projets, qu’ils jugent dangereux.
Et l’opposition ne manquera pas
de monter au créneau si elle
constate que les remèdes annon-
cés par François Fillon pour lutter
contre le chômage ne sont pas aus-
si efficaces que le promet le minis-
tre des affaires sociales.
Francine Aizicovici
EUROPE OFFRES
D’EMPLOI
le ministre
du travail va
ouvrir le marché
de la réinsertion
professionnelle
à de nouveaux
acteurs privés
La perte de confiance
des investisseurs
internationaux
vis-à-vis de Washington
pèse sur le billet vert.
Le 18 novembre, un euro
valait 1,1973 dollar,
un niveau historique p. V
Nombre de chômeurs (au sensduBIT)
en milliers (donnéesCVS)
UNE DÉGRADATION CONTINUE
Sources:ANPE,Dares
3 000
2800
2 600
2400
S D M S
20012002 2003
SJ D M J
2 639Sept. 2003
Sources:ANPE,Dares
DES MÉTIERS QUI ONT DU MAL À RECRUTER
Ratio : offresd'emploisenregistrées/demandes
enregistrées,au1ersemestre2003
1,7
1,4
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,68
Agriculture, marine, pêche
Hôtellerie, restauration, alim.
Industriesde process
Banquesetassurances
Bâtiment,travaux publics
Electricité, électronique
Mécanique, travail desmétaux
Moyenne tous secteurs
UN ÉVENTAIL PLUS LARGE DE GUICHETS
Avec une croissance
moyenne de 3,3 %,
les pays de l’Est
qui, le 1er mai 2004,
vont rejoindre
les Quinze devraient
doper l’économie
de l’Union p. IV
bDirigeants bFinance, administration,
juridique, RH bBanque, assurance
bConseil, auditbMarketing, commer-
cial, communication bSanté bIndus-
tries et technologies bCarrières inter-
nationales bMultipostes bCollectivi-
tés territoriales p. IX à XII
« L’Etat peut toujours essayer de mettre
en question les institutions, et cela est
légitime, mais sur quels outils scientifiques
s’appuie-t-on pour juger de l’efficacité
de notre service public de l’emploi ? »
,
LE DÉCALAGE S'AGGRAVE
Source : NatexisBanques populaires
Taux de change dollar/euro
(échelle de gauche)
PIB zone Euroland (échelle de droite)
4
3
2
1
0
-1
-2
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
99 00 0102 03
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
7
€
ECONOMIE
MARDI 25 NOVEMBRE 2003

Quand le RC Lens se met à jouer en division « recrutement »
Les associations risquent d’être les perdantes de l’ouverture du monopole
, la passion du football mène à tout,
même à l’emploi. Sensibilisé par la multiplication
des plans sociaux, le RC Lens avait déjà joué au pro-
fit des licenciés de Metaleurop et de la Comilog.
Depuis un mois, le club s’est associé à une entrepri-
se d’intérim pour transformer le stade Bollaert en
une gigantesque Bourse à l’emploi. Avec la béné-
diction et la participation active de l’ANPE.
Fondé et financé, à l’origine, par les Houillères,
le RC Lens a toujours été un miroir du monde du
travail. A chaque match, les responsables et invi-
tés de 450 entreprises – ses sponsors – envahis-
sent le stade aux côtés de ses 40 000 supporteurs.
« Il n’existe aucun point de rencontre équivalent au
nord de Paris », souligne Stéphane Bigeard, respon-
sable du marketing au club. « Ce sont aussi de gen-
tils entrepreneurs bien au chaud qui dégustent des
petits fours dans l’espace VIP, face à une foule de
gens dont 15 % à 20 % sont au chômage », tempère
Fabienne Saudemont, directrice pour la région
Nord-Est du groupe belge Creyf’s Intérim, l’une
des « entreprises partenaires » du club lensois.
«Depuis dix ans, notre partenariat se cantonnait à
de la publicité sur des panneaux autour du stade ou
sur les maillots, poursuit-elle. Nous avons voulu fai-
re du sponsoring utile. »
Née « un soir autour d’une bière », l’idée s’est
concrétisée le 25 octobre, à l’occasion du match de
championnat Lens-Lille. Depuis, à chaque rencontre,
les spectateurs peuvent déposer leur curriculum
vitae – ou celui de leurs amis et voisins – dans sept
urnes disposées autour du stade. Une huitième se
trouve dans l’« espace VIP », pour recueillir les offres
des employeurs à la recherche de salariés, intérimai-
res ou non. Le dispositif est complété par une « agen-
ce mobile », une caravane munie de panneaux d’in-
formation et d’offres d’emplois, dans laquelle des
hôtesses de Creyf’s expliquent ce qu’est l’intérim et
les objectifs de l’opération.
En trois matches, Creyf’s a pu ainsi recueillir
83 offres des entreprises partenaires du club, et
quelque 400 CV, dont 255 exploitables, précise
Fabienne Saudemont. La majorité des demandeurs
ont moins de 26 ans, 30 % – parmi lesquels trente
cadres – ont été licenciés ou ont envie de changer
de voie et possèdent déjà une certaine expérience
professionnelle. Les 255 candidats recevables
seront tous convoqués pour constitution d’un dos-
sier. Parmi eux, 35 ont déjà accepté des missions
d’intérim, 40 ont trouvé un nouvel emploi pour
début janvier, après leur période de préavis. Et
Creyf’s dispose d’offres de mission pour 70 autres.
Jean-Paul Boultchynski, directeur délégué de
l’ANPE pour le centre du Pas-de-Calais, affirme
n’avoir « aucun état d’âme » face à cette initiative.
«Plus de 30 % des offres que nous traitons provien-
nent déjà des sociétés d’intérim, dit-il. Creyf’s est l’un
de nos gros clients, ainsi, d’ailleurs, que le RC Lens. »
Tous deux l’ont informé de leurs intentions avant
son lancement. « J’aurais pu, c’est vrai, en avoir eu
l’idée avant eux, sourit-il. Mais je n’aurais pas pu la
réaliser : Creyf’s dépense en simple logistique pour
un seul match une somme supérieure à mon budget
de communication pour l’année ! »
Cette semaine, il doit rencontrer le directeur géné-
ral de Creyf’s pour la France, Fabrice Carré, pour pré-
ciser leur coopération. Creyf’s a promis de rétrocé-
der immédiatement à l’ANPE toutes les offres de
contrats en durée indéterminée qu’il recevra, et
pourrait aider l’agence à évaluer les demandeurs
d’emploi. Jean-Paul Boultchynski est ravi. « Je viens
de la région parisienne et j’ai été très agréablement
surpris en arrivant, dit-il. Ici, quand il s’agit d’aider les
chômeurs, toutes les entreprises jouent le jeu. »
Jean-Paul Dufour
R
eportée à janvier 2004,
la réforme de l’Agence
nationale pour l’em-
ploi (ANPE) reprendra
«les mêmes modali-
tés » que celles initiale-
ment prévues dans le cadre du pro-
jet de loi sur la formation tout au
long de la vie et le dialogue social
actuellement débattu au Parlement,
indique le ministère du travail. Elle
mettra donc fin au monopole légal
de l’ANPE, autorisant l’entrée sur le
marché de bureaux de placement
privés, bien que la France n’ait pas
ratifié la convention de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT)
de 1997 sur ce sujet. Quels acteurs
pourraient venir sur ce marché ?
Un grand nombre est déjà pré-
sent, et beaucoup collaborent déjà
avec l’ANPE, qui compte 4 000 pres-
tataires extérieurs. Les associations,
par exemple, interviennent, en sous-
traitance, généralement dans l’ac-
compagnement de publics en diffi-
culté, tandis que des sociétés d’inté-
rim, comme Manpower, réalisent
pour l’ANPE « des évaluations de
compétences ». D’autres partena-
riats consistent à échanger offres et
CV entre l’ANPE d’une part, les
entreprises de travail temporaire
(ETT) et les cabinets de recrutement
de l’autre. Avec la fin du monopole,
on pourrait assister à une multiplica-
tion des opérateurs privés dans le
domaine du placement.
Quelles catégories de chômeurs
seraient susceptibles d’attirer ces
convoitises ? « Reclasser les person-
nes peu formées nécessite du temps,
des formations qualifiantes et, sur ce
gâteau peu rentable, il n’y aura pas
beaucoup de monde », estime Philip-
pe Sabater, membre du bureau
national du syndicat SNU-ANPE
(FSU). Pour lui, les opérateurs s’inté-
resseront « plutôt aux personnes les
plus employables ». Dans un entre-
tien au Monde (daté du 12 novem-
bre), Michel Bernard, directeur géné-
ral de l’ANPE, estimait, au contraire,
que ces nouveaux acteurs ont des
prestations d’un coût « générale-
ment élevé, de l’ordre de 3 000 à
4000 euros par personne traitée » et
que, « à ce tarif, de tels services ne
peuvent être que réservés aux chô-
meurs les plus en difficulté ».
Mais « quelle société privée, dont
le but est de réaliser un profit maxi-
mum, va investir sur ce segment ? »,
se demande un expert du marché
du travail. Les ETT qui ont l’habitu-
de des publics peu qualifiés ? Elles
pourront, en effet, entrer sur le mar-
ché du placement à condition de
créer une filiale distincte pour cette
activité. Mais rien ne dit qu’elles y
trouveront un intérêt financier,
selon l’expert. « La société d’intérim
place elle-même ses salariés dans des
entreprises pour des missions tempo-
raires. C’est un jeu répété, où elle peut
espérer du profit à chaque fois. En
revanche, pour un bureau de place-
ment, comme pour un cabinet de
recrutement, une fois l’embauche réa-
lisée, la relation avec l’entreprise est
coupée, l’opérateur est payé. »
« »
Le problème essentiel, c’est celui
du financement des prestations. Cer-
tes, des entreprises pourront payer
ce service, comme dans le cas des
cabinets de recrutement. Mais sans
doute pas pour des personnes en dif-
ficulté. Pour celles-ci, il faudra comp-
ter avec les financements publics,
notamment de l’ANPE, mais aussi
des conseils généraux, des direc-
tions départementales de l’emploi,
etc. Et, sur ce créneau, les opéra-
teurs viendront essentiellement
concurrencer les associations.
Risquent-elles de souffrir de cette
concurrence ? La Fédération natio-
nale des associations de réinsertion
sociale (FNARS) d’Ile-de-France,
qui a signé en 2002 une convention
avec l’ANPE d’Ile-de-France, pour
habiliter ses Espaces emploi, est
constituée d’associations telles que
les Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS). « Je ne
pense pas que la concurrence mettra
en danger nos structures, estime
Danièle Cornet, coordinatrice char-
gée de l’insertion par l’économique.
Elles accueillent un public très éloigné
de l’emploi, qui a besoin d’un accom-
pagnement global – santé, logement,
travail… Quand on arrive à en placer
15 % en emploi, on estime que c’est
un bon score. C’est un travail difficile
et non rentable. » Les CHRS sont
financés par la direction de l’action
sociale du ministère et, si besoin,
par d’autres sources telles que le
Fonds social européen (FSE).
Si certains points de la future
réforme peuvent avoir des « aspects
positifs », en offrant, par exemple,
l’opportunité aux associations inter-
médiaires (AI), qui aujourd’hui ser-
vent de sas d’insertion, de venir sur
le marché du placement, Danièle
Cornet y voit aussi le risque d’une
«concurrence sauvage, car l’ouvertu-
re du marché n’est pas encadrée ».
C’est aussi la crainte de ce responsa-
ble associatif, dont la structure ne
fonctionne que via des conventions
avec l’ANPE. « Il y aura davantage
de concurrence, donc moins de
publics à traiter pour chaque associa-
tion. Il est vrai que nous avons une
expérience auprès des personnes en
difficulté, mais les opérateurs privés
vont s’adapter et, pourquoi pas, recru-
ter dans les associations en offrant de
meilleurs salaires. » En raison de cet-
te concurrence accrue, « l’ANPE, qui
devra faire des choix entre les structu-
res, aura sans doute plus d’exigences
en termes de résultats ».
«Le critère, dans le choix des asso-
ciations, c’est vraiment leur efficacité,
explique-t-on à l’ANPE. Elles répon-
dent à des appels d’offres. Elles sont
déjà dans cette logique concurren-
tielle. » Mais la pression pourrait
s’accentuer sur ces structures sou-
vent fragiles, et en laisser quelques-
unes au bord de la route.
F. A.
la concurrence
des opérateurs
privés inquiète
certains
responsables
D
’un côté, plus de
2,5 millions de chô-
meurs, de l’autre,
300 000 offres d’em-
plois non satisfaites.
Chacun verra là un
paradoxe. Un paradoxe « inaccep-
table », comme l’a déclaré François
Fillon ? C’est, en tout cas, l’un des
arguments avancés par le ministre
du travail pour justifier la fin pro-
chaine du monopole de l’Agence
nationale pour l’emploi (ANPE),
destinée à « fluidifier » le marché
du travail. Il s’est même engagé à
diminuer de 100 000 en 2004 le nom-
bre de ces offres non pourvues, en
mettant en place des formations
spécifiques et des mesures « pour
convaincre les chômeurs d’accepter
les postes proposés ». Un pari loin
d’être gagné, selon plusieurs
experts.
Pour commencer, d’où vient ce
chiffre de 300 000 ? En moyenne,
15 % des offres proposées par
l’ANPE ne sont pas pourvues au
bout de trois mois, soit environ
450 000. Le ministère en enlève
celles retirées par les entreprises
pour diverses raisons. Il en reste
120 000. L’ANPE captant 40 % du
marché des offres, le ministère en
déduit qu’au total environ 300 000
postes ne sont pas pourvus. Un
chiffre peu fiable car le pourcentage
des 15 % à l’origine du raisonne-
ment inclut déjà, en réalité, les
offres retirées, mais pas toutes.
«Les entreprises ne nous préviennent
pas toujours lorsque leur offre d’em-
ploi a été pourvue en interne ou que
le recrutement a été différé », indi-
que-t-on à l’ANPE. De plus, la réfé-
rence à une durée de trois mois n’a
pas grand sens dans ce débat.
Quels sont les profils de ces
emplois ? Aucune donnée précise.
Certains relèvent forcément des sec-
teurs connaissant des difficultés de
recrutement, repérés par l’enquête
de l’ANPE/Dares (ministère du tra-
vail) sur « les tensions sur le marché
du travail ». Ainsi, au premier semes-
tre, le rapport offres sur demandes
est supérieur à 1 chez les ouvriers
qualifiés du BTP, les employés et
techniciens des assurances, les infir-
miers et sages-femmes, les bou-
chers, charcutiers et boulangers, les
cuisiniers, le personnel de l’hôtelle-
rie, etc. Dans certains métiers, ces
tensions sont assorties d’un faible
taux de chômage, comme chez les
infirmiers ; dans d’autres, elles
coexistent avec un grand nombre
de demandes d’emploi, comme
pour les métiers de bouche ou l’hô-
tellerie. Les causes de ces tensions
sont donc multiples et mériteraient
une analyse fine. Cette étude ne
fournit pas non plus le volume d’em-
plois difficiles à pourvoir.
Mais, pour le ministère, aucun
doute : ces 300 000 postes relèvent
«essentiellement de secteurs comme
le BTP ou l’hôtellerie-restauration,
qui ont un déficit d’image en raison
des conditions de travail et des
salaires » trop faibles. L’ANPE reste
prudente : « On ne peut pas dire que
les postes non pourvus relèvent tous
de métiers en tension, le problème est
plus complexe. » L’Agence vient de
lancer une étude sur ces offres,
attendue à la fin de l’année.
Beaucoup d’experts ne se retrou-
vent pas dans la vision de M. Fillon.
Ces postes vacants, « qui existent
dans toute économie », sont le pen-
dant du « chômage frictionnel »,
souligne Philippe Askenazy, cher-
cheur au CNRS, qui ajoute que la
France connaît là une « situation
standard par rapport à d’autres
pays. Je vois difficilement comment la
mise en concurrence de l’ANPE, qui
adéjà accompli beaucoup de pro-
grès, pourrait réduire ce volant de
postes vacants. »
Divergence aussi sur les emplois
concernés. Ceux qui relèvent « de
secteurs mal rémunérés où les condi-
tions de travail sont pénibles consti-
tuent un tiers de ces 300 000
postes », estime le chercheur, voire
occupent une place « marginale »
selon Pierre Cahuc, professeur à
l’université Paris-I. Les autres
emplois inoccupés, affirment-ils,
sont liés aux mouvements de main-
d’œuvre, accentués ces dernières
années par la multiplication des
contrats précaires. « Chaque jour
ouvrable, précise Pierre Cahuc,
30 000 salariés quittent leur emploi
(retraite, fin de CDD, licenciement,
démission), soit plus de 6 millions par
an. Il y a ainsi en permanence des
personnes entre deux emplois, et en
face des postes en attente. Il faut le
temps que la rencontre se fasse. » Il
ne voit pas là « de dysfonctionne-
ment du marché du travail. Ces
300 000 postes représentent 1,5 % de
l’emploi total, c’est peu. Aux Etats-
Unis, ce taux était de 3 % fin 2002 »,
avec un chômage plus faible qu’en
France.
Au-delà du manque d’attractivité
de certains métiers, il faut aussi
prendre en compte « les problèmes
de qualification inadéquate, de loca-
lisation des postes, d’entreprises qui
cherchent le mouton à cinq pattes,
etc. », ajoute Jean-Luc Biacabe,
secrétaire général du Centre d’ob-
servation économique de la cham-
bre de commerce et d’industrie de
Paris. Aussi, « on peut sûrement
améliorer l’efficacité de l’ANPE, mais
je ne dis pas que cela va supprimer
ces postes non pourvus ». « On dis-
pose de très peu d’analyses sur ce
problème, observe Denis Fougère,
directeur de recherche au CNRS.
On peut toujours essayer de mettre
en question les institutions, et cela est
légitime, mais sur quels outils scienti-
fiques s’appuie-t-on pour juger de
l’efficacité de notre service public de
l’emploi ? Cette tension sur le marché
du travail a toujours existé. Elle est
structurelle. Simplement, la crise la
rend plus visible aujourd’hui. »
Francine Aizicovici
1
Que prévoit
la réforme
de l’ANPE ?
Initialement prévue dans le projet
de loi relatif à la formation profes-
sionnelle et au dialogue social,
actuellement débattu au Parle-
ment, la réforme de l’Agence natio-
nale pour l’emploi (ANPE) a été
reportée à janvier 2004, date à
laquelle François Fillon, ministre
du travail, disposera du rapport du
conseiller d’Etat Jean Marimbert,
portant, notamment, sur un rap-
prochement entre l’ANPE et
l’Unedic.
Les modalités de la réforme ne
devraient pas être modifiées,
selon le ministère. La fin du mono-
pole légal de l’ANPE dans le place-
ment des chômeurs est acquise,
même si cette ouverture existe
déjà. Préalablement déclarés
auprès de l’administration, des
bureaux de placement privés pour-
ront intervenir sur ce marché, cet-
te activité étant cependant
«incompatible » avec d’autres ser-
vices à but lucratif, à l’exception
de ceux « ayant trait à la recherche
d’emplois ». Aucuns frais ne pour-
ront être demandés aux chô-
meurs, qui devront continuer à
s’inscrire à l’ANPE.
L’ANPE pourra fournir des presta-
tions payantes aux entreprises et
«prendre des participations, partici-
per à des groupements et créer des
filiales ». M. Fillon vient d’annon-
cer de nouvelles mesures pour cet-
te réforme, en vue d’une « indivi-
dualisation plus grande » du suivi
des chômeurs et du « système d’in-
demnisation ».
2
Quel est
le bilan
du PARE ?
Entré en application le 1er juillet
2001, le Plan d’aide au retour à
l’emploi (PARE) s’inscrit dans la
nouvelle convention d’assurance-
chômage, qui supprime la dégressi-
vité des allocations et propose un
projet d’action personnalisé (PAP)
aux chômeurs soumis à un renfor-
cement de leurs obligations.
En juillet 2003, les gestionnaires
de l’assurance-chômage ont pré-
senté un point d’étape sur le PARE.
Le taux de retour à l’emploi après
formation est deux fois supérieur
au taux moyen habituel ; la durée
moyenne d’indemnisation a dimi-
nué de neuf jours en 2002. L’ANPE
estime, elle, que la durée moyen-
ne de chômage est passée de
13 mois en 2000 à 11 mois en 2002.
Cependant, une autre étude, en
cours de réalisation par le Centre
d’études de l’emploi pour l’ANPE
apporte des éléments contradictoi-
res. Ses premiers résultats indi-
quent que « la vitesse de sortie du
chômage n’a pas changé de façon
significative avec le PARE ». Néan-
moins, les chômeurs qui ont béné-
ficié d’un accompagnement appro-
fondi sortent « plus vite » du chô-
mage que ceux qui n’en n’ont pas
profité.
De son côté, la Dares (ministère du
travail) a interrogé un échantillon
de chômeurs ayant signé un PAP.
L’étude a été publiée en novem-
bre. Onze mois après la signature
du PAP, près des deux tiers des pro-
jets d’action sont réalisés mais
60 % des demandeurs d’emploi
sont encore à la recherche d’un tra-
vail. L’idée selon laquelle le PARE
et le PAP se traduisent par « davan-
tage de contrôles est largement par-
tagée ». Cependant, 73 % estiment
que l’entretien six mois après l’ins-
cription « a été l’occasion de faire
le bilan des derniers mois de recher-
che ». Les chômeurs souhaitent
que l’accompagnement soit plus
important et intervienne plus tôt.
3
Quelle incidence aura
la décentralisation
de la formation
qualifiante pour les
chômeurs sur l’AFPA ?
Inscrite dans le cadre du projet de
loi relatif aux responsabilités loca-
les, actuellement débattu, cet élar-
gissement des compétences des
régions s’accompagne du transfert
de crédits. Sur les 700 millions de
subventions que l’Etat affectait
auparavant à l’Association pour la
formation professionnelle des
adultes (AFPA), 450 seront transfé-
rés, l’Etat conservant la distribu-
tion des fonds de l’orientation. Ce
transfert débutera en 2005.
Le donneur d’ordre ne sera plus
l’Etat, mais la région, qui n’aura
pas obligation de s’adresser à l’AF-
PA. Celle-ci sera mise en concurren-
ce avec d’autres centres de forma-
tion, dans le cadre d’appels d’of-
fres, alors qu’elle fonctionnait jus-
qu’à présent avec des subventions.
Dans certains domaines, comme le
BTP ou l’hôtellerie-restauration,
l’AFPA n’a sans doute pas de souci
àse faire, car elle dispose d’instal-
lations techniques que peu d’orga-
nismes pourraient s’offrir.
En revanche, sur les formations ter-
tiaires, elle risque d’être perdante
dans les appels d’offres compte
tenu de ses coûts, liés aux charges
de service public. Elle dispose,
notamment, de capacités d’héber-
gement qui permettent à des sta-
giaires éloignés des centres de for-
mation de venir quand même se
former. Aura-t-elle encore les
moyens de s’occuper des chô-
meurs en situation d’exclusion ?
C’est l’une des inquiétudes, l’autre
étant que, si l’AFPA perd des parts
de marché, elle devra se restructu-
rer, avec sans doute des licencie-
ments à la clé.
françois fillon
veut diminuer
du tiers
les 300 000 offres
non satisfaites
POUR EN SAVOIR PLUS
QUESTIONS-RÉPONSES
Chômage
DOSSIER
L’idée de réformer l’ANPE repose
sur une vision contestée du marché de l’emploi
>Les politiques de l’emploi
et du marché du travail, ministère
des affaires sociales, du travail et de
la solidarité. Direction de l’animation
de la recherche, des statistiques
(La Découverte, coll. « Repères »,
2003, 122 p., 7,95 ¤).
>La nouvelle enquête emploi,
l’activité et le chômage, Insee -
Economie et statistique, 2003,
no362, 122 p., 7 ¤).
> Réformes structurelles du marché
du travail et politiques
macroéconomiques, par Edmond
Malinvaud, Revue de l’OFCE, n˚ 86,
juillet 2003, 24 p. (http://www.ofce.
sciences-po.fr/pdf/revue/1-86.pdf)
> Pour un Grenelle de l’Unedic,
de Robert Crémieux, Didier Gélot
et Christine Lanoizelez, Fondation
Copernic (2003, Syllepse, 163 p., 7 ¤).
> Chômage et chômeurs, de Robert
Holcman (2003, éd. ENSP, 287 p., 32 ¤).
>Sur Internet, les derniers chiffres
http://www.travail.gouv.fr/etudes/
embargo_marche.asp
II/LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003

La réforme du service public
de l’emploi (SPE) envisagée en
France intervient dans un contex-
te de doute sur son efficience
face à la montée du chômage. En
a-t-il été de même pour les réfor-
mes dont nous sommes censés
nous inspirer, menées ces derniè-
res années au Danemark, aux
Pays-Bas et, plus récemment, en
Allemagne ?
Au Danemark, la réforme date
de 1994. Le taux de chômage était
alors faible, et le marché du travail
connaissait des situations de pénu-
rie. La politique de l’emploi a donc
changé de stratégie au profit d’une
«activation des dépenses passi-
ves », dont le but était de rappro-
cher de l’emploi les personnes qui
en étaient les plus éloignées. L’une
des composantes de cette politique
aété la réforme du SPE. Celui-ci
devait, désormais, devenir capable
d’offrir à chaque demandeur d’em-
ploi un accompagnement indivi-
dualisé, ce droit étant assorti d’un
devoir : accepter l’emploi proposé
àl’issue de ce parcours. Il s’est vu
aussi confier la mission d’analyser
et de répondre très exactement
aux besoins de chaque entreprise.
Le SPE a donc été déconcentré,
passant théoriquement sous la res-
ponsabilité de quatorze « conseils
régionaux du marché du travail »,
associant partenaires sociaux et
autorités politiques régionales,
jugés plus à même d’analyser l’of-
fre et la demande au niveau local,
et de mettre en œuvre les outils sus-
ceptibles de les rapprocher (forma-
tion, emplois subventionnés dans
le secteur marchand ou non mar-
chand).
Aux Pays-Bas, la réforme, adop-
tée en 2000, est également interve-
nue dans un contexte de chômage
encore faible, mais le problème
invoqué n’était pas tant celui de la
pénurie de main-d’œuvre, que
celui du coût trop important pour
la collectivité du système de presta-
tions aux « invalides », une catégo-
rie englobant des personnes en réa-
lité aptes à entrer sur le marché du
travail. Là encore, la notion de
«droits et devoirs » a été mise en
avant. La réforme a donc consisté à
fusionner localement, en un gui-
chet unique, les Centres de travail
et de revenus (CWI), les caisses d’al-
locations-chômage et les caisses
invalidité, mais aussi les services de
placement et les services locaux
d’aide sociale.
En Allemagne en revanche, c’est
bien la forte remontée du chômage
et les doutes sur l’efficience de l’Of-
fice fédéral de l’emploi – accusé de
«truquer » ses statistiques – qui
ont justifié la réforme. Mais celle-ci
s’inscrit dans un ensemble plus vas-
te, qui inclut à la fois des mesures
en faveur de la flexibilité du mar-
ché du travail (encouragements au
temps partiel et aux contrats à
durée déterminée), et de la réduc-
tion du montant des prestations
chômage. Les Job Centers locaux
créés par la réforme sont, comme
aux Pays-Bas, des guichets uniques
chargés d’aider les chômeurs à
trouver un emploi et de leur payer
les indemnités.
Quels sont les points com-
muns et les divergences entre les
modalités de ces différentes
réformes, et la réforme envisa-
gée en France ?
La tendance est partout à la
fusion entre les fonctions de place-
ment et de versement des alloca-
tions sociales. Même au Dane-
mark, où les caisses de chômage
ont conservé leur autonomie, des
mécanismes de coordination de
leurs versements avec l’action des
agences locales pour l’emploi ont
été mis en place. Plus générale-
ment, ce rapprochement dans le
binôme indemnisation-placement
ne fait que renouer avec la tradi-
tion historique : les caisses de chô-
mage, créées au XIXesiècle par les
syndicats, possédaient toutes un
bureau de placement, y compris en
France jusqu’à leur suppression
par le régime de Vichy, et avant
que ne soit créée l’Unedic en 1958.
Pour les syndicats en effet, il n’était
pas question de laisser se créer une
«armée de réserve » qui permet-
tait au patronat de faire baisser les
salaires : la priorité était au réem-
ploi le plus rapide possible des chô-
meurs.
Séparer le revenu minimum d’ac-
tivité (RMA) de la fonction de pla-
cement, en le mettant sous la res-
ponsabilité des départements,
situe, à cet égard, la France à
rebours de la tendance européen-
ne. Le Danemark avait, en un pre-
mier temps, laissé la réinsertion
professionnelle des bénéficiaires
des minima sociaux aux commu-
nes. Mais il semblerait que l’incohé-
rence avec les politiques menées
par les « conseils régionaux » ait
conduit en 2002 le gouvernement
danois à rapprocher ces bénéficiai-
res des services de l’emploi – à l’ins-
tar de la situation prévalant depuis
les réformes aux Pays-Bas et en
Allemagne. Tous les demandeurs
d’emploi, quel que soit leur statut
indemnitaire, sont gérés par les ins-
titutions qui sont, également, char-
gés du placement sur le marché de
l’emploi.
La mise en concurrence avec
des acteurs privés est-elle une
caractéristique commune de ces
réformes ?
En Allemagne, un demandeur
d’emploi qui n’a pas trouvé d’em-
bauche au bout de trois mois par le
canal du service public devrait
désormais avoir le droit de s’adres-
ser à un service privé – sans doute
des agences de travail temporai-
re –, à qui l’office public devra ver-
ser une commission en cas de suc-
cès. Par ailleurs, chaque Job Center
pourrait, dorénavant, passer un
appel d’offres pour sélectionner
une agence privée à qui elle sous-
traiterait le soin de trouver des
emplois temporaires aux chô-
meurs de longue durée (CLD).
Aux Pays-Bas, la mise en concur-
rence existe aussi, mais elle se base
sur des conventions passées entre
les CWI et des prestataires privés.
Dans la pratique, ces conventions
concernent également les CLD. Le
dernier rapport du Syndicat néer-
landais des agences de travail tem-
poraire indique, d’ailleurs, qu’un
quart des personnes qu’elles pla-
cent appartiennent aux catégories
«en difficulté », sur le marché du
travail (basse qualification, immi-
gré, jeune, handicapé, etc.). La
mise en concurrence ne signifie
donc pas forcément un service de
l’emploi à deux vitesses, où le servi-
ce public céderait au privé les cas
les plus « faciles ». Tout dépend de
la façon dont on encadre cette
ouverture à la concurrence. Mais,
en tout état de cause, la coopéra-
tion doit l’emporter sur la concur-
rence sauvage, pour ne pas accroî-
tre la segmentation des publics.
Comment ces réformes ont-
elles été accueillies ?
Contrairement au cas français, la
refonte des SPE a plutôt fait l’objet
d’un relatif consensus tant dans
l’opinion que parmi les syndicats.
Au Danemark comme aux Pays-
Bas, le compromis a été de ne pas
toucher au montant des alloca-
tions, très élevées par rapport à la
situation française, en échange de
la mise en place de la réforme. En
Allemagne, le mécontentement
des syndicats tient au fait que le
chancelier Gerhard Schröder n’a
finalement pas tenu sa promesse
de respecter un tel compromis, en
rognant sur les allocations-chôma-
ge. Mais le soupçon d’une volonté
de « liquidation » du service public
de l’emploi a été moins marqué
qu’en France…
Le vrai débat va plutôt porter sur
la qualité des emplois que les nou-
veaux dispositifs contraignent peu
ou prou les chômeurs à accepter.
Aux Pays-Bas ou au Danemark, la
réforme indique précisément que
ces emplois devront correspondre
àla qualification du chômeur et
aux normes salariales imposées
par les conventions collectives ;
mais en Allemagne, la loi dit que la
rémunération de l’emploi devra
être « conforme à l’usage local »,
ce qui laisse une large marge d’ap-
préciation aux Jobs Centers ! En
France, ce débat reste encore à
mener.
Propos recueillis par
Antoine Reverchon
L
es Néerlandais sont déjà
dans la place. « Et il y a
trois semaines, raconte ce
cadre de l’Unedic, nous
avons vu débarquer des
Australiens, venus eux aus-
si nous proposer leurs services… »
L’annonce de nouvelles brèches
dans le monopole de l’ANPE a
franchi les océans. D’ores et déjà,
l’antenne Assedic de l’Ouest franci-
lien a confié à la filiale française de
l’agence privée hollandaise Maatwe-
rk 150 chômeurs de longue durée.
Charge à elle de leur dénicher un
contrat de travail d’au moins six
mois, et ce dans un délai maximum
de 24 mois. « Ce n’est qu’une expéri-
mentation, commente-t-on à
l’Unedic. Et nous attendons les résul-
tats. Mais il est sûr que les moyens
dont dispose l’ANPE pour aider les
personnes qui sont les plus éloignées
du travail ne sont pas suffisants… »
L’Unedic ne sera pas la cible des
acteurs privés français et étrangers
du marché de l’emploi : « N’oubliez
pas notre fonction : nous sommes un
établissement payeur, géré paritaire-
ment. Qui voudrait se substituer à
nous ? » En revanche, à l’Unedic, on
sait bien que l’ANPE, risque, elle, de
se faire marcher sur les pieds… y
compris par l’Unedic qui pourrait
confier à d’autres que des Hollan-
dais la réintégration professionnelle
des chômeurs en difficulté.
Pas d’erreur néanmoins, l’idée
du gouvernement est bien de rap-
procher – encore et un peu plus –
les deux acteurs majeurs du servi-
ce public de l’emploi (SPE). Un rap-
port est attendu sur le sujet : celui,
en janvier, de Jean Marimbert,
conseiller d’Etat et ancien direc-
teur général de l’ANPE. Mais d’ici
àla fin de l’année, François Fillon
disposera aussi d’une étude
menée par Dominique Balmary,
ancien délégué à l’emploi, égale-
ment conseiller d’Etat, qui va, lui,
s’interroger sur une « Evaluation
des pratiques de recours à des opé-
rateurs externes pour la mise en
œuvre des politiques actives de
l’emploi ».
Mais rapprocher jusqu’où ? Une
fusion ? Au ministère, on ne l’imagi-
ne même pas. Personne n’a oublié
les ambitions de Philippe Séguin
qui, en 1987, avait imaginé la créa-
tion « d’un grand service unifié de
l’emploi ». Patatras. Un rapport de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) était venu lui rappe-
ler que la fusion des deux organis-
mes dont les statuts sont différents
– l’Unedic est une association de loi
1901 avec plus de 12 000 salariés de
droit privé ; l’ANPE, forte de
23 000 agents contractuels sous sta-
tut public, est un établissement
public administratif (Epad – entraî-
nerait pour le personnel de
l’Unedic un mieux disant social…
au coût élevé.
’
Il faut donc imaginer de nouvel-
les synergies, sachant que les deux
institutions ne se regardent plus
en chiens de faïence depuis long-
temps. En 1993, le conseil d’orien-
tation et de surveillance (COS)
chargé de coordonner l’ANPE et
l’Unedic a été créé… un succès d’es-
time. La nouvelle étape (2001)
date évidemment de l’introduc-
tion du Plan d’aide au retour à
l’emploi (PARE) pour lequel
l’ANPE perçoit un peu moins d’un
tiers de son financement par
l’Unedic. « Bref, proteste-t-on aux
Assedic de Paris, on va nous faire le
coup d’un énième rapport supplé-
mentaire sur les synergies que nous
devons mettre en place. Mais qui
débouchera sur quoi ? » La situa-
tion financière de l’organisme pari-
taire, dont le déficit pourrait attein-
dre près de 4,3 milliards d’euros
cette année puis 1,2 milliard l’an-
née prochaine, préoccupe plutôt
les esprits, même si la perspective
de l’équilibre en 2005 est toujours
d’actualité, grâce à un emprunt
qui a été contracté.
Au ministère des affaires socia-
les, on lance quand même quel-
ques idées en attendant le rapport
Marimbert. « Les systèmes informa-
tiques des deux organismes sont très
différents. On pourrait faire des sim-
plifications techniques qui
devraient accélérer le traitement
des dossiers ». Effectivement…
C’est la version soft. Idée plus
ambitieuse : « l’instauration d’un
guichet unique pour le demandeur
d’emploi », solution qui se dévelop-
pe de plus en plus en Europe,
mais, précise-t-on immédiatement
pour calmer les esprits des person-
nels des deux organismes : « tout
en gardant les institutions telles
qu’elles sont ». Jean Marimbert
devra faire preuve d’imagination.
Marie-Béatrice Baudet
CHRONIQUE
Une vague montante
en janvier 2004,
un rapport se
prononcera sur
le rapprochement
des deux
organismes
Carole Tuchszirer, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES)
«La fusion entre indemnisation
et placement se renforce partout en Europe »
f1999 Carole Tuchszirer est l’auteur,
avec Christine Daniel, de L’Etat face
aux chômeurs (Flammarion), un ouvrage
sur l’histoire de l’indemnisation
des chômeurs en France.
f1996 Elle prend les fonctions
de chargée de recherche à l’Institut
de recherches économiques
et sociales (IRES).
f1989 Docteur en économie
du travail, elle est chargée de recherche
au Centre d’études de l’emploi (CEE),
puis à l’ANPE à partir de 1990.
par Serge Marti
CAROLE TUCHSZIRER
Le retour du « guichet unique » ANPE-Unedic
DOSSIER
«Le vrai débat va plutôt porter
sur la qualité des emplois que les nouveaux
dispositifs contraignent peu ou prou
les chômeurs à accepter »
’ àMumbaï !
En rompant les rangs de la mani-
festation qui, samedi 15 novem-
bre, a clôturé la centaine de
débats qui, durant trois jours, ont
marqué ce Forum social européen
(FSE) ouvert aux représentants
d’une soixantaine de pays, des
dizaines de milliers d’altermondia-
listes se sont déjà donné rendez-
vous à Bombay, en Inde, où, du 16
au 21 janvier, se tiendra le pro-
chain Forum social mondial
(FSM).
Le décalage est surprenant
entre la couverture médiatique
parfois surdimensionnée qui a pré-
cédé ce rassemblement organisé
dans la ceinture rouge parisienne
et les commentaires souvent désa-
busés, après coup, sur les résultats
concrets ou à attendre de ce gigan-
tesque happening qui, en tout
point, a pourtant répondu aux
attentes de ses organisateurs.
Avant de parler de « l’après »,
revenons sur « l’avant ». Quand
on évoque les débuts de la contes-
tation contre les dérives de la glo-
balisation, c’est Seattle et décem-
bre 1999 qui viennent à l’esprit,
lorsque les manifestants infligè-
rent un premier échec à la confé-
rence ministérielle de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). En réalité, c’est juillet 1997
et la crise financière asiatique,
puis les tourmentes – qui, chaque
année, ont ensuite affecté un
pays émergent – qui ont délié les
langues et mis directement en
cause le fameux consensus de
Washington. Lequel imprimait,
depuis une bonne quinzaine d’an-
nées, sa marque unique sur la
politique qu’il convenait d’appli-
quer à l’économie mondiale.
Fait de libéralisation totale des
marchés et des échanges, de déré-
gulations et de privatisations
sans frein, ce credo a subi son pre-
mier revers, lorsque, un an plus
tard, les institutions financières
internationales dites de Bretton
Woods admettaient à propos de
l’un des piliers de ce consensus –
la libéralisation des mouvements
de capitaux – la nécessité de pro-
céder dorénavant à une libéralisa-
tion ordonnée, à savoir adaptée
aux besoins.
Dès lors, le ver était dans le
fruit et la victoire remportée sur
l’Accord multilatéral sur l’investis-
sement (AMI), en avril 1998, par
ceux qui étaient encore des anti-
mondialistes n’était que la suite
logique d’une contestation appe-
lée à s’amplifier. D’autant qu’elle
allait venir dorénavant de l’inté-
rieur même du système.
En effet, à côté de dizaines de
milliers d’anonymes, les contesta-
taires ont aussi pour noms Joseph
Stiglitz, Prix Nobel d’économie,
ancien économiste en chef de la
Banque mondiale, qui ne rate pas
une occasion de dénoncer les
erreurs commises au nom du néo-
libéralisme. Son successeur, Fran-
çois Bourguignon, beaucoup
moins virulent, mais qui, dans
nos colonnes (« Le Monde Econo-
mie », daté 11 novembre 2003),
reconnaissait tout de même le
creusement des inégalités résul-
tant de la mondialisation.
Par goût du paradoxe, on pour-
rait y ajouter Horst Köhler, le
directeur général du Fonds moné-
taire international (FMI) qui ne
peut plus commencer un dis-
cours sans utiliser le mot « pau-
vreté » à la deuxième phrase, ou
encore Supachai Panitchpakdi, le
patron de l’Organisation mondia-
le du commerce (OMC), qui,
après l’échec de Cancun, recon-
naissait la nécessité « d’une pau-
se » dans la libéralisation des
échanges.
« »
Ce recadrage étant fait, parlons
de « l’après ». Des parlotes, tout
et son contraire, rien de concret…
Que n’a-t-on lu et entendu à l’is-
sue de ce FSE, généralement de la
part de commentateurs qui n’y
ont jamais mis les pieds. Pour-
tant, quiconque a suivi, par exem-
ple, les cafouillages, les déclara-
tions aussi irresponsables que
contradictoires qui rythment la
construction cahotante de
l’Union européenne – et dont le
sommet de Nice de décem-
bre 2000 a été le point d’orgue –,
ne peut qu’être enclin à une cer-
taine humilité face aux « déma-
gos » et aux « braillards » de Saint-
Denis ou de Bobigny. Car ceux-ci
ont quelques réussites à leur
actif.
Sur la réduction de la dette des
pays pauvres, l’accès aux médica-
ments par les nations les plus
démunies, l’obligation d’une
meilleure transparence dans le
quotidien des institutions interna-
tionales, la réflexion sur l’instau-
ration d’un prélèvement financier
destiné à compenser les méfaits
des inégalités ou sur la réhabilita-
tion des services publics, rien de
cela n’aurait certainement vu le
jour si la société civile ne s’était
pas mobilisée.
Il en ira de même demain. Le
mouvement, aujourd’hui protéi-
forme, va se structurer. Certains
altermondialistes s’empareront
de la perche que leur tendent les
partis politiques ; d’autres conti-
nueront à œuvrer en dehors de
cet autre « consensus » qu’ils
dénoncent à leur tour. Il y a une
bonne vingtaine d’années, le mou-
vement écologiste international
est né ainsi. Sur fond de « parlo-
tes », de manifestations violen-
tes, de revendications utopistes. Il
aensuite soigné ses maladies
infantiles.
Ainsi, aujourd’hui, face à un
aréopage politique conservateur
ou social-libéral souvent aphone,
ce sont deux anciens lanceurs de
pavés vert-rouge – Joschka Fis-
cher et Daniel Cohn-Bendit – qui
sont certainement les meilleurs
porte-parole du discours d’avenir
que devrait tenir l’Europe. Deux
anciens « braillards ».
LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003/III

L’Espagne adopte avec prudence
les fonds de pension
MADRID,
de notre correspondante
N
’attendez pas, c’est
le dernier moment
pour assurer votre
avenir et payer
moins d’impôts. »
Traditionnellement,
en novembre et en décembre, les
banques, les caisses d’épargne et
les compagnies d’assurances font
assaut de campagnes publicitaires
pour proposer leurs offres de plans
de pension en insistant sur les avan-
tages fiscaux prévus par la loi.
Quelque 6,5 millions d’Espagnols
ont d’ores et déjà choisi cette solu-
tion qui vient en complément de
leurs retraites. Environ 6 millions
l’ont fait à titre individuel car ils ne
sont qu’un peu plus de 700 000 à bé-
néficier de plans de pension finan-
cés par l’entreprise dans laquelle ils
travaillent. Ce qui peut s’expliquer
par le tissu industriel espagnol,
composé à 90 % de petites entre-
prises et d’artisans.
Les analystes insistent pour dire
que ce système n’est pas encore
assez développé et représente à
peine 7 % du produit intérieur brut
(PIB), face à une moyenne de 25 %
dans l’Union européenne et plus de
50 % aux Etats-Unis. Mais il se déve-
loppe puisque, il y a dix ans, il ne
représentait que 2 % de la richesse
nationale.
Un des grands obstacles à ces
mesures de précaution réside dans
l’endettement des familles, au-delà
des 60 %, qui résulte en grande
partie de l’explosion des prix de
l’immobilier. D’une part, 90 % des
Espagnols achètent leur logement ;
d’autre part, le placement dans la
pierre, depuis l’année 2000 et les
pertes considérables enregistrées
en Bourse, apparaît comme le
moyen le plus sûr de constituer un
patrimoine. Les fonds de pension
semblent pour le moment réservés
aux plus hauts revenus, seuls capa-
bles d’investir. Ce qui joue, selon
les partis de gauche, dans le sens
d’un accroissement des inégalités
sociales, la solution passant par la
généralisation de plans d’entreprise
et un contrôle accru de l’Etat pour
limiter les risques.
Les avantages fiscaux vont dans
le sens d’un encouragement aux re-
traites complémentaires, mais ils
ne sont encore souvent perçus que
sous cet aspect, un moyen de payer
moins d’impôts. Les déductions
peuvent aller, selon le revenu, jus-
qu’à 45 % des sommes versées. Si
les prestations sont imposées, en
tant que revenus provenant du tra-
vail, ceux qui choisissent de récu-
pérer leur capital en une fois ne
payent pas d’impôts sur 40 % du
capital consolidé. Chacun peut
changer de fonds quand et comme
bon lui semble, sans pénalités fisca-
les, y compris si les prestations ont
déjà commencé à être versées. On
peut également en détenir plu-
sieurs pour avoir une bonne diversi-
fication, et verser ce que l’on veut.
Autre incitation, les doutes sur la
viabilité à long terme du système
de retraites actuel ont sensibilisé la
population à la nécessité de pré-
parer sa retraite d’une autre façon
que les générations précédentes.
Il n’en reste pas moins que la
rentabilité des plans de pension a
déçu bien des participants. Mais les
plans privés se sont mieux compor-
tés ces derniers mois : sur 512 plans
analysés par l’Association des ins-
titutions d’investissement collectif
(Inverco), plus de 480, soit 94 %,
ont obtenu des bénéfices, en
moyenne de 3,86 % entre septem-
bre 2002 et septembre 2003. Il faut
toutefois distinguer entre les plans
àrentabilité variable, indiscuta-
blement les plus avantageux
(+ 8,79 %) et ceux à rente fixe (en
dessous des 3 %). Mais, à moyen
terme, c’est exactement l’inverse
qui s’est produit, les plans à rente
variable continuant à entraîner de
lourdes pertes alors que les plans
fixes sont bénéficiaires.
La rentabilité des plans d’entre-
prise reste négative depuis l’année
2000, après des années de crois-
sance. Selon l’Inverco, elle a reculé
de 3,72 % en 2002 et de 0,77 % sur
les trois dernières années. Toute-
fois, comme il s’agit d’un investisse-
ment à long terme, les employés
qui ont pris leur retraite récem-
ment n’en ont pas trop souffert,
leur épargne ayant été quand
même bonifiée. De toute façon, les
risques restent contrôlés, les ges-
tionnaires des fonds sont en géné-
ral prudents et conservateurs dans
leurs choix, et la plupart du temps
ils sont sous contrôle syndical. En
outre, ils savent que les participants
proviennent de tranches d’âge diffé-
rentes, ce qui les oblige à diversifier
et à garder une part importante
d’investissements à rentabilité fixe,
les moins risqués. Ce qui fait que le
poids de la Bourse reste en géné-
ral assez léger. Même si, quand la
Bourse va bien, la rentabilité est
plus importante, il ne faut pas ou-
blier que l’objectif des plans reste
d’être un complément de retraite,
et non un produit d’investissement.
La majorité des plans d’entreprise
se font sur la base d’un apport défi-
ni, l’entreprise mettant sur le fonds
de pension un pourcentage du salai-
re et l’employé étant invité à le com-
pléter. Au contraire des Etats-Unis,
où ce sont les prestations qui sont
définies, afin d’éviter les répercus-
sions des fluctuations du marché sur
le revenu de l’épargne.
Martine Silber
EN DIRECT DE BRUXELLES
Mare nostrum ?
C
esont quasiment des
petits tigres écono-
miques que l’Union
européenne (UE) va
accueillir en son giron
le 1er mai 2004. Alors
que la conjoncture économique
reste maussade à l’Ouest, les pays
d’Europe centrale et orientale
(PECO) connaissent une croissance
moyenne de 3,3 % de leur produit
intérieur brut (PIB) en 2003. Tel est
l’un des principaux enseignements
du dixième « Rapport sur les écono-
mies en transition », rendu public
en novembre par la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement (BERD).
Ces performances sont même
encore plus élevées si l’on prend en
compte l’ensemble des pays cou-
verts par la BERD, soit les 27 pays
de l’ex-bloc communiste. Les pays
de l’Europe du Sud et de l’Est, hors
les futurs adhérents à l’Union (Alba-
nie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
République de Macédoine, Rou-
manie et Serbie-Monténégro) de-
vraient afficher en 2003 une crois-
sance moyenne de 3,9 %. Quant aux
pays membres de la Communauté
des Etats indépendants (CEI), leur
taux de croissance devrait atteindre
6,2 % en 2003, mais ces bons résul-
tats sont pour l’essentiel le produit
de l’extraction pétrolière et gazière.
Selon Jean Lemierre, président
de la BERD, « les PECO avancent
bien. Ils ont fait des progrès consi-
dérables, motivés par leur adhésion
àl’Union ». Cette étape constitue
en effet une formidable opportu-
nité pour les nouveaux entrants,
même si elle est aussi une source
de difficultés, avec un renforce-
ment de la concurrence, des des-
tructions massives d’emploi dans
les secteurs en reconversion (mi-
nes, aciéries, chantiers navals, agri-
culture), sans oublier les efforts
consentis pour la mise aux normes
européennes, conformément à la
politique de « reprise de l’acquis
communautaire ».
Les gouvernements en place doi-
vent aussi tenir compte des fortes
aspirations d’une partie de leurs
populations qui s’est impliquée de-
puis dix ans dans le processus de
modernisation de leur économie,
mais qui en escompte aujourd’hui
des contreparties.
Sur la dernière période, la palme
du dynamisme revient aux Etats
baltes. Avec 6,5 % de croissance
pré-vue sur l’année 2003, la Litua-
nie devance la Lettonie (6 %) et
l’Estonie (4,5 %). Ces performan-
ces devraient se maintenir dans les
mois qui viennent. Sur les 28 mil-
liards de dollars d’investissements
directs étrangers (IDE) qui ont
afflué en 2002 sur la zone couverte
par la BERD, un tiers est allé aux
PECO. En 2004, ils vont bénéficier
de l’apport supplémentaire des
fonds structurels européens. Des
questions demeurent sur la capaci-
té de ces pays à utiliser la totalité
des sommes mises à leur disposi-
tion, mais ils devraient profiter de
l’aide de spécialistes des finance-
ments européens.
La croissance économique des
huit nouveaux membres de l’UE
repose cependant sur une forte aug-
mentation des dépenses publiques.
Selon la BERD, les projections de
déficit en 2003 sont de 8,3 % du PIB
pour la République tchèque, de
6,9 % pour la Pologne, de 5,5 %
pour la Hongrie et de 5 % pour la
Slovaquie, alors que, en 2002 déjà,
aucun de ces quatre pays n’avait
affiché un chiffre de déficit inférieur
à6,7 % du PIB. « Nous nous atten-
dions à ces déficits », explique Jean
Lemierre, pour qui « le plus impor-
tant est que les PECO parviennent à
améliorer la qualité de leurs infras-
tructures publiques (routes, hôpitaux,
écoles) et qu’ils puissent, à l’avenir,
faire reposer leur taux de croissance
sur les investissements privés ». Dans
ces conditions, on peut envisager
des scénarios assez proches de ceux
qui ont permis, en leur temps, les
décollages économiques espagnols
ou irlandais.
Sur le front de l’inflation, la
moyenne estimée de la zone est de
2,9 % pour 2003, mais elle cache de
fortes disparités. Avec 8,5 %, la Slo-
vaquie fait figure de plus mauvais
élève, devant la Hongrie (4,7 %). La
BERD constate que la Roumanie,
dont l’adhésion à l’UE est prévue en
2007, met les bouchés doubles,
même si des efforts sont toujours à
faire sur l’amélioration de son systè-
me judiciaire, ce qui vaut d’ailleurs
pour l’ensemble de la zone. De
même, la Croatie devrait bientôt
frapper à la porte. Avec une crois-
sance de 4,2 % du PIB en 2003,
selon les estimations de la BERD,
elle essaie de se placer dans le sil-
lage des bonnes performances éco-
nomiques de la Slovénie, pays de la
vague d’adhésions de juin 2004 qui
reste le plus avancé.
La transition économique qui se
fait jour dans les PECO conduit
néanmoins à accroître les taux de
chômage, et surtout les disparités
régionales à l’intérieur de chacun
d’entre eux. La BERD pointe en
outre un autre danger, pourtant
directement lié au progrès que
constitue la mobilité de la main-
d’œuvre. C’est en effet la popula-
tion la plus jeune et la plus qualifiée
qui risque de se déplacer le plus faci-
lement hors de ses frontières d’ori-
gine. Le départ de ces élites natio-
nales bien formées pourrait ralentir
et contrarier le potentiel de déve-
loppement de l’Europe centrale et
orientale.
Alain Beuve-Méry
l’immobilier reste,
pour les familles,
le moyen
le plus sûr
de se constituer
un patrimoine
«Le plus important est que ces pays parviennent
à améliorer la qualité de leurs infrastructures
publiques (routes, hôpitaux, écoles) et qu’ils
puissent, à l’avenir, faire reposer leur taux
de croissance sur les investissements privés »
,
par Laurent Zecchini
La bonne santé des pays d’Europe
de l’Est devrait doper l’Union
les futurs
adhérents
pourraient
connaître un
essor économique
comparable à
celui de l’irlande
et de l’espagne
EUROPE
’ des
Européens et le cours de leur his-
toire ont été en partie irrigués
par la mer Méditerranée, pour-
quoi donc consacrer à Mare nos-
trum si peu d’attention ? Le
«Sud » reste une culture et un
rêve pour l’esprit, mais il est le
parent pauvre des préoccupa-
tions politiques et financières de
l’Europe. La Méditerranée a long-
temps été considérée comme
une mosaïque compliquée de
pays qui se méfient trop l’un de
l’autre pour coopérer entre eux,
et dont les niveaux de dévelop-
pement économique (et démo-
cratique) les situent paradoxale-
ment loin de l’Union européenne
(UE).
C’est pourtant avec elle que
les pays du Sud préfèrent com-
mercer. En 2000, le commerce
intrarégional ne représentait
que 4,7 % du commerce extérieur
des pays méditerranéens, contre
près de 50 % pour le commerce
avec l’Union. Les Européens s’ef-
forcent, depuis 1995, de lutter
contre ce déséquilibre, avec le
stratégique et très décevant
«processus de Barcelone ». A cha-
que conférence Euroméditerra-
née, un constat rituel est dressé :
ce médiocre bilan est dû à la failli-
te du processus de paix israélo-
palestinien. Si la paix régnait
dans la région, faut-il compren-
dre, la prospérité et la démocra-
tie s’épanouiraient.
Ce défaitisme aura des parti-
sans lors de la 6econférence
d’Euromed, qui se tiendra à
Naples, les 2 et 3 décembre.
Mais pour une fois, ce ne devrait
pas être le seul son de cloche.
Neuf pays (la France, l’Allema-
gne, Chypre, l’Espagne, le Royau-
me-Uni, la Grèce, Malte, la
Pologne et le Portugal) ont fait
des propositions communes
pour relancer le partenariat
euroméditerranéen, quitte à
malmener un peu le conformis-
me de l’Europe et de ses cousins
du Sud.
Car s’il est vrai que l’adoption
de la Charte euroméditerranéen-
ne de paix et de stabilité reste
un vœu pieux, trop souvent,
indique un document de cette
avant-garde de pays de l’Union,
«le conflit du Proche-Orient a
servi d’alibi à l’immobilisme des
partenaires, et à dissimuler,
s’agissant des pays méditerra-
néens, des réticences explicables
par l’absence d’une tradition de
relations internationales entre
pays du Sud ».
Pourquoi alors ce sursaut ?
D’abord, parce que la situation
économique de cette région est
inquiétante. La plupart des pays
méditerranéens se sont mal insé-
rés dans le marché mondial. Cer-
tains d’entre eux ont su mener à
bien l’ajustement de leur écono-
mie à grand renfort de potions
amères imposées par les organi-
sations financières internationa-
les, mais la réduction de la dette
publique qui en a résulté n’a pas
été compensée par une augmen-
tation des investissements pri-
vés. Le résultat est que le taux
de croissance par habitant des
pays méditerranéens a sensible-
ment diminué depuis vingt ans.
Pour espérer maintenir le chôma-
ge de ces économies à son
niveau actuel, il faudrait créer
45 millions d’emplois au cours
de la prochaine décennie.
Des raisons géostratégiques
incitent à pousser un cri d’alar-
me. Dans leurs propositions, les
«Neuf » soulignent que les
effets du « 11 septembre 2001 »
et du conflit irakien ont conduit
les Etats-Unis à s’investir dans la
région, avec la Middle East
Partnership Initiative, un projet
de zone de libre-échange d’ici à
2013, et avec une initiative de l’Or-
ganisation du traité de l’Atlanti-
que nord (OTAN) en faveur de la
Méditerranée, pour y créer un
équivalent de l’organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). Or l’élar-
gissement de l’Europe vers l’est
du continent, ainsi que la pous-
sée d’influence américaine dans
la région, crée une « demande
d’Europe ». A laquelle n’a répon-
du aucune relance du partena-
riat euroméditerranéen.
ANaples, les « Neuf » vont pro-
poser que l’intensité de l’aide de
l’Union aux pays du Sud soit liée
« à l’implication de [ses] partenai-
res dans la mise en œuvre des
réformes, sur une base contrac-
tuelle ». La Commission euro-
péenne serait invitée à évaluer
systématiquement l’impact de
ses programmes au regard de
conditionnalités qui auraient été
systématiquement communi-
quées aux Etats membres, les-
quels, en contrepartie, seraient
associés beaucoup plus étroite-
ment à la prise de décision. Afin
de dynamiser la coopération
financière, il est envisagé de
transformer l’actuelle facilité
euroméditerranéenne d’investis-
sement et de partenariat
(Femip) en une véritable filiale
de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI).
Pour favoriser l’intégration
régionale et sous-régionale, la
France a lancé une initiative en
faveur d’un partenariat renforcé
avec le Maghreb, laquelle accom-
pagne le projet de zone de libre-
échange lancé par quatre pays
(le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et
la Jordanie). Cette coopération
pourrait constituer un projet pilo-
te, qui, en cas de succès, pourrait
être généralisé à l’ensemble des
pays partenaires.
Reste à faire progresser Mare
nostrum dans les esprits. Telle
sera la mission de la Fondation
euroméditerranéenne pour le dia-
logue des cultures, et de l’Assem-
blée parlementaire euroméditer-
ranéenne. Il faut espérer que ces
propositions seront approuvées
àNaples, puis soutenues par une
volonté politique et des finance-
ments adéquats. Sinon, il y a
tout lieu de craindre que la Médi-
terranée, jadis unifiée par la
«paix romaine », le devienne par
la « pax americana ».
Croissance duPIB,
en pourcentage
DE BONNES PERFORMANCES À L'EST
Source : BERD/FMI * moinsChypre, Malte etla Croatie
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003
Nouveaux
membresde l'UE*
Europe duSud-Est
(ex.Youg)Etats indép.
dansl'ex-bloc
soviétique
Europe de l'Ouest
Zone euro
Etats-Unis
Pays d'Asie
en voie de
dévelop-
pement
2,5
4,5
3,9
4,8
6,2
3,3
Les avantages fiscaux vont dans le sens d’un
encouragement aux retraites complémentaires,
mais ils ne sont encore souvent perçus que sous
cet aspect, un moyen de payer moins d’impôts
Pour favoriser l’intégration
régionale et sous-régionale,
la France a lancé une initiative
en faveur d’un partenariat
renforcé avec le Maghreb, laquelle
accompagne le projet de zone
d
e libre-échange lancé par l’Egypte,
le Maroc, la Tunisie et la Jordanie
IV/LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003

L’euro fort, une devise internationale ?
L
es professeurs d’écono-
mie pourront utiliser
l’épisode monétaire
actuel pour démontrer à
leurs étudiants le caractè-
re mystérieux du marché
des changes. L’euro est monté, mar-
di 18 novembre, à un plus haut
niveau historique de 1,1973 dollar.
D’un point de vue économique, cet-
te envolée de la monnaie unique
apparaît comme une anomalie, en
contradiction avec le principe selon
lequel la force d’une monnaie est
d’abord déterminée par la vigueur
d’une économie. La progression du
produit intérieur brut (PIB) aux
Etats-Unis s’est établie à 7,2 % au
troisième trimestre, un rythme jugé
époustouflant par les experts.
Au cours de la même période, le
PIB de la zone euro a augmenté de
1,6 %, en rythme annualisé, ce qui a
été considéré… comme une grande
victoire puisqu’il est survenu après
trois trimestres consécutifs de recul
ou de stagnation. L’écart de crois-
sance de part et d’autre de l’Atlanti-
que ne s’est donc pas réduit. Si l’Eu-
rope redémarre enfin, l’Amérique
va de plus en plus vite et les prévi-
sions pour 2004 ne devraient pas
changer la donne. Le président de
la Réserve fédérale de Philadelphie,
Anthony Santomero, a jugé possi-
ble que l’économie américaine
connaisse en 2004 une augmenta-
tion de son PIB supérieure à 4 %.
Pour la zone euro, les économistes
interrogés par la Banque centrale
européenne (BCE) parient sur une
croissance d’environ 1,5 %.
Ce décalage d’activité présente
toutefois une conséquence qui,
elle, pèse directement sur le dollar.
C’est celle de creuser le déficit des
comptes extérieurs américains (la
hausse des importations aux Etats-
Unis n’est pas compensée, faute de
demande suffisante en provenance
de l’étranger, par une progression
des exportations de produits améri-
cains). En septembre, le déficit com-
mercial américain s’est accru, à
41,3 milliards de dollars, avec une
hausse de 3,3 % des importations
de biens et de services. Les autori-
tés américaines ont beau jeu de
dire, dans ces conditions, que le
problème de leur déficit commer-
cial – qui pourrait frôler la barre
des 500 milliards de dollars en
2003 – et donc le problème de la
faiblesse du dollar, est d’abord
celui du manque de croissance
dans le reste du monde.
Cet argument ne tient guère tou-
tefois, vis-à-vis de la Chine, elle aus-
si en plein boom économique.
Avec ce pays, le déficit commercial
américain a atteint un nouveau
record en septembre à 12,7 mil-
liards de dollars. Aussi l’administra-
tion américaine, faute de pouvoir
obliger Pékin à réévaluer le yuan
a-t-elle annoncé, le 18 novembre,
son intention d’imposer de nou-
veaux quotas sur les importations
de textiles chinois. Cette décision
inattendue, qui fait craindre un
regain de protectionnisme aux
Etats-Unis, est jugée comme un fac-
teur d’affaiblissement du dollar par
les économistes.
Ils y voient un signe inquiétant
que la Maison Blanche est prête à
utiliser tous les moyens à sa dispo-
sition pour satisfaire les milieux
industriels américains et stimuler
le marché de l’emploi avant les
élections. De façon générale, les
experts soulignent la perte de cré-
dibilité de l’administration améri-
caine auprès de la communauté
financière internationale, et ce mal-
gré le retour d’une forte croissan-
ce aux Etats-Unis. A cet égard, les
difficultés rencontrées par les trou-
pes américaines en Irak, mais aussi
la montée des menaces terroristes
contre les Etats-Unis, semblent
jouer de façon très négative pour
le billet vert, qui se voit progressi-
vement privé de son statut de
valeur refuge. L’euro, mais aussi le
yen, moins exposés sur le plan géo-
politique, en profitent. Mais c’est
surtout l’or, dont les cours ne ces-
sent de s’apprécier, qui attire vers
lui les investisseurs de plus en plus
inquiets.
Cette désaffection vis-à-vis de
l’Amérique de George Bush est
confirmée par les statistiques de
flux de capitaux. Le Trésor améri-
cain a annoncé que les investis-
seurs étrangers avaient acheté
pour 4,2 milliards de dollars seule-
ment de bons du Trésor et d’ac-
tions américains au mois de sep-
tembre, un montant très faible par
rapport aux 49,9 milliards du mois
d’août, ou encore par rapport aux
76 milliards investis en moyenne
aux Etats-Unis au cours des six
mois précédents.
On est donc loin de la situation
monétaire observée au printemps,
au lendemain de la chute éclair de
Bagdad. A l’époque, la baisse du
dollar, presque officiellement reven-
diquée par la Maison Blanche,
devait plutôt être interprétée com-
me un signe de l’hyperpuissance
américaine, du moins de la capacité
de Washington à se faire écouter
des marchés et à les influencer. La
dépréciation actuelle du billet vert
apparaît au contraire comme un
signe de la perte de confiance des
investisseurs internationaux dans
l’Amérique et surtout dans ses diri-
geants.
Pierre-Antoine Delhommais
ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
Test
de crédibilité
L
etemps de l’euro fort –
ou du dollar faible – est
venu. Si une telle évolu-
tion menace la reprise
européenne, elle consti-
tue d’un point de vue
monétariste une puissante incita-
tion aux réformes de structure dont
le Vieux Continent aurait besoin.
Ne vantait-on pas, il y a peu, les ver-
tus d’avoir un franc ou un deutsche-
mark forts ? Au-delà de ce débat,
avant 1999, ne prêtait-on pas à
l’euro la possibilité de pouvoir
concurrencer à terme le dollar et de
s’imposer comme devise internatio-
nale ? Le rééquilibrage tant attendu
a-t-il commencé ?
Dans un premier temps, cette
ambition fut mise entre parenthèses
après l’introduction de la monnaie
unique et l’épisode de l’euro faible
qui a prévalu à son lancement. Avec
un inconvénient de départ : une mon-
naie faible ne peut s’imposer comme
unité de compte pour les transac-
tions transfrontalières – commercia-
les et financières – et comme mon-
naie de réserve à l’échelle mondiale.
Pour autant, la force d’une monnaie
lui confère-t-elle mécaniquement les
statuts de devise internationale ?
«Le dollar s’est imposé comme
monnaie de référence depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, alors
même qu’il a connu plusieurs pério-
des de faiblesse », remarque Philippe
Weber, économiste en chef chez
CPR-AM. Inversement, le franc suisse
et la livre sterling, à l’instar du deuts-
chemark et du yen, historiquement
forts, ne se sont pas affirmés com-
me devise internationale au cours
des dernières années.
La valeur d’une monnaie n’appa-
raît donc plus comme un indica-
teur pertinent de sa force et de sa
position internationale. Dès lors,
qu’entend-on par monnaie forte ?
Pascal Blanqué, responsable de la
recherche économique au Crédit
agricole, définit une telle devise
comme « une monnaie structurelle-
ment stable en termes de fluctua-
tions, et assortie de faibles taux d’in-
térêt ». Le nouveau président de la
Banque centrale européenne, Jean-
Claude Trichet, préfère parler de
«monnaie crédible » pour l’euro.
Une monnaie forte n’est donc
pas simplement une monnaie chè-
re. Elle doit être désirée pour elle-
même et de façon durable. En
outre, cette force n’implique pas
une promotion mécanique au rang
de devise internationale, même si
cela reste un passage obligé. Avant
cela, il faut s’imposer comme mon-
naie de référence dans les transac-
tions financières et commerciales,
puis dans les réserves officielles,
reflet des comportements privés.
Pour l’euro, ce chemin est encore
long. Sur le plan commercial, si les
Etats-Unis comptent pour 20 %
dans les échanges mondiaux, la Ban-
que des règlements internationaux
(BRI) évalue la part du dollar dans
ces échanges à 50 %. L’euro ne fait
pas mieux en 2001 que le deutsche-
mark, pris seul avant en 1999, soit
15 % des transactions totales.
Au niveau des marchés de capi-
taux, la prédominance du dollar est
encore plus flagrante. Selon la BRI,
en 2002, les deux tiers des emprunts
mondiaux prenaient source outre-
Atlantique. Fin 2001, sur les
2021 milliards de dollars de réser-
ves internationales que comptent
les banques centrales, près des trois
quarts étaient encore libellés dans
la devise de l’Oncle Sam, contre
moins de 15 % en euro.
«Ce qui a fait le succès de la devise
américaine, c’est l’importance des pla-
ces boursières américaines dans les cir-
cuits financiers mondiaux, analyse
Antoine Brunet, stratège chez HSBC-
CCF. Wall Street, qui concentre 50 %
de la capitalisation boursière mondia-
le, est incontournable. » En comparai-
son, les marchés européens, en dépit
de leurs rapprochements partiels,
n’offrent pas le même sentiment
d’unicité. « L’euro a beau être crédi-
ble, il aura beaucoup de mal à rivali-
ser par rapport au billet vert avec des
marchés financiers encore un peu étri-
qués, poursuit ce spécialiste. Mais le
rééquilibrage est engagé. »
Même si la visibilité de ce mouve-
ment est limitée, il semble que les
investisseurs asiatiques, arabes et
russes – les arbitres des évolutions
àvenir – se dirigent à nouveau vers
la zone euro, qui constitue aujour-
d’hui un recours sérieux face à la
zone dollar.
Pascal Blanqué perçoit dans cette
période-clé « le début d’une redistri-
bution des cartes, légitime au regard
des déséquilibres américains, et la
préfiguration de ce que sera le paysa-
ge monétaire de demain : un monde
partagé en deux zones monétaires en
compétition ». A l’image des Etats-
Unis, peut-on espérer à terme un
financement par l’étranger de la
croissance européenne ?
Quentin Domart
50 % des échanges
mondiaux sont
encore libellés
en dollars
par Pierre Jacquet
que l’Assem-
blée générale des Nations unies a
adopté les huit Objectifs du Millé-
naire pour le développement :
contre l’extrême pauvreté et la
faim, les pandémies, la mortalité
infantile et maternelle ; pour
l’éducation primaire universelle,
l’égalité des sexes, la protection
de l’environnement et la constitu-
tion d’un partenariat mondial
des acteurs économiques et
sociaux au service du développe-
ment durable.
Ces engagements solennels
entérinent une démarche nou-
velle et ambitieuse, fondée sur
l’obtention de résultats mesura-
bles. Ils tranchent avec les décla-
rations d’intention passées par
leur précision : ils se déclinent
en dix-huit sous-objectifs à
atteindre avant l’an 2015, et en
quarante-huit indicateurs de
contrôle qui facilitent la coordi-
nation de l’aide publique au
développement (APD). Néan-
moins, une fois proclamées, ces
ambitions se heurtent à quatre
séries de difficultés.
Tout d’abord, d’importantes
ressources additionnelles sont
nécessaires. Elles sont évaluées,
de façon encore approximative, à
50 milliards de dollars par an, ce
qui reviendrait à doubler le mon-
tant de l’APD. Les pays donateurs,
notamment lors de la conférence
de Monterrey (Mexique) en
mars 2002, se sont montrés déter-
minés à accroître leur effort.
La France, en particulier, a
annoncé qu’elle ferait passer sa
contribution de 0,34 % du pro-
duit intérieur brut en 2002 à
0,5 % en 2007, pour atteindre
0,7 % en 2012. Toutefois, les enga-
gements pris par les pays riches
ne suffiront pas à doubler l’aide
internationale.
Plus préoccupante encore : l’ini-
tiative « Education pour tous ».
Première mise en œuvre structu-
rée des Objectifs du Millénaire,
elle bute sur une mobilisation
trop lente des ressources promi-
ses. Les pays développés doivent,
bien sûr, tenir leurs engage-
ments, mais il faut aussi associer
davantage de financements de
marché : cela passe par des parte-
nariats public-privé, ou encore
des outils novateurs d’ingénierie
financière qui permettent une
levée immédiate de ressources
tout en lissant l’effort budgé-
taire. C’est cette idée que propose
d’exploiter une initiative britanni-
que récente (International Finan-
cial Facility), sorte de « titrisation »
des promesses d’augmentation
future de l’APD : sur la base de ces
promesses, qu’il faudrait alors for-
maliser et institutionnaliser, les
pays riches emprunteraient dès à
présent des capitaux privés pour
constituer un fonds dédié à la
mise en œuvre des Objectifs du
Millénaire.
Deuxièmement, comment gérer
sur le terrain la montée en puis-
sance des services sociaux ? Ce
n’est pas uniquement une ques-
tion de ressources. Celles-ci ne
pourront être utilisées de façon
efficace que si les pays bénéfi-
ciaires développent en même
temps leur capacité d’absorp-
tion, mélange de savoir-faire ins-
titutionnel, de capacité de ges-
tion et de bonne gouvernance. Il
n’est pas évident que les pays
les plus pauvres soient en mesu-
re d’employer utilement des
flux d’APD soudainement dou-
blés. Cette question constitue
un défi collatéral majeur des
Objectifs du Millénaire. On peut,
certes, tenter de la traiter en
allégeant les procédures admi-
nistratives attachées à l’obten-
tion de l’aide et en développant
des formules d’aide budgétaire,
mais ce n’est là qu’un aspect du
problème. Il faut donc adapter
le rythme de mise à disposition
des fonds à l’évolution de la
capacité d’absorption.
Troisièmement, comment main-
tenir l’effort dans la durée ? Par
quels moyens assurer la pérennité
des succès obtenus dans les pays
pauvres ? Certains d’entre eux
n’auront toujours pas, en 2015, la
capacité budgétaire requise pour
maintenir ces nouveaux services
éducatifs et sociaux. La pertinen-
ce des Objectifs du Millénaire
repose donc aussi sur l’aptitude
de la communauté internationale
àfinancer des coûts récurrents.
Or l’attention est aujourd’hui pola-
risée par la mise en œuvre et le
financement d’investissements
ponctuels dans un horizon tempo-
rel limité.
Enfin, les Objectifs du Millénaire
ne résolvent pas à eux seuls le pro-
blème du développement. La
réduction de la pauvreté et des
inégalités améliore, certes, la
capacité productive des pays ;
mais elle ne sera pérenne que si
sont mises en œuvre des straté-
gies de croissance économique.
Celles-ci appellent des efforts
renouvelés pour financer les
infrastructures, appuyer l’ouvertu-
re et la mise à niveau des écono-
mies, et créer un cadre commer-
cial multilatéral équilibré.
Au total, les Objectifs du Millé-
naire constituent pour les pays
industrialisés un double test de
crédibilité. Après l’échec des négo-
ciations commerciales de Cancun,
qui porte les germes de nouvelles
tensions Nord-Sud, il serait dom-
mageable que les pays du Nord
prennent la responsabilité d’un
échec de la démarche du Millénai-
re, faute de tenir leurs engage-
ments et de débloquer suffisam-
ment de moyens.
D’autre part, comme de nom-
breux pays ne pourront générer
les ressources nécessaires, ces
Objectifs tendent à faire de l’APD
l’amorce d’une politique sociale
mondiale, garante de l’accès des
plus pauvres aux services essen-
tiels. Cette perspective place les
pays riches devant une nouvelle
responsabilité : imaginer les méca-
nismes qui répondront demain à
un besoin de financement péren-
ne. Voilà sans doute la prochaine
étape-clé de la gestion de la mon-
dialisation.
Pierre Jacquet est économiste en
chef à l’Agence française de déve-
loppement et enseigne à l’Ecole
nationale des ponts et chaussées.
La désaffection vis-à-vis de la politique
américaine pèse sur le billet vert
les quotas imposés
aux importations
de textiles chinois
font craindre
un regain de
protectionnisme
de la part
de washington
FOCUS
UNE DOMINATION FINANCIÈRE BIPOLAIRE
Source : « Dollar,actualité etavenirde lamonnaie impériale » de MarianStepzcynski (Favre2003),
donnéesFMI
Répartition de lacapitalisation
boursière mondiale...
...etde larichesse financière
mondiale
Etats-UnisEtats-Unis
Union
européenne
Union
européenne
Reste du
monde
Reste du
monde
Japon Japon
21%
8%
23 % 34%
15 %
14 %
48 %37 %
«La réduction de la pauvreté
et des inégalités améliore, certes,
la capacité productive des pays ;
mais elle ne sera pérenne que si
sont mises en œuvre des stratégies
de croissance économique »
UN DÉCALAGE QUI S'AGGRAVE
Source : NatexisBanques populaires
Taux de change dollar/euro(échelle de gauche)
PIB zone Euroland (échelle de droite)
1,4 5
4
3
2
1
0
-1
-2
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
9394 95 969798 99 00 0102 03
LE MONDE/MARDI 25 NOVEMBRE 2003/V
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%