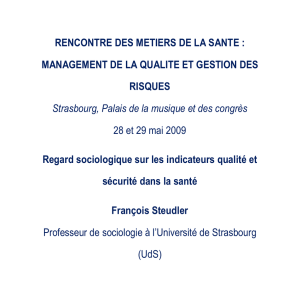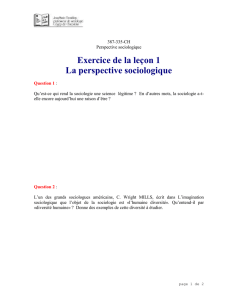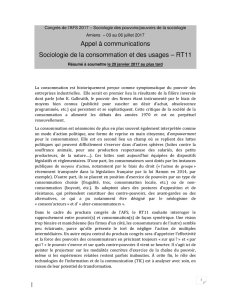GT45 Sociologie des conflits Responsables

GT45 Sociologie des conflits
Responsables: Nicolas Amadio (Université de Strasbourg), Jérôme Ferret
(Université de Toulouse 1 Capitole, Dietmar Loch (Université de Lille 1)
Présentation du GT 45 Sociologie des conflits
Thématique
Ce groupe se propose comme lieu d’échanges et de recherches sur les conflits et leurs
régulations. Le reflux des affrontements majeurs entre blocs, classes, nations, n’a pas
mis fin aux conflits individuels et collectifs. Ceux-ci ont plutôt tendance à se
fragmenter, se diversifier, se disséminer. Des domaines longtemps perçus comme
stables, par exemple la santé, la mort, l’appartenance ethnique, l’environnement, la
prison, le travail et l’organisation, sont devenus aujourd’hui autant d’enjeux
agonistiques. Le groupe s’intéresse particulièrement aux formes nouvelles de
conflictualités, à leurs dynamiques et leurs effets. Dans une perspective positive et
dynamique, le conflit permet de préciser une position, voire une identité ; en
intensifiant les relations entre les hommes, il présente un effet socialisateur. Il
développe des compétences stratégiques, tactiques, organisationnelles ; en
bousculant les équilibres, il dégage des solutions nouvelles, suscite ruse et inventivité
et donne lieu à des créations institutionnelles. Autrement dit, le conflit est envisagé
comme un analyseur et un catalyseur social mettant en évidence ce qui passe pour
aller de soi, précipitant des évolutions en cours.
Objectifs
À travers les situations étudiées, le groupe s’attache à identifier les logiques à l’œuvre
dans les conflictualités contemporaines. Il met l’accent sur deux aspects : une
dimension comparative afin de saisir les différences et les points communs entre des
conflits de nature, d’échelle, et d’intensité diverses ; une dimension dynamique, afin
de saisir les effets des conflits : tensions, expressions, négociations, médiations,
créations, déplacements, traces.
Mot clefs : antagonisme - création - conflictualité - dynamique conflictuelle - ennemi
- guerre - négociation - ritualisation du conflit - socialisation - tiers.
Appel à communication pour le 6ème Congrès de l’AFS
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
29 juin-2 juillet 2015
Les propositions de communication (3000 signes maximum, espaces compris)
présenteront l’objet de la recherche, le questionnement et la problématique, le
terrain, les catégories et la méthodologie utilisée pour le recueil des données (ou à
défaut, les corpus systématiques de sources si ce travail n’est pas lié à un terrain).
Les propositions comprendront les éléments suivants dans l’ordre d’apparition :
• Nom, prénom du/des auteur-e-s
• Fonction et institution de rattachement
• Adresse mail
• Titre de la communication
• 5 mots clés

• Proposition de communication (3000 signes maximum espaces compris)
• Titre et résumé de la proposition (1500 signes espaces compris)
Les propositions doivent être adressées sous fichier word et rtf à
[email protected] avant le
15 février 2015
.
Les réponses aux propositions reçues seront envoyées courant mars 2015.
Les résumés (1500 signes) des propositions acceptées figureront dans le volume édité
pour le congrès. C’est au moment de vous inscrire au congrès sur le site de l’AFS que
vous devrez y déposer votre résumé afin qu’il figure dans le volume édité pour le
congrès, cette responsabilité incombant donc aux auteurs.
Nous vous remercions de bien vouloir :
1- indiquer en objet de votre message : AFS-GT 45 proposition congrès 2015
2- nommer votre fichier de la façon suivante : nom-congrès AFS 2015.doc
TEXTE DE L’APPEL
Nous vous proposons ci-après quelques éléments d’orientation de nos futurs
discussions autour de la thématique du congrès 2015 « Conflit et naturalisation /
modélisation du social : quelles spécificités de l’analyse sociologique du conflit ? »
Toutefois, dans la continuité des activités du GT 45 Sociologie des conflits et à la
demande de nombreux participants de continuer à œuvrer dans cette voie, le présent
appel à communication rappel aussi l’intérêt de poursuivre, lors du congrès 2015, les
travaux concernant :
- Poursuite des travaux du GT45
1) Les traditions théoriques et réflexions épistémologiques d’une
sociologie du conflit
Il s’agit d’interroger les questions épistémologiques que soulève l’attention au conflit.
Par exemple, la question du positionnement d’une théorie du conflit à l’intérieur des
disciplines, la mise en exergue des différences et/ou de la porosité des frontières
disciplinaires, l’impact du conflit sur le positionnement disciplinaire mais aussi les
comparaisons entre théories du conflit selon les contextes historiques
et/géographiques de production etc.
2) La sociologie du conflit et ses méthodes
Les recherches en sociologie du conflit se caractérisent-elles par des méthodes
particulières ? Quelles sont les méthodes les plus utilisées en sociologie du conflit
(qualitatives, quantitatives, production directes de données, données de seconde
main, méthodes innovantes, approches cliniques, poids des exemples et illustration
dans l’argumentation, utilisation de ces illustrations –objective/subjective/narrative-,
etc.) Y-a-t ’il des méthodes innovantes, créatives ? Qu’en est-il de la différenciation
des disciplines à partir de l’utilisation de méthodes spécifiques d’analyse des conflits

(ou non). Existe-t-il des méthodes suivant les types de conflits ou suivant les types
d’acteurs, de contextes, etc. ?
3) Formes, fonctions et significations du conflit
Il s’agit ici de réfléchir sur les formes (latent, manifeste, violent, agonal ou polémique,
guerrier, etc.), fonctions (cohésives, destructrice, créatrice, régulation, etc.),
significations (négatives, positives, questions éthiques et déontologiques, pouvoir,
domination), et sphères du conflit (individuelle, collective, niveau micro- et méso-
sociologique).
4) Le conflit dans les différents champs de la société
Il s’agit ici de réfléchir sur les champs de la société dans lesquels nous pouvons
analyser le conflit (travail, santé, organisation, justice, défense et sécurité intérieure
ou extérieure, environnement, genre, monde artistique, travail social, etc.) et ainsi
aussi sur la question du contenu porté par le conflit.
- Conflit et naturalisation / modélisation du social :
quelles spécificités de l’analyse sociologique du conflit ?
Quand on prend soin de regarder la recomposition du champ sociologique, on
observe que des thématiques comme le conflit sont maintenant massivement
entreprises par des champs de connaissances qui peuvent revendiquer un monopole
du savoir au prétexte qu’elle serait plus « scientifique » comme l’économie cognitive,
la biologie comportementaliste, la neuro-socio-biologie, les sciences
computationnelles ou digitales…
Sans présager aucunement d’une réponse claire, c’est plutôt au regard d’une
inquiétude qu’il convient de s’interroger sur le retour et la prétention de tels
raisonnements potentiellement porteurs de régressions se fondant par exemple sur
une hypothétique nature biologique qui nous amènerait à agir selon des instincts
ancestraux. Les individus, sans qu’ils ne soient questionnés comme des sujets,
seraient alors des êtres influencés par des facteurs apparemment sans importance
tels que les différences individuelles, la force, le corps, la masculinité, ou les
fluctuations à court terme de la faim, des incitations biologiques. N’y a-t-il pas là un
danger sous la forme d’un retour des raisonnements spencériens, « struggle of life »,
sans parler de réductionnisme scientifique ?
Ici peut intervenir la question de certains objets en lien avec les conflits, par exemple,
les émotions et d’autres phénomènes de régulation sociale (par exemple les effets de
la colère, les processus d’instrumentalisation dans les négociations, la montée aux
extrêmes et le passage à l’acte, etc.). Peut-on et doit-on en particulier se fixer comme
objectif de saisir le moment du passage à l’acte ? On pense encore ici à l’idée que
certains d’entre nous seraient « nés » pour être pacificateurs ou médiateurs ou, au
contraire, agresseurs, déviants, dangereux, asociaux.
Au passage, c’est bien pour justifier la sociologie que Randall Collins, tout en faisant
valoir qu'il existe chez les êtres humains une peur innée de nuire à d’autres
personnes, montre bien que dans une interaction sociale antagoniste, il peut se
produire autre chose que la lutte pour la survie ou la fuite sous l’effet de la peur de la
défaite. Cette troisième alternative est d’une importance cruciale car elle rend le

social, interactionniste ou intersubjectif (au sens de Michel Wieviorka), possible et
impossible à prévoir.
Sur le plan cette fois des méthodes, les computationnal studies, digital studies, très
en vogue sont-elles capables de nous aider à analyser et à comprendre la complexité
des interactions conflictuelles ?
Et si oui, comment penser l’articulation avec la sociologie « old school » ? Les
sciences digitales (simulation sociale en particulier) présentent l’intérêt de pouvoir
analyser ce que la sociologie a du mal à saisir à savoir les processus, les émergences,
l’incertitude, les rationalités en action, en co-constructions, scenarii…Les digital
studies permettraient l’accumulation d’une masse de données importantes et inédites
(les fameuses Big Data), en mettant le sociologue en extériorité de l’observation
quitte à ne pas avertir les observés et expliquer sa stratégie scientifique et en assurer
l'acceptation sociale des sciences sociales. Mais ces analyses virtuelles ne sont-elles
pas pour autant limitées à des phénomènes émergents stabilisés ? Ne contribuent-
elles pas par un effet de mode à l’oubli du patrimoine des sciences sociales, de
l’histoire. Et pour finir, ne contribue-t-elle pas à la prédiction de comportements
sociaux dont les institutions pourraient s’emparer pour justifier des choix de
politiques urbaines ? On pense ici à l’utilisation de logiciels d’inférence statistique par
la police américaine lui permettant de prédire une infraction ou un crime et d’aborder
des conflits urbains par une politique de répression anticipée.
Nouveaux espaces ? Conflits dans et autour des sociétés numérisées
L’ère du numérique transformerait profondément nos sociétés. Ainsi, peut-on dire
que la théorie des conflits sociaux était une bonne théorie pour les systèmes de nos
sociétés classiques hiérarchisées, mais qu’en est-il des sociétés connexionnistes
numériques complexes? Plus modestement, ne doit-on pas analyser sérieusement
comment cette « société numérique » s’ajoute et s’encastre aux structures déjà
existantes de la société mais sans aucunement les supplanter voire même de les
modifier ? Dans cet ordre d’idées, les médias sociaux peuvent-ils contribuer à
publiciser, à conflictualiser une question sociale (la numérisation de nos vies) sans
pour autant exclure la nécessité de se réunir physiquement pour la confrontation ? Le
numérique, s’il ne modifie pas la nature profonde du conflit, en modifie t-il son
émergence et sa dynamique temporelle ? Le nombre de personnes connectées en
réseau rend-il la phase d’une mobilisation plus rapide? Les connexions numériques
facilitent-elles la croissance d’un mouvement pacifique, ou à l’inverse favorisent-elles
les mouvements polarisants? Ce sont autant de questions de recherche que des
propositions de communication pourraient éclairer.
1
/
4
100%