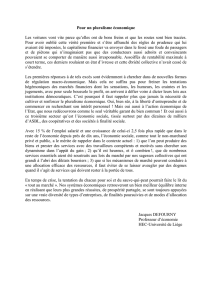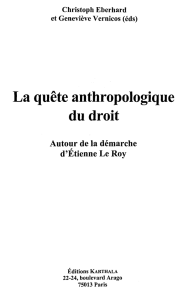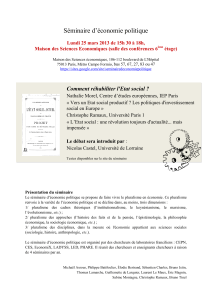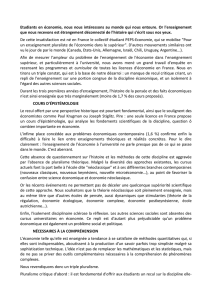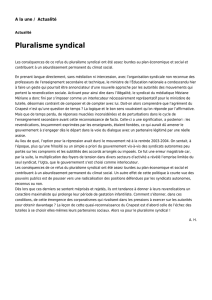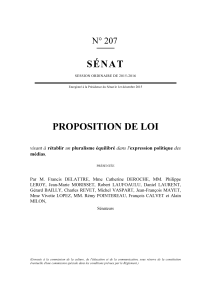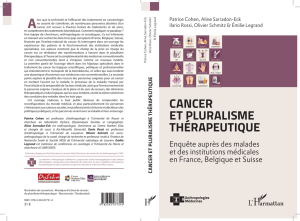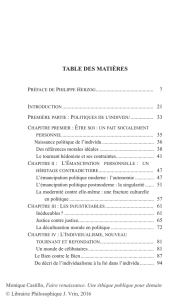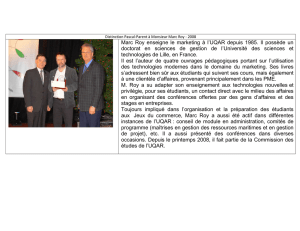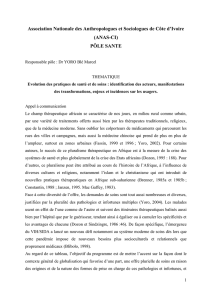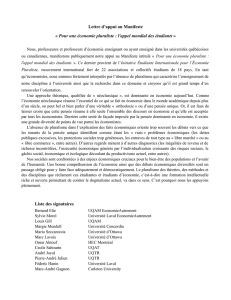Les recherches sur le droit interne des pays en

.-?
3
Les recherches sur le droit interne
des pays en développement
Du droit du développement
àla définition pluraliste de l'État de droit
Étienne LE
Roy
1. Le paradigme développementaliste
Comme en droit international, les juristes français et francopho-
nes appelés à travailler outre-mer ont partagé initialement la même
conception de la contribution du droit au développementdes États issus
de la décolonisation. Mais, dans l'ordre interne, cette conception
«
développementaliste » est rapidement devenue
«
quasi religieuse » en
ce sens que non seulement elle est apparue indissolublement liée à
une approche dogmatique - et évolutionniste- des transferts de droit,
mais aussi parce que progressivement la fonction du droit est deve-
nue axiologique.
Dans cette perspective, les juristes francophonespartagent avec leurs
collègues américains une conception de leur rôle.que F.G. Snyder qua-
lifie de
«
legal missionaries ». TIdésigne par là les juristes dévelop-
pementalistes en Amérique latine pour lesquels
«
the answer to many
problems in underdevelopped countries lays in the "modernization"
of legal and social structures according 10 an idealized version of United
States history» (Snyder, 1982, p. 387). Pour les francophones, et spé-
cialement pour ce qui concerne la coopération juridique française ou
belge (Chape1, 1969), c'est moins un ordre social que l'on cherche

76
ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT LE DROIT INTERNE DES PAYS DU DÉVELOPPEMENT 77
à maintenir ou à diffuser qu'une conception
«
civilisée » du droit. Par
civilisé, on rattache le contenu du droit à des valeurs de civilisation
qu'on prétend incarner mais surtout on se réfère au code
«
civil »,
considéré depuis la période coloniale comme la
«
raison écrite ». Dès
le début des années soixante, se met en place un paradigme qui reste
valable, malgré les critiques qui ne manqueront pas de naître, pour
une majorité de juristes praticiens trente ans après. Pour atteindre le
progrès, les sociétés doivent développer leur économie et leurs insti-
tutions sur le modèle occidental. La modernisation est ainsi le moyen
et la condition du développement, ce qui implique de méconnaître ou
de faire disparaître tout ce qui pourrait y faire obstacle. Le droit doit
y concourir puissamment et être en avance sur les mentalités car ce
sont les populations qui doivent s'adapter au droit, non le droit aux
valeurs anciennes d'une société à moderniser. Tirant les leçons de son
expérience de rédacteur du code éthiopien, René David (David, 1962)
suggérera de généraliser la codification et sera très largement entendu.
Très représentative de cette époque est la conclusion suivante de cet
auteur:
«
Les coutumes éthiopiennes n'existent en effet qu'au sein de com-
munautés de villages ou de tribus, sociétés fermées dans lesquelles la
notion de droit n'a pas sa place. Elles n'ont pas le caractère de coutu-
mes juridiques ... Le droit coutumier n'est qu'une illusion; avec les
coutumes d'Éthiopie on est beaucoup plus proche du non-droit qui, selon
les marxistes, existait dans les sociétés primitives... » (David, 1962,
pp. 161-162).
2. La critique du paradigme et le pluralisme juridique
Dès le début des années soixante, des auteurs ont la prescience
des difficultés que vont rencontrer les juristes développementalistes.
R. de Cottignie adresse une
«
prière à Thémis pour l'Afrique» (Cot-
tignie (de), 1968). Michel Alliot, faisant le bilan des premières
«
résis-
tances traditionnelles au droit moderne» (Alliot, 1965), doute que l'uni-
fication (Alliot, 1967) puisse résoudre les problèmes qui ne peuvent
être abordés que par une africanisation des règles juridiques. Au début
de la décennie soixante-dix et avec un optimisme démenti par la suite,
j'analyse les conditions d'un dépassement du paradigme par une
«
indi-
génisation» du droit (Le Roy, 1971, p. 52). Mais la critique la plus
pertinente est celle d'E. Schaeffer (Schaeffer, 1968), doutant de l'apti-
tude du droit à servir le développement:
«
TI
faut craindre, d'une part
que le développement ne puisse pas, en raison de la nature du droit,
être objet du droit et, d'autre part, qu'une règle prise en vue du déve-
loppement ne soit pas reçue par le sujet de droit» (Schaeffer, 1973,
p. 8). Ayant rappelé que
«
le consensus des sujets importe autant que
le commandement du prince », l'auteur évoque le risque
«
qu'au lieu
d'un consensus se dégage un véritable
«
dissensus » à l'égard de la
loi nouvelle. Car il y a des degrés dans la non-réception qui peut aller
de l'indifférence paralysant les effets de la règle jusqu'à une vérita-
ble désobéissance passive mais consciente, en attendant l'hostilité
ouverte» (Schaeffer, 1973, p. 8).
Ce diagnostic, largement ignoré à l'époque, s'est ensuite révélé
particulièrement clairvoyant, encore que la réaction des populations
soit moins caractérisée par le rejet que par une tentative, apparem-
ment réussie, de
«
domestication» (Le Roy, à paraître) ou de métis-
sage des innovations exogènes. Mais, durant les années soixante-dix,
trois problématiques se développent dans un contexte caractérisé par
une nette césure entre la recherche universitaire et les pratiques déve-
loppementalistes des praticiens.
La première de ces problématiques a été le
«
pluralisme juridique »
qu'il faut associer aux travaux de pionniers de J. Gilissen et de J.
Vanderlinden de l'Université libre de Bruxelles. Ceux-ci ont eu pour
premier mérite, au sein de l'association Jean Bodin pour l'histoire com-
parative des institutions, de réintroduire les sociétés non européennes
dans les préoccupations de la recherche historique, même si le cane-
vas en restait
«
ethnocentrique ». Leur second mérite reste d'avoir élargi
la perspective de l'ethnologie juridique (Gilissen, 1960) à celle du plu-
ralisme juridique (Vanderlinden, 1972) qui avait été développée en
France par le sociologue Georges Gurvitch en 1935 avant que ce thème
ne devienne la préoccupation centrale des anthropologues du droit à
l'échelle mondiale
1•
1. La
«
Commission on folk law and legal pluralism
»
de l'Union internationale des scien-
ces anthropologiques et ethnologiques ne comprend que quelques françophones, pour des rai-
sons examinées dans Le Roy, 1986, pp. 139-150.

78 ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT LE DROIT INTERNE DES PAYS DU DÉVELOPPEMENT 79
DU PLURALISME AU MULTIJURIDISME
Dans son récent ouvrage Aux confins du Droit (Paris, O. Ja-
cob, 1991, p. 141), N. Rouland écrit:
« ...
on est frappé de
constater qu'après tant d'années le pluralisme juridique apparaisse
aujourd'hui encore en France une idée neuve, voire dangereuse ».
En effet, durant la période coloniale, ce sont les anthropologues
qui ont vérifié les thèses du pluralisme, sur des terrains exoti-
ques, « là où l'expansion européenne a favorisé l'émergence de
sociétés pluri-ethniques, multiraciales, de cultures fort différen-
tes ~ (1991, p. 142). En Europe, ces démarches et attitudes furent
ignorées, en dehors de celles qui influencèrent G. Gurvitch.
N. Rouland insiste sur le rôle de L. Petrazycki, juriste polonais
(1867-1931), qui « élève à la dignité du droit des systèmes de
normes qui concurrencent le droit officiel : règles de jeu, codes
sportifs, lois du milieu, jeux enfantins, règlement des établisse-
ments psychiatriques, réciprocités entre amants ou amis, etc. Le
sociologue G. Gurvitch (1894-1965) est son élève. Il pense aussi
que le droit n'a pas besoin de l'État pour exister et met l'accent
sur le rôle créateur du droit exercé par des entités telles que
la féodalité, l'Église, les corporations ou les syndicats, et insiste
sur le caractère communautairedu droit social qu'engendre chacun
de ces groupes. Les facultés de droit ignorèrent très largement
ses théories» (1991, p. 143).
Le développement des études sur le pluralisme juridique est
ainsi rarement le fait des juristes si on excepte la place excep-
tionnelle qu'a occupé aux USA le travail de Llewellyn, co-auteur
avec l'anthropologue Adamson-Hoebel de Cheyenne way (1941),
décrivant la manière indienne de régler les différends selon que
l'on se situe, ou non, au sein d'une unité sociale où la média-
tion peut s'exercer. Cet ouvrage inspirera une très large part des
anthropologues du droit anglo-américains travaillant dans le
domaine, spécialement John Griffith, Sally Falk Moore ou June
Starr. Cependant, People's Law and State Law, the Bellagio
Papers, publié chez Foris, en 1985, par A. Allot et G. Wood-
man, souligne dans son introduction générale que le pluralisme
juridique entendu comme étude de l'influence des systèmes juri-
diques entre eux, spécialement l'incidence du droit étatique sur
les droits
«
populaires ~ (pa~e 2) ne reçoit pas l'accord de tous
les anthropologuesdu droit. Etudiantdans cet ouvrage l'émergence
d'un
«
droit local ~ au Sénégal (Le Roy, 1985, pp. 253-262),
j'excluerai l'existence d'un pluralisme dans le droit sénégalais
en raison de la logique
«
unitaire ~ héritée de la conception juri-
dique du colonisateur français. Fidèle dans ce cas au point de
vue des juristes, je m'attacherai à comprendre quels sont les obs-
tacles au pluralisme dans la pensée et dans les pratiques des juris-
tes français ou francophones.
Jacques Chevallier
«(
L'ordre juridique~, Le droit en pro-
cès, Paris, PUF, 1984, p. 47),
à
la suite de S. Romano, analyse
le pluralisme des ordres juridiques et spécialement leurs relations
mutuelles. Selon lui,
«
la pluralité des ordres est donc corrigée
par un principe d'agencement et de structuration qui varie selon
les sociétés et assure une certaine cohésion globale ». Dans une
société comme la société française, dominée par l'institution éta-
tique, il y a une double tendance d'une part
«
à
faire de l'État
la seule réalité sociale organisée et le seul point de référence
identitaire », d'autre part
à
appréhender l'ordre étatique comme
«
pris en tenaille entre les ordres juridiques infra-étatiques fon-
dés sur des solidarités partielles et locales et des ordres juridi-
ques supra-étatiques nés de l'émergence de communautés plus
larges. .. ~ (1984, p. 47). Dans tous les cas,
«
l'ordre juridique
étatique est en position de force et occupe une place privilégiée,
puisqu'il est le seul
à
disposer d'une puissance de contrainte
inconditionnée et irrésistible ~ il est du même coup en mesure
de dicter ses conditions aux autres ordres juridiques et agir sur
eux, soit qu'ils se trouvent au niveau infra-étatique en établis-
sant sa tutelle, soit qu'ils se trouvent au niveau supra-étatique
en imposant sa médiation» (1984, p. 48).
Cette position, qui reste sans doute la plus avancée adoptée
par des juristes français a été remise en question par Jacques
Vanderlinden lors de rencontres organisées sur ce thème
à
Lei-
den en 1989 et
à
Aix-en-Provence en 1991. Son texte n'a mal-
heureusement été publié qu'en traduction anglaise
(<<
Return to
legal pluralism : Twenty Years Later », Journal of Legal Plura-
lism, number 28, 1989, pp. 149-157). Dans ce texte remarqua-
ble, l'auteur reconnaît avoir été victime du modèle étatique et,
à la manière du socialisme, «du pluralisme juridique dans un
seul pays ~. Prenant conscience que l'ordre juridique étatique n'a
pas de validité absolue mais dépend du discours de ceux qui cons-
truisent et alimentent ce modèle, il renverse le paradigme et au
lieu de concevoir le droit à partir de l'ordre étatique, i1le consi-

80 ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT LE DROIT INTERNE DES PAYS DU DÉVELOPPEMENT 81
dère selon le point de vue du citoyen, sujet de droits, le pluriel
étant ici de rigueur.
TI
en tire pour conséquence le paradoxe que
si du point de vue de l'ordre juridique étatique 1'hypothèse du
pluralisme juridique est impensable, par contre elle peut l'être
en adoptant le point de vue de l'individu qui participe toujours
à une multiplicité de groupes dont les régulations s'imposent à
lui. Pour théoriser cette lecture renouvelée, nous avons actuelle-
ment tendance à parler de
«
multijuridisme » pour traduire le fait
que chaque individu est partie prenante, dans sa vie familiale,
professionnelle ou publique, de multiples groupes dont les règles,
règlements, habitudes ou habitus s'imposent à lui de manière J2lus
ou moins concurrentielle. Si, jadis, les régulations de l'Etat
avaient tendance à prévaloir, ce type de situation est en cours
de changement et nous tentons de le systématiser dans une lec-
ture
«
post-moderne du droit », en particulier en matière de théo-
rie des droits de l'homme et d'État de droit en Afrique (E. Le
Roy et T. von Trotha, La violence et l'État, Paris, L'Harmat-
tan, 1993). Dans la perspective d'une anthropologie dynamique
du droit, selon les enseignements de l'analyse processuelle du
droit développées par Sally Falk Moore (Law as Process, Lon-
don, Henley, 1977), nous en approfondirons prochainement les
implications.
En France et en Belgique, les anthropologues et philosophes du
Droit privilégient cependant à une époque une deuxième problémati-
que centrée sur le transfert des modèles juridiques et mettant en évi-
dence progressivementle rôle des logiques à l'œuvre dans de tels trans-
ferts. Le point de départ en fut l'établissement du Dictionnaire d'an-
thropologie juridique édité par le Laboratoire d'anthropologie juridi-
que de Paris où la pensée à l'œuvre dans le droit traditionnel fut systé-
matiquement relevée (Le Roy, 1972). Par la suite, Michel Alliot exa-
mine les conditions historiques de tels transferts (Alliot, 1980) et un
programme de l'UNESCO sur le
«
transfert des connaissances » per-
met l'examen de la réception de l'idéalisme juridique occidental en
Afrique et en Amérique latine
2•
L'idée selon laquelle les systèmes
juridiques ne sont comparables qu'à travers la logique qui les
2. Voir les contributions de
J.
Lenoble, F. Ost, E. Le Roy, R. Entelman et B. Crousse
au chapitre
c
le transfert des systèmesjuridiques •.
Domination
ou
partage, développement endo-
gène
et
transfert
de
connaissances,
Paris, UNESCO, 1980, pp. 75-142. Voir aussi les commen-
taires de F.O. Snyder, (Snyder, 1980).
détermine reste un trait marquant de l'anthropologie française du Droit
(Le Roy, 1989).
Le troisième courant qui, enfin, s'oppose à l'idéologie développe-
mentaliste s'est développé autour du centre Droit et Cultures et de
R. Verdier. Depuis près de quinze ans, la revue Droit et Cultures
et les publications collectives sur la vengeance et le serment (Ver-
dier, 1980-1984) ont permis d'approfondir une anthropologie histori-
que du droit, se situant dans le prolongement de l'école durkheimienne
à la recherche de lois générales du fonctionnement des sociétés.
3. Quelques orientations de recherches juridiques
contemporaines
Si, comme le remarque R. Verdier, l'un des enjeux majeurs reste
de
«
repérer la juridicité de toute société humaine, proche ou loin-
taine» (Verdier, 1990) c'est bien parce que, hors du modèle de la
loi, la juridicité reste un
«
mystère» et que l'espoir d'une définition
unitaire du droit s'éloigne à mesure que les travaux s'accumulent. Selon
N. Rouland, «on ne peut définir le droit, mais seulement le penser...
La bonne question n'est pas "qu'est-ce que le droit", mais plutôt "quel
est le domaine du droit"
?
Autrement dit, il convient de porter son
attention moins sur le droit que sur les processus de juridicisation »
(Rouland, 1990, pp. 77-78 et 1988).
A LA RECHERCHE
DE NOUVELLES RÉGULATIONS JURIDIQUES
La revue Droits a fait appel, en 1990, à une trentaine de
spécialistesfrançais et européens pour tenter de
«
définir le droit »
sans aboutir à un point de vue unitaire. A ce propos, et dans
le même numéro, N. Rouland écrit:
«
Tout juriste quelque peu
insatisfait - l'espèce paraît moins menacée qu'il y a quelque
temps - sait qu'il n'est guère de question plus irritante que celle
de la définition de l'objet de sa discipline »3. Au-delà de la
3. N. Rouland,
c
Chroniqued'anthropologie juridique; relire notre droit (pour une anthro-
pologie du détour) .,
Droits,
1990, vol. 10, p. 148.

82
ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT LE DROIT INTERNE DES PAYS DU DÉVELOPPEMENT
83
prolifération des textes et des exégèses, la conception actuelle
du droit bute sur une contradiction essentielle entre une tendance
des professionnels à une perfection toujours plus grande des
modèles et des systèmes juridiques et une demande d'un droit
pragmatique, collant aux problèmes de société à résoudre au jour
le jour. Lors des « états généraux de la médiation ,. tenus à Gre-
noble en avril 1992, nous avons ainsi entendu un travailleur social
exprimer le besoin d'un «droit social» qui ne soit point un
« droit juridique,.. Pour étonnante qu'apparaisse une telle for-
mule, qu'on retrouve plus ou moins dans le travail qu'on peut
faire sur le terrain avec d'autres intervenants sociaux, il n'en
apparaît pas moins qu'une partie de la société civile impliquée
par les phénomènes de marginalité, de chômage, de délinquance
ou d'exclusion cherche des réponses nouvelles. Il faut y conju-
guer l'unité du cadre normatif et la pluralité des formes d'orga-
nisation en faisant évoluer la conception « moderne » du droit
pour, selon les termes d'A.-J. Arnaud, « assumer le pluralisme
et gérer la complexité»
4.
Selon cet auteur, il faut distinguer
« entre le droit posé, l'expérience savante et l'expérience vul-
gaire qui s'analysent en systèmes officiels (ce qu'on nomme cou-
ramment « le droit») et systèmes juridiques non officiels, appar-
tenant au « champ juridique vulgaire,. (Ibidem).
Un des enjeux des politiques juridiques de ces prochaines
années sera donc de construire de nouveaux modèles de régula-
tion qui devront combiner de manière originale les ressources
respectives de la coutume (valorisant les modèles de comporte-
ments) et de la loi (exprimant les attentes et les contraintes socia-
les de manière générale et impersonnelle). Si une de nos
hypothèses5serait de mieux distinguer entre deux modes de
régulation, actuellement enchassés l'un dans l'autre, et de cons-
truire un « droit des formes» (des procédures et des pratiques)
complémentairementau droit substantielcombinant règles de fond
et règles de forme, ce n'est là qu'une piste parmi d'autres dans
un contexte conceptuel et institutionnel en pleine mutation, tant
en Europe qu'en Afrique.
4. A.-J. Arnaud.
Pour
une
pensée juridique
européenne, Paris, PUF, 1991, pp. 288-289.
5. E. Le Roy,
«
Un droit peut en cacher un autre -,
Informations sociales,
n° spécial la
demande de droit, volume 23, mars 1993.
L'ensemble des pays musulmans et les communautés immigrées
en Europe offrent des terrains d'observations remarquables parce que,
comme le remarque J.-R. Henry, le droit «est désormais perçu
aujourd'hui dans cette région du monde comme la pointe dure du dis-
cours social et non seulement comme l'instrument relativement neutre
d'un projet de développementconduit par l'État,. (Henry, 1990, p. 13).
C'est pourquoi, les recherches se spécialisent-elles de moins en
moins sur une région et envisagent les hommes, leurs droits et leurs
enjeux au nord comme au sud de la Méditerranée, à l'est comme
comme à l'ouest de l'Europe. En dissolvant la spécificité discutable
des droits du Tiers monde dans l'étude des processus de juridicité à
l'échelle mondiale, la recherche contemporaine soumet aux mêmes pro-
tocoles scientifiquesles droits d'ici et de là-bas et se donne les moyens
d'éviter l'évolutionnisme et l'idéalisme des démarches juridiques naï-
ves. Les recherches portent donc particulièrement sur les approches
« interculturelles » du droit, à la suite des travaux du québécois R.
Vachon (Vachon, 1988, p. 372). On note également un grand prag-
matisme dans les objectifs des chercheurs, une approche de la théorie
plus déductive et empirique, et un fort souci d'applications sur le ter-
rain, par exemple en participant
à
la rédaction de textes juridiques
dans la perspective de l'élaboration d'une nouvelle génération de réfor-
mes agro-foncières en Afrique ou d'une conception renouvelée de
l'administration publique au service du développement (Timsit, 1986).
En conséquence, les effets du paradigme développementaliste sont
maintenant non seulement identifiés mais aussi analysés et maîtrisés,
de telle sorte que la nouvelle génération des juristes se prépare
à
penser
le droit non seulement dans son universalité mais surtout dans sa rela-
tivité. Les juristes du développement, avec une meilleure conscience
des limites de la «modernisation» des sociétés par le droit, affron-
tent actuellement deux problèmes : concevoir la notion d'État de droit
de telle façon qu'elle soit confortée par l'opinion publique et la société
civile et, d'autre part, contribuer
à
un meilleur encadrement institu-
tionnel de l'économie informelle sans lui retirer sa nécessaire flexibilité.
ÉTAT DE
DROIT
ET DROITS DE L'HOMME
Lors de la troisième réunion annuelle des directeurs d'insti-
tuts de droits de l'homme, tenue à Paris le 6 décembre 1991,
les participants ont relevé qu'au-delà de l'harmonisation des ensei-
gnements et de la collaboration entre les institutions représen-
 6
6
 7
7
1
/
7
100%