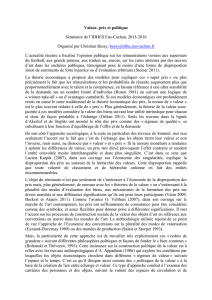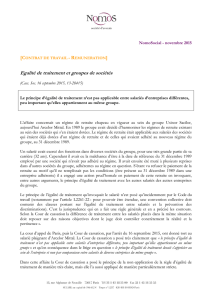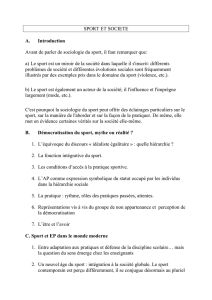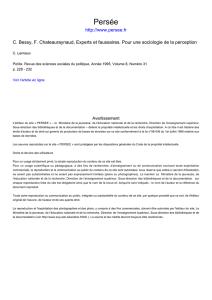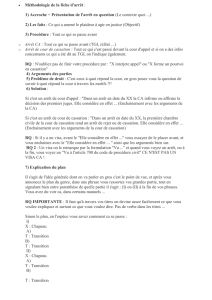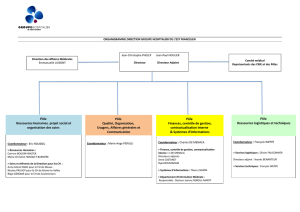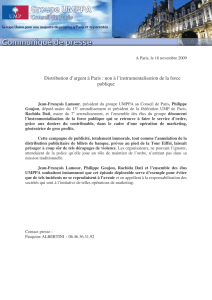La contractualisation de la relation de travail

La contractualisation de la relation de travail
Christian Bessy
LGDJ, coll. « Droit et Société », 2007, 301 p. + annexes.
Cet ouvrage de Christian Bessy ne manque pas d’ampleur, tant par son contenu que par les
problèmes qu’il soulève. Il présente les résultats d’une recherche empirique consacrée aux
contrats de travail, avec l’ambition « d’analyser les pratiques effectives des entreprises et de
leurs usages du droit à l’occasion de la rédaction des contrats » (p. 13). L’analyse proposée
par C. Bessy tout au long de cet ouvrage s’appuie sur une base empirique constituée d’environ
quatre cents contrats de travail collectés auprès d’entreprises. Cette base empirique a fait
l’objet d’une exploitation statistique dont les résultats sont présentés de manière
problématisée tout au long des dix chapitres de l’ouvrage. Une annexe méthodologique
précise la nature des données et les techniques de traitement utilisées.
Si l’on devait résumer la thèse de C. Bessy, quatre aspects majeurs et complémentaires
pourraient être retenus : d’abord, que la gestion de l’emploi par les entreprises tend à redonner
au contrat une vigueur et une importance qu’elle avait perdues au fil du temps, au profit des
cadres collectifs de la relation de travail ; ensuite, que cette pratique de la contractualisation
(des objectifs, des conditions de la rupture du contrat de travail) révèle une
« instrumentalisation » du droit du travail par les entreprises, qui constitue elle-même une
réponse, au moins partielle, à la réaffirmation par la Cour de cassation de l’intangibilité du
contrat. Cette dernière signale la résistance de la Chambre sociale de la Cour de cassation à la
pratique des licenciements individuels motivés par le refus du salarié d’accepter une
modification de ses conditions de travail non prévue au contrat initial ou qui en constitue une
modification substantielle (par exemple un changement du lieu de travail décidé par
l’employeur). La rencontre des positions jurisprudentielles et des pratiques de gestion du
personnel par les entreprises donne une impulsion à la conclusion de contrats plus précis, qui
définissent des objectifs à atteindre, des critères de performance du salarié, voire balisent les
conditions de la rupture du contrat de travail. En troisième lieu, le droit du travail constitue un
ensemble de « repères formels » qui se prêtent à des « risques d’instrumentalisation » que
l’analyse des usages stratégiques permet de faire apparaître. Enfin, les pratiques et les usages
du contrat de travail ne sont pas homogènes : ils sont marqués par une diversité que la
typologie proposée dans le chapitre 7 explicite. Cette pluralité des pratiques de rédaction des
contrats de travail révèle « la pluralité à la fois des rapports salariaux et des usages du droit. »
(p. 194).
C. Bessy distingue en effet quatre types de contrats de travail qui se caractérisent par des
degrés différents de complexité de la structure contractuelle. Sans entrer dans le détail,
retenons les principaux éléments caractéristiques de ces quatre classes : la classe 1 (« stabilité
des conditions d’emploi »), qui représente un tiers des contrats de la base de C. Bessy, renvoie
à une relation de travail « statutaire » au sens où elle s’appuie essentiellement sur les
dispositions des conventions collectives en matière de rémunération, de qualification, etc.
Dans ce contexte, le contrat de travail est plus un « dispositif d’information du salarié sur ses
principales conditions d’emploi qu’un dispositif contractuel orienté vers la négociation
interindividuelle » (p. 191). La classe 2 (« flexibilité modérée »), qui représente 40 % des
contrats de la base, est comme la classe 1 marquée par la faiblesse de la structure
contractuelle, mais elle s’en distingue par une définition plus explicite du contenu de l’emploi
et une plus forte individualisation des rémunérations. Cependant, la visée du contrat de travail
reste la même : un dispositif d’information. La classe 3 (« flexibilité généralisée et

subordination du salarié ») représente 11 % des contrats, qui sont caractérisés par une
structure contractuelle plus complexe que les précédentes : des clauses précisent les
conditions temporelles du travail (horaires flexibles…), le contenu du travail, etc., ce qui
révèle une démarche de « responsabilisation » des salariés et de « contractualisation de
l’implication du salarié dans son travail », ce qui va de pair avec un contrôle très étroit exercé
par l’employeur (p. 183). Dans ce contexte, l’usage du droit en révèle une
« instrumentalisation » par l’employeur qui lui permet d’accroître son pouvoir (p. 193). Enfin,
la classe 4 (« protection des actifs immatériels et contrats négociés par des professionnels »)
représente 13 % des contrats. Elle regroupe les contrats les plus complexes : les clauses
révèlent une volonté de l’employeur de protéger ses actifs immatériels (capital humain,
clientèle, technologie), une pratique de compléments de salaires basés sur la performance du
salarié. Cette classe concerne, on l’aura compris, des pratiques de contractualisation du
comportement de salariés hautement qualifiés, de cadres ayant une position de professionnel
dans leur activité.
La fréquence et la récurrence des termes « usages », « instrumentalisation »,
« contractualisation » dans l’ouvrage donnent l’opportunité d’une première observation. Ces
expressions convergent vers l’idée centrale défendue par C. Bessy : la prégnance d’une
tendance à l’intégration dans le contrat de travail d’une gestion individualisée de l’emploi.
Toutefois, l’utilisation des termes « usages » et « instrumentalisation » révèle elle-même une
conception implicite de la vocation et des finalités du droit, qu’il est important de rendre
explicites. Les usages, souvent qualifiés de « stratégiques », renvoient à deux idées : la
première est que les employeurs contourneraient les garanties que le principe d’intangibilité
du contrat affirmée par la Cour de cassation, via la pratique d’une individualisation
contractualisée renforcée. La deuxième est que le droit porte des règles et des repères formels
dont la mise en œuvre ne saurait se passer de règles informelles « qui permettent de stabiliser
la coopération, de réguler les litiges et arbitrer les conflits » (p. 21-22). La première idée est
une modalité d’une préoccupation pour la compréhension de « ce qu’il en advient dans la
communauté » quant aux rapports des règles juridiques et des actions, pour reprendre
l’expression de Max Weber. La deuxième idée révèle l’attachement de l’auteur au cadre
théorique de la théorie des conventions, dont les principes sont réaffirmés tout au long de
l’ouvrage sans que l’on n’en perçoive la portée pratique dans l’étude empirique qui constitue
l’essentiel de l’ouvrage. Et ce d’autant plus que C. Bessy déclare également adhérer, dans une
mesure qui n’est pas définie avec précision, au cadre théorique du courant institutionnaliste en
économie du droit (celui proposé par Nicholas Mercuro et Steven Medema) qui n’est pas, lui,
porteur d’une théorie des usages du droit. Quant au lexique de l’instrumentalisation, il peut
être interprété comme l’expression d’une théorisation implicite du droit : celle de la vocation
formelle et normative du droit. Une théorisation alternative, en l’occurrence celle dont est
porteuse la méthode réaliste/pragmatiste de l’économie du droit institutionnaliste, considère le
droit comme un outil d’ingénierie sociale. Dans cette perspective, il est naturellement
considéré que le droit constitue un instrument de la régulation sociale, instrument non neutre
qui révèle en quelque sorte une balance des intérêts. Or, dans le domaine qui occupe C. Bessy,
la chambre sociale de la Cour de cassation est un opérateur de cette balance des intérêts.
Le fait que le contrat de travail demeure une forme juridique encadrée par la législation et la
jurisprudence, mais aussi par des accords conventionnels fussent-ils d’entreprise, conduit à
penser que la contractualisation au sens où C. Bessy l’entend n’est pas synonyme de
« dépublicisation » du contrat. C’est pourtant ce que peut laisser entendre le terme
« contractualisation », qui est nettement connoté « regain de l’accord de volonté individuelle »
et « déclin des cadres statutaires ». Le contrat reste une institution sous la couverture de l’Etat

et des tribunaux ; il reste et demeure un cadre publicisé de relations juridiques, ce que l’on
peut percevoir dans l’ouvrage par les références constantes à la Cour de cassation et aux
Conseils de prud’hommes, à la loi1. Il y certes une transformation des cadres collectifs de la
relation de travail, que l’on peut voir dans certaines classes de contrats (classes 3 et surtout
4) : reflux des conventions collectives aux niveaux interprofessionnels ou de la branche,
déclin du pouvoir syndical, etc. Une question que l’on peut légitimement se poser est de
savoir dans quelle mesure cette tendance est liée aussi au développement de l’emploi dans des
entreprises de petite taille qui sont en dessous des seuils imposant la constitution d’institutions
représentatives du personnel2. Plus généralement, l’ouvrage de C. Bessy n’aborde par le
problème des mutations structurelles, par exemple le déclin des entreprises fordistes ou l’essor
des services où le contrôle patronal de la prestation de travail repose moins sur la technologie
que sur des outils contractuels.
Une dernière observation pour conclure : et si l’ouvrage de C. Bessy portait moins sur la
« contractualisation » que sur l’individualisation de la relation de travail ? Il semble que ce
soit avant tout de cela qu’il s’agit, d’une individualisation qui passe par de nouvelles formes
de pratiques du contrat de travail, non pas pour l’ensemble des contrats de travail constituant
la base empirique de C. Bessy, mais pour ceux de la classe 4 de la typologie proposée, soit 45
cas sur plus de 400.
Thierry Kirat
Université Paris Dauphine
1 Voir à ce propos l’analyse éclairante, et toujours d’actualité, de Louis Josserand, « La publicisation du
contrat », recueils Lambert, Sirey, 1938.
2 Sur ce point, on ne peut manquer de renvoyer aux travaux de N. Thèvenot et J. Valentin sur le recours à la
sous-traitance comme moyen de contourner les seuils légaux de représentation du personnel : « La sous-traitance
comme alternative au contrat de travail : une évaluation empirique pour la France, 1984-2000 », Économie
appliquée, tome LVIII, n° 3, 2005, p. 51-79. Pour une interprétation élargie, voir : C. Perraudin, N. Thèvenot, B.
Tinel, J. Valentin, « Sous-traitance et ineffectivité du droit du travail : une analyse économique », Économie et
Institutions, n° 9, 2006, p. 35-55.
1
/
3
100%