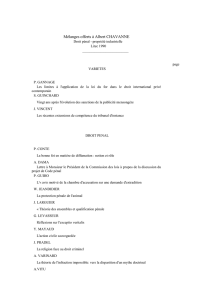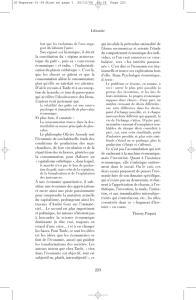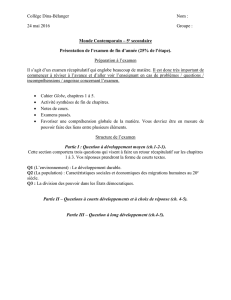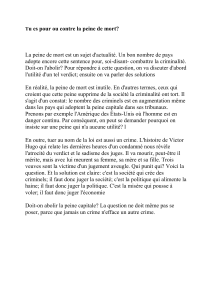la philosophie pénale - fédération internationale des étudiants

Gabriel TARDE (1890)
La philosophie
pénale
Chapitres VI à IX inclusivement
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Courriel: [email protected]
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm

Gabriel Tarde (1890), La philosophie pénale : chapitres VI à IX 2
Un document produit bénévolement en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole, à
partir de :
Gabriel Tarde (1890)
La philosophie pénale.
Chapitres VI à IX inclusivement.
Une édition électronique réalisée du livre publié en 1890, La philosophie pénale
(1890). Paris: Éditions Cujas, 1972, 578 pages. Réimpression du texte de la 4e
édition. Collection: La bibliothèque internationale de criminologie..
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word
2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
Édition complétée le 9 février 2003 à Chicoutimi, Québec.

Gabriel Tarde (1890), La philosophie pénale : chapitres VI à IX 3
Table des matières
Chapitre I : Considérations générales
I. - La criminalité des sauvages ; préjugés à cet égard. Une minorité de tribus
belliqueuses, criminelles, a dû triompher d'une majorité de tribus paisibles. Mais,
moralisation du maître par le sujet. Moralisation aussi de l'homme par la femme :
exemple, le cannibalisme
II. - L'apogée du droit criminel est lié au déclin de la criminalité. Autre cause de la
crise actuelle du droit pénal : la crise de la morale. Essais de reconstruction morale
dans toutes les écoles contemporaines. La modernisation de la morale. Nécessité et
difficulté de réformer la législation pénale
III. - Préjugé de penser que le libre arbitre est le fondement essentiel de la
responsabilité morale. Kant et sa liberté nouménale ; M. Fouillée et sa liberté idéale.
Origine scolastique de ce préjugé. Aperçus historiques. Le libre arbitre et la science
IV. - Analyse des notions de devoir et de droit, de responsabilité et de justice. Le
devoir dérive de la simple finalité. Conséquences de cette dérivation
V. - Le devoir de punir. Critique des Idées de MM. Fouillée et Guyau à ce sujet
Chapitre II: L'école positiviste
I. - Origines de l'école positiviste ; ses représentants actuels ; son succès et ses
progrès
II. - Exposé de ses doctrines. - Observations préliminaires. - I. Qu'est-ce que la
responsabilité ? - II. Qu'est-ce que le criminel ? Classification des criminels. III.
Qu'est-ce que le crime ? Ses caractères et ses causes. Les trois facteurs. - IV. Quel est
le remède au délit ? Sociologie criminelle
Chapitre III : Théorie de la responsabilité
Observations préliminaires

Gabriel Tarde (1890), La philosophie pénale : chapitres VI à IX 4
I. - La responsabilité morale fondée sur l'identité personnelle et la similitude
sociale. - II. Idéal de la responsabilité parfaite. États de l'âme, associables et non
associables : opposition à ce point de vue entre les désirs de production et de
consommation, les croyances objectives et subjectives. Les conditions
psychologiques de l'identité personnelle sont, en général, celles aussi de la similitude
sociale. - III. Comparaison avec la responsabilité collective d'une nation. Ses
analogies nombreuses avec la responsabilité individuelle
II. - Ce qu'il faut entendre par la similitude sociale. - I. Il ne s'agit pas de
similitudes physiques ni même de tous les genres de similitudes physiologiques. Le
sens moral. Le syllogisme téléologique. Le bien et le mal, leur explication
sociologique. Le subjectivisme social. Le devoir de croire ou de ne pas croire. - II.
Les jugements unanimes de blâme ou d'approbation ; nécessité de ce conformisme. -
III. Importance de préciser la limite d'une société. Cette limite s'étend toujours, et en
plusieurs sens. Traité d'extradition
III. - Ce qu'il faut entendre par l'identité personnelle. - I. L'identité, permanence de
la personne. Qu'est-ce que la personne ? L'individualité de la personne, éclairée par
l'individualité de l'organisme et surtout par celle de l'état. Coordination logique et
téléologique. L'âme immortelle et les villes éternelles ; conceptions sœurs. - II.
Différence malgré les analogies. L'identité du moi, bien plus profonde que l'identité
de l'État. L'hypothèse des monades. - III. L'État est à la nation ce que le mot est au
cerveau. Les idées-forces de M. Fouillée. L'identité se fait et se défait, elle a ses
degrés. - IV. Fondements de la prescription des poursuites criminelles ; réformes à y
Introduire. - V. La responsabilité civile
IV. - Notre théorie s'accorde avec l'historique de la responsabilité. - I. La solidarité
familiale des temps primitifs ; vendetta. Survivances de ce passé, représailles. - II. La
justice royale a pris modèle, non sur les tribunaux domestiques de l'ère antérieure,
mais sur les procédés belliqueux : malfaiteurs partout traités en ennemis. - III.
Caractère expiatoire de la peine transition individuelle. - IV. Résumé et complément
Chapitre IV : Théorie de l'irresponsabilité
Observations préliminaires. - Réponse à M. Binet. Causes différentes
d'irresponsabilité
I. - La folie. - I. La folie désassimile et aliène en même temps. Le sens moral. - II.
Dualité interne de l'aliéné : Félida et Rousseau. Responsabilité ou irresponsabilité des
grands hommes. - III. Duel interne de l'aliéné. Psychologie des mystiques. - Les
diverses formes de la folie. - IV. L'épilepsie, folie intermittente. Maladies analogues
du corps social. - V. La folie consolidée. La folie morale, état opposé à la folie
véritable. L'hérédité, nullement contraire à la responsabilité individuelle. - VI.
Théorie de la responsabilité par M. Dubuisson. Erreur d'opposer la responsabilité
morale à la responsabilité sociale. - VII. Responsabilité partielle des aliénés, M.
FaIret. Les criminels fous et les génies fous
II.- L'ivresse, - Homicide par imprudence et homicide en état d'ivresse, folie
alcoolique. L'ivresse doit-elle être une circonstance d'autant plus atténuante qu'elle est

Gabriel Tarde (1890), La philosophie pénale : chapitres VI à IX 5
plus invétérée ? Contradiction entre les déterministes et leurs adversaires sur ce point.
Amnésie
III. - L'hypnotisme. - L'hypnotisme et l'identité. L'hypnose et le songe, deux
formes de l'association des images, qui implique la réalité de la personne identique.
La décision volontaire est donc autre chose qu'une suggestion compliquée
IV. - La vieillesse. - L'âge et le sexe
V. - La conversion morale, aliénation salutaire. - Lenteur des grandes conversions.
Nécessité de la suggestion ambiante. Profondeur des transformations morales
obtenues par les fondateurs de sectes ou de religions. Effets de la transportation
pénale. Le remords et le repentir
VI. - La souveraineté
Chapitre V : Le criminel
Observations préliminaires
I. - I. Le type criminel. - II. - Délit naturel et criminalité native font deux. - III.
Impossibilité de localiser cérébralement cette aptitude complexe, la criminalité, avant
d'avoir localisé ses éléments. - IV. Le criminel n'est pas un fou. - V. Le criminel n'est
pas un sauvage réapparu parmi nous. Fondements illusoires de l'hypothèse de
l'atavisme : anomalies corporelles, tatouage, argot. - VI. Le criminel est-il un
épileptique ? Réfutation de cette thèse prise à la lettre L'exemple de Misdéa analysé.
Ce qu'il y a peut-être de vrai au fond de cette idée. Périodicité essentielle aux
phénomènes psychologiques. - VII. Le type criminel est un type professionnel.
Physiognomonie et graphologie. - VIII. Psychologie du criminel. Le criminel est en
partie l'œuvre de son propre crime et de la justice criminelle
II. - I. La classification des criminels doit être surtout sociologique. Le criminel
rural et le criminel urbain. - II. Le brigandage rural en Corse et en Sicile. Ses
caractères. La gendarmerie et la police. – III. - (suite). La maffia sicilienne. - IV. Le
brigandage urbain. La criminalité à Barcelone
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
1
/
183
100%