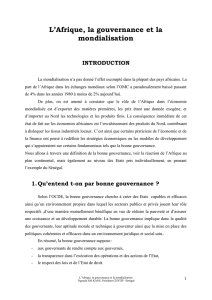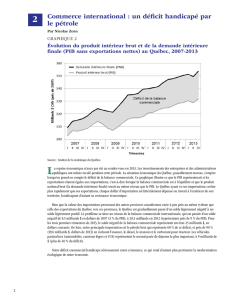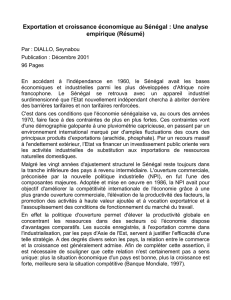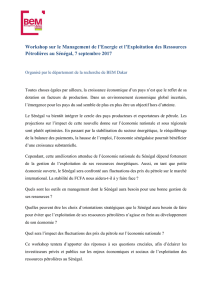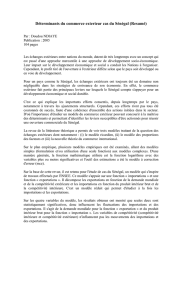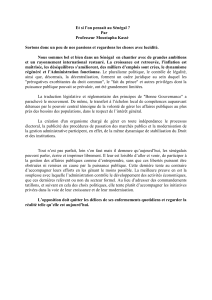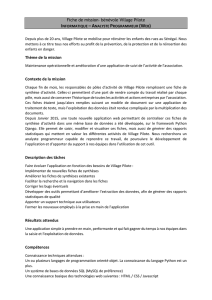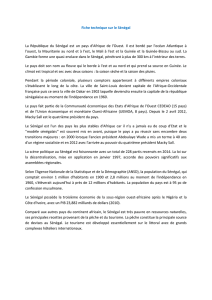Sénégal dans le contexte de mondialisation

________________________________________________________________________
Cabinet A&C
:
Etude sur le contexte international
1
L
LE
E
S
SE
EN
NE
EG
GA
AL
L
D
DA
AN
NS
S
L
LE
E
C
CO
ON
NT
TE
EX
XT
TE
E
D
DE
E
M
MO
ON
ND
DI
IA
AL
LI
IS
SA
AT
TI
IO
ON
N
Par
Professeur
Professeur Professeur
Professeur
Moustapha Kassé
Moustapha KasséMoustapha Kassé
Moustapha Kassé

________________________________________________________________________
Cabinet A&C
:
Etude sur le contexte international
2
Introduction
Considérée comme une chance pour les uns, une menace pour les autres, le
phénomène de la mondialisation qui, pour beaucoup de monde, semble déterminer désormais
l’avenir de la planète suscite des débats passionnés, des controverses savantes et des
proclamations politiques aussi simplistes que péremptoires. Mais d’abord, de quoi s’agit-il
lorsqu’on parle de mondialisation ?
A l’origine, la mondialisation était essentiellement perçue par les auteurs comme un
fait économique et financier qui indiquait la suppression progressive de barrières douanières
et réglementaires pour les entreprises industrielles, commerciales et financières ce qui
permettait le déploiement sans entrave et la délocalisation des activités dans l’espace mondial.
Les firmes multinationales se trouvaient ainsi au cœur d’un processus productif de dimension
mondiale commandé par la recherche d’un profit optimal axé sur l’exploitation des dotations
factorielles naturelles des pays. Le phénomène s’est par la suite élargi au point d’affecter
aujourd’hui le politique, le social et le culturel. Cela soulève beaucoup d’interrogations.
Pourtant, le concept malgré son utilisation abusive fait l’objet de plusieurs
compréhensions tant au niveau des chercheurs qu’à celui du grand public. Le sujet est vaste,
complexe, largement débattu, souvent diabolisé au détriment d’analyses robustes avec des
statistiques crédibles. Selon la remarque de R. BOYER, «quand des ouvriers d’un abattoir de
poulets se mettent en grève pour contester un aménagement de leurs horaires de travail, on
décrète qu’ils se battent contre la mondialisation qui impose sa rationalité aux entreprises de
ce secteur étroitement dépendant de ses performances à l’exportation. Lorsqu’un
gouvernement choisit de renoncer à exercer ses prérogatives pour s’aligner sur les positions
des lobbies favorables au tout-déréglementation, il se justifie en se fondant sur les nouvelles
exigences de la mondialisation
1
».
Bien que les termes de « mondialisation », « globalisation », « internationalisation »
soient à la fois flous et empreints d’ambiguïté, chacun pense que leurs conséquences (sans
pouvoir les cerner précision) sont importantes. Pour certains économistes, l’entrée dans la
mondialisation se mesure par un pourcentage significatif du PIB de la nation réalisé avec
l'extérieur alors que pour d'autres, ce pourcentage est moins significatif que la «dépendance »
ou «l’indépendance» de la nation vis-à-vis de décisions prises par des acteurs de l'étranger :
firmes ou Etats compte tenu du caractère de "price taker" ou de "price maker" que détiennent
ces acteurs sur le marché mondial. Pour d'autres enfin, la mondialisation s’exprime à travers
l’ensemble des « mécanismes d’accumulation à l’échelle mondiale » qui enrichit les
partenaires les plus riches et appauvrit les autres par l’échange inégal caractéristique des
distorsions dans le processus de formation des marchés internationaux et de distribution des
revenus.
Malgré sa forte présence dans plusieurs secteurs et dans plusieurs régions du globe, la
mondialisation n’est pas encore universelle. Au contraire, une de ses particularités marquantes
est qu’elle est paradoxalement non homogène et fortement asymétrique, dans la mesure où
toutes les activités économiques, financières comme culturelles ne se mondialisent ni au
même rythme ni de la même manière. Certaines, telles que la finance et les entreprises sont
mondialisées depuis des siècles, alors que d’autres encore solidement chevillées dans des
1
R. Boyer et al : Mondialisation au-delà des mythes, Edit. La Découverte, 1997, 174p.

________________________________________________________________________
Cabinet A&C
:
Etude sur le contexte international
3
frontières géographiques nationales dont elles portent les marques. C’est bel et bien une
mondialisation à plusieurs vitesses entraînant des chocs asymétriques.
Considérée comme un phénomène polyforme, elle pose des questions déterminantes
pour l’ordre national : Offre-t-elle les mêmes chances et les mêmes avantages à tous les
partenaires ou participants? Quelles sont objectivement ses conséquences directes et
indirectes sur les différents partenaires singulièrement les plus faibles d’entre eux?
2
Pourra-t-
elle contribuer positivement à la croissance économique des pays d’Afrique sub-saharienne,
au développement de l’emploi, à l’éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités ?
Quel sort réserve-t-elle aux acteurs nationaux les plus fragiles et les plus déficients ? Va-t-elle
harmoniser les structures institutionnelles et les normes et valeurs propres aux sociétés ? Est-
elle inéluctable ou contournable ?
Ces questions sont déterminantes pour un pays comme le Sénégal qui se lance dans un
travail de prospective pour l’horizon temporel 2015 qui correspond à la réalisation des
Objectifs du Millénaire (OMD) du PNUD gravitant autour de la réduction de la pauvreté de
masse qui menace tous les équilibres économiques comme non économiques. La prospective
dans ce cadre est un excellent outil pour définir les scénarios du futur en vue d’agir sur la
réalité et peser efficacement sur le cours des choses. Le contexte mondial doit y tenir une
place centrale.
I- La configuration de la mondialisation
multipolaire.
La mondialisation présente un caractère de contrastes et de paradoxes. Les statistiques
des Organisations internationales montrent que jamais le monde n’a disposé d’autant de
techniques et n’a produit autant de richesses, pourtant, jamais elle n’a produit autant
d’inégalités et de pauvreté révélant ainsi la marque d’une humanité socialement duale. Le
Produit mondial a connu au cours du siècle une croissance exceptionnelle : en dollars de
1975, il est passé de 580 milliards en 1900 à 25000 milliards au milieu des années 90 ce qui
représente en moyenne 4500 dollars per capita. Seulement, ce tableau idyllique est traversé
par beaucoup de problèmes et il est altéré par la succession de crises graves qui sont autant de
périls économiques, financiers et sociaux dont les dernières en date ont été la déroute de
certains Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie et d’Amérique Latine souvent proposés comme
modèle de référence pour sortir du sous-développement en une génération. Ces crises répétées
et de plus en plus profondes montrent l’ampleur des risques, des incertitudes et des
dysfonctionnements que les Institutions Financières Internationales n’ont pas pu gérer faute
de disposer de ressources suffisantes et d’instruments adéquats de régulation. C’est ce qui est
apparu dans le cas de la crise financière en Asie, au Mexique, au Brésil et en Uruguay.
2
Moustapha KASSE (2003) : De l’UEMOA au NEPAD : le nouveau régionalisme africain, Edition Nouvelles
du Sud, 256 p

________________________________________________________________________
Cabinet A&C
:
Etude sur le contexte international
4
A défaut d’un consensus sur la définition, les pratiques et les tendances de
l’économie mondiale, dans sa double sphère réelle et monétaire, laissent apparaître une
triple interdépendance que l’on pourrait qualifier de mondialisation. Essayons de cerner de
plus prés ces interdépendances pour bien en mesurer toutes les conséquences à la fois sur
les économies et sur les différents acteurs:
- L’interdépendance par la production se caractérise par une décomposition
internationale des processus productifs qui s’appuie sur un réseau de filiales ou de
sous- traitants et le nomadisme de segments entiers des appareils de production selon
la logique des avantages comparatifs ;
- L’interdépendance par les marchés qui se traduit par la disparition des frontières
géographiques, l’abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires qui accélère
alors les échanges commerciaux ;
- L’interdépendance financière qui procède d’une interconnexion des places financières
mondiales fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à la conjugaison de
trois éléments que sont la déréglementation, le décloisonnement des marchés et la
désintermédiation ;
- L’interdépendance par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) qui, avec les transports, intensifient la mobilité et la flexibilité
des capitaux, des biens, des services et des personnes.

________________________________________________________________________
Cabinet A&C
:
Etude sur le contexte international
5
Ce sont ces interdépendances qui déterminent les relations entre les différents acteurs
du jeu économique, financier, politique et social mondial.
Les Etats doivent avoir une perception claire de cette configuration mondiale pour en
évaluer les coûts et les opportunités par des politiques économiques et financières
appropriées.
1) La première interdépendance est relative à la production : un système
productif dominé par des firmes multinationales.
Elle se caractérise par une division internationale du travail qui unifie les processus
productifs nationaux et s’appuie, en conséquence, sur un réseau de filiales ou de sous-traitant
qui opèrent la délocalisation de segments entiers des appareils de production selon la logique
des avantages comparatifs. Cette structuration est le fait des firmes multinationales qui
façonnent l’espace mondial en réseaux de production. Elles sont de plus en plus nombreuses,
puissantes et originaires de diverses zones. Cette stratégie d’implantation leur permet de
maximiser leurs profits à partir d’une optimisation de la localisation de leur production. Ce
sont aujourd’hui, quelques 37 000 firmes multinationales de taille très inégale qui réalisent et
contrôlent l’essentiel de la production mondiale de biens et services, les 500 d’entre elles les
plus puissantes contrôlent presque 30 à 40 % du PIB mondial soit 25 000 milliards de dollars.
Elles effectuent les 2/3 du commerce international sous forme d’échanges internes avec leurs
27 000 filiales soigneusement réparties dans l’espace mondial. Egalement, le négoce
international des produits de base est largement sous le contrôle des firmes multinationales
Le processus de délocalisation des activités industrielles réalisé par les firmes
multinationales sépare les lieux de production ou de transformation de certaines marchandises
de leurs lieux de consommation. Il va s’amplifier sous l’influence de la Nouvelle Révolution
des Technologies de l’Information et de la Communication, de la dématérialisation de
capitaux et de l’extension des aires géographiques du libéralisme. Il a surtout fortement
contribué au décollage industriel de la plupart des pays industrialisés d’Asie. En effet, les
transferts d'activités industrielles et de services du Nord vers le Sud, appelés "délocalisations",
sont l'une des causes les plus spectaculaires de l’industrialisation rapide des pays asiatiques
même si par ailleurs, elle dévitalise les économies du Nord et y opère une destruction des
emplois. S’agit-il alors d’un « partage des richesses ou d’un partage de la misère? Sans nul
doute ; la mondialisation libérale complètement soumise aux lois du marché et du profit à
court terme n'apportera pas de réponse à cette question.
Les Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie et d’Amérique Latine ont tiré profit de cette
délocalisation en attirant des segments de production industrielle en valorisant leur dotation
factorielle liée à l’espace géographique, à la qualité des ressources humaines ou à l’offre
illimitée de main d’œuvre. Ils ont réussi à mettre en place un tissu industriel dans les
domaines des hautes technologies.
Certains Etats africains ont fait les mêmes tentatives avec la création des Zones
franches industrielles considérées comme des moyens d’attirer les investissements étrangers,
créer des emplois, développer l'industrie nationale et les infrastructures, favoriser les
transferts de technologies et se procurer des devises. A l’exception de l’Ile Maurice, les Zones
Franches africaines ont produit des résultats médiocres. Ce modèle de réussite procède des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
1
/
59
100%