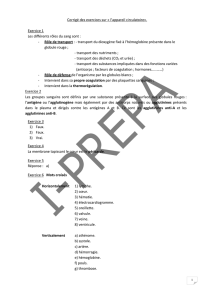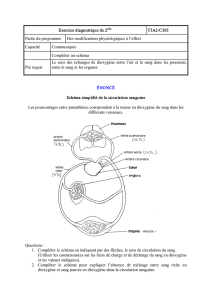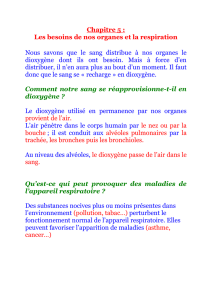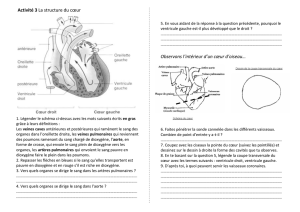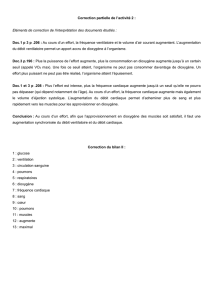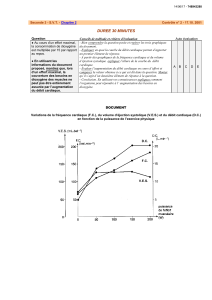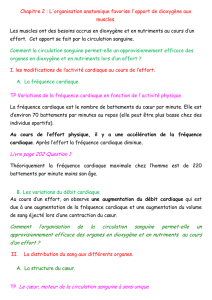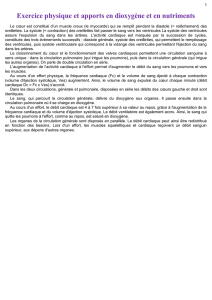2. - Hachette

76
>
>Mode d’emploi
2.
Pour démarrer
Doc. 1 Les voies respiratoires de l’homme, du nez aux alvéoles
pulmonaires.
1.Le cœur et
la circulation
L’appareil circulatoire est formé d’un organe
moteur,le cœur*, et de vaisseaux
qui constituent un réseau important dont
le rôle est d’irriguer les organes du corps
(vu en 5e). Le sang qui circule permet
le transport du dioxygène* et des nutriments*
nécessaires au fonctionnement de toutes
les cellules de l’organisme. La circulation
sanguine est assurée par les contractions
du cœur,une véritable pompe (vu en 5eet en 3e).
2.Les poumons et
les échanges gazeux
Les poumons permettent le
réapprovisionnement de l’organisme
en dioxygène (vu en 5e). Les échanges gazeux
sanguins de dioxygène et de dioxyde de
carbone* ont lieu dans des alvéoles pulmonaires,
petits sacs qui terminent les ramifications
des voies respiratoires .
>Doc. 1 et 2
capillaires
capillaires
POUMONS
ORGANE
veine
veine artère
artère
CO2
CO2
O2
O2
CŒUR
sang riche en dioxygène
sang appauvri en dioxygène
et enrichi en dioxyde de carbone
sens de la circulation sanguine < Doc. 2 Schéma simplifié de la circulation
et des échanges gazeux.
<
L’organisme en fonctionnement
29
>
>
Sommaire des activités
1. La circulation et la respiration,
deux fonctions associées.
2. La structure du cœur et la circulation.
3. Le fonctionnement du cœur.
4. Le cœur à l’effort.
5. La distribution du sang oxygéné
aux organes.
6. La réoxygénation pulmonaire du sang.
Au cours d’un effort musculaire, il y a une consommation accrue de glucose,
principale source d’énergie,et de dioxygène. Ce dernier n’est pas stocké
dans l’organisme; par conséquent,
le sang doit assurer son apport
en permanence et en quantité
suffisante pour couvrir les besoins
des cellules musculaires.
L’activité cardio-
respiratoire et l’apport
de dioxygène
Chapitre
2.
>
[
Comment les deux fonctions associées,
la circulation et la respiration, assurent-
elles l’apport continu et approprié
en dioxygène aux cellules musculaires
en fonction de l’effort fourni?
>
Chapitre
Le sang assure le transport des gaz respira-
toires : le dioxygène O2et le dioxyde de car-
bone CO2. Le renouvellement du dioxygène se
fait au niveau des alvéoles pulmonaires. Les
échanges se font à travers les fines parois des
alvéoles et des capillaires . Dans le
sang réapprovisionné en dioxygène, la quan-
>Doc.2
Les échanges gazeux et le transport du dioxygène par le sang
2. tité de ce gaz fixée par l’hémoglobine est de
0,2 litre par litre de sang. La concentration en
dioxygène du sang artériel est toujours cons-
tante. Dans les cellules musculaires comme
dans toutes les autres cellules, l’approvision-
nement en dioxygène se fait au niveau des
capillaires sanguins .
>Doc.3
31
L’organisme en fonctionnement
< Doc. 2 Tissu pulmonaire montrant
un capillaire sanguin contenant
des hématies (MEB, 830,
en fausses couleurs).
1. Décrire les deux circulations,générale
et pulmonaire, et dégager l’importance
du cœur dans un tel circuit [ Doc. 1 ].
2. En vous aidant du modèle d’un circuit
électrique (voir doc. 2, activité 5,p. 38),
montrer que le cœur et les poumons et,
par extension, que la circulation générale
et la circulation pulmonaire sont disposés
en série [ Doc. 1 ].
3. Bilan : Sachant que le sang est
réapprovisionné en dioxygène à la sortie
des poumons, montrer l’intérêt
de cette disposition en série.
>
Exploitation
Doc. 3 Cellules musculaires en coupe transversale montrant
un vaisseau sanguin (MO, 1 850).
> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène
>
2.
30
>
>
Activités
Comment la structure de l’appareil
circulatoire permet-elle
la distribution du sang
réapprovisionné en dioxygène
aux différents organes ?
Les organes reçoivent en permanence le dioxygène transporté par le sang et nécessaire
à leur fonctionnement.
[
>
Chapitre
La double circulation
L’appareil circulatoire est formé d’un réseau
clos de vaisseaux sanguins. Les artères trans-
portent le sang depuis le cœur jusqu’aux
organes. Les veines véhiculent le sang depuis
les organes jusqu’au cœur. Les artères et les
veines se ramifient respectivement
en artérioles et en veinules, de diamètres de
plus en plus fins, puis en capillaires sanguins.
Tous ces vaisseaux forment un double circuit
correspondant à une double circulation : la
circulation générale* ou systémique et la
petite circulation ou circulation pulmonaire*.
>Doc.1
1.
> Doc. 1 Schéma de l’appareil circulatoire
de l’homme.
1.La circulation et la respiration,
deux fonctions associées
cellule musculaire
vaisseau sanguin noyaux
CO2
O2
CO2O2
alvéole
pulmonaire
capillaire
sanguin
globules
rouges
cellule
pulmonaire
alvéole
pulmonaire
33
L’organisme en fonctionnement
> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène
2.
32
>
>
Activités
Comment l’organisation du cœur
permet-elle la circulation du sang
entre ces deux circuits ?
Le cœur est un passage obligé entre le circuit de la circulation pulmonaire
et le circuit de la circulation générale.
[
>
Chapitre
> Doc.X Xxx
2.La structure du cœur et la circulation
L’anatomie externe du cœur
> Objectif : montrer que le cœur est
un organe cloisonné en deux structures
formées chacune de deux cavités en
relation avec des vaisseaux bien
identifiés.
1.
Les caractéristiques
de la circulation cardiaque
> Objectif : déterminer le sens
de la circulation dans le cœur.
2.
Résultats
Le document 2 présente les résultats de cette
expérience.
L’anatomie interne du cœur
> Objectif : établir la relation
entre l’organisation du cœur
et le sens de la circulation.
3.
Protocole
Sur un cœur, après avoir ligaturé tous
les tuyaux et cousu toutes les ouvertures,
réaliser des injections d’eau, colorée ou non,
dans chacun des tuyaux précisés dans
le tableau ci-contre .
>Doc.2
Protocole
•Ouverture du « cœur droit » : disposer
le cœur face ventrale au-dessus et couper
longitudinalement le tronc artériel
pulmonaire, puis sectionner la paroi
du ventricule droit en longeant le sillon
interventriculaire .
•Ouverture du « cœur gauche » : sectionner
l’aorte, puis la paroi du ventricule gauche
en suivant le sillon jusqu’à la pointe du cœur
.
•Pour chaque « cœur », observer :
– à la limite du ventricule et du vaisseau
sectionné, trois lames membraneuses
blanches en corbeille, qui constituent
la valvule artérielle ou sigmoïde (droite
ou gauche) ; introduire une petite bille ou du
coton dans l’une d’entre elles pour distinguer
leur forme, puis repérer à leur niveau l’orifice
des artères coronaires ;
– les lamelles fibreuses entre l’oreillette
et le ventricule, qui constituent la valvule
auriculoventriculaire* (droite ou gauche) ;
leur pointe est reliée par des cordons
tendineux rattachés à des piliers en saillie.
>Doc.3
>Doc.1
>Doc.1
Doc. 1 Anatomie externe du cœur (face ventrale).
Ligne d’incision du tronc pulmonaire et du ventricule droit.
Ligne d’incision du tronc aortique et du ventricule gauche.
>
tronc
aortique
oreillette
droite
veine cave
inférieure
tronc
pulmonaire
ventricule
droit
sillon
interventriculaire
ventricule
gauche
oreillette
gauche
veine cave
supérieure
artère aorte
veines
pulmonaires
artère
pulmonaire
< Doc.2
injection d’eau
dans le tuyau relié à observation
la veine cave l’eau ressort par
l’artère pulmonaire
l’artère pulmonaire l’eau ne s’écoule pas
la veine pulmonaire l’eau ressort par
l’artère aorte
l’artère aorte l’eau ne s’écoule pas
artère
pulmonaire
artère aorte
première
moitié
du ventricule
droit seconde
moitié
du ventricule
droit
paroi interventriculaire
ventricule
gauche
oreillette droite
valvules
auriculo-
ventriculaires
valvules
artérielles
1. Exploiter les expériences d’injection d’eau pour dégager
les caractéristiques de la circulation sanguine du cœur [ Doc. 2 ].
2. Justifier la dénomination de « cœur droit » et de « cœur gauche »
en indiquant les cavités qui constituent chacune de ces deux
parties du cœur [ Doc. 1 ].
3. Préciser,en argumentant à partir des observations de la
dissection, dans quel sens les différentes valvules s’ouvrent
et se referment [ Doc. 3 ]. En quoi cela permet-il d’expliquer
que la circulation du sang dans le cœur se fait à sens unique?
4.Bilan : Le « cœur droit » reçoit du sang appauvri en dioxygène
et le « cœur gauche » du sang enrichi en dioxygène. Retracer
le circuit du sang dans les différents vaisseaux et cavités du cœur
en exploitant ces informations.
>
Exploitation
Doc.3 Cœur ouvert de mouton.
>
Protocole
•Localiser la face ventrale bombée d’un cœur
de mouton et la face dorsale plate,
la pointe du cœur étant vers le bas.
Sur chaque face, un sillon oblique marque
la limite entre les ventricules ; ce sillon
interventriculaire contient les artères coronaires
qui irriguent le cœur. Le tissu blanchâtre
qui les entoure est un tissu adipeux*.
•Repérer les oreillettes droite et gauche,
aplaties et rouge-sombre, et les ventricules,
qui forment la masse principale du cœur.
•Distinguer les artères à section circulaire
béante qui partent des ventricules et les
veines à section aplatie refermée qui
partent des oreillettes.
•Identifier les veines caves qui partent de
l’oreillette droite et les veines pulmonaires de
l’oreillette gauche; introduire la sonde
cannelée dans l’ouverture des autres vaisseaux.
La sonde est engagée dans le tronc artériel
aortique et le ventricule gauche si elle arrive
dans la pointe du cœur ; au contraire, la sonde
est engagée dans le tronc artériel pulmonaire
et le ventricule droit si elle arrive à gauche.
•Introduire différents tuyaux en plastique dans
l’aorte, puis dans la veine pulmonaire, la veine
cave et enfin l’artère pulmonaire.
>Doc.1
Livres et revues
– W. Voet, Massacre à la chaîne,révélations sur 30 ans
de tricherie, Calmann-Lévy,1999.
– Le Dopage, dossier hors série de Sciences et Vie,
n° 206, mars 1999.
Sites internet
– http://www.santesport.gouv.fr
Sources d’information
[
>
67
L’organisme en fonctionnement
Données chiffrées
Le rythme cardiaque moyen du
coureur non dopé, sur l’ensem-
ble de la course, est de 150 batte-
ments par minute, et ne descend
jamais en dessous de 100 batte-
ments par minute, même dans
les zones faciles. Après cinq
heures de course, son cœur
s’épuise. La fréquence cardia-
que moyenne du coureur dopé à
l’EPO est de 90 battements par
minute. Lors des efforts finaux,
le cœur de l’athlète a encore des
réserves.
Courbe de performances d’un célèbre sprinter
(16 ans de carrière)
On constate une brusque amélioration des performances en 1985.
En 1988, un contrôle antidopage se révélait positif aux stéroïdes anabolisants.
Dr J.-P. de Mondenard,
spécialiste du dopage
Un contrôle négatif ne constitue donc
pas une preuve de non-dopage?
Effectivement, la première caractéristique
d’un contrôle négatif, c’est qu’il ne permet
pas de conclure à l’absence de dopage. La
principale raison de cette lacune tient aux
nombreuses substances indécelables: la
cortisone naturelle, hormone corticosurré-
nale euphorisante et anti-inflammatoire qui
facilite l’adaptation au stress et aux charges
de travail élevées ; l’hormone de croissance,
qui stimule la production de globules rouges
et augmente l’oxygénation musculaire ;
l’hormone thyroïdienne ; l’hormone cortico-
trophine, qui stimule les glandes surrénales
productrices d’anabolisants stéroïdiens ; la
gonadolibérine d’origine hypothalamique,
qui déclenche la sécrétion d’hormones mâles
par les testicules ; la somatostatine, qui blo-
que la sécrétion d’hormones de croissance et
permet d’orienter le développement des
gymnastes...
La deuxième raison tient à l’utilisation
des produits dits d’entraînement, comme
les stéroïdes anabolisants injectables. La
plupart sont détectables, mais peuvent être
arrêtés suffisamment longtemps avant les
compétitions. Il suffit d’enchaîner alors avec
les dopants indétectables – principalement
l’hormone de croissance – ou rapidement
éliminés – comme certains stéroïdes anabo-
lisants administrables par la bouche, qui
disparaissent en cinq jours...
Sciences et Avenir,n° 593,juillet 1996.
Interview
Pistes de recherche
•Quels sont les effets recherchés par les sportifs utilisant les
substances dopantes ? Sur quels organes agissent-elles ?
•Quelles maladies soigne-t-on avec les principales substances
dopantes ? Quels risques ces substances présentent-elles
pour la santé?
•Recherchez dans l’actualité récente des cas de dopage. Quels ont
été les produits utilisés,et quel bénéfice l’athlète escomptait-il ?
012345
012345
67
fréquence cardiaque (battements par minute)
fréquence cardiaque (battements par minute)
temps de course (heures)
temps de course (heures)
coureur non dopé
coureur dopé à l’EPO
40
40
60
80
100
120
140
160
180
60
80
100
120
140
160
180
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993
10,0
10,5
année civile
contrôle positif
aux stéroïdes
performance au 100 mètres (s)
Les courbes ci-dessus présentent les enregistrements cardiaques de deux coureurs,
l’un non dopé, l’autre dopé à l’EPO, dans deux courses de difficultés équivalentes.
Comparaison de deux coureurs cyclistes
> Thèmes au choix
1.
>
Thèmes au choix
66
Les performances
surhumaines
des cyclistes du Tour
de France 1997
devaient beaucoup
à l’EPO.
>
Le dopage des sportifs
Les sportifs de haut niveau cherchent à augmenter
leurs performances. Certains utilisent même des substances illicites
pour accroître la puissance et l’oxygénation de leurs muscles.
Informations
>
Des stimulants de l’agressivité, tels
les amphétamines ou cocaïne, sont
parfois utilisés comme dopants.
Dangereux et améliorant peu les
performances sportives, ils sont aisé-
ment détectés dans les urines au
cours des contrôles.
La recherche biomédicale produit
désormais des substances utiles pour
soigner certaines maladies, mais
détournées de leur bon usage par des
sportifs.
Davantage de dioxygène
• L’érythropoïétine (EPO)
La performance au cours d’un exer-
cice de longue durée (cyclisme sur
route, ski de fond, marathon…)
dépend surtout de l’aptitude maxi-
male des muscles à consommer du
dioxygène. Cette aptitude augmente
avec la capacité du sang artériel à
transporter le dioxygène. Ce sont les
globules rouges (grâce à l’hémoglo-
bine qu’ils contiennent) qui transpor-
tent le dioxygène des poumons vers
les muscles.
Le rein sécrète naturellement de
l’EPO, une hormone permettant la
multiplication des futurs globules
rouges. L’entraînement en altitude
augmente cette sécrétion naturelle :
la production des globules rouges
sanguins peut être multipliée jusqu’à
plus de sept fois! Dès 1988, la prise
d’EPO artificielle a permis une spec-
taculaire augmentation des perfor-
mances dans les sports d’endurance,
mais elle peut conduire à un accident
vasculaire grave car elle augmente la
viscosité du sang.
• Les substituts du sang
Dans les années 1970, la pratique de
l’autotransfusion après un séjour en
altitude, qui augmente le nombre de
globules rouges, s’est développée.
De nos jours, des substituts du sang
tels que les hémoglobines modifiées
ou les PFC (perfluorocarbones) per-
mettent de récupérer une quantité
supplémentaire de dioxygène lors-
qu’ils sont injectés dans le sang. Les
dangers (infections, accidents vas-
culaires) sont encore mal connus.
Davantage de muscle
• Les stéroïdes anabolisants
Substances analogues à l’hormone
mâle naturelle, la testostérone, ils
stimulent la croissance musculaire et
l’agressivité, et améliorent la capa-
cité d’entraînement. Le vainqueur du
100 m des jeux de Séoul, en 1988,
fut convaincu de dopage avec un
stéroïde anabolisant. L’ex-RDA dopait
systématiquement ses athlètes de
cette façon.
Les risques de l’usage des stéroïdes
sont très nombreux: problèmes vas-
culaires, cancers...
• L’hormone de croissance (GH)
L’hypophyse sécrète naturellement
la GH. L’hormone de croissance
semi-synthétique est détectable dans
les contrôles depuis 1999. Comme
l’hormone naturelle, elle favorise
le développement musculaire et la
mobilisation des graisses de réserve,
et accélère la réparation des tissus
après une blessure.
Les conséquences néfastes de la prise
de GH sont l’allongement du menton
et des mains, des maladies cardia-
ques, parfois des diabètes.
Aux championnats du monde d’athlétisme d’Edmonton, en 2001, deux athlètes britanniques
protestent contre la gagnante du 5000 m féminin, contrôlée positive à l’EPO: « Dehors, les
tricheurs à l’EPO ».
>
Partie
Introduction
du chapitre
Les questions
qui se posent
Le sommaire
des activités
du chapitre
>
>
Exercice résolu
45
L’organisme en fonctionnement
Solution
> Décrire les variations de la fréquence et du débit cardiaque
avec l’intensité de l’effort chez des individus entraînés
et des individus non entraînés.
> Proposer une explication à la différence de variation
du débit cardiaque entre les individus entraînés
et les individus non entraînés.
> Relier le débit sanguin aux besoins cellulaires.
Développement
Chez l’individu non entraîné et l’individu entraîné, la fréquence
cardiaque et le augmentent régulièrement
lorsque la puissance de l’exercice s’intensifie. Pour l’individu
entraîné, la passe de 80 batmin– 1 au
repos à 140 batmin– 1 pour un effort d’intensité notée 5, et le
débit cardiaque de 5 Lmin– 1 à 25 Lmin– 1.
Sans entraînement, la fréquence cardiaque varie de 90 à
170 batmin– 1 et le débit cardiaque de 5 à 20 Lmin– 1.
fréquence cardiaque
débit cardiaque
Pour un exercice d’intensité donnée, on constate que, chez
l’individu non entraîné,la fréquence cardiaque est supérieure
et le débit cardiaque inférieur à ce que l’on mesure chez un
individu entraîné.
Après l’ , la fréquence cardiaque s’élève moins
vite et le débit cardiaque augmente rapidement avec la
puissance de l’effort. Le débitcardiaque est le volume de sang
qui circule à chaque minute ; il est le produit de la fréquence
cardiaque et du volume d’éjection systolique. Chez l’individu
entraîné, le débit cardiaque augmente alors que la fréquence
diminue ; cela s’explique par une augmentation du
.
L’augmentation du débit sanguin cardiaque permet une
distribution plus importante du nécessaire aux
cellules musculaires pour produire de l’énergie.
dioxygène
d’éjection systolique volume
entraînement
> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène
Exploitation de documents
Entraînement et modifications des performances
>Sujet
<
Dans la pratique d’un sport, l’entraînement permet l’amélioration des performances. Cette amélioration dépend de nom-
breux paramètres physiologiques tels que l’activité cardiaque, l’activité pulmonaire, etc.
Question: à partir de l’exploitation rigoureuse des documents 1 et 2 et de vos connaissances,
montrer comment l’entraînement modifie le fonctionnement cardiaque et expliquer en partie l’amélioration
des performances sportives.
Doc. 1 et 2 Variations de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque en fonction de l’intensité de l’effort
chez des individus avant et après une période d’entraînement.
>
débit cardiaque (L .min–1)
intensité de l’effort
0
repos
12345
10
20
30
40
50
2
1
sans entraînement
avec entraînement
2
1
fréquence cardiaque (bat.min–1)
intensité de l’effort
0
repos 12345
60
80
100
120
140
160
180
2
1
sans entraînement
avec entraînement
2
1
47
L’organisme en fonctionnement
> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène
7.Le travail musculaire et la consommation
de dioxygène
> Objectif : résoudre un problème physiologique à partir
de l’analyse de courbes.
On étudie la variation de la consommation de dioxygène
par un sujet au cours d’un exercice musculaire d’intensité
croissante. On obtient les courbes ci-dessous.
1.À partir de l’étude générale de ces courbes, montrer
comment évolue la consommation de dioxygène au cours
du temps quelle que soit l’intensité de l’exercice.
2.Donner une explication physiologique.
8. La révolution cardiaque
> Objectif : restituer des connaissances à partir de l’étude
d’un document. 1.Légender le schéma.
2.À quelle phase
de la révolution cardiaque
correspond ce schéma ?
Justifier la réponse.
3.Rappeler les
principaux événements
correspondant
à cette phase.
4.Pourquoi dit-on que
la circulation est
orientée ?
9. L’oxygénation du sang
> Objectif : analyser et interpréter les données d’un graphe.
Le graphe ci-après représente les variations de
la concentration en dioxygène d’une artère (CA) et d’une
veine (CV) en fonction d’un effort d’intensité croissante.
1.Comment chacune de ces concentrations varie-t-elle
au cours d’un effort ?
2.Calculer le débit cardiaque au repos et au cours de l’effort
maximal ?
4
1
2
3
5
6
consommation de
dioxygène (L.min–1)puissance
de l’exercice (W)
temps (min)
250
200
150
100
50
012345
1
2
3
4
3.Proposer une explication physiologique rendant compte
des réponses aux questions précédentes.
10.Le cycle cardiaque
> Objectif : utiliser des informations nouvelles.
Lors d’un cycle cardiaque, on enregistre simultanément
les variations des pressions de l’oreillette gauche,
du ventricule gauche et de l’aorte, et les bruits cardiaques.
1.Identifier les événements numérotés de 1 à 4
qui marquent le cycle cardiaque. Justifier la réponse.
2.À partir de la réponse précédente et des enregistrements
des bruits cardiaques, nommer les étapes A,B et C.
0
20
40
60
80
100
120
bruits
cardiaques
pression
(mm de Hg)
A B C
1er 2e
pression
aortique pression
ventriculaire
gauche
pression
auriculaire
gauche
2
3
4
1
concentration en dioxygène (mL par 100 mL de sang)
effort d’intensité croissante
repos
consommation
de dioxygène
(L.min–1)
CA O2
CA O2 - CV O2
CV O2
012345
4
8
12
16
2.
>
>
Exercices
Chapitre
46
Évaluation des acquis
>Voir corrigé, p.267
Restitution organisée
des connaissances
4. L’apport en dioxygène aux organes
Pour permettre le bon fonctionnement de l’organisme,
l’apport en dioxygène aux cellules doit être constant
et adapté aux besoins.
Question : montrer comment l’organisation de la
circulation sanguine,l’organisation du cœur ainsi que
le fonctionnement cardiaque permettent un apport
continu en dioxygène aux organes.
5. Les adaptations cardiorespiratoires
Lors d’un effort physique,le fonctionnement
cardiorespiratoire change; on parle d’adaptation.
Question : dégager les modifications cardiovasculaires
survenant lors d’un effort et montrer en quoi elles
constituent une réponse adaptée à cet effort.
Exploitation de documents
6. Les contractions cardiaques
> Objectif : mobiliser des connaissances.
1. Retrouver la (ou les) bonne(s) réponse(s)
Dans chaque cas, justifier votre choix.
1.La circulation pulmonaire et la circulation générale
sont:
a.disposées en parallèle ;
b. indépendantes l’une de l’autre ;
c.disposées en série.
2.Lors d’une révolution cardiaque :
a.la systole ventriculaire précède la systole auriculaire;
b. la systole ventriculaire du « cœur droit » précède celle
du « cœur gauche » ;
c.la systole ventriculaire éjecte le sang dans
les artères.
3.Les valvules auriculoventriculaires sont ouvertes:
a.lors de la contraction des oreillettes;
b. au cours de la diastole ;
c.lors de la systole ventriculaire.
4.Les valvules artérielles s’ouvrent :
a.lors de la contraction des oreillettes;
b. au cours de la diastole ;
c.lors de la systole ventriculaire.
5.Les artères sont des vaisseaux qui transportent:
a.du sang oxygéné ;
b. du sang appauvri en dioxygène ;
c.du sang des organes vers le cœur.
6.Le sang saturé en dioxygène circule :
a.dans les deux oreillettes ;
b. dans le ventricule gauche ;
c.dans l’artère aorte.
7. Lors d’un effort physique:
a.le débit cardiaque augmente ;
b. la ventilation pulmonaire diminue;
c.l’irrigation de tous les organes est accrue.
2. Définir les expressions et le mot suivants
a.Circulation en série.
b. Circulation en parallèle.
c.Débit cardiaque.
d.Révolution cardiaque.
e.Valvules.
3. Rédiger une phrase en utilisant
les expressions et mots suivants
a.Diastole ; révolution cardiaque ;systole.
b.Ventilation pulmonaire ;effort ; débit cardiaque.
Les deux documents ci-dessus représentent une coupe
du myocarde, obtenue après exploration du cœur
par scintigraphie.
1.Proposer une légende pour et . Justifier la réponse.
2.À quelle(s) phase(s) de la révolution cardiaque correspond
chacun de ces documents ? Justifier la réponse.
3.Préciser ce que devient le sang contenu dans chacune
des cavités.
ba
ab
second temps, de l’ouverture des valvules artérielles.
L’éjection du sang dans les artères aorte et pulmonaire a lieu
à pression constante.
Une fois le sang expulsé, les valvules artérielles se referment
sous l’effet de la pression du sang artériel, empêchant ainsi le
reflux du sang dans les ventricules.
1. La distribution du sang oxygéné
aux organes
La disposition en série des deux circulations, le fonctionne-
ment du cœur et la circulation intracardiaque orientée
concourent à la présence d’un sang saturé en dioxygène lors
de son éjection dans la circulation générale au niveau du
tronc artériel aortique. Ce tronc se ramifie en de nombreuses
artères qui permettent l’irrigation des différents organes.
Ceux-ci (reins, intestin, cerveau,etc.) sont donc, par analogie
avec un montage électrique, disposés en parallèle. Chaque
organe reçoit ainsi une partie du sang saturé en dioxygène
(activité 5)
.
La quantité de dioxygène consommée par les muscles ou
tout autre organe dépend donc de cet apport, mais aussi de
la quantité prélevée. Cette quantité correspond à la diffé-
rence entre la concentration du sang artériel afférent en
dioxygène (CA O
2
) et la concentration du sang veineux
sortant en dioxygène (CVO
2
)
(activité 6)
.
2. Le contrôle local de la circulation
vasculaire
Au cours d’une activité physique, le débit du sang qui arrive
dans chacun des organes au repos est modifié en fonction des
besoins. Les muscles reçoivent une quantité importante de
sang oxygéné, tandis que d’autres organes comme les reins en
reçoivent peu.Seule l’irrigation cérébrale demeure constante.
La circulation vasculaire locale est donc modifiable. Les arté-
rioles sont capables de modifier le flux sanguin arrivant dans
un organe soit en le favorisant par vasodilatation*, soit en le
limitant par vasoconstriction*.
Entourant les capillaires sanguins, de petits muscles ronds,
appelés sphincters,peuvent se contracter ou se relâcher ; leur
contraction exerce une constriction des capillaires et bloque
ainsi la circulation, alors que leur relâchement la permet
(activité 5)
.
L’importance de la surface d’échange entre le sang et les
cellules de l’organe dépend du nombre de capillaires, fermés
ou ouverts, et varie en fonction des besoins. L’adaptation de
cette distribution du sang suppose une coordination fonc-
tionnelle du système vasculaire
(activité 5)
.
3. L’augmentation du débit cardiaque et
de la ventilation pulmonaire
Les besoins accrus au cours d’un effort impliquent une
augmentation de l’approvisionnement et de la distribution
en dioxygène. Cela est permis par l’augmentation du débit
cardiaque* DC (en L
min– 1), qui dépend à la fois de la
fréquence cardiaque* FC (en coup
min– 1 ou bat
min– 1) et
du volume de sang éjecté à chaque systole ou volume
d’éjection systolique VES(en mL
bat– 1)
(activité 4)
.
L’augmentation de la ventilation permet de maintenir dans
les alvéoles un air suffisamment riche en dioxygène pour
assurer la saturation du sang au niveau des poumons malgré
l’augmentation du débit cardiaque et de la différence
artérioveineuse. Il y a donc couplage de l’augmentation des
activités cardiaque et ventilatoire
(activité 6)
.
La période de contraction estsuivie de la diastole générale.Le
myocarde est entièrement relâché. Le sang afflue par les
veines caves dans l’oreillette droite et le ventricule droit, et
par les veines pulmonaires dans l’oreillette gauche et le
ventricule gauche
(activité 3)
.
Circulation générale
Circulation pulmonaire
Cœur
Débit cardiaque
Diastole
Fréquence cardiaque
Myocarde
Révolution cardiaque
Saturation en dioxygène
Systole auriculaire
Systole ventriculaire
Valvules
Vasoconstriction
Vasodilatation
Mots-clés
[
>
43
L’organisme en fonctionnement
> 2. L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène
Les adaptations vasculaire,cardiaque
et respiratoire au cours d’un effort
>
42
expulsé dans les artères pulmonaires vers les poumons.
Le sang circule alors dans les capillaires pulmonaires où il
est saturé en dioxygène*. Le dioxygène, gazeux dans l’air
alvéolaire, se combine avec l’hémoglobine,protéine présente
dans les hématies, sous forme d’oxyhémoglobine
(activité 5)
.
En même temps, le dioxyde de carbone, produit de la respi-
ration cellulaire, passe du sang dans l’air alvéolaire. Ainsi
oxygéné, le sang rejoint le « cœur gauche » par les veines
pulmonaires ; il est éjecté dans l’aorte, rejoignant la circula-
tion générale* qui assure l’apport en dioxygène à tous les
organes.
Par analogie avec un montage électrique,on peut dire que le
cœur et les poumons sont deux organes disposés en série
puisqu’ils reçoivent successivement la totalité du sang cir-
culant
(activités 1 et 5)
.
1. Les appareils circulatoire et respiratoire
L’appareil circulatoire est formé d’un organe moteur, le
cœur*, et de vaisseaux qui constituent un réseau important
permettant l’irrigation de l’ensemble des organes. Le sang
circule dans ces vaisseaux suivant un circuit à double circula-
tion : la circulation générale et la circulation pulmonaire.
L’appareil respiratoire est constitué par les deux poumons et
les voies respiratoires (trachée et bronches). Le réseau des
ramifications à partir des bronches se termine par de petits
sacs, les alvéoles pulmonaires où aboutitl’air
(activité 1)
.
2. La double circulation
Au cours de la circulation pulmonaire*, la totalité du sang,
provenant de la circulation générale par les veines caves et
appauvri en dioxygène, passe par le « cœur droit ». Il est
2. Le fonctionnement ordonné
de la pompe cardiaque
Le cœur a une activité rythmique de 70à 80 battements par
minute au repos.Chaque battement correspond à une pério-
de appelée révolution cardiaque* ou cycle cardiaque*, au
cours de laquelle le myocarde se contracte et se relâche.
Chaque cycle cardiaque présente trois phases :la contraction
des oreillettes ou systole auriculaire*, la contraction des
ventricules ou systole ventriculaire* et la période de repos
général ou diastole* générale. Ces trois événements sont
synchrones pour les deux parties droite et gauche du cœur.
Au cours de la systole auriculaire, les oreillettes, qui se sont
remplies passivement de sang au cours de la diastole, se
contractent et expulsent le sang dans les ventricules en
grande partie remplis en même temps que les oreillettes.Les
valvules auriculoventriculaires sont ouvertes et les valvules
artérielles fermées.
Les ventricules,entièrement remplis, se contractent lors de la
systole entraînant une augmentation de la pression ventri-
culaire. Celle-ci est responsable,dans un premier temps,de la
fermeture des valvules auriculoventriculaires, puis, dans un
1. La circulation orientée dans le cœur
Le cœur est un organe cloisonné formé de quatre cavités :
deux oreillettes et deux ventricules. Chaque oreillette
communique avec un ventricule et l’ensemble constitue une
partie du cœur. La circulation du sang est orientée grâce aux
valvules*.
Les valvules auriculoventriculaires* sont des lamelles mem-
braneuses localisées entre une oreillette etun ventricule.Ces
membranes ou valves,rattachées par des cordons tendineux
à des piliers du myocarde*, ne s’ouvrent que dans le sens
oreillettes ➝ventricules.
Les valvules artérielles ou sigmoïdes, lamelles membra-
neuses en corbeille localisées à la limite des ventricules
et des vaisseaux qui en partent (tronc artériel aortique
et tronc pulmonaire), ne s’ouvrent que dans le sens ventri-
cules ➝vaisseaux.
L’ouverture et la fermeture des valvules dépendent des
pressions qui s’exercent sur elles au cours des
contractions. La fermeture des valvules s’accompagne de
deux bruits perceptibles à l’auscultation au stéthoscope*
(activités 2 et 3)
.
2.
>
>
L’essentiel
Chapitre
La circulation et la respiration,
deux fonctions associées
>
Le rôle du cœur
>
>
>
44
L’activité cardiorespiratoire et l’apport de dioxygène
2.
>
>
Bilan
Chapitre
La disposition en parallèle de la circulation générale (entre le cœur et les organes) et la disposition en série
de la circulation pulmonaire (entre le cœur et les poumons) permettent aux muscles de recevoir du sang
saturé en dioxygène.La circulation cloisonnée et orientée du cœur organise cette distribution.
Au cours d’un effort, les modifications du débit cardiaque et de la ventilation pulmonaire,et la réorganisation
de la distribution sanguine au niveau des capillaires entraînent une oxygénation optimale nécessaire
au fonctionnement musculaire. Lors d’une activité physique,les réponses cardiorespiratoires sont couplées.
Les connaissances essentielles sous forme d’un résumé structuré avec les mots-clés du chapitre et d’un schéma bilan
Des exercices de niveaux variés pour s’entraîner
À la fin de chaque partie, des thèmes d’actualité riches en documents avec des pistes
de recherche et des sources d’information
Des notions déjà
vues dans les classes
ou les chapitres
antérieurs
De nombreux
documents sous
des formes variées
(photographies,
schémas
d’interprétation,
extraits de textes,
etc.)
L’exploitation
des documents
aboutissant à
une question bilan
L’exploitation
des résultats
Un protocole
réalisable
en classe
Les questions
auxquelles
l’activité
se propose
de répondre
Des activités
expérimentales
clairement
identifiées
1
/
1
100%