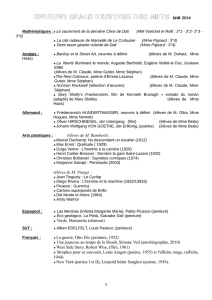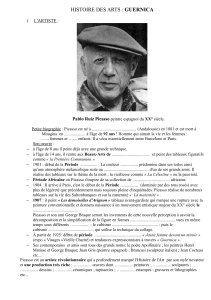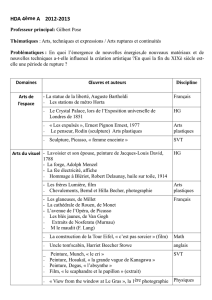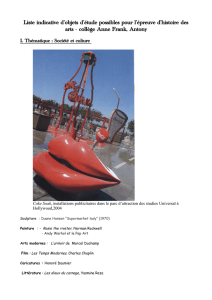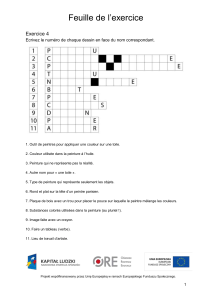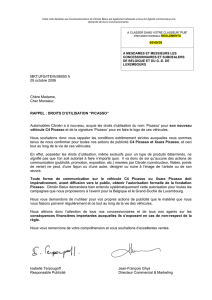Théâtralité dans l`œuvre de Picasso

2
éâtralité
dans l’œuvre de Picasso
Saida Rahal Khamassi
9.42 528864
----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique
[Roman (134x204)]
NB Pages : 108 pages
- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 7.94
----------------------------------------------------------------------------
éâtralité dans l’œuvre de Picasso
Saida Rahal Khamassi

2
2

2
3
Introduction
« La peinture » passe d’une image qui sert pour
visualiser l’aboutissement d’un long et pénible
processus d’érudition et de calculs à une entité active
dans la poïétique. C’est à partir de ce moment décisif,
qu’un discours sur la théâtralité devient possible.
Picasso est fasciné par les acquis que son
prédécesseur classique Vélasquez a réalisé à la peinture
espagnole, notamment le rôle de prospection qu’il
réussit à lui faire attribuer. Il s’agit de la prospection
des autres artifices du scénario de la représentation
classique, qui ne se passe pas sans jeu avec le dispositif
perspectif. Il en finit par déduire que la peinture peut
être l’équivalent ou le substitut de la réalité.
Cet événement inédit, fait la véritable
spectacularité de l’œuvre de Picasso. Ce peintre qui
en épuisant dans l’univers de l’altérité, celle de la
peinture de ses prédécesseurs et celle de la réalité qui
l’entoure, inverse et trans-forme toutes les anciennes
conceptions et options relatives à l’acte de peindre.
Que fait Picasso ou comment procède-t-il pour créer
et pour re-créer l’espace où s’exprime cette
théâtralité ? Cet espace qui d’après ses Ménines, ne

2
4
contient ni « écriture perspectiviste », ni mise en cadre
séparative, cet espace où on ne peut cliver la fiction de
la réalité, ni l’illusion de la vérité ?
Ce qui explique, peut être, l’énigme et l’ambigüité
suscitées par l’œuvre de Picasso, notamment ses
Ménines, cette œuvre, qui tout en gardant « sa charge
mimétique », reflète un grand effort de faire l’écart
avec le « modèle ».
Ce fait, est l’un des principaux « enjeux », qui
constitue le dialogue peinture-réalité, qui est un
dialogue de souche classique. Dans ce dialogue, le
spectateur peut voir et peut sentir une forte présence
de théâtralité.
Mais, est ce que cet enjeu, suffit-il à épuiser l’idée
d’une théâtralité de la peinture ? Ou, faut-il encore
ajouter l’existence d’une manière spécifique de
travailler et de faire la peinture ?
Picasso dit : « Je ne cherche pas », ce qui revient à
dire ; je ne m’efforce pas de trouver des solutions aux
énigmes soulevées par les générations picturales
précédentes. Mais il s’agit plutôt – pour lui – de
trouver toujours de nouvelles énigmes dans et à la
peinture. Ce fait constitue le véritable attrait du
spectacle de la peinture.
Ainsi, Picasso a-t-il réussi à trouver et à nommer
l’énigme des Ménines comme telle ? A-t-il réussi à la
faire dé-tourner en de nouvelles énigmes, pertinentes,
qui peuvent servir la peinture.
Il ajoute « Je trouve », c’est-à-dire je rencontre les
autres, leur peinture et leur « moi » (plastique). Cette
rencontre-dé-couverte, constitue la véritable intention
picassienne. « Trouver », veut dire en latin
« composer », « mettre ensemble ». Quoi ? Sinon la

2
5
subjectivité et l’altérité picturales. La théâtralité, est
donc ce mystérieux et énigmatique procédé qui
permet, de faire co-exister subjectivité et universalité.
Le principe d’universalité sera appliqué au présent
ouvrage, dans le sens de varier les témoins et les
témoignages, pour relever un double défi, celui de
bien définir et celui de bien analyser la théâtralité,
comme étant une notion qui se rattache, autant à
l’esthétique qu’à la poïétique.
A ce niveau, il est peut être judicieux de préciser
que la notion en question dans cet ouvrage, celle de la
théâtralité, n’est pas réduite à un certain parallélisme
ou à une certaine correspondance entre deux formes
d’expression artistique distinctes, à savoir la peinture
et le théâtre. Et ceci, parce que « pour Picasso, la
peinture et le théâtre sont des représentations du réel.
Ils sont autonomes et ils adoptent la même
démarche »1.
La théâtralité a son autonomie par rapport au
« théâtre » proprement dit, et théâtraliser en peinture,
ce n’est pas chercher à obtenir l’effet du cube
scénographique sur les deux dimensions du tableau,
comme c’était le cas dans la tradition picturale de la
Renaissance.
Au contraire, la théâtralité se voit comme un
procédé de « visibilité plastique (…) qui exprime
l’essence et l’autonomie (…) de la peinture vis-à-vis
1 H. Hemaidi, Picasso et le théâtre in Ecriture et peinture au
XXe siècle, Sud Editions, Maisonneuve et Larose, 2004, p222.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%