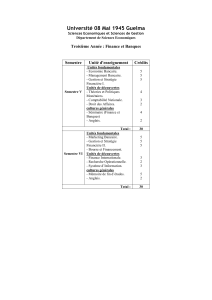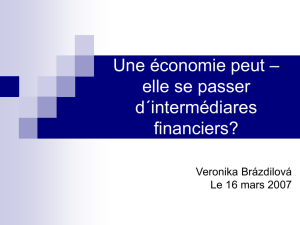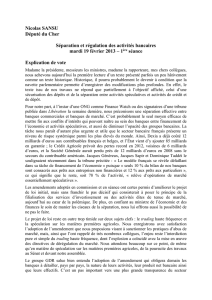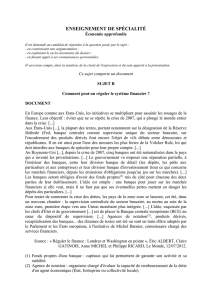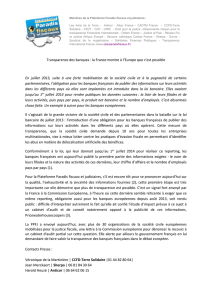Leçons 1 à 9

Index d'articles mis à jour le 02 Fevrier 2014
Les leçons de l'Histoire
➫ § 01. De l’innovation financière pas si novatrice que ça - 02.04.2013
➫ § 02. Les “Trente Demoiselles de Genève” et la Révolution Française - 13.04.2013
➫ § 03. La séparation bancaire (1/3) L’Autre Séparation : la séparation de la banque et
du commerce aux Etats-Unis - 06.05.2013
➫ § 04. La séparation bancaire (2/3) La véritable histoire du Glass-Steagall Act de
1933 - 20.05.2013
➫ § 05. La séparation bancaire (3/3) : Pourquoi l’Europe n’a pas copié le Glass-
Steagall Act - 24.07.2013
➫ § 06. Les leçons de l’histoire VI : la vente à découvert - 06.10.2013
➫ § 07. Les leçons de l’histoire VII - La crise de la tulipe et l’imposition par les élites
d’une interprétation - 15.01.2013
➫ § 08. Les leçons de l’histoire VIII – De l’utilité sociale de la finance - 19.12.2013
➫ § 09. L’actionnaire et le capitaliste. Une réflexion historique sur la gouvernance
d’entreprise - 26.01.2014
➫ § 10.
➫ § 11.
➫ § 12.
➫ § 13.
➫ § 14.
➫ § 15.
➫ § 16.
1

Date de publication: 02 Avril 2013
Par Fabien Hassan, contributeur invité*
§ 01. Leçon I : De l’innovation
financière pas si novatrice que ça
L’œuvre de Joseph de la Vega montre que certaines
caractéristiques "modernes" de la finance, comme les produits
dérivés, les ventes à découvert, et le trading sur compte propre,
étaient déjà courantes au 17ème siècle à Amsterdam.
Joseph de la Vega (1650-1692) est un Juif portugais dont la famille a immigré à
Amsterdam pour fuir l’Inquisition en Espagne et au Portugal. A la fois banquier,
homme d’affaires, et écrivain, il publie en 1688 Confusion de Confusiones, en
espagnol. Ce livre est un dialogue est en quatre parties, entre un philosophe,
un marchand, et un actionnaire.
Malgré un style incertain et parfois peu clair,
Confusion de Confusiones demeure un pilier
majeur de l’histoire financière ; car ce livre
constitue la première description précise d’un
marché boursier. Pour le lecteur du 21ème siècle, certaines parties
du récit sont étrangement familières.
Quelques éléments de contexte sont importants pour comprendre le
marché boursier d’Amsterdam à l’époque. Les actions de la
Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Vereenigde Oost-
Indische Compagnie, ou VOC) constituent le principal actif échangé.
Crée en 1602, la VOC disposait d’un monopole national sur le
commerce colonial en Asie. Dans une moindre mesure, les actions
de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales sont aussi
échangées.
En 1688, les produits dérivés existaient déjà depuis longtemps sur
des biens comme les épices et les céréales. Mais les actions étaient
des produits relativement nouveaux. La valeur unitaire d’une action de la VOC était très élevée
(17 000 florins en 1688), ce qui constitue une incitation à développer des produits dérivés afin de
limiter les risques, ou de proposer des produits plus abordables. L’incitation a bien fonctionné. Dans
2
Cet article est le premier d’une série intitulée “Les leçons de
l’histoire”, qui vise à fournir des éléments de contexte historique
aux problématiques financières aujourd’hui.

l’introduction de l’édition américaine des dialogues, H. Kellenbenz explique que : "En quelques
décennies, les Néerlandais, aidés peut-être par des membres de la ‘nation portugaise’, ont réussi à
concevoir des procédures et des stratagèmes que les opérateurs modernes n’ont quasiment pas pu
améliorer". En d’autres termes, les principaux contrats financiers d’aujourd’hui existaient déjà dans
l’Amsterdam des années 1680 : contrats à terme, options, appels de marge…
De la Vega distingue trois catégories d’investisseurs : les "princes des affaires", les "marchands" et
les "spéculateurs". Il affirme que le marché est devenu un "jeu" parce que les spéculateurs y
occupent une part trop importante. Il aurait pu dire cela des marchés dérivés sur les matières
premières d’aujourd’hui, où ce même constat a provoqué des campagnes contre la spéculation sur
les produits alimentaires. Finance Watch fait partie de ceux qui ont appelé à limiter les excès de la
spéculation sur les marchés de matières premières (voir page 38 du rapport “Investing not betting”,
en anglais).
Increasing market share of commodity speculators
Sur la régulation, De la Vega nous raconte une histoire déconcertante. Frédéric-Henri d'Orange-
Nassau, qui régna sur la Hollande jusqu’en 1647, avait interdit les ventes à découvert. Pour mettre
en œuvre cette mesure, il a autorisé les acheteurs à "implorer Frédéric", i.e. à répudier le contrat.
D’après de la Vega, cela a en réalité renforcé la spéculation parce qu’il était possible de spéculer en
utilisant des ventes à découvert, et ensuite de refuser de payer en cas d’imprévu. Les ventes à
découvert sont mieux organisées de nos jours, mais restent controversées, et suscitent de nouvelles
règles, la dernière en 2012.
La complexité du marché se reflète dans celle du vocabulaire : "J’ai réellement cru que j’étais à la
construction de la Tour de Babel quand j’ai entendu le désordre des langues et le mélange des
langages sur le marché boursier", écrit de la Vega (Dialogue II).
Le dialogue IV est la description d’un stratagème en douze étapes, d’une subtilité fascinante, conçu
par des groupes de spéculateurs pour faire plonger le prix des actions. Les conflits d’intérêt des
courtiers en bourse sont parfaitement expliqués : "le courtier en question faisait des affaires pour son
propre compte […]. S’il reçoit un ordre, dont l’exécution le mène dans la direction inverse de ses
propres transactions, son cœur se met à trembler […], et à moins qu’il ne soit… habile pour échapper
au danger… il périt fébrilement et meurt tel un fou". Le langage est un peu plus fleuri que celui que
vous trouverez dans la Règle Volcker, (une mesure américaine destinée à interdire le trading sur
3

compte propre dans les grandes banques américaines), ou dans les recommandations de Finance
Watch, mais les problèmes sont fondamentalement les mêmes.
De la Vega explique aussi comment le manque de transparence permet aux spéculateurs de
manipuler les prix et favorise la diffusion de rumeurs. Le scandale du LIBOR semble bien avoir des
ancêtres.
Ne vous y trompez pas : il y a bien eu de l’innovation financière au cours de l’histoire, mais
l’explosion récente du secteur financier est avant tout due à la dérégulation, et non à l’innovation.
Pour en savoir plus :
➤ Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones, 1688, Portions Descriptive of the Amsterdam
Stock Exchange, Baker Library, Harvard Graduate School of Business Administration, 1957,
introduction by Hermann Kellenbenz (en anglais)
retour à l'index
Date de publication: 13 April 2013
Par Fabien Hassan, contributeur invité
§ 02. Leçon II : Les “Trente
Demoiselles de Genève” et la
Révolution Française
Quel est le point commun entre la crise financière, la Révolution
Française, et les enfants de la bourgeoisie suisse du 18ème
siècle ? En un mot, la titrisation.
4
* Fabien est élève à l’Ecole Normale Supérieure, Paris, actuellement en échange
à l’Université de Princeton, aux USA. Il a effectué un stage chez Finance Watch à
l’automne 2012. Il possède aussi son propre blog sur le site du
magazine Alternatives Economiques.

Une des principales causes de la Révolution Française réside
dans une crise de la dette publique. La France du 18'eme siècle,
contrairement à l’Angleterre, n’a jamais réussi à équilibrer ses
finances, ce qui l’a poussé à faire défaut à plusieurs reprises.
En 1789, Louis XVI, qui s’était engagé à ne jamais faire défaut,
choisit de convoquer les Etats Généraux pour trouver de nouvelles
ressources. C’est le début de la Révolution.
L’ancienne méthode de financement du déficit public
C’est alors qu’entrent en scène les petites filles de la bourgeoisie suisse. Comment ? La forme de
dette publique la plus courante à l’époque est la rente viagère. Le souscripteur verse une somme fixe
à l’Etat, en échange de quoi il reçoit un certain pourcentage de cette somme chaque année jusqu’à
sa mort. Je prête 100 à l’Etat en 1700, et je reçois 10 jusqu’à ma mort. Vers 1690 déjà, le taux versé
au rentier dépend de son âge. Plus la personne est âgée lors de la souscription, plus elle reçoit
chaque année, ce qui permet d’équilibrer les revenus sur une vie. Pour l’Etat, peu importe donc que
le souscripteur soit jeune ou âgé, le coût est à peu près le même.
Pour différentes raisons, encore discutées aujourd’hui, le gouvernement français a choisi de revenir à
la technique plus sommaire des rentes “à taux fixe” autour de 1760. Cela signifie que quel soit l’âge
du souscripteur, il percevra la même somme chaque année jusqu’à la fin de sa vie. Au départ, cela
n’a pas posé de problème parce que les souscripteurs étaient en général des adultes, et que le taux
fixe était calculé pour correspondre à l’ancien taux d’un emprunteur de 50 ans environ.
Failles juridiques et astuces
Mais en 1771, des banques genevoises se sont rendu compte qu’aucune règle n’imposait de prendre
une rente en son nom. Pour toucher son argent, il fallait prouver que l’on était en vie. Or les
certificats de vie étaient coûteux, et beaucoup de gens choisissaient plutôt de souscrire une rente
dont la durée de vie était celle d’une personnalité célèbre. Lors de son exécution en 1793, 400 000£
de rentes reposaient sur la vie de Louis XVI. Exploitant la faille, les banques ont donc sélectionnée
des jeunes filles de 4 à 7 ans (la plupart des maladies infantiles surviennent entre 0 et 3 ans, donc
l’espérance de vie d’un enfant est supérieure à celle d’un nouveau-né), et placé les rentes en leurs
noms. On leur payait même un suivi médical… Marc Cramer raconte que quand des garçons étaient
choisis, “on alla jusqu'à leur offrir de petites pensions, en échange de l'engagement qu'ils prenaient
de ne pas quitter le pays et de ne pas embrasser des carrières, jugées dangereuses, comme le
service étranger”. Rien de tel que le calme des montagnes suisses pour préserver la santé…
La titrisation
Habiles, les banquiers suisses ont poussé le mécanisme encore plus loin : “pour diminuer le risque
de pertes par accident, le banquier choisissait un certain nombre de "têtes", 30, 50, 60 (le plus
souvent 30, d'où le nom d'Emprunt des 30 têtes genevoises)”. Les rentes étaient regroupées dans un
seul package financier, dont les parts étaient ensuite proposées aux clients. Cela vous rappelle
quelque chose ? C’est le même mécanisme que la titrisation des prêts immobiliers**, une technique
soi-disant révolutionnaire qui fut à l’origine de la crise des subprimes. Mais nous allons voir que c’est
dans l’autre sens du mot que la technique fut révolutionnaire.
Les rentes étaient réunies dans un fonds, puis les parts de ce fonds étaient mises en vente. Ainsi, si
un enfant décède, le risque est limité, parce que les autres annuités continuent de rapporter. Les
actionnaires du fonds touchent donc de toute façon de l’argent. Le profit est assuré, du moins en
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%