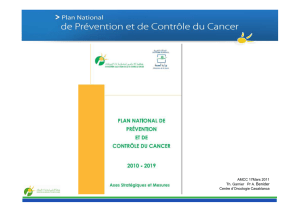LES SOINS PALLIATIFS DANS LE CADRE DES SOINS

LES SOINS PALLIATIFS DANS LE
CADRE DES SOINS STATIONNAIRES
DE LONGUE DURÉE
PRISE DE POSITION DE CURAVIVA SUISSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
LA STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS

L’association CURAVIVA couvre les trois domaines spécialisés suivants:
• «Personnes âgées» (env. 1600 EMS accueillant quelque 80 000 résidents),
• «adultes avec handicaps» (360 homes proposant env. 10 000 places) et
• «enfants et adolescents avec des besoins spécifiques»
(280 homes offrant quelque 7000 places).
CURAVIVA Suisse s’investit dans la politique sociale et sanitaire afin d’offrir des conditions
de vie agréables et dignes aux résidents des homes. Dans le cadre de la Stratégie nationale
en matière de soins palliatifs, CURAVIVA Suisse s’engage en faveur d’une offre de soins
de premier recours compétente sur tout le territoire en matière de soins hospitaliers de
longue durée. Cela englobe les homes pour personnes âgées ainsi que les institutions
accueillant des patients souffrant de handicaps physiques, mentaux ou multiples. Les en-
fants et adolescents qui ont besoin de soins palliatifs sont généralement pris en charge
par des services spécialisés. Ils ne sont pas pris en compte explicitement dans ce document.
La présente prise de position a pour but de présenter les formes spécifiques de soins pallia-
tifs dans les services de soins stationnaires de longue durée. Elle donnera lieu à des pré-
occupations et des exigences concernant les conditions-cadres et la mise en œuvre des
soins palliatifs dans les homes et institutions sociales. La prise de position se réfère aux
Directives nationales concernant les soins palliatifs 1, adoptées le 21 octobre 2010 par le Dia-
logue de la politique nationale de la santé (OFSP et CDS). L’extension et la promotion des
soins de premier recours dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins pallia-
tifs constituent une préoccupation importante. Il est nécessaire d’agir tant au niveau des
compétences professionnelles que de la prise en charge financière des prestations fournies.
1 Source. Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Publications fédérales, CH-3003 Berne;
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html?, numéro d’article: 316.716.d
INTRODUCTION

LA FIN DE VIE DANS LES HOMES
Comme le montrent les statistiques depuis plusieurs décennies, un nombre croissant de
personnes meurt dans les hôpitaux et les homes, et non plus à la maison 1. Entre 1969 et
2001, le nombre de personnes décédées chez elles est passé de 38 % à 23 %, tandis que celui
des résidents d’EMS est passé de 6 % à 34 %. Durant la même période, le nombre des
patients qui meurent à l’hôpital – toutes tranches d’âge confondues – a reculé de 56 % à
37 %. Il est très probable que cette tendance sera amplifiée par la mise en place à l’échelle
nationale du système d’indemnisation selon des forfaits par cas homogènes liés au diagnos-
tic (DRG)
à compter de 2012. Si l’on considère séparément les décès de personnes âgées,
la situation se complique. Selon les informations communiquées actuellement par l’Office
fédéral de la statistique 2, en 2007, seuls 15 % des plus de 75 ans et à peine 5 % des plus de
90 ans sont morts à la maison. En conséquence, 51 % des personnes de 75 ans et 75 % des
plus de 90 ans passent la dernière phase de leur vie dans un EMS et, généralement, y dé-
cèdent. Dans les hôpitaux, ce chiffre était de 20 %.
Cette situation tient à plusieurs raisons. Les avancées de notre société et le développement
de la médecine ont contribué à allonger l’espérance de vie. La mort n’intervient plus de
façon inattendue au cours des diverses phases de la vie, mais de plus en plus à un âge avancé,
comme le constate la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs
3
. Souvent, la si tu a -
tion
des personnes très âgées se caractérise par des pathologies et handicaps divers (multi-
morbidité). Cela entraîne chez de nombreuses personnes en fin de vie une plus grande
fragilité et des besoins en soins accrus sur le long terme.
Ces soins et cet accompagnement intensifs dépassent souvent les possibilités des services
(ambulatoires) d’aide et de soins à domicile. De plus, compte tenu des évolutions socié-
tales et démographiques, telles que l’activité professionnelle des femmes et des hommes,
les familles de petite taille, recomposées ou monoparentales, mais aussi de la mobilité
professionnelle croissante, il arrive souvent que le réseau d’entraide familial et de voisinage
disparaisse. La situation se complique lorsque les aînés vivent seuls. Ainsi, nombre de
1 Cf. Fischer, Susanne Bosshard, Georg/Zellweger, Ueli/Faisst, Karin: Der Sterbeort: «Wo sterben die Menschen heute in
der Schweiz?» in: Z Gerontol Geriat 37 (2004) 467-474
2 Selon la communiqué de presse OFS Nr. 0350-0910-10 du 17 septembre 2009
3 Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012/Version abrégée, p. 3
personnes âgées ne peuvent plus être soignées à la maison durant la dernière phase de
leur
vie 4. Elles ont besoin de soins complets, continus et de qualité, ainsi que d’un environ-
nement social tels que ceux proposés par les EMS.
On observe une tendance similaire chez les personnes handicapées. Grâce à des conditions
de vie favorables et au progrès médical, elles aussi atteignent un âge avancé. Et elles ne
sont pas non plus à l’abri de maladies chroniques graves et incurables en fin de vie. Aussi,
de plus en plus de homes pour personnes handicapées ont intégré dans leurs équipes du
personnel soignant spécialisé et/ou mis en place des services de soins spécialisés. Il convient
en particulier de veiller à que ces personnes puissent rester dans leur environnement ha-
bituel, même lorsqu’elles ont besoin de soins.
En dépit de l’extension régulière de l’offre de soins, en particulier dans le secteur ambu-
latoire, nombre de personnes âgées et handicapées sont tributaires d’une prise en charge
dans des institutions de soins de longue durée. Cette situation s’aggravera du fait de
l’évolution démographique. L’Office fédéral de la statistique enregistre aujourd’hui près de
60 000 décès par an et s’attend à ce que ce chiffre avoisine 90 000 décès par an d’ici
2050 5.
4 L’OFSP définit la « dernière phase de vie » comme un intervalle de temps de deux ans à six mois avant le décès;
cf. Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012/Version abrégée, p. 3.
5 Cf. Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012/Version abrégée, p. 3

LES SOINS PALLIATIFS DANS LE CADRE DES
SOINS DE LONGUE DURÉE
Les soins palliatifs, la prise en charge complète et l’accompagnement des résidents en fin
de vie, ainsi que de leurs proches et personnes de référence, prennent donc une impor-
tance croissante dans les homes pour personnes âgées et pour handicapés. Dans le même
temps, il faut remarquer que les EMS assument d’autres tâches en plus des soins pallia-
tifs, dans le cadre de la prise en charge gériatrique et sociopédagogique, par exemple la ré-
habilitation, la prise en charge de la démence, l’organisation de l’environnement de vie,
l’assistance pour les actes du quotidien. Ces tâches élémentaires jouent également un rôle
important dans les institutions pour handicapés.
Dans les soins stationnaires de longue durée, les soins palliatifs entrent en ligne de compte
lorsque, en cas de maladie chronique évolutive, l’objectif thérapeutique des mesures d’ac-
compagnement vise à atténuer les symptômes. On recourt plus particulièrement aux soins
palliatifs lorsque la personne est en fin de vie. Les possibilités palliatives sont prioritaire-
ment utilisées pour traiter et prendre en charge les résidents en l’EMS de façon à éviter un
transfert à l’hôpital.
Le traitement et l’accompagnement palliatifs des résidents dans les EMS soulèvent actuel-
lement plusieurs grands défis supplémentaires:
PLURALITÉ DES SITUATIONS DE SOINS
Actuellement, les institutions de soins de longue durée accueillent en même temps des
personnes ayant des tableaux cliniques très divers et présentant des limitations physiques,
psychiques et mentales très variées. Cela englobe notamment des personnes atteintes
de maladies graves et/ou chroniques évolutives et incurables, des personnes plus jeunes
souffrant de cancer ou de maladies neurologiques graves, des patients atteints de dé-
mence, présentant des troubles physiques et/ou psychiatriques, voire des personnes ayant
des handicaps physiques et/ou mentaux. Chaque type de patient a des besoins spéci-
fiques en matière de soins et d’accompagnement 1, et il requiert souvent des soins palliatifs
spécifiquement adaptés à sa situation.
1 Les Directives nationales concernant les soins paliatifs précisent à la p.4 que les soins palliatifs comprennent
les traitements médicaux et les soins; le terme «accompagnement» englobe le soutien psychologique, social ou spi-
rituel.
UNE QUALITÉ DE VIE INDIVIDUELLE ÉLEVÉE EN FIN DE VIE
Toutes ces personnes devraient pouvoir bénéficier d’une qualité de vie la plus élevée
possible
en matière physique, psychosociale, culturelle et spirituelle, grâce à des soins pal-
liatifs
et à un accompagnement de fin de vie de haut niveau. Cela exige en particulier de
prendre au sérieux les besoins psychiques, sociaux, culturels et spirituels, mais aussi de
créer un environnement individualisé qui corresponde à la personne en fin de vie. Dans
les institutions de soins de longue durée également, les résidents doivent bénéficier de
conditions leur permettant de mourir dans la dignité.
Il est par ailleurs important de maintenir le contact avec les proches et les personnes de
référence qui jouent un rôle important pour le résident. Celles-ci devraient pouvoir assumer
pleinement un rôle d’accompagnement, en particulier durant la phase finale. En même
temps, ces gens ont eux aussi besoin de pouvoir bénéficier assez tôt de l’attention, des
conseils et de l’accompagnement requis.
DURÉE DE SÉJOUR COURTE
Souvent, les personnes d’un âge avancé ne sont admises dans un hôpital ou un EMS que
lorsqu’elles exigent beaucoup de soins ou après un séjour à l’hôpital. Dès lors, leur séjour
dans un home est très court et ne dure souvent que quelques semaines ou mois. Le per-
sonnel soignant doit alors se familiariser en très peu de temps et de façon plus intense
avec la situation de vie actuelle du résident, avec ses habitudes et ses besoins. Cette courte
durée de séjour a pour corollaire un nombre accru de décès chaque année. De ce fait, les
soignants sont confrontés en peu de temps à de nombreuses situations de fin de vie. Même
si l’accompagnement de ces résidents suppose des compétences professionnelles avérées,
la prise en charge de patients en phase terminale représente un fardeau supplémentaire.
Les institutions et le personnel d’encadrement doivent donc veiller à ce que le personnel
soignant ne soit pas dépassé par ses responsabilités, et ainsi à éviter le burn-out.

LE CADRE DANS LEQUEL S’INSCRIT
LA STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE
DE SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs de premier recours dans les soins de longue durée, tels que les con-
çoit
CURAVIVA Suisse, s’inspire des Directives nationales concernant les soins palliatifs. Se-
lon ce document de fond, les personnes souffrant de maladies incurables, potentielle-
ment mor
telles et/ou chroniques évolutives prises en charge dans des institutions de soins
de longue
durée appartiennent à la catégorie de patient A. Les prestations dont elles
font l’objet doivent être imputées sur les soins de premier recours. Elles représentent la
plus grande partie des personnes exigeant des soins palliatifs. En général, la complexité
de leur traitement et de leur prise en charge est stable. Mais cela n’implique pas qu’elles
exigent moins de soins et de temps!
Source: Stratégie nationale en matière de soins palliatifs, page 15, OFSP, Berne 2010
Toutefois, certains patients appartenant au groupe A ont besoin par moment de soins
palliatifs spécialisés supplémentaires, par exemple en cas d’évolution de la maladie par
poussée, d’augmentation des symptômes ou lors de phases prolongées d’instabilité.
En conséquence, la transition entre les groupes de patients A et B est floue. En d’autres
termes, une personne appartenant au groupe A peut bénéficier de soins palliatifs dans le
cadre des soins de premier recours, à la condition toutefois que l’ensemble du personnel
soignant de l’établissement dispose des compétences de bases requises en matière de soins
palliatifs. En cas de phase d’instabilité ou d’évolution complexe de la maladie, il est né-
cessaire de recourir ponctuellement à des soins palliatifs spécialisés. Les solutions envisa-
geables sont soit le transfert du patient dans une unité spécialisée de soins palliatifs,
soit l’intervention d’une équipe de soins palliatifs ambulatoire chargée de seconder le per-
sonnel de soins et d’accompagnement. L’accès aux soins palliatifs spécialisés est soumis
à des critères d’indication précis, qui seront définis dans le cadre des différents domaines
s’inscrivant dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale.
Il est préférable de ne pas transférer les personnes âgées vivant en EMS dans une autre
institution ; dans ces cas, les homes ont surtout besoin du soutien de personnes spécialisées
en soins palliatifs dans l’institution même. Des professionnels appartenant à des équipes
mobiles spécialisées soutiennent alors le personnel soignant de façon ponctuelle ou dans
le cadre d’une coopération régulière. Dans le même temps, le personnel soignant de l’EMS
est formé de façon à pouvoir dispenser durablement et de façon autonome des soins pal-
liatifs complexes.
Soins palliatifs spécialisés
nécessaires selon les phases
B.
Patients
recevant des
soins palliatifs
spécialisés
A. Patients recevant des soins
palliatifs de premier recours
Diminution du nombre de personnes concernées
Complexité croissante du traitement et des mesures de soutien
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%