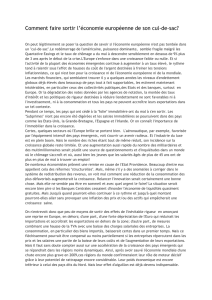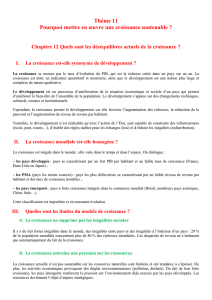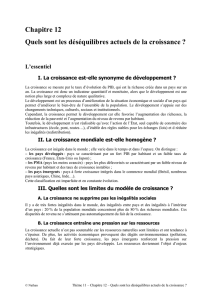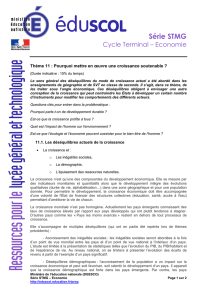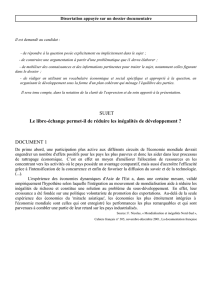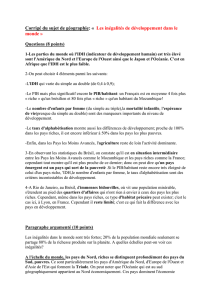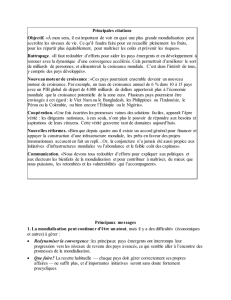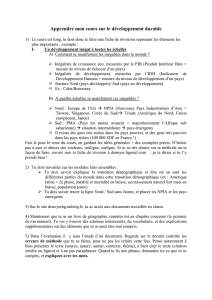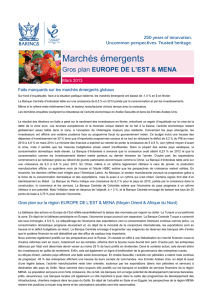Le développement, la crise et la mondialisation

1
Le développement, la crise et la mondialisation
Michel Husson
La première décennie du XXIème siècle a été marquée par un phénomène
frappant : les trajectoires économiques des pays avancés et du reste du
monde se sont mises à diverger, alors qu’elles étaient jusque là
relativement parallèles. C’est le point de départ de ce chapitre qui cherche
ensuite à analyser ce phénomène autour de trois questions : quels sont les
effets sociaux de ce grand basculement opéré par la mondialisation ?
Quelles sont les inflexions apportées par la crise ? A quelles conditions le
développement est-il compatible avec les contraintes environnementales ?
Le grand basculement du monde
Entre 2000 et 2013, la croissance des pays avancés a été de 1,6 % par an et 6,1 % pour le
reste du monde. L’écart se resserre si l’on raisonne en PIB par tête, mais il reste
considérable : 1,0 % dans les pays avancés contre 4,7 % dans le reste du monde. Ces
données reposent sur un certain nombre de conventions quant à la mesure des taux de change
et à la définition des zones de l’économie mondiale, mais elles suffisent à mettre en lumière
ce fait inédit : désormais les gains de croissance - et de productivité- se font au Sud et
s’épuisent au Nord.
La même divergence peut être observée sur la seule production industrielle : au cours de la
dernière décennie, l’intégralité de sa progression au niveau mondial a été réalisées dans les
pays émergents (Graphique 1). Elle a doublé en Asie. Les pays de l’Europe continentale et
orientale (PECO) font presque aussi bien au moins jusqu’à la crise, tandis que l’Amérique
latine, l’Afrique et le Moyen-Orient profitent aussi de cette tendance, mais dans une moindre
mesure. Ce mouvement d’ensemble conduit à ce fait historique : en 2012, les pays émergents
réalisent la moitié des exportations industrielles mondiales, alors que leur part n’était que de
30 % au début des années 1990.
Ce grand basculement a été confirmé par la crise qui aura aussi servi de révélateur. Dans un
premier temps, la thèse du « découplage » avait été avancée, selon laquelle le dynamisme
des pays émergents permettrait d’amortir le choc récessif. C'était prendre conscience de leur
rôle moteur dans la croissance mondiale, mais aussi sous-estimer leur dépendance à l’égard
des débouchés fournis par les pays avancés. En réalité, la croissance a reculé de manière
comparable dans les deux groupes de pays, parce qu’il existe entre eux une forte
synchronisation des évolutions cycliques (Kemal Dervis, 2012). Leur différentiel de
croissance a permis aux pays émergents, pris dans leur ensemble, d’éviter la récession mais
plusieurs grands pays comme le Brésil et l’Afrique du Sud n’y ont pas échappé.
Chapitre 5 de Enjeux et défis du développement international, sous la direction de Pierre Beaudet et Paul
Haslam, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2014

2
Graphique 1
La production industrielle mondiale
Base 100 en 2000. Source : CPB.
La sortie du creux s’est faite de manière parallèle dans les deux groupes de pays, confirmant
les écarts de croissance antérieurs. Autrement dit, le dynamisme des pays émergents reste
actuellement le moteur de l’économie mondiale mais il dépend réciproquement du
dynamisme des pays du centre.
Des transformations aussi profondes ont conduit à faire évoluer la terminologie : le monde
était traditionnellement divisé entre pays développés ou avancés, d'un côté, et pays en
développement de l'autre. Parmi ces derniers, on s’est mis à distinguer les pays
« émergents », pour désigner les plus performants. C’est un économiste de Goldman Sachs
qui a inventé le terme de BRIC pour désigner l’ensemble formé par le Brésil, la Russie,
l’Inde et la Chine auxquels on ajoute l’Afrique du Sud. Les experts de cette même banque
ont ensuite identifié le groupe des onze prochains émergents (Next Eleven ou N-11) qui
rassemble les pays suivants : Bangladesh, Corée du Sud, Égypte, Indonésie, Iran, Mexique,
Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie et Viêt Nam.
Le retournement s’amorce durant les années 1990, mais c’est dans la première décennie du
XXIème siècle que le mouvement prend toute son ampleur : entre 2000 et 2010, la part des
pays avancés dans le PIB mondial baisse de 77,8 % à 64,5 % et celle des BRIC augmente
spectaculairement, passant de 8,3 % à 18,2 %.
Ces chiffres sont réellement impressionnants mais leurs effets doivent d’abord être
relativisés en prenant en compte les écarts de niveaux de vie. Les pays en développement
partent en effet de très loin : en 2010, le Pib par tête moyen dans les BRIC représente 12 %
de celui des pays avancés, une proportion nettement moins élevée que pour les autres pays
en développement (28 %). Autrement dit, les pays émergents, et notamment les BRIC, sont
parmi les plus pauvres de la planète. Compte tenu des tendances démographiques, le niveau
de vie moyen resterait largement inférieur à celui des pays avancés à horizon de 10 ans.
Même à l’horizon 2050, le niveau de vie moyen dans l’ensemble des pays émergents
resterait au mieux inférieur de moitié à celui des pays avancés.

3
Cette description d’ensemble masque des évolutions beaucoup plus différenciés. Il faudrait
plutôt parler d’un monde à quatre vitesses (Four Speed World), comme l’avait suggéré
l’ancien président de la Banque mondiale, James Wolfensohn (2004) qui proposait de
distinguer deux autres groupes de pays. Il y a d’abord les « pays à la traîne » qui « ont connu
des poussées de croissance, mais aussi des périodes de déclin ou de stagnation, surtout une
fois qu'ils atteignent le statut de pays à revenu intermédiaire » (James Wolfensohn, 2004). Il
s’agit notamment de l’Amérique latine et du Moyen-Orient, soit un cinquième de la
population mondiale. Viennent ensuite les pays « laissés pour compte » dont les revenus
stagnent ou baissent. Ce dernier groupe de pays principalement situés en Afrique sub-
saharienne correspond au « milliard du bas », pour reprendre le titre du livre de Paul Collier
(2007). Ils ont, toujours selon Wolfensohn, « peu bénéficié de la mondialisation, et sont
parmi les plus vulnérables à ses effets délétères, tels que le changement climatique et le
renchérissement des produits de base. »
Encadré
Une nouvelle cartographie du monde
Au début du XIXe siècle, il était possible d’analyser les relations internationales à partir de cette
grille de lecture : un pays, un capital, un État, une monnaie, etc. Aujourd’hui, cette équation a perdu
en grande partie de sa validité. A partir du moment où une firme multinationale peut potentiellement
produire dans n’importe quel pays et vendre dans d’autres pays, le lien entre l’exploitation de la force
de travail et les débouchés est distendu : dans la plupart des pays émergents, les salariés n’ont pas les
moyens d’acheter ce qu’ils produisent. Il y a près de 100 ans, Vladimir Ilitch Lénine faisait de
l’exportation des capitaux l’un des éléments de sa définition de l’impérialisme Aujourd’hui, les États-
Unis sont un importateur massif de capitaux.
Ces mutations remettent en cause la validité des théories classiques de l’impérialisme et du sous-
développement qui reposaient toutes sur l’idée d’une asymétrie entre pays dominants et pays
dominés : le « Nord » prospérait aux dépens du « Sud » et, en tout cas, entravait son développement
(Pierre Jalée, 1965 ; Samir Amin, 1970 ; Theotonio Dos Santos, 1970 ; André Gunder Frank, 1972).
La nouveauté est donc qu’un groupe de pays rompt avec cette situation de stricte dépendance. La
mondialisation a ainsi fait éclater le découpage du monde entre pays développés, Tiers-Monde et
« bloc socialiste » et l’a remplacé par une structure hiérarchisée en fonction de l’internationalisation
du capital. Il faut donc dépasser la représentation de l’économie mondiale comme une simple
juxtaposition d’économies nationales et la remplacer par un concept d’économie mondiale intégrée
dont la structuration est de plus en plus dissociée de la cartographie des États.
Cette nouvelle mondialisation n’est pas née par génération spontanée. Pour qu’elle puisse émerger, il
a fallu faire disparaître tout ce qui contenait l’internationalisation du capital dans certaines limites. Le
modèle de développement de beaucoup de pays du Sud, notamment en Amérique latine, combinait
une certaine dose de protectionnisme régulateur et un appel contrôlé aux capitaux étrangers. Ce
modèle dit de substitution d’importations, qui commençait à buter sur ses limites, a été percuté par la
crise de la dette provoquée par la hausse unilatérale des taux d’intérêt en 1979. On a alors imposé aux
pays concernés des plans d’ajustement structurel qui avaient tous en commun d’imposer une levée
des mesures d’encadrement des capitaux étrangers et la réorientation de l’appareil productif vers les
exportations.
L’étape suivante a été l’institutionnalisation de l’absence de règles à travers la création de l’OMC
(Organisation Mondiale du Commerce) dont la tâche essentielle est au fond d’organiser la libre
circulation des capitaux. Son effet majeur est la mise en concurrence directe des salariés à travers le
monde et la formation d’une « classe ouvrière mondiale. »

4
La formation d’une classe ouvrière mondiale
Durant les années 1990, un phénomène décisif s’est produit avec l’entrée sur le marché
mondial de la Chine, de l’Inde et de l’ancien bloc soviétique, qui a conduit à un doublement
de la force de travail confrontée à la concurrence sur le marché mondial (Richard Freeman,
2005). Ce doublement s’accompagne d’une baisse de plus de moitié du capital par tête qui
représente une contribution positive à la rentabilité potentielle. On retrouve le même type de
résultat sur la seule industrie manufacturière : entre 1980 et 2005, la main-d’œuvre
industrielle a augmenté de 120 % dans les pays en développement, mais baissé de 19 % dans
les pays développés (John Smith, 2011). Ce constat a été récemment confirmé par une étude
du FMI (2013) qui calcule la force de travail dans les secteurs exportateurs de chaque pays.
Là encore, la divergence est flagrante : entre 1990 et 2010, la force de travail globale ainsi
calculée a augmenté de 190 % dans les pays en développement, contre 46 % dans les pays
avancés.
La mondialisation conduit donc tendanciellement à la formation d’un marché mondial et
aussi à celle d’une classe ouvrière mondiale. Cette dernière est extraordinairement
segmentée, en raison de d’écarts de salaire considérables, mais sa mobilité est limitée alors
que les capitaux ont obtenu une liberté de circulation à peu près totale. Dans ces conditions,
la mondialisation a pour effet de mettre potentiellement en concurrence les travailleurs de
tous les pays. Cette pression concurrentielle s’exerce aussi bien sur les salariés des pays
avancés que sur ceux des pays émergents et se traduit par une baisse tendancielle de la part
des salaires dans le revenu mondial (Graphique 2).
Graphique 2
Part des salaires dans le revenu mondial 1970-2010
En % du PIB. Calculs propres à partir de Stockhammer, 2013. Moyenne des pays suivants :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède.
Argentine, Brésil, Chili, Chine, Costa Rica, Kenya, Mexique, Namibie,
Oman, Panama, Pérou, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Thaïlande,
Turquie.

5
Les effets sociaux de la mondialisation
Les institutions internationales insistent sur le recul de la pauvreté absolue, définie le fait de
vivre avec un pouvoir d’achat inférieur à 1,25 dollar par jour (aux prix de 2005). Plus
concrètement, « les personnes qui se trouvent en dessous de ce seuil mènent des vies
misérables, pénibles, dures et courtes. Ce n’est pas seulement l'éducation, la santé, un
logement et des vêtements décents qui leur font défaut mais tout simplement une
alimentation suffisante pour qu’elles conservent leur santé physique et mentale. » (The
Economist ,2013).
L’objectif du Millénaire - diviser par deux la pauvreté absolue - a été atteint avec 5 ans
d’avance : « dans les régions en développement, la proportion de personnes vivant avec
moins de 1,25 dollar par jour a diminué de 47 % en 1990 à 22 % en 2010. Il y a eu environ
700 millions de personnes en moins vivant dans des conditions d’extrême pauvreté en 2010
qu’en 1990 » (OMD, 2013). En revanche, le nombre de personnes en situation de pauvreté
relative (moins de 50 % du revenu médian du pays où ils vivent) a augmenté, même si leur
part dans la population mondiale a baissé.
Ce bilan relativement optimiste doit cependant être nuancé. Le recul du nombre de « pauvres
absolus » est intégralement le fait de la Chine et il n’a pas baissé dans le reste du monde. En
outre, il était relativement facile de faire franchir le seuil de 1,25 dollar par jour parce que
beaucoup de gens étaient juste en dessous. C’est pourquoi, il faut élargir un peu le spectre et
considérer la catégorie des personnes « proches de la pauvreté » qui représentent un quart de
la force de travail mondiale des pays en développement (OIT, 2013).
La question plus générale des inégalités est complexe parce que la notion d’inégalités est
multidimensionnelle. Si l’on s’intéresse à l’inégalité entre pays, le plus simple est de classer
les pays en fonction de leur Pib par tête et de calculer un indicateur de répartition, par
exemple le coefficient de Gini qui varie entre 0 (répartition parfaitement égalitaire) et 1
(répartition parfaitement inégalitaire). Chaque pays compte alors comme « un individu »
mais, dans ce cas, un petit pays riche pèse autant qu’un grand pays pauvre. Pour compenser
ce biais, on peut alors pondérer chaque pays en fonction de sa population. Mais ce calcul
n’est pas non plus entièrement satisfaisant car chaque individu figure avec le revenu moyen
de son pays alors que les inégalités ont pu s’y creuser.
Il faut donc calculer un indicateur global qui mélange l’ensemble des habitants de la planète
et montre que les inégalités mondiales n’ont pratiquement jamais cessé de se creuser depuis
les origines du capitalisme (Graphique 3). Les seules exceptions correspondent aux périodes
pendant lesquelles de grands pays du Sud ont adopté un modèle de croissance plus
autocentré : durant l’entre-deux guerres et les « Trente glorieuses ».
Sur la période récente, les inégalités se creusent à partir de 1980, avant de se stabiliser à un
niveau élevé. C’est le résultat de deux mécanismes qui se compensent : les inégalités entre
pays se réduisent avec la croissance plus rapide des pays émergents, mais les inégalités se
creusent dans l’immense majorité des pays. Le Brésil fait exception à ce principe, mais de
manière générale, ces évolutions ne confirment pas la « courbe de Kuznets » selon laquelle
les inégalités augmenteraient dans une première phase, mais baisseraient à partir d’un certain
niveau de développement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%