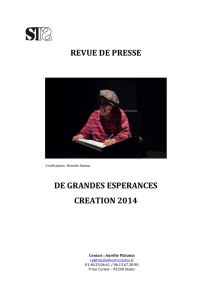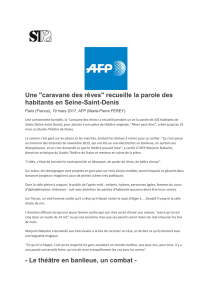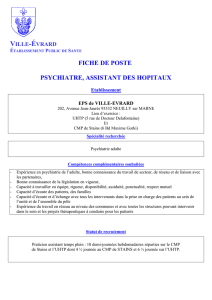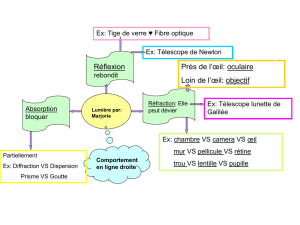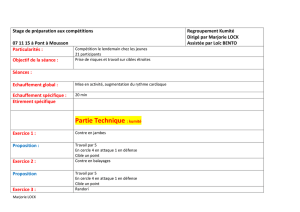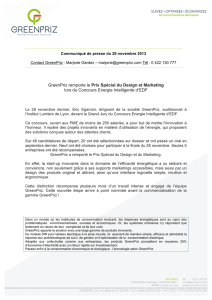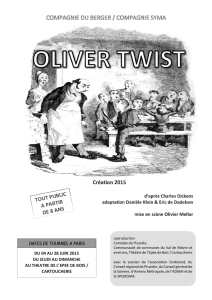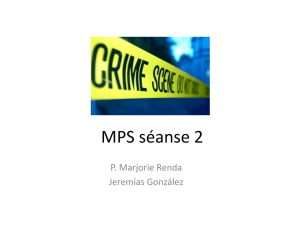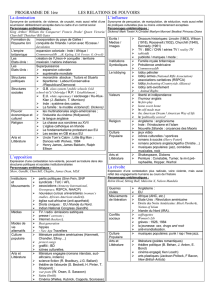De grandes espérances - Studio Théâtre de Stains

De grandes espérances
1ère adaptation théâtrale de l’œuvre de Charles Dickens
Spectacle tout public
Le Studio Théâtre de Stains est soutenu par la ville de Stains, Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et par le Conseil Régional Ile-de- France

De grandes espérances
D’après l’œuvre de Charles Dickens
Traduction de Charles Bernard-Derosne revue par Jean Pierre Naugrette
Editions « Le livre de Poche classique »
Mise en scène Marjorie Nakache
Avec
Marthe Fieschi, Nicolas Guillemot, Elisa Habibi,
Charles Leplomb, Xavier Marcheschi, Marina Pastor
Adaptation
Xavier Marcheschi
Décor : Jean Michel Adam
Costumes : Nadia Rémond
Lumière : Lauriano de la Rosa
Masques : Geneviève David
Musique originale : Gérard Maimone
Vidéo : Brahim Saaï
Régie générale : Hervé Janlin
Régisseurs : Rachid Baha et Théo Errichiello
Chargée de relations presse et relations publiques
Aurélie Platania
01 48 23 06 61 / 06.13.67.30.90
rp@studiotheatrestains.fr
Contacts diffusion
Kamel Ouarti / Muriel Dorival
Tél.: 01 48 23 06 61
contact@studiotheatrestains.fr
www.studiotheatrestains.fr

« L'extraordinaire puissance de Dickens a un effet étrange. Elle
fait de nous des créateurs, pas seulement des lecteurs et des
spectateurs »
Virginia Woolf
Orphelin, le jeune Pip est destiné à être forgeron
jusqu’au jour où, promis à de grandes espérances, il sera
propulsé dans le monde fabuleux de Miss Havisham et
tombera éperdument amoureux de sa fille adoptive,
Estella.
Evasions rocambolesques, déchirements amoureux, vils
profiteurs, hommes de loi de glace, étrange sorcière
échevelée, sublime beauté au cœur froid… De grandes
espérances est un spectacle aux multiples facettes, un
récit plein de suspense, de rebondissements, de
brouillard et de tempête.

NOTE D’INTENTION ET CHOIX DE MISE EN SCENE
POURQUOI DE GRANDES ESPERANCES EN 2014 ?
De grandes espérances...de grandes attentes. Prendre ses rêves pour la réalité future ?
L’œuvre, toujours moderne, a souvent fait l’objet - encore récemment - d’adaptations
au cinéma et à la télévision.
Pleine de drôlerie et d’humour, la force mythique de certains thèmes donne lieu à des
scènes d’anthologie. Roman des illusions perdues, des espoirs envolés, comédie des
erreurs, fausse éducation sentimentale, on peut établir un parallèle entre ce XIX° siècle
et 2014.
La société que dépeint Dickens est oppressive, figée dans l’archaïsme de son mode de
vie et la pesanteur de ses habitudes ; figée dans le carcan d’une hiérarchie immuable :
une classe laborieuse (ouvrière) engluée dans la misère, exploitée par une classe
dominante (bourgeoise) aux desseins égoïstes, enfermée dans ses manoirs où ne vivent
que des fantômes.
Ce fractionnement en strates sociales bien hermétiques, comporte des niveaux à jamais
inaccessibles pour qui n’est pas issu d’une famille fortunée ou noble. Ainsi, les gens ne
sortent jamais de leur quartier, village, et, s’aventurer loin des lieux assignés à leur
condition sociale est, non seulement hors de propos, mais périlleux. Ils sont donc
contraints de stagner. Le marais –lieu où débute l’action - tel un périphérique, les
sépare, faisant office de douves et de muraille pour protéger la citadelle de Miss
Havisham. Qu’ils viennent, de quelque façon que ce soit, à transgresser cet ordre, et le
destin se chargera de les châtier avec sévérité.
Pip (comme le jeune Dickens) vivait dans
un univers simple, cohérent, dont il aura
honte, et le voilà projeté dans un univers,
sans véritables valeurs morales,
impitoyable et factice, qui le méprisera.
Ce monde infiltre tous les tempéraments ;
cache, puis révèle tous les pièges, les
travers de notre société : vulgarité,
étalage, appât du gain facile, envie... les
sept péchés de la capitale où l’argent
règne, en maître incontesté !
Lui seul permet le lien entre les classes sociales, se substituant à toute
autre communication. Substitution imposée par la classe dominante.
© Benoîte Fanton

Dickens n’est pas un révolutionnaire. Il serait plutôt un conservateur, au mieux un
réformateur ; il ne se fait guère d’illusion sur les politiques, la bourgeoisie, les nobles ; il
ne les critique pas. C’est plutôt le comportement des gens qui est jugé (avec beaucoup
de générosité, par Dickens, en empathie avec ses personnages, surtout quand la
douleur et l’injustice sont dues à l’attitude égoïste d’autres êtres humains.) C’est ce
comportement qui empêche tout progrès. Car, au lieu de combattre les injustices, ses
personnages envient les riches, ceux qui réussissent, et ils veulent les imiter. Ils sont
victimes de leur complaisance et on ne peut pas voir en eux des persécutés. Et, même
s’ils se font de fausses illusions sur la générosité des nantis - Pip l’apprend à ses
dépends-, à tout le moins, ces derniers les font rêver. On ne tue pas le rêve. Aussi, rien
n’évolue car personne ne veut remettre en question l’ordre établi. Ils le renforceraient,
même. Pip découvrira plus tard que son désir de devenir un gentilhomme l’a amené à
dédaigner, un moment, certaines richesses de la vie.
Quel doit être notre comportement quand l’heure du choix arrive. Pip reniera-t-il
son passé, son milieu et ceux qui l’ont élevé ? Pour quel but ? Les Grandes
espérances sont-elles vouées à l’échec si elles vous éloignent de votre passé ?
Pour réussir faut-il (se) trahir ?
De grandes espérances raconte le parcours initiatique de deux orphelins -Pip et
Estella- leur éducation, leur relation à la famille, au milieu social où ils vivent. Passage
de l’enfance à l’âge adulte ; du conte de fées à la lutte pour la vie ; de l’innocence à la
culpabilité ; de l’amour à l’argent.
Dickens s’est toujours montré très critique vis-à-vis d’une éducation, d’un « dressage »,
qui ne prendrait pas en compte la personnalité des enfants, leurs aspirations, leurs
participations au processus de la connaissance ; à l’égalité des chances.
QUE PRIVILEGIER ?
Transposer en restant fidèle au texte ? Projet théâtral impossible, l’ensemble des signes
de la représentation : les personnages, décor, lumières, costumes, musique,
accessoires... constituent un sens, une rhétorique, une poétique théâtrale (métaphore,
métonymie), qui va au-delà de l’ensemble textuel.
Le choix esthétique de la mise en scène s’appuie délibérément sur le mode féerique qui
permet une mise à distance de la réalité –le texte étant ainsi théâtralisé- nous assistons
à une quête de la part de ces jeunes, une fuite éperdue vers on ne sait quelle issue.
Conte de fée, entre rêve et réalité : -le forçat Magwicht dans le rôle de l’Ogre qui veut
dévorer le Petit Poucet, Pip, surgissant, tel un diable, un revenant, un génie, non de la
lampe d’Aladin mais d’une tombe, pour jouer le rôle de Gepetto (Pinocchio), à la fois
Pygmalion /Frankenstein/ père ;
-une Ogresse, sa sœur (il y a même, au cimetière, outre les parents, cinq gosses, frères
et sœurs de Pip, toute la famille enterrée, sauf l’Ogresse !) ;
-Miss Havisham, la mauvaise Fée, la méchante reine ;
-Pip, Le Prince Charmant, qui vient délivrer la Princesse enfermée, Estella.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%