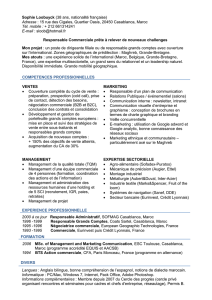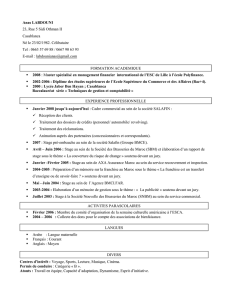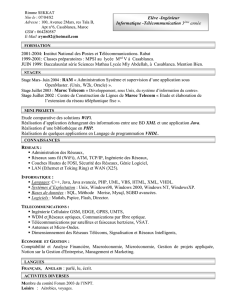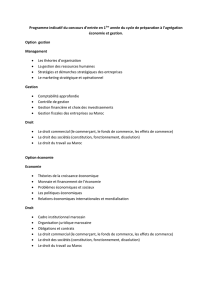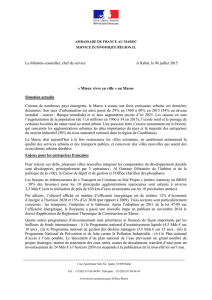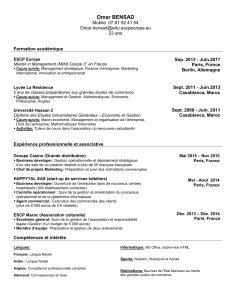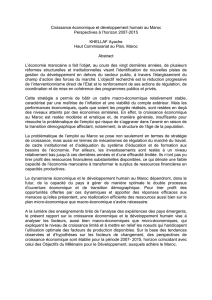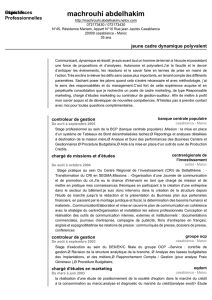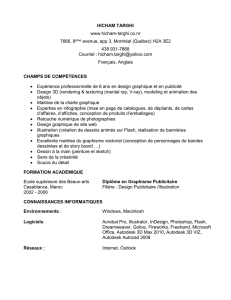Revue économique du 15 mars 2013-1 (Lecture seule)

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Direction de la Diplomatie Publique et des Acteurs non Étatiques
Revue Économique hebdomadaire
N° 86
Du 15 mars 2013
L’Europe investit pour
la croissance et l’em-
ploi
L’économie européenne est engagée dans un
long processus de rééquilibrage. Les
déséquilibres macroéconomiques qui se sont
creusés ces dix dernières années, souvent
aggravés par un boom du crédit, sont en voie
de correction...
Actes
Le Maroc a heureusement vendu sa dette
avant que la situation des Finances publiques
ne s’aggrave. Autrement, il aura fallu dealer
avec d’autres conditions sur le marché inter-
national! Et au risque d’alimenter le camp
des cassandres, les check-up n’annoncent
guère un rétablissement du malade. Ces
réserves ne s’appuient pas seulement sur les
scénarios pessimistes pour 2013...
Télécoms: les des-
sous du détourne-
ment du trafic inter-
national
Le détournement du trafic international
taraude les opérateurs télécoms et prend
des proportions importantes. Ces
dernières années, le phénomène s’inten-
sifie et devient plus sophistiqué. Les
fraudeurs recourent à des méthodes de
plus en plus ingénieuses et difficiles à
appréhender....
Le grand découplage
Depuis le second semestre 2012, les
marchés financiers ont connu une forte
reprise dans le monde entier. En effet
aux États-Unis le Dow Jones a battu son
record de tous les temps début mars,
après avoir augmenté de près de 9%
depuis septembre En Europe les «armes
pour le mois d'août», du président de la
Banque centrale...
S O M M A I R E
Bourse de Casablan-
ca: pas d’éclaircie
en 2013
La situation ne s’arrange pas à la
Bourse de Casablanca. Après avoir
clôturé sa cinquième année de baisse
depuis 2008, avec une contre-
performance de 15% en 2012, la place
semble avoir entamé une nouvelle
année baissière. Au 22 février, l’indice
de toutes les valeurs s’est enfoncé à -
5%...
08
06
Presse économique nationale
02 Actes
02 A quoi jour le Trésor?
02 Mirages numériques
03 Professions libérales: le coût invisible d’une concurrence
boiteuse
03 IDE: les prescriptions de Mckinsey
Presse économique internationale
04 3% et alors?
04 La Silicon Valley décline-t-elle ou perd-t-elle seulement sa
spécificité?
05 Wall Street: à la santé de Ben!
05 Le grand découplage
Page Finances
06 CGI: les retards de livraison limitent les résultats
06 20 milliards: c’est, en dollar, ce que pourrait perdre Gold-
man Sachs en cas de crise
06 Bourse de Casablanca: pas d’éclaircie en 2013
07 La Banque mondiale approuve un prêt de 160 millions de
dollars
07 Les émergents investissent de plus en plus dans les pays
occidentaux
07 Les principaux barrages du Maroc remplis à 80%
07 Zone euro: lueur d’espoir pour la croissance selon
l’OCDE
07 L’Espagne à l’abri de la crise italienne
07 Un don saoudien de 400 millions de dollars
07 Le Qatar prépare une nouvelle offensive en Angleterre
Eco zoom
08 Télécoms: les dessous du détournement du trafic
international
08 L’Europe investit pour la croissance et l’emploi
02
05
08
Brèves Eco

Actes
Le Maroc a heureusement vendu
sa dette avant que la situation des
Finances publiques ne s’aggrave.
Autrement, il aura fallu dealer
avec d’autres conditions sur le
marché international! Et au risque d’alimenter le camp des
cassandres, les check-up n’annoncent guère un
rétablissement du malade. Ces réserves ne s’appuient pas
seulement sur les scénarios pessimistes pour 2013 qui se
multiplient ici et là, ni sur la mission que les services du
FMI conduisent depuis plus d’une semaine au Maroc.
Mission rendue au demeurant inévitable après les dernières
dégradations du déficit budgétaire. Elles sont aussi
entretenues par ce qui peut paraître comme un manque de
réactivité, du moins à l’aune de la gravité de la situation.
Nous sommes en mars, et il n’y a pas, en dépit de ces
warnings, suffisamment de gages sur les dispositifs
déployés pour affronter l’orage. C’est regrettable car quels
que soient les points de croissance à récupérer, ils ne seront
jamais par ailleurs suffisants s’il n’est pas mis fin à cette
spirale. Côté recettes, il faut forcer l’optimisme pour
retrouver les avantages d’un budget qui manque pour le
moins d’originalité. Le débat sur les subventions? Il a sans
doute pris une ampleur inédite et même si certains partis de
l’opposition, voire aussi de la majorité, s’y opposent, on
sent qu’il y a moins de crispation idéologique sur la
décompensation. Au point de susciter une psychose pour
l’approvisionnement en bouteilles de gaz dans certaines
villes. Mais plus que des paroles, il faut des actes sur ce
dossier, on le sait. Le gouvernement semble montrer qu’il a
l’envie de s’y attaquer. Il faut maintenant qu’il prouve
qu’il en a l’énergie et... le temps!
L’Économiste
Revue Nationale: Éditoriaux et Chroniques
P 2
Mirages numériques
L’administration numérique! Cela fait plus
de dix ans que les gouvernements qui se
sont succédéontessayédenous
convaincre qu’ils allaient faire la révolution
et puis rien ou presque. Il y a quelques
jours, le ministre de la justice a inauguré en
grande pompe des locaux flambant neufs
où les Casablancais pouvaient obtenir leur
casier judiciaire à distance et sans se dépla-
cer dans leurs villes natales. C’est un pas
géant pour le pays en effet. Avant lui, son
collègue du transport nous a expliqué que
dans pas longtemps on allait pouvoir
obtenir des permis et des cartes grises par
voie électronique. C’est tant mieux. Mais
encore faut-il que ces annonces soient
suivies d’application réelle sur le terrain.
Ce qui n’est malheureusement pas toujours
le cas. Prenons l’exemple le plus basique de
la carte nationale biométrique. Quand elle
avait été instaurée, cette dernière a été
présentée comme étant la solution à tous
nos problèmes de paperasse. On nous a
promis que c’en allait être fini avec notre
calvaire chez les moqataâte, tous les
documents qui ont marqué à vie des généra-
tions de Marocains…Mais le discours est
une chose, la réalité en est une autre. Jugez-
en ! Sur le site , on nous dit que pour le
renouvellement de la carte biométrique, par
exemple, il faut juste présenter la carte
actuelle accompagnée d’un certificat de
résidence, 2 photos, payer 75 DH et le tour
est joué. Dans les faits, voilà à quoi cela
ressemble : d’abord, il faut un certificat de
résidence délivré par la moqataâ du coin. Et
pour l’avoir il faut payer 20 DH, fournir des
quittances d’eau et d’électricité et des
photos. Une fois ce certificat en poche, il
faut aller en refaire un autre mais cette fois-
ci chez la police. Là, de nouveau d’autres
photos, d’autres quittances, une copie de la
CIN et, surprise, une attestation de travail
même si l’information sur la profession
n’existe plus sur la CIN biométrique. Une
fois cette deuxième étape franchie, il faut se
munir du nouveau certificat de la police qui
a, apparemment, plus de probité que celui
de la moqataâ et aller à la préfecture de
police pour entamer la vraie procédure de
renouvellement. Et là, d’autres surprises ne
manquent pas. Rephotos, nouveau paiement
de 75 DH et, le comble, on vous demande
de déposer des empreintes que vous êtes
censés avoir déjà déposées. De deux
choses l’une alors: soit que les
responsables de notre administration,
volontairement, ne nous ont pas tout dit sur
le site officiel, soit qu’ils ne savent rien de
ce qui se passe réellement sur le terrain...
La Vie Eco
A quoi joue le Trésor?
Les investisseurs nationaux sont, depuis quelques
semaines, dans l’expectative. Et pour cause, les
sources de financement se font de plus en plus
rares. En clair, le crédit bancaire classique devient
chiche et les levées de fonds par les institutionnels n’ont plus la cote.
Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés à cette situation,
préjudiciable à l’ensemble de l’économie nationale ? En 2012, l’État s’est
trouvé face à une insuffisance de capitaux qui mettait en péril le
financement de la Caisse de compensation, atteignant des niveaux records
et le déficit budgétaire s’est anormalement accru. Le besoin de
financement, par l’État, était tellement ressenti que les taux des bons du
Trésor ont atteint des niveaux très attrayants pour les investisseurs. Quelle
aubaine pour les banques, qui constataient l’augmentation fulgurante du
risque crédit de l’entreprise du fait de la crise. En outre, la possibilité de
recourir à Bank Al Maghrib pour lever des fonds à une moyenne de 3% et
de placer l’excédent en bons du Trésor jusqu’à 4,2%, constituait une
solution idéale pour les banques commerciales. Ainsi, en janvier 2013, les
émissions de bons du Trésor se sont élevées à 18,2 MMDH, contre
seulement 9,8 MMDH, soit +62%, par rapport à janvier 2012 ! Dans ce
décor, il ne faut pas blâmer les banques commerciales, qui sont dans leur
rôle de rechercher la sécurité, de minimiser le risque et de produire des
bénéfices à présenter aux action- naires. C’est l’ADN même d’un bon
gestionnaire. Maintenant, il y a aussi le rôle de régulateur que doivent
tenir les instances de l’État et leur objectif concernant le devenir de
l’économie. Le choix devrait-il porter sur une économie d’endettement de
l’État au détriment du tissu productif ou sur un équilibre qui n’existe
aujourd’hui que dans le subconscient des décideurs? En effet, si Bank
Al-Maghrib demande aux banques de démontrer leur niveau de
financement des PME pour prétendre au recours à ses liquidités, il leur
laisse le choix de substituer cette «condition» par la production d’une
assise conséquente en bons du Trésor ! Le choix des banquiers est donc
vite fait !
Les Échos (Maroc)

P 3
Professions libérales: le
coût invisible d’une
concurrence boiteuse
Le Conseil de la concurrence poursuit son
exploration économique. Après la
téléphonie mobile, les huiles de table, les
médicaments, les aides de l’État pour
l’habitat notamment, place aux professions
libérales réglementées: avocats, notaires,
experts-comptables, architectes, médecins
et pharmaciens. Une des conclusions phare
de son étude est que «les barrières à l’entrée
sont de moins en moins justifiées». Or, le
Conseil de la concurrence qualifie
«l’espace» de ces professions comme un
«marché à part entière» dans la mesure «il
génère un échange économique via la loi de
l’offre et de la demande». Conséquence,
une étude notariale ou un cabinet d’avocats
«est une entreprise qui obéit au droit de la
concurrence», estime Hicham Bouayad,
rapporteur au Conseil et auteur de l’étude
qui s’appuie sur un indice de concurrentia-
bilité. Les restrictions d’accès aux
professions libérales prennent plusieurs
formes. A titre d’exemple, la durée d’études
pour un expert-comptable est de 10 ans. La
reconversion professionnelle est également
un obstacle. Un conservateur foncier qui
souhaite intégrer le notariat doit justifier de
10 ans d’expérience tout en démissionnant
au préalable de sa fonction. Chez les
avocats, la loi exige 15
ans d’expérience pour
plaider à la Cour de
cassation. C’est une
entrave au cœur même
de la profession! Globa-
lement, le Conseil de la
concurrence relève un
«faible taux de pénétra-
tion» par les jeunes di-
plômé. D’où l’insuffi-
sance de l’offre et une
large concentration au
niveau de l’axe Casa-
Rabat. Des restrictions
quantitatives à la concur-
rence qui créent «une
raréfaction artificielle»
des services: prix, qualité, compétitivité et
emplois». Face à l’accentuation de la
libéralisation des marchés, y compris celle
des services, il y a urgence d’une mise à
niveau. Les avocats pâtissent déjà de
l’arrivée de grands cabinets internationaux
et qui emploient d’ailleurs des juristes
fraîchement diplômés. Ce qui, au fond, va
forcer la profession à se régénérer. Le
monde change et nous avec. Que recom-
mande le Conseil de la concurrence?
«Développer l’offre
universitaire en préconi-
sant 3 pistes. Normali-
ser l’accès aux profes-
sions libérales et unifier
les formations universi-
taires», prône-t-il.
Favoriser en fait les
passerelles pour sortir
des «ghettos» profes-
sionnels. L’idée de créer
des corps intermédiaires
est conseillée: Clercs
pour les notaires, comp-
tables agréés pour les
experts-comptables,
conseillers juridiques
pour les avocats…».
Ces derniers existent en réalité. Mais pei-
nent relativement à coexister dans un
marché mal structuré: regroupement, diver-
sification des services, spécialisation… Ce
n’est pas forcément leur faute.
L’Économiste
P 3
Analyses
IDE: les prescriptions de Mckinsey
«Le Maroc va devoir trouver un nouvel équilibre, dans lequel il
attirera davantage de financements directs et indirects d'autres pays
émergents. Un essor accéléré du marché des capitaux et de la
Bourse de Casablanca seront nécessaires pour réaliser cet objectif,
face notamment à la concurrence accrue d'autres places
émergentes. Il faudra également s'inscrire dans une démarche
proactive pour s'ouvrir et attirer de nouveaux partenaires
investisseurs, des BRICS en particulier». Les propos sont de
Mourad Taoufiki, directeur général de
McKinsey Maroc, suite à la publication
par McKinsey Global Institute (MGI),
d’un rapport consacré à l’analyse des
marchés de capitaux au niveau mondial.
De manière générale, le rapport souligne
le gel de la valeur des actifs financiers
mondiaux (actions, obligations, prêts),
accompagné d’un effondrement des flux
de capitaux transfrontaliers de plus de 60% par rapport à la période
pré-crise. Le Maroc, qui mise sur son attractivité pour attirer les
fonds internationaux doit, si l’on en croit Taoufiki, impérativement
recadrer son ciblage des fonds étrangers. Or, c’est vers les pays du
Golfe que le Maroc s’est orienté pour réaliser cet objectif, en
accédant depuis peu, avec la Jordanie, au statut de «partenaire
stratégique». Ce partenariat a été consolidé par l’engagement des
pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à accorder un
soutien financier au Maroc de cinq milliards de dollars sur 4 ans.
Pas plus tard que le mois précédent, le Fonds Saoudien pour le
développement (Saudi Fund for Development SFD) a donné son
accord pour octroyer au Maroc 400 millions de dollars, somme
faisant partie de la quote-part de l’Arabie Saoudite s’élevant à 1,
25 milliard de dollars. «Finalement, cette dynamique confirme
l'opportunité pour le Maroc de se positionner, grâce à Casablanca
Finance City, comme un pont entre l'Afrique et les capitaux
internationaux, notamment ceux des pays émergents», poursuit
Taoufiki. Il s’agit certainement d’une réelle opportunité
stratégique. Eu égard au positionnement économique du pays, le
Maroc est réellement perçu par les opérateurs mondiaux comme
étant une plateforme de développement régional. Constat négatif
Le rapport fait état d’une stagnation de la valeur des actifs
financiers et une véritable chute des flux de capitaux transfronta-
liers qui caractérisent le système financier mondial depuis le début
de la crise mondiale en 2008. En effet,
la valeur globale des actifs financiers
mondiaux, qui capitalise les marchés
boursiers, la valeur des obligations
d’entreprises et des obligations d’États
et les prêts, s’élève actuellement à 225
000 milliards de dollars. Or, le rythme
de croissance de cette valeur a chuté de
manière considérable depuis 2008,
(1,9% par an en moyenne contre 7,9% entre 1990 et 2007). Pire
encore, ce ralentissement concerne les économies matures en
p
hase de désendettement, aussi bien que les économies
émergentes. À cet égard, la situation des pays émergents reste
mitigée. L’impact de la crise financière n’y est globalement pas
aussi négatif que dans certains marchés européens, tels que celui
l’Espagne ou de la Grèce, bien que leurs marchés financiers aient
cessé de se développer depuis 2008. En outre, leur profondeur
financière est en moyenne inférieure comparée à celle des marchés
matures (157% du PIB contre 108% du PIB en 2012).
Les Échos (Maroc)
L’indice global est basé sur les
indices de la restriction à l’accès à
la profession et de l’exercice de
celle-ci. Comparé à des pays euro-
péens, le Maroc est placé dans une
«zone hautement restrictive» en
termes de concurrence.

P 4
Revue internationale: Éditoriaux et Chroniques
3% et alors?
C'était promis, juré, intangi-
ble, irréversible… Et puis
non finalement ! En dépit
des engagements cent fois
répétés, le déficit public
français ne descendra pas
sous la barre fatidique des 3
% de produit intérieur brut
(PIB) en 2013. En cause,
une croissance plus faible que prévu, et donc
des recettes plus basses qu'escompté.
Contrairement à ce que suggère sa mise en
scène médiatique, la nouvelle n'est
cependant ni une surprise ni un drame: nous
l'écrivions déjà dans notre numéro de
septembre dernier et nous étions loin d'être
les seuls. Les marchés financiers l'ont
d'ailleurs accueillie avec une souveraine
indifférence. Non par manque de vigilance,
mais parce qu'ils savent que le surcroît de
sacrifices qu'il faudrait s'infliger pour
atteindre un tel objectif serait
potentiellement pire que le mal. Même le
Fonds monétaire international a fini par se
ranger à cette opinion en reconnaissant au
passage ses erreurs passées.
C'est dire ! Mais à défaut
d'être un événement écono-
mique, cette nouvelle cons-
titue un sérieux problème
politique. Car elle redonne
des arguments aux partisans
d'un nouveau tour de vis.
De ce côté-ci du Rhin, pour
exiger en urgence des coupes supplémentai-
res dans les dépenses publiques. Et de l'autre
côté, pour faire, à quelques mois des
prochaines élections législatives, une
démonstration d'intransigeance devant
l'opinion publique. Il y a pourtant de bonnes
raisons de s'opposer à un nouvel ajustement
budgétaire, outre qu'il serait économique-
ment et socialement dévastateur dans un
pays qui compte désormais plus de trois
millions de chômeurs. La première est que,
si l'on s'en tient aux règles du traité de
stabilité, il n'est pas absolument indispensa-
ble : le traité permet en effet de différer
l'effort d'ajustement en cas de conjoncture
particulièrement défavorable. C'est
clairement le cas aujourd'hui. La seconde
raison est politique : l'Hexagone a déjà fait
une bonne partie du chemin en acceptant de
signer le traité de stabilité sans le renégocier
(contrairement aux promesses de François
Hollande), en augmentant substantiellement
les impôts et en s'apprêtant à transcrire dans
la loi les réformes du marché du travail
décidées par les partenaires sociaux le 11
janvier dernier. Quoi qu'on pense de ces
décisions- et certaines ont été âprement criti-
quées ici mêm -, elles constituent des gages
assez significatifs pour que Bruxelles et
Berlin acceptent à présent de mettre de l'eau
dans leur vin. Il ne s'agit nullement
d'enterrer la nécessité de réduire les déficits
publics, mais simplement de se donner un
peu plus de temps pour le faire et de cueillir
ainsi les fruits de la confiance retrouvée.
Celle-là même qui, à force de concessions
mutuelles, a permis de mettre un terme, au
moins provisoire, à la crise de l'euro.
Alternatives Économiques
La Silicon Valley décline-t-
elle ou perd-elle seulement
sa spécificité?
Point historique de rencontre entre les
campus universitaires, la contre-culture c
alifornienne et l’esprit d’entreprise
américain, la Silicon Valley est devenue
depuis les années 1970 un des principaux
technopoles de l’innovation économique, un
centre mondial du capitalisme high-tech en
même temps qu’un mythe de l’économie
dite «de la connaissance». Apple, Hewlett-
Packard, Intel et, plus tard, Google et
Facebook: la Valley a fait émerger les plus
grandes success stories de l’économie post-
industrielle. Et puis, écrit James McQuivey
sur All Things D, c’est quand même le seul
lieu au monde où même les surfeurs rêvent
de devenir millionnaires, comme en
témoigne le succès de la GoPro. «En réalité,
les acteurs de la Silicon Valley sont en train
de planter les graines de leur propre
disparition», poursuit pourtant cet analyste,
spécialiste de l’innovation numérique et
vice-président de la société de conseil
Forrester Research. Les facteurs qui ont
amené la Valley à développer et faire
fructifier autant d’innovations radicales dans
le domaine des technologies de l’informa-
tion et de la communication vont
être, selon McQuivey, de moins
en moins exclusivement présents
sur place. Pour le développe-
ment de l’économie de la
connaissance, la concentration
d’informations et de savoirs est un élément
essentiel. Or, ce fut longtemps une denrée
rare. La Silicon Valley, à travers de nom-
breuses innovations, contribue à scier la
branche sur laquelle elle se tient en ayant
rendu gratuites, libres et foisonnantes
quantité d’informations. Certains de ces
outils sont en effet devenus des armatures de
base pour le développement de nouveaux
services. Qu’on pense aux partenariats avec
Amazon, aux applications mashup qui
utilisent les informations et données
contenues sur d’autres, ou encore au
paiement par téléphone, qui facilite le
commerce de proximité. Par ailleurs, la
Silicon Valley avait su attirer du capital-
risque pour faire de ses petites start-ups des
géants mondiaux, mais aujourd'hui, le
développement d’une société innovante
nécessite beaucoup moins de capital qu’il y
a dix ans, selon l’auteur, qui a interrogé des
vétérans du business. En somme, c’est bien
moins un déclin de la Silicon Valley que
l'auteur entrevoit qu’une généralisation de
son modèle à d’autres technopo-
les. C’est donc un déclin relatif,
précise-t-il, et un rattrapage du
reste du monde. Une silicon-
valleyisation générale? Ce que
l'article ne dit pas, et qui en
revanche ne changera pas avec la généralisa-
tion des nouvelles technologies et en
particulier l’accès à Internet, c’est le rôle
prédominant des métropoles innovantes dans
le processus de création de valeur. Car les
travailleurs intellectuels diplômés et les
centres de recherche sont de plus en plus
concentrés géographiquement dans quelques
centres urbains, ce qui rend quelque peu
utopique la croyance en une société de
l’innovation et de la connaissance hors sol,
qui se contenterait des réseaux à distance
pour fonctionner. C'est même tout l'inverse.
En cela, le modèle de la Silicon Valley est
adaptable, mais reste indépassable. Et c’est
là que, d’une certaine façon, l’idéologie
californienne reste dominante. A l’image de
son gourou le plus célèbre, Steve Jobs, qui
valorisait énormément l'hybridation des
disciplines, des idées et des hommes. Un
p
rocessus qui nécessite des contacts
fréquents, souvent informels, que seule la
ville «créative» rend possibles.
La Tribune

Analyses
Wall Street: à la santé de Ben!
Merci Ben ! Les actionnaires américains peuvent remercier le patron
de la Fed. Si, la semaine dernière, le Dow Jones, le baromètre de
Wall Street, a battu le record historique d'octobre
2007, ils le doivent avant tout à la politique très
accommodante menée par leur banque centrale ces
cinq dernières années. Depuis que la crise financière a
démarré, ce ne sont pas moins de 3.000 milliards de
dollars qui ont été ainsi injectés dans l'économie du
pays. Une somme à laquelle il convient d'ajouter,
pour être tout à fait exact, 1.000 milliards de facilités
accordées au secteur financier. Un « shoot » massif de
liquidités à des taux défiant toute concurrence, qui a permis non
seulement d'éviter l'effondrement de la première économie
mondiale, mais aussi d'assurer son rebond. La hausse du Dow Jones
qui regroupe les fleurons historiques de «Corporate America» en est
la manifestation concrète. Obsédé par les ravages de la Grande
Dépression, Ben Bernanke voulait à tout prix éviter la déflation, il a
atteint son objectif. Après le krach de 1929, il avait fallu vingt-cinq
ans au Dow Jones pour retrouver les sommets ; cette fois-ci, il aura
suffi de cinq ans à peine. Alors bien sûr, on peut dénoncer les
risques de cette politique expansionniste. Souligner le caractère
artificiel de cette hausse des cours et du rebond de
la croissance en cours. En gonflant encore la bulle
de cash qu'avait contribuée à former son
prédécesseur, le patron de la Fed nous emmène dans
des territoires inconnus. Surtout, la question de la
pérennité de cette tendance reste entière. Que se
passera-t-il une fois que la Fed sera revenue à une
politique monétaire plus traditionnelle ? L'embellie
résistera-t-elle aux coupes budgétaires de l'État
fédéral ? Il n'empêche, pour le moment, le choix est payant. Et le
contraste avec la situation européenne flagrant. Quand l'Europe en
pleine cure de rigueur fait grise mine, l'euphorie américaine fait
envie.
Les Échos (France)
Le grand découplage
Depuis le second semestre 2012, les marchés financiers ont connu
une forte reprise dans le monde entier. En effet aux États-Unis le
Dow Jones a battu son record de tous les temps début mars, après
avoir augmenté de près de 9% depuis septembre. En Europe les
«armes pour le mois d'août», du président de la Banque centrale
européenne Mario Draghi se sont avérées particulièrement efficaces.
Draghi a relégué la baisse de l'euro dans l'oubli en promettant des
achats potentiellement illimités d'obligations des gouvernements
membres. Entre le 1er septembre et le 22 février, l'indice
FTSEurofirst a augmenté de près de 7%. En Asie aussi, les marchés
financiers sont en hausse depuis septembre, tout
particulièrement au Japon. Même les élections
italiennes de fin février ne semblent pas trop
avoir bouleversé les marchés (du moins jusqu'à
présent). Bien que des écarts de taux d'intérêt
des obligations sur 10 ans italiennes et
espagnoles par rapport aux obligations
allemandes aient brièvement fait un bond de 30 à
50 points après l'annonce des résultats, ils ont
ensuite été reculés à 300-350 points de base par
rapport à 500-600 points de base avant la
décision de la BCE d'établir son programme
« d'opérations monétaires à terme sec » (OMT). Mais ce dynamisme
du marché financier est en contradiction avec les événements
politiques et avec les véritables indicateurs économiques. Aux États-
Unis, la performance économique ne s'est améliorée qu'à la marge en
2012, avec une augmentation du PIB annuel de 2,3%, contre 1,8%
en 2011. Le taux de chômage était toujours fort, à 7,8% fin 2012, et
il n'y a eu quasiment aucune hausse des salaires lors des dernières
années. Le revenu moyen des ménages aux États-Unis est encore
inférieur à son niveau de 2007 (en fait, il est proche de son niveau
d'il y a deux décennies) et environ 90% de toutes les augmentations
de revenus aux États-Unis dans la période post-crise ont concouru à
la tranche supérieure de 1% des ménages. Les indices de la zone
euro sont encore pires. L'économie s'est contractée en 2012 et les
salaires ont diminué, malgré la hausse en Allemagne et dans certains
pays du Nord. Des statistiques fiables ne sont pas encore
disponibles, mais la pauvreté dans le Sud de l'Europe est en hausse
pour la première fois depuis des décennies. Sur le plan politique, les
États-unis font face à une impasse législative presque complète, sans
aucun signe d'un compromis qui pourrait conduire à la combinaison
optimale de mesures : un soutien à court terme pour stimuler la
demande effective, des réformes structurelles à long terme et un
assainissement budgétaire. En Europe, la Grèce a été en mesure,
jusqu'ici, de maintenir une majorité parlementaire pour soutenir le
gouvernement de coalition, mais là, comme ailleurs, les partis hyper-
populistes gagnent du terrain. Les résultats des élections italiennes
pourraient servir d'indicateur pour l'Europe. Beppe Grillo du
Mouvement populiste 5 Etoiles a émergé avec 25% du vote
populaire : le plus large soutien pour un parti unique. L'ancien
Premier ministre Silvio Berlusconi, confondant ceux qui avaient
prévu sa disparition politique, est réapparu à la tête d'une coalition
populiste de droite, qui a fini à seulement 0,3% de la victoire. En
bref, on assiste à un découplage rapide entre les
marchés financiers et le bien-être social et
économique global. Aux États-Unis et dans de
nombreux autres endroits, les bénéfices des
société proportionnellement au revenu
national sont à un niveau élevé depuis des
décennies, en partie grâce à la technologie qui
permet d'économiser la main-d'œuvre dans une
multitude de secteurs. En outre, les grandes
entreprises sont en mesure de tirer pleinement
profit de la mondialisation (par exemple, en
arbitrant les régimes fiscaux pour diminuer leurs
paiements). En conséquence, le revenu de l'élite mondiale augmente
à la fois rapidement et indépendamment de ce qui se passe en
termes de production globale et de croissance de l'emploi. La
demande de produits de luxe est en plein essor, aux côtés de la faible
demande en biens et services consommés par les groupes à faibles
revenus. Tout cela se déroule au beau milieu de politiques
monétaires très expansionnistes et de taux d'intérêt proches de zéro,
sauf dans les pays confrontés à une crise immédiate. La
concentration structurelle des revenus au sommet se combine avec
l'argent facile et une course au rendement, conduisant à
l'augmentation du risque sur actions. Et pourtant, malgré l'inquiétude
et l'anxiété généralisée face à la pauvreté, au chômage, à l'inégalité
et à la concentration extrême des revenus et des richesses, aucun
modèle de croissance alternatif n'a vu le jour. L'opposition au
courant dominant en Europe se divise entre ce qui est toujours trop
souvent une gauche « ancienne » qui peine à s'adapter aux réalités
du 21ème siècle, et des partis populistes, anti-étrangers, voire parfois
ouvertement fascistes à droite.
Project Syndicate
P 6
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%