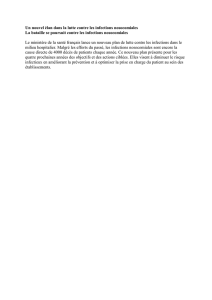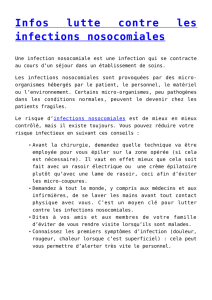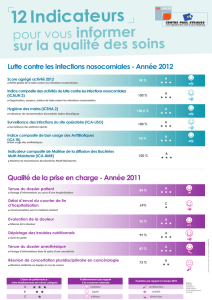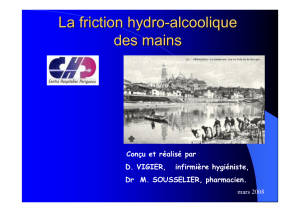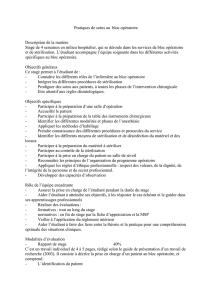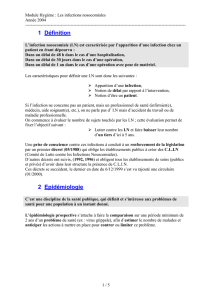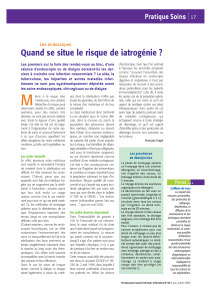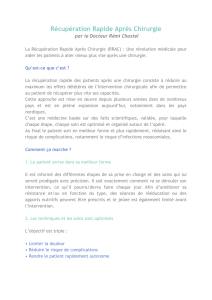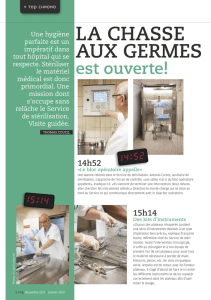Quand l hygiene reprend sa place : la première

L’hôpital est certes ce lieu privilégié où la propagation microbienne est
inévitable, mais toutes les mesures doivent être prises pour réduire les
risques d’infection. Les infections nosocomiales, dont les coûts humains et
économiques sont considérables, traduisent une défectuosité dans l’orga-
nisation des structures et dans le respect des bonnes pratiques de soins,
l’hygiène étant partie intégrante de ces derniers.
Plusieurs facteurs sont déterminants dans la lutte contre l’infection : la
connaissance des causes, le pouvoir de transmission des germes patho-
gènes, la traçabilité des actes et des lieux de soins depuis l’admission du
patient à l’hôpital. La contamination microbienne ne se faisant pas seule-
ment par contact direct, il est important de connaître le parcours du mala-
de dans l’établissement.
Il est toujours difficile de distinguer la part des infections liée à la propre
flore du patient de celle liée à une flore importée, en dehors des épidé-
mies de souches ayant des caractères particuliers.
La politique d’hygiène est validée par les Clin
La lutte contre les infections nosocomiales nécessite un consensus de l’en-
semble du personnel hospitalier. La politique d’hygiène doit reposer sur
des protocoles écrits, validés par le Clin (Comité de lutte contre les infec-
tions nosocomiales). Les questions de l’hygiéniste ne doivent en aucun cas
être interprétées comme une recherche pour une sanction mais comme
bases d’une meilleure prévention.
Depuis 1998, tous les établissements de santé participant au service
public doivent disposer d’un comité de lutte contre les infections nosoco-
miales dont le rôle est d’exercer une surveillance et de mettre en place des
programmes de prévention. La France est divisée en cinq régions, chacu-
ne étant dotée d’un comité de coordination des Clin. Un comité tech-
nique national des infections nosocomiales conseille le ministère et défi-
nit la politique à suivre. Normalement, les hôpitaux devraient disposer
d’une infirmière hygiéniste pour 400 à 500 lits et d’un praticien pour 800
à 1 000 lits. En 1994, le ministère de la Santé s’était donné pour objectif
de réduire de 30 %, en 5 ans, le nombre d’infections nosocomiales.
Quand l’hygiène
reprend sa place :
la première
Comment parler d’hygiène pour se faire
entendre ? Tout acte de soin devrait, en principe,
avoir pour corollaire un réflexe d’acte d’hygiène.
Il est urgent de rappeler au personnel, et pas
seulement aux infirmières, comment respecter
les mesures les plus élémentaires.
Sommaire
Quand l’hygiène
reprend sa place ::
la première
Évaluations en hygiène
hospitalière, pourquoi,
comment ?
L’acinetobacter
baumannii
Germes multirésistants,
l’isolement
des patients
Démarche qualité,
un comité
d’utilisateurs
Blocs opératoires.
L’ère de la
formalisation
Endoscopes :
désinfecter
ou stériliser ?
Chirurgie vasculaire
au Vietnam
Infections
nosocomiales :
une réponse juridique
en construction
15
INFIRMIER
fessions santé
pro
INFIRMIÈRE
●●●
Avant le règne des
antibiotiques et des
vaccins, l’hygiène
constituait le seul
moyen de prévention
des infections. Or le
pays de Pasteur ne
place pas encore l’hy-
giène comme une spé-
cialité recherchée par
les meilleurs.
Gastro-intest
2,5 %
Autres 4%
Cathéter 4 %
ORL/œil 6 %
Bact/septicémies
6 %
Resp. autres
8 %
Peau/tis. mous
10,5 %
Site opératoire
10,5 %
Respiratoires basses
12,5 %
Répartition des sites d'infections nosocomiales
(données de l'enquête nationnale de 1996)
Site urinaire
36 %

Le but n’est pas atteint. Difficile, quand on sait que les Américains qui avaient des programmes
de lutte ambitieux ont dû réviser leurs positions, même en disposant de gros moyens.
Les infections nosocomiales ne sont pas une spécificité française. Tous les pays industrialisés y sont
confrontés. Mais en France, ce n’est que dans les années 80 que les autorités sanitaires ont pris les
premières mesures. L’usage intensif des antibiotiques, notamment en France, a donné des effets per-
vers. Il a fait prendre de mauvaises habitudes puisqu’il induit un relâchement de la vigilance du per-
sonnel et fait apparaître des souches plus résistantes. L’évolution des bactéries vers la multirésistance
aux antibiotiques n’est d’ailleurs pas un phénomène nouveau.
Les mesures permettant le contrôle de la dissémination des bactéries reposent d’abord sur la détection
et le signalement rapide des souches par les laboratoires. Cette propagation des souches doit être
ensuite empêchée par l’isolement du patient et l’instauration de mesures strictes qui sont essentielle-
ment des mesures dites «barrières».
Le lavage des mains est la base des règles d’hygiène
La peau est le vecteur important d’infections mais il est difficile de faire admettre qu’une peau bien
lavée puisse redevenir à risque, car même après un lavage bien effectué, la peau sécrète les germes
microbiens de la flore résidente. Le respect des procédures implique donc un nombre important de
lavages quotidiens qui exposent à un risque toxique et agressif de la peau.
Mais les enquêtes menées par les pharmaciens hospitaliers et les fabricants indiquent clairement que
le lavage des mains n’est pas la cause réelle des problèmes dermatologiques des soignants. Il s’agit,
dans la plupart des cas, de l’utilisation de savons antiseptiques pour un lavage simple, ou encore des
associations de produits non compatibles pour le lavage antiseptique (par exemple bétadine + chlo-
rexidine, bétadine + chlore), ou du non respect des bonnes procédures dans le lavage simple comme
la mise directe du savon sur des mains sèches, l’absence
de rinçage et de séchage soigneux. Et dans certains cas,
les plaignants ont un antécédent allergique, depuis même
parfois de nombreuses années, sans qu’un suivi médical
assidu n’ait été effectué.
Le manque de temps n’est pas une excuse, de même que
l’éloignement des lavabos. Mais les infirmières ne sont pas
les plus manquantes à tous ces protocoles. Que dire des
médecins qui visitent leur malade en tenue de ville, et les
touchent sans prendre le soin de se laver les mains ? Ou
du laxisme envers des visiteurs qui circulent dans les cou-
loirs sans contrôle et s’assoient sur le lit du patient, rédui-
sant d’un coup le travail accompli auparavant.
En matière d’hygiène, on a longtemps cru qu’une seule
recette valable partout suffisait. Il se dégage aujourd’hui
que l’important est d’organiser des mesures concrètes,
service par service, en tenant compte du type de mala-
des admis, de la gravité de leur état, du personnel et
de sa formation, de l’architecture des locaux et des
moyens techniques mis à disposition pour optimiser la
prévention.
Motiver la communauté hospitalière à ce sujet sensible est
encore un vaste programme. ■
Andrée-Lucie Pissondes
16
Quand la l’hygiène reprend sa place : la première
●●●
LES DOUZE COMMANDEMENTS DE LA DÉESSE HYGIE
1 • A chacun de tes gestes au patient tu penseras
2 • Tes mains très souvent tu laveras
3 • De blouse quotidiennement tu changeras
4 • Avant désinfection toujours tu nettoieras
5 • Des produits la dose tu respecteras
6 • Le temps de contact préconisé tu observeras
7 • Les procédures écrites tu appliqueras
8 • La date de péremption tu vérifieras
9 • Jamais sans autorisation de produits tu
ne mélangeras
10 • Le balayage humide seul tu pratiqueras
11 • Le code couleur tu retiendras
12 • Sur ta pratique quotidienne souvent tu
t’interrogeras. Hélène De Ligt, cadre supérieur
infirmier hygiéniste, AP-HP
Source : «Hygiène hospitalière - Recommandations à l’usage
des personnels», Collection Les guides de l’AP-HP, Doin édi-
teurs/Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

18
Dans le domaine de la santé, le concept de l’évaluation se développe en France dès la fin des années
70, tant à l’initiative des pouvoirs publics que des professionnels de santé. A la connotation de
contrôle, de surveillance qui caractérise longtemps l’évaluation dans certains esprits, succède la notion
de démarche d’assurance qualité. En 1986, l’OMS définit l’audit comme «une procédure scientifique
et systématique visant à déterminer dans quelle mesure une action ou un ensemble d’actions attei-
gnent avec succès un ou des objectifs préalablement fixés». Le concept, appliqué à l’hygiène hospita-
lière, consiste en un examen méthodique et indépendant, analysant une situation. Comme l’explique
Muriel Rivet, cadre supérieur infirmier hygiéniste à l’hôpital Rothschild, «une évaluation des pratiques
par exemple, permet d’obtenir une photographie des pratiques du terrain à un instant donné. Selon
les résultats, l’évaluation peut éventuellement déboucher sur la modification du protocole ou sur une
actualisation des connaissances».
Les facteurs déclenchants
L’évaluation est généralement déclenchée après l’identification de certains facteurs, tels que :
– Un problème à répétition (rupture du stock d’essuie-mains).
– La gravité d’une situation (une épidémie de staphylocoques dorés résistants à la méticilline).
– Un changement d’orientation économique (changement de savons).
– L’amélioration de la qualité des soins (adéquation entre le type de lavage des mains et un acte de soins).
– Un projet d’établissement ou de service (mise en place de lavabos équipés).
Orientation de travail
«On peut tout évaluer. Les orientations données à une évaluation dépendent évidemment des facteurs
déclenchants, mais elles sont aussi fonction des points que l’on cherche justement à observer», indique
Muriel Rivet. Les audits en hygiène hospitalière connaissent 4 domaines de prédilection :
– La structure : l’audit est orienté sur l’architecture, les locaux.
– Les ressources : l’audit est orienté sur le mobilier, le matériel, les consommables.
– Les procédures (trois axes possibles). L’audit des pratiques, des attitudes ou celui des connaissances.
– Enfin, les résultats (pourcentage de professionnels observant un lavage des mains dans un service sui-
vant les référentiels définis).
L’évaluation peut donc connaître une orientation simple (un seul item) ou une orientation mixte (plu-
sieurs items). Elle se déroule sur une période variant d’une journée à plusieurs mois selon le projet.
Bien entendu, l’évaluation peut être menée par des personnes étrangères à l’établissement hospitalier,
tels des représentants du Cclin ou de l’Anaes
S’il est aujourd’hui grandement question de démarche d’assurance qualité et d’accréditation, la finali-
té de l’évaluation est avant tout de promouvoir la qualité des prestations dispensées aux usagers au
sein d’un établissement de soins. ■Isabelle Forestier
Évaluations en hygiène hospitalière
Pourquoi, comment...
Évaluation, audit... Ces deux mots sont dans toutes
les bouches. Mais en quoi consiste une évaluation ?
Est-il possible de tout évaluer ? Quels en sont
les critères ? A quoi cela sert-il ? Explications...
MÉTHODES
D’ÉVALUATION
Qui évalue qui ?
A cette question
font face des
volontés institu-
tionnelles et des
contraintes en
moyens humains.
Différents choix
sont possibles.
«La phase d’éva-
luation des pra-
tiques est l’abou-
tissement d’une
démarche infir-
mière comprenant
l’analyse de nos
pratiques, l’écritu-
re de nos procé-
dures, la réalisa-
tion de nos outils
d’évaluation et la
mise en œuvre de
l’audit», indique
Muriel Rivet.

19
INFIRMIER
fessions santé
pro
INFIRMIÈRE
Depuis les années 70, une espèce nouvelle est apparue, née de l’acquisition, à partir d’une bactérie
déjà résistante, d’une parcelle chromosomique qui transfert cette résistance à une autre bactérie.
Est ainsi créée une nouvelle souche, résistante d’emblée à l’antibiothérapie : l’Acinetobacter bauman-
nii. Le Lancet du 12 novembre 1994, faisait état d’infections à Acinetobacter baumanni à l’Hospital
Medical Center of Queens de New York entre septembre 1991 et septembre 1992 : 18 patients infec-
tés et 59 considérés comme porteurs.
Les prélèvements effectués révélaient la présence de la bactérie dans les lits, sur les tables, sur les appa-
reillages médicaux de surveillance, les respirateurs et sur les mains du personnel.
Acinetobacter baumannii est une espèce pathogène responsable d’infections nosocomiales dans les
services de réanimation médicale, chirurgicale ou neurochirurgicale, d’hémodialyse et de brûlés.
Une enquête réalisée en 1991 dans les CHU en France a montré que les I.N. à Acinetobacter sont liées
à la multirésistance de la bactérie aux antibiotiques et à sa persistance dans l’unité médicale.
Toutefois, l’incidence des colonisations de cette bactérie est de plus en plus fréquente en raison des
procédures d’investigations ou de thérapeutiques invasives.
La peau représente le site de prédilection initiale de la colonisation
Aussi toute rupture de la barrière cutanée, peut en présence d’une colonisation à Acinetobacter, être
le point de départ d’une infection locale ou sanguine. Ainsi, les infections rencontrées peuvent être
des septicémies (sur cathéters intra vasculaires), des broncho-pneumopathies après colonisation des
narines et du pharynx, ou encore des colonisations digestives.
A l’arrêt d’une alimentation entérale et au retour dans un environnement normal (hors assistance ven-
tilatoire par exemple), les colonisations pharyngées et digestives disparaissent. Les malades infectés ou
colonisés sont le réservoir primaire de la maladie. La contamination se propage très facilement aux
patients à l’intérieur d’un même service. L’environnement n’a qu’un rôle secondaire à partir des
malades atteints. La bactérie est essentiellement retrouvée sur les supports solides proches du patient.
Laérocontamination est très faible même en cas d’épidémie. Les bactéries se fixent sur les particules
présentes dans l’air qui vont ensuite se déposer rapidement sur les surfaces. Sur les sols hospitaliers,
13 % des prélèvements révèlent la présence d’Acinetobacter et celle-ci peut vivre 2 à 15 jours sur une
surface sèche.
Comme pour beaucoup d’agents responsables d’I.N. Acinetobacter évolue par bouffées épidémiques
sur fond d’endémie. Les bouffées épidémiques se font principalement par contamination directe
de patient à patient ou indirecte à partir de supports inertes contaminés et se transmettent par
manuportage.
En situation endémique dans un service, il est retrouvé 13 à 32 % d’Acinetobacter sur les mains du per-
sonnel, et cela malgré les nombreux lavages effectués.
Une souche résistante
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter a été longtemps considéré comme un
germe de la flore saprophyte et commensale, au même
titre que le staphylocoque à coagulase négative, sans
pouvoir pathogène d’emblée. Il a été retrouvé au sein
de la flore cutanée, mais aussi sur le sol, l’eau et les
environnements chauds et humides.
L’acinetobacter
baumannii est un
coccobacille
gram négatif,
non sporulé
et strictement
aérobie.
●●●

20
Ces infections sont préoccupantes car elles sont résistantes à de nombreuses classes d’antibio-
tiques et surviennent sur des terrains particulièrement fragiles.
Mais rien ne peut prouver que ce germe puisse, dans l’état actuel des connaissances, être un risque
létal chez des malades immunodéprimés ou atteints de maladies non curables. En effet, le même indi-
vidu immunodéprimé peut voir sa durée de vie abrégée par une surinfection grippale.
Par ces multiples pathologies l’hôpital est un foyer propice au développement des germes banals ou
pathogènes. Le sujet hospitalisé (comme le personnel) n’est pas à l’abri d’une contamination. Le risque
zéro n’existe pas et n’a jamais existé en milieu hospitalier.
C’est devant cet état de fait et de prise de conscience que les Clin ont été constitués. Ils suivent dans
chaque établissement les services à risques endémiques, quel que soit le germe référencé pour parer au
plus vite aux mesures médicales et sanitaires à prendre dans l’hypothèse d’une épidémie. Des enquêtes
de prévalence sont régulièrement assurées afin de pallier le risque épidémique, ainsi qu’une formation
continue sur le terrain des mesures d’hygiène à prendre et de la formation du personnel .
Des mesures d’hygiène strictes, mais simples, permettent d’éradiquer l’épidémie et de maintenir l’en-
démie à un niveau minimum.
La décontamination du matériel, qui risquerait d’être un réservoir, par l’application d’un désinfectant
de surface puis d’un nettoyage à l’eau de Javel de tout ce qui touche ou est proche du patient, doit
être assuré. Un temps de contact de 5 minutes doit être observé avant le rinçage.
Un deuxième nettoyage à l’aide d’un produit désinfectant détersif et nettoyant par pulvérisations doit
être fait. Le temps de contact est égal au temps de séchage du à l’effet rémanent du produit.
La sectorisation des patients atteints, le nettoyage-désinfection de la chambre du malade ou de l’unité
entière, l’utilisation de matériel à usage unique, et surtout un lavage des mains fréquents et soigneux
sont des mesures simples d’hygiène hospitalière.
Exemple de protocole appliqué au bloc opératoire du
CHU Bicêtre lors de la dernière épidémie de novembre-décembre 1998
Six patients atteints par l’Acinetobacter Baumannii faisaient l’objet de soins sous A.G. en salle septique
du bloc opératoire. Entre chaque malade, la salle d’intervention le mobilier et les accessoires subissaient
les étapes suivantes :
•Nettoyage de tout le mobilier au Surfanios®
•Nettoyage à l’eau de Javel de tout ce qui est en contact avec le patient en laissant agir 5 minutes
avant de rincer.
•Pulvérisation d’Amphospray®en respectant un temps de contact de 20 minutes.
En milieu hospitalier le problème des I.N. est fondamental, et quel que soit le germe, les mesures d’hy-
giène élémentaires doivent être constamment présentes à l’esprit. Qu’il s’agisse d’Acinetobacter bau-
mannii dans une épidémie récente ou d’autres germes connus ou encore inconnus, on ne pourra jamais
supprimer totalement le risque de surinfection, malgré les précautions minutieuses du personnel qui
apporte ses soins aux malades. ■Camille Foret
Ibode, Bloc opératoire CHU Bicêtre
* Surfanios®, Amphospray®Laboratoires Anios ; A.G. : anesthésie générale I.N. : infections nosocomiales ;
A. : acinetobacter
Sources : Et l’hygiène n°37 1993 • Panorama du Médecin nov. 1994 • Revue de presse A.P.-H.P. édition spéciale
du 16-01 au 22-01-99 • Protocole de décontamination pour le bloc opératoire : Mme Protin, surveillante
hygiéniste CHU Bicêtre.
Acinetobacter baumannii
●●●
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%