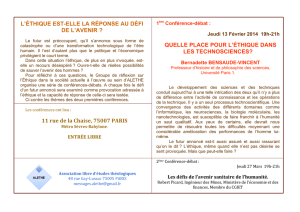La conscience chrétienne : choix du permis ou du compromis

Revue AH n°188 octobre 2005
1
La conscience chrétienne :
Choix du permis ou du compromis ?
L’objectif de cet article est d’apporter des éléments de réflexion et de décision
pour aider tout un chacun à se situer en vérité face à des « lois » qui sont à
recevoir non comme une contrainte inconditionnelle, mais comme une ressource
apte à nous éclairer et nous soutenir lorsque des circonstances particulières
viennent compliquer le choix des conduites à tenir.
On tirera davantage profit de ce qu’expose à ce sujet Patrice Pauliat, théologien
moraliste, si, à la lecture individuelle assez exigeante de ce texte, succède un
partage susceptible de faire apparaître ce que chacun en retient en se référant à
des expériences qui ont pu laisser des traces d’incertitude ou de perplexité.
A la question «
Que dois-je faire pour bien faire
? », qui est la question première
que se pose la conscience morale, la réponse n’est pas toujours une évidence. Si,
à la mesure des jours dans la répétition d’une vie quotidienne, le « devoir »
s’impose, il n’en va pas de même lorsque l’esprit se trouve en face de choix où
l’idéal des valeurs qui induisent mon comportement ne s’imposent plus
concrètement par un geste absolu, transparent et unique qu’il suffirait de
mettre en œuvre. La conscience guidée par sa loi intérieure et, dans la foi, par
les commandements de Dieu, n’en donne plus la recette et n’en impose plus
spontanément l’application.
L’Idéal impossible ?
Alors que les valeurs universelles que nous évoquions nous paraissent si
simples, si belles, au point de nous faire rêver et de nous donner la nostalgie du
paradis terrestre, pourquoi ce fameux « idéal » dont chacun porte en lui le désir
– et dont l’Ecriture comme l’Eglise tentent de nous tracer la voie – ne
fonctionne-t-il plus, n‘est-il plus d’emblée applicable à la lettre alors que nous en
possédons précisément la lettre même ?
Pour plusieurs raisons qui ne sont probablement pas assez réfléchies en ces
temps où le temps se fait court et où l’on agit souvent à la mesure de ses
idéologies ou – ce qui n’est pas mieux – de ses émotions spontanées.
De la Valeur aux valeurs : un choix s’impose
La première raison de l’opacité du bien « concret », incarné, à décider et du
geste à poser « ici et maintenant » est que l’on s’aperçoit que la valeur qui nous
enthousiasme tant dans son abstraction, c’est-à-dire son mirage, de soi est
vide, et qu’elle ne peut telle quelle s’appliquer à la vie. « Il suffit d’aimer »,
certes, « quand on n’a que l’amour » oui ; que souhaiter de mieux ? Cependant,
encore faut-il savoir ce que le mot cache et comment lui faire prendre chair et
sang. Que veut dire aimer face à un adversaire, voire un ennemi ? Que veut dire
« être juste » dans une entreprise où se pose la question d’entreprendre une
grève ou d’y mettre fin ? Que veut dire « respecter la vie » en réanimation
néonatale ou sur le chemin d’un processus conduisant inexorablement à la
mort ? Nous percevons ici que si l’idéal, valeur fondamentale pour le respect de
l’homme et sa dignité ne souffre pas de discussion, le réel va habiter la Valeur

Revue AH n°188 octobre 2005
2
de plusieurs autres valeurs parmi lesquelles il va bien falloir choisir car elles ne
pourront pas toutes subsister ensemble.
Dans le domaine médical qui nous concerne, « respecter la vie », impératif que
Dieu nous transmet dans le « Tu ne tueras pas » du Décalogue, peut signifier à
la fois refuser de voler la mort en refusant l’abus thérapeutique, refuser de
donner la mort en renonçant à l’euthanasie, et entrer dans un « donner de
mourir » lorsque l’heure est venue pour le souffrant de passer d’un vouloir vivre
terrestre à un vouloir vivre d’éternité. On l’accompagnera alors médicalement,
spirituellement voire religieusement dans ce passage, dernière et première
étape de l’homme invité par Dieu. De la Valeur, nous voici donc face à un
conflit de valeurs et donc à une perplexité de notre conscience indécise et
inquiète. Or, il nous faudra l’accepter comme première conversion : pas de
conscience adulte sans cas de conscience.
Le pur est aussi impur
Un autre élément ajoutant à la complexité de la décision éthique prend racine
dans une fausse conception du bien et du mal, comme si les comportements se
partageaient entre l’action pure –d’où nous sortirions superbement parfaits – et
l’action impure qui nous vouerait aux ténèbres éternelles. Or, il nous faut
accepter de ne jamais pouvoir rejoindre totalement l’idéal, de ne pas
maîtriser la totalité du bien, de demeurer, puisque le choix lui-même nous y
oblige, dans une certaine « immoralité ». Choisir en effet – condition de notre
liberté – c’est aussi renoncer à ce que je ne choisis pas et où pourtant se cache
aussi le bien, un bien que je ne puis que laisser échapper. Et il n’est pas
innocent que Jésus, tout en maintenant l’idéal du Décalogue comme fondement
éthique de l’agir humain (il n’est pas question, énonce-t-il, d’en changer un iota),
nous en montre la limite quand bien même la possibilité nous serait donnée d’en
respecter la lettre : si l’on peut être quitte avec la loi, on sera toujours en dette
d’amour. C’est pourquoi le double commandement concernant l’amour de Dieu
et du prochain, explicité par les Béatitudes, nous ouvre un espace d’exigences
infinies. Nul n’aura jamais fini d’aimer. Nul ne pourra se dire « satisfait » sur la
route de la perfection. «
Si tu dis : ‘’j’en ai fait assez’’, tu es mort
», écrit, avec
finesse, saint Augustin.
La moralité de la morale : une intelligence créatrice
On retiendra une troisième composante à la difficulté du discernement éthique,
particulière au croyant : l’idée foncièrement enracinée que la loi sous sa forme
d’impératif ou d’interdit serait –étant Parole de Dieu et donc inspirée par
l’Esprit – parfaitement immuable dans sa compréhension. Etrange attitude
d’ailleurs : puisqu’on admet aisément l’évolution du dogme pourtant lui aussi
fondé sur l’Ecriture, pourquoi condamner cette même Ecriture à une immuable
perception, obligeant l’homme dans le domaine de l’éthique – quelle que soit la
situation en laquelle il se trouve – à répéter sans autre forme de procès les
comportements figés hérités du passé ? Or la vie est à-venir, évolution,
changement, ce que les croyants ont dans le passé expérimenté, évalué, érigé
pour eux et pour leur temps comme l’expression pratique et historique des
valeurs permanentes et universelles ; nous avons nous aussi à l’inventer
pour notre temps, dans la fidélité à la valeur immuable mais avec d’autres
moyens, sous d’autres formes, par un autre chemin. Si les valeurs viennent de
Dieu et qu’on ne peut demeurer en son amour sans leur être fidèles, la manière
de les concevoir, comme les formes par lesquelles nous les exprimerons, doivent

Revue AH n°188 octobre 2005
3
et devront varier de manière constante et vivante. En chrétienté, ce n’est plus la
norme dans une compréhension univoque qui mérite le respect, mais la Parole
toujours neuve et parfois inattendue que, dans la marche avec le Christ,
nous adresse l’Esprit Saint. Nous pressentons à ce point de notre itinéraire
combien la question devient grave : considérons-nous la Bible, voire les écrits du
Magistère, dans la sphère de l’épanouissement et du bonheur des personnes et
des groupes comme des règles à transmettre, à imposer, à intégrer comme
indiscutablement normatives dans leur expression, ou bien considérons-nous
que la vie à la suite de Jésus est une activité créatrice, en recherche de
nouvelles incarnations pour dire aujourd’hui les exigences de toujours mais qui
se ramènent toutes à ceci : est-ce que dans les choix élus par ma conscience
j’humanise le plus possible l’homme – moi et les autres -, je christianise le mieux
possible le croyant – moi et mes communautés de foi -, j’engendre, au maximum
de mon discernement et de mes capacités, du vivant ? Il n’est pas de notion plus
éthique, et donc plus évangélique, que cette perspective : avoir la vie, donner de
la vie en abondance, en faisant le choix à travers les conflits les plus complexes
de ce que Dieu lui-même propose à l’homme ; «
Vois, je mets aujourd’hui devant
toi la vie et le
bonheur
… » (Dt 30, 15).
De l’application de recettes à une liberté responsable
Après avoir tenté d’esquisser le nouveau cadre éthique dans lequel doit
désormais s’exercer la conscience, il reste à considérer la difficulté majeure :
comment peut-on, dans la complexité des valeurs en cause, discerner avec
justesse, décider sans remords, et surtout mettre en œuvre courageusement
l’option choisie ? L’éthique sen effet ne permet pas de rêver, elle contraint à
faire et ce, nous l’avons dit, sans les sécurités – abusives mais reposantes pour
l’esprit – que nous offraient il y a peu de temps encore les recettes qui privaient
trop de consciences inquiètes de leur liberté singulière.
Permanence de la loi de Dieu vécue en Eglise
La première conversion, s’imposant comme base d’une éthique responsable, est
double.
D’abord tenir que la loi reçue de Dieu, ses commandements (interdits et
impératifs) demeurent des normes fondatrices ayant prix en tout temps et tout
lieu comme principes de l’idéal humain, comme le plus parfait universel à
rejoindre autant qu’il est possible. Mais l’idéal rêvé ne trouve pas son
incarnation intégrale dans le réel. Il est cet horizon vers lequel doivent se
porter le regard et le désir dans l’humilité de ne pouvoir l’atteindre. Du moins
doit-il toujours être pris en compte par une conscience qui se prétend éclairée,
lucide, en vérité face à elle-même. La vie, l’amour, la mort qui sont les enjeux
quotidiens de la pastorale de la santé et où la dignité humaine est profondément
engagée, obligent le croyant au regard qui est celui de son propre Créateur. Ce
que nous soulignons d’ailleurs ici des préceptes bibliques au sens strict vaut
également pour toute l’Ecriture. Ce lieu premier d’une morale qui se veut
théologique, et donc chrétiennement éthique, ne peut être ignoré et doit même
faire l’objet d’une réflexion, d’une méditation, d’une intériorisation exigeante. A
cela, il est tout aussi essentiel d’ajouter que cette parole de Dieu adressée à
l’homme passe aussi par la lecture qu’en fait l’Eglise, communauté vivant de
cette parole, qui y fonde sa foi et y trouve son épanouissement et sa joie. En
somme, on ne peut oublier – en chrétienté catholique – que le message biblique
pour être vécu amoureusement et donc « justement », a deux sources. Le Père

Revue AH n°188 octobre 2005
4
se révèle, et par l’Ecriture, et par cette même Ecriture méditée et expérimentée
communautairement, qu’expriment à un certain moment, sur certains sujets,
pour une époque culturelle donnée, les documents du Magistère. C’est ce qu’on
nomme : la Tradition, c’est-à-dire la vie croyante évaluée et transmise comme un
nouvel apport pour mieux vivre.
De l’émotion à la raison
Une autre exigence convoque la conscience, lorsque le choix n’est plus entre un
bien et un mal mais entre plusieurs valeurs en conflit, générant en notre liberté
une concurrence de devoirs souvent insupportable. La première attitude éthique
consiste alors à prendre le temps de calmer ses peurs premières, ses passions
angoissantes, le sentiment envahissant et presque paralysant que tout n’est que
malheur, que la catastrophe autorise le tout et le n’importe quoi pour échapper
au désespoir. Tel est souvent l’état provoqué par une grossesse non désirée
voire non désirable, par des souffrances difficiles à supporter, des douleurs
aiguës faisant envisager la mort… Chacun saura trouver dans sa vie des
exemples où il n’est plus lui-même tant il est « mal » selon l’expression
aujourd’hui consacrée. Sorti « hors de soi », il convient sans précipitation de
revenir « en soi » afin de se retrouver face à un réel moins pessimiste qu’un
imaginaire spontané ne l’avait suggéré. C’est alors qu’en concertation avec des
proches s’impose une évaluation paisible de la situation : n’existe-t-il pas de
solution qui permettrait de sortir de l’impasse en respectant l’exigence éthique
dans sa globalité ? Bien des fractures de vie, laissant beaucoup d’amertume, ont
tout simplement pour cause cette première étape oubliée. On a voulu faire
l’économie de la lenteur du temps. Or l’émotion, jusqu’à la déchirure de l’âme,
au même titre que l’amour-passion, n’est pas bonne conseillère. Les étapes vers
la paix retrouvée sont des passages obligés pour qui veut décider de manière
libre et responsable.
Quand le mieux nous échappe
Malgré une volonté d’application intégrale de la loi, il est encore possible que la
conscience se heurte à des obstacles la faisant hésiter entre diverses options. Et
en certains cas, elle ne pourra trouver de solution éthiquement satisfaisante que
dans la transgression de la loi elle-même. Ces transgressions sont parfois
nécessaires : au cours de l’histoire, bien des changements se sont imposés
comme allant de soi au fur et à mesure que progressait la conscience de
l’humanité. Dans l’Eglise elle-même, dès ses débuts, le Concile de Jérusalem a
choisi de renoncer à la pratique de la circoncision, ce qui a modifié
profondément l’esprit et la conduite de ses communautés. Et, plus tard, la
morale, dans le domaine concret de la situation éthique, a souvent évolué en ses
normes. A titre d’illustration, même si le respect de la vie s’impose toujours,
inspiré du «
Tu ne tueras pas
» décalogal, le Magistère, suivant les théologiens
les plus classiques, n’a pas hésité à justifier la légitime défense, la guerre au
nom de la justice, voire la peine de mort qu’un saint Thomas d’Aquin jugeait
exemplaire et donc socialement légitime pour la protection d’individus
innocents. La réflexion du même théologien conduira de la même manière à
permettre le vol contre le septième commandement, dans le cas où le manque
de nourriture mettrait la vie en péril.
On perçoit ainsi que, en fonction des situations et des expériences, la valeur
universelle, au contact de l’histoire particulière et de ses propres exigences
éthiques en faveur du respect de l’homme, peut et doit trouver des expressions
nouvelles, inédites, à l’opposé parfois – et au nom cependant d’une même valeur

Revue AH n°188 octobre 2005
5
– de ce qu’elle énonçait dans sa lettre. Autrement dit, si la valeur demeure
intangible, ce ne sera pas forcément le cas pour la loi.
Choisir de transgresser
Or il est un cas où la transgression nécessaire est perçue comme
particulièrement délicate et douloureuse : il s’agit du débat ne se posant plus au
sein du groupe, de la société, de l’Eglise, mais qui habite la seule conscience en
qui les principes, les valeurs, la difficulté à accepter l’idéal, à décider de ce qui
est « ici et maintenant » le plus humain possible, ou le moins inhumain
souhaitable, sont en conflit.
Nous ne sommes plus face à un déplacement collectif de normes particulières,
reconnu nécessaire par la majorité, même si elle oblige à un nouveau regard,
mais à un choix singulier relevant d’une décision personnelle devant soi, Dieu,
et les autres. Je pense ici aux désirs d’IVG, et à leur demande. En effet, une
valeur indubitable est l’accueil de la vie à naître, quelle qu’elle soit car elle est
une « autre vie » qui ne m’appartient plus et qui relève du Tout-Autre. Mais une
valeur aussi est la vie d’une femme se voyant contrainte à accepter à court et à
long terme ce qu’elle n’a pas librement désiré et qui – surtout à un très jeune
âge, ou dans le cas de malformations diagnostiquées avant la naissance – porte
aussi son drame, sa tragédie intime. Ici et là, deux vies à sauvegarder, à
défendre, à respecter. En faveur de laquelle se prononcer en conscience ?
Comment savoir répondre à la plus grande humanisation, au plus juste appel du
côté de Dieu ? De plus, comment y répondre également en fonction des
capacités psychologiques, intellectuelles, spirituelles, matérielles aussi
appartenant à chacun ?
Devant une telle situation, le moraliste s’attache d’abord à partager ces conflits
puisque la solution le dépasse. Mais il peut sans doute aider la conscience à voir
plus clairement les enjeux et à décider le plus sereinement possible.
Pour une éthique de la transgression
Outre les conditions déjà énoncées rendant la transgression recevable
éthiquement, il importe de souligner quelques repères pour que l’homme
demeure digne de lui, et fidèle à sa vocation de disiple du Christ.
Ainsi ne sera-t-il jamais possible de banaliser un acte qui de soi est grave en ce
qu’il touche l’homme en ses racines. En restant par exemple dans le domaine de
la santé, l’éthique interdira de considérer l’IVG comme un acte indifférent et
neutre : un embryon n’est pas un kyste ! C’est pourquoi, même si l’agir
humanisé ne peut se fonder uniquement sur le permis et le défendu, il se doit
cependant de le prendre en compte en priorité. Si tout vaut tout, sans
distinction, sans hiérarchie dans les valeurs, tout est insignifiant et la vie elle-
même perd son sens. Ainsi comment ne pas s’interroger sur l’évolution de la loi
Veil : de la dépénalisation pour les cas de détresse exceptionnelle, nous voilà
arrivés à l’avortement comme simple moyen de contraception.
Et pourtant il est également vrai qu’on ne peut juger d’un acte, lui donner une
qualification éthique uniquement d’après la matérialité de ce qu’il est. Pour
décider de sa moralité, il faut donc tenir compte de la signification que la
conscience décide de donner à tel comportement. On saisit alors combien
 6
6
1
/
6
100%