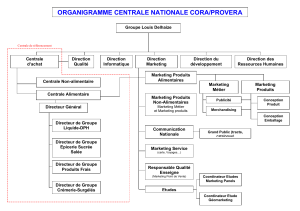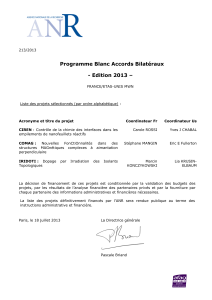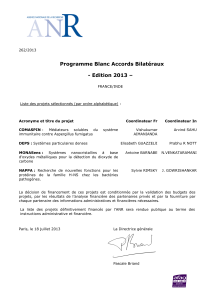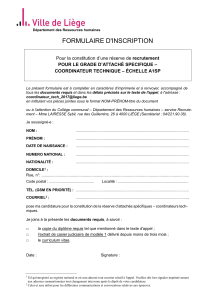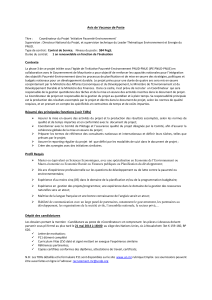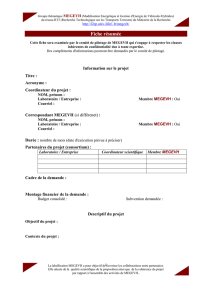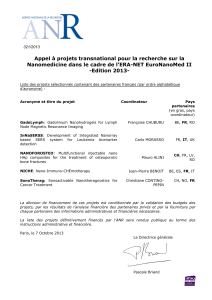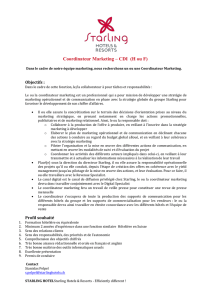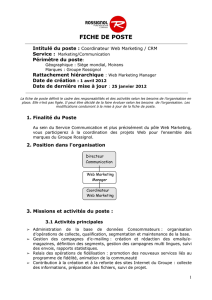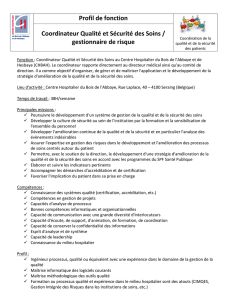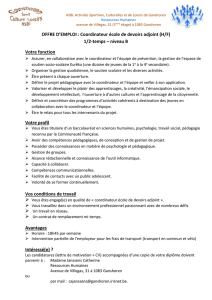Docteur Linda BENATTAR

DIU Médecin Coordinateur PARIS V – Projet de soins / Projet de vie / Projet d’établissement
Docteur Linda BENATTAR – 22 janvier 2007
1
LE PROJET DE SOINS
Il fait partie du Projet de Vie de l’établissement.
Le médecin coordinateur l’élabore avec l’équipe soignante et non soignante (libérale et
salariée) de l’établissement en collaboration avec l’infirmière coordinatrice référente, mais il
en est le garant.
Le but étant de « garantir une prise en charge gérontologique de qualité tout en maîtrisant les
dépenses de santé » selon les engagements de la convention tripartite.
Les principes de ce projet sont :
Coordination avec le réseau de soins local régional par le passage de conventions
Ouverture sur la ville et par des réunions d’information aux services médico-sociaux et
aux citoyens
Démarche qualité
Démarche éthique
Organisation des soins et de leur permanence
Evaluation des soins
Evaluation des risques
Participation aux admissions et accueil du nouveau résident et de sa famille
Mise en œuvre de programmes de prévention
Rapport annuel d’activités médicales
Formation continue des équipes
Recueil des consentements
Tout d’abord, il faut préciser que le médecin coordinateur n’a pas de pouvoir hiérarchique ;
s’il en a, c’est par délégation de la direction de l’établissement afin de mener à bien le projet
de soins.
L’idéal est de s’inclure dans l’équipe de direction afin de participer à l’ensemble du projet de
vie et de déterminer avec elle les grands objectifs de prise en charge ainsi, l’équipe se sentira
portée par trinôme uni ( IDEC-DIR-M.CO) qui la renforcera
Le Projet de Soins se décompose en plusieurs parties :
1. Le projet de soins global qui va influencer les objectifs du projet de vie ; en effet, en
connaissant l’état d’autonomie ou dépendance des personnes accueillies, il rendra plus
crédible le projet de vie, comment envisager le même projet de vie dans un établissement
où le GMP diffère parfois de 200 points !!, ou un établissement a plus de 60% de
personnes désorientés ?

DIU Médecin Coordinateur PARIS V – Projet de soins / Projet de vie / Projet d’établissement
Docteur Linda BENATTAR – 22 janvier 2007
2
2. Les projets des unités spécialisées
• Unités protégées accueillant des personnes désorientées
• Unités d’accueil temporaires
• Unités d’accueil de jour, de nuit parfois
• Unités de « répit » ou d’« accompagnement »
• Unités pour handicapés vieillissants
3. Les projets de soins individuels
Il tiendra compte de l’individu hébergé et sera articulé avec le plan de soins infirmiers
individualisé.
Son but principal est, tout en respectant le désir de la personne, son individualité dans la
collectivité de vie, de lui permettre de resocialiser, ou de maintenir une socialisation avec son
environnement familial.
Il faut se fixer des objectifs simples et réalistes, en équipe pour lui permettre malgré ses
handicaps de vivre dans la dignité, le confort, en privilégiant des petits plaisirs où des
moments précis de la journée lui sont chers ( visite d’un parent, partie de bridge,
feuilleton,…)
Le rôle du médecin coordinateur, c’est l’écoute, l’observation, l’échange, maintenir, stimuler,
oui, mais à quel prix pour la personne ? Pour quel bénéfice immédiat ou futur ? Est-elle
consentante ? Notre projet correspond-il à son désir ?
C’est toute la délicatesse et la finesse du rôle du médecin coordinateur qui entre en jeu. Ce
n’est pas le désir d’une équipe qui prône mais celui de la personne âgée.
a) La mise en œuvre des programmes de prévention :
- troubles cognitifs-troubles de l’équilibre
- malnutrition
- chutes
- pertes d’autonomie
- incontinence
- souffrance des soignants–accidents du travail
Il établit des feuilles de recueil, d’évaluation pour pouvoir analyser les risques, travailler sur
leur problématique : élaboration des menus spécifiques, programmes mictionnels, formations
adaptées, plans de stimulation.

DIU Médecin Coordinateur PARIS V – Projet de soins / Projet de vie / Projet d’établissement
Docteur Linda BENATTAR – 22 janvier 2007
3
b) Il évalue les risques :
- évaluation de la douleur
- risques infectieux ( BMR, locaux DASRI, procédures d’isolement)
- architecture
- décoration
- protection des zones à risques
- alimentaires-troubles de déglutition
- comportementaux
- maltraitances
- malveillances,….
et établit des plans d’action avec l’équipe et/ou la direction (inclure un exemple de plan
d’actions)
c) Il s’inclut dans un CLIC, met en œuvre des conventions de travail avec les
secteurs médico-sociaux :
- service psychiatrique
- cliniques privées médico chirurgicales
- centres hospitaliers
- équipes mobiles de soins palliatifs
- associations de bénévoles
où le partenariat peut dépasser les admissions des résidents notamment pour améliorer la
qualité de l’accueil de ces structures, pour les formations des équipes, pour des échanges de
connaissances….
d) Les consentements : (loi du 4/03/2002) sur le droit des malades
- Consentement aux soins
- Autorisation de contentions
- Autorisation de transfert
- Transmissions des données médicales
e) L’organisation des soins :
- Il participe au recrutement des personnels soignants
- Il participe à la répartition des postes des professions paramédicales et à leur choix
- Il met en place des procédures de travail, de suivi, d’urgence et des protocoles pour
potentialiser les actions des soignants
- Il travaille avec l’infirmière coordinatrice pour homogénéiser les interventions des
libéraux et celles des salariés de l’établissement, pour le respect de la traçabilité de leurs
actes

DIU Médecin Coordinateur PARIS V – Projet de soins / Projet de vie / Projet d’établissement
Docteur Linda BENATTAR – 22 janvier 2007
4
Il veille sur la qualité de ceux-ci dans le respect des personnes dont ils ont la charge.
Les intervenants paramédicaux : ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues,
kinésithérapeutes, s’intègrent à ce projet. Il a un rôle d’arbitre et le mieux serait de chef
d’orchestre, plutôt que celui de tampon des situations de crise ou de conflits.
Mieux vaut prévenir que guérir !
Comment ?:
Par la mise en place de réunions, d’échanges, de coordinations internes et ouvertes aux
intervenants libéraux. Il est le garant de cette harmonie.
Persuader les libéraux d’inscrire leurs plans de soins, de renseigner un dossier médical, de
remplir les fiches de suivi.
Comment faire quand les IDE libérales viennent faire leurs soins et les nursing à 5h30 du
matin et à 21h00 ; en institution privée, elles sont d’une grande aide mais comment accepter
cela ? A la signature de la convention, dans la majorité des cas, elles disparaissent,
l’organisation est à refaire, les tâches à répartir, les embauches à faire.
Comment faire quand un médecin libéral est appelé en urgence auprès de son patient et ne
vient que 48h après ? Où qu’il prescrit un régime amaigrissant à une dame qui a des escarres
aux 2 talons ? Ou encore un régime hyper-calorique sans graisses !
La permanence des soins, c’est vérifier, organiser, informer, afficher le nom des personnes
d’astreintes, la liste de garde des médecins, et mettre en place des procédures
d’hospitalisation, faciliter l’accès aux données médicales pour le service d’urgence (SOS
médecins, 15, SAMU,…)
L’évaluation des soins s’inscrit dans la démarche qualité : repérer les écarts, mettre en place
des audits internes de contrôle des tâches, des grilles d’auto évaluation : évaluer
l’amélioration de la qualité de la prise en charge par le traitement des plaintes, l’écoute des
soignants, la baisse de la malnutrition ou des chutes.
Elle fait partie du rapport annuel d’activités que le médecin coordinateur doit fournir aux
tutelles. Il comporte l’analyse statistique chiffrée des évènements survenus pendant l’année :
journée d’hospitalisation, nombre de décès, causes, chutes, contentions, formation des
équipes…
On analyse l’évolution du GMP et du PMP.
La formation institutionnelle présentée aux délégués du personnel s’intègre aussi au projet
de soins. Il doit tenir :
- Maladie d’Alzheimer
- Prévention de la maltraitance
- Gestes et postures
- Gestes d’urgences
- Accompagnement de fin de vie
- Prévention de la malnutrition
- Prévention des chutes

DIU Médecin Coordinateur PARIS V – Projet de soins / Projet de vie / Projet d’établissement
Docteur Linda BENATTAR – 22 janvier 2007
5
C’est un gage d’amélioration de la qualité.
La politique de l’établissement va beaucoup l’influencer : le médecin coordinateur se doit de
donner son avis, d’y participer ; de même, il doit donner son avis sur le choix des organismes
de formation, des prestations des formateurs, du contenu, qui doit s’adapter à la population
accueillie et au profil des soignants.
Les formations de terrain souvent élaborées et dispensées par le médecin coordinateur ou
d’autres personnes qualifiées dans l’institution ; elles vont permettre de résoudre des
problématiques spécifiques de l’institution au coup par coup.
Exemple : utilisation d’un lève malade, que faire devant un dément déambulant ou agressif ?
Que faire devant un refus d’alimentation ?
« C’est celui qui sait qui diffuse son savoir ! », mais gardons les pieds sur terre, la réalité est
tout autrement.
La démarche éthique
Il faut améliorer l’accompagnement des familles : en les intégrant dans la vie de l’institution
(projet de vie), mais aussi en réalisant des temps de rencontre, d’information dans le domaine
du soin, de la connaissance des pathologies de leur proche ; en les aidant à mieux supporter
l’aggravation, voire l’approche de la mort prochaine.
Le médecin coordinateur sera le garant :
- Du respect de la dignité
- Du respect de l’individualité
- D’une garantie d’un accueil personnalisé
- D’un travail de réflexion des équipes soignantes sur ces différents thèmes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%