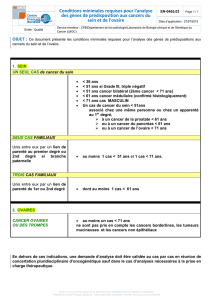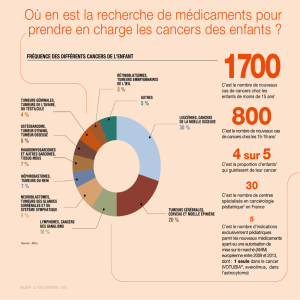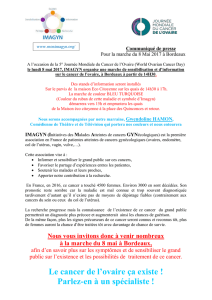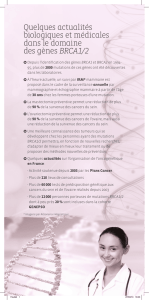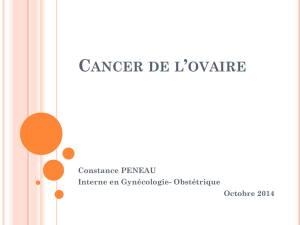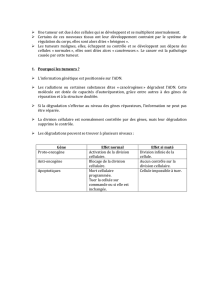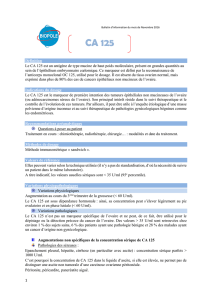Hypothèses physiopathologiques dans les tumeurs épithéliales de l

Hypothèses physiopathologiques
dans les tumeurs épithéliales de l’ovaire
C. Borg et E. Guardiola
Les tumeurs épithéliales de l’ovaire représentent la première cause de mortalité
par cancer gynécologique chez la femme. Le cancer de l’ovaire représente en
France, chaque année, 4 000 patientes dont 70% des cas sont diagnostiqués à
des stades tardifs. Le traitement des tumeurs épithéliales de l’ovaire de stade III
ou IV, essentiellement basé sur la chirurgie et l’administration de chimiothéra-
pies associant le plus souvent des sels de platine et des taxanes, ne permet la
guérison que de 20% à 30% des patientes.
90 % des cancers de l’ovaire sont décrits comme ayant une origine épithé-
liale. L’ovaire est une structure complexe constituée de nombreux types
cellulaires, assurant les fonctions de l’ovulation et une production hormonale.
L’épithélium ovarien se différencie à partir de l’épithélium cœlomique, au
cours de la phase précoce de l’embryogenèse.
De nombreuses études ont permis de mieux comprendre les processus de
l’oncogenèse des cancers. Les travaux de Fearon et Volgenstein ont permis
d’établir un modèle de cancérogenèse multi-étapes, montrant que la transfor-
mation de lésions bénignes de l’épithélium colique en cancer est le fait de
l’accumulation d’altérations génétiques (1). Cependant, si ces travaux ont
suscité de nombreux progrès dans la biologie du cancer, les mécanismes spéci-
fiques de l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire restent méconnus et
ces cancers sont toujours actuellement de mauvais pronostic. Une meilleure
compréhension des mécanismes de l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de
l’ovaire reste nécessaire pour l’introduction de thérapies ciblées dans cette
pathologie. Néanmoins, l’étude de la biologie de ces cancers est entravée par
leur découverte clinique tardive, la diversité des présentations histologiques et
l’absence de modèles animaux.
Ainsi, ce chapitre est dédié à la synthèse des données qui permettent l’iden-
tification des principaux gènes impliqués dans la genèse des cancers de l’ovaire.
Dans un premier temps, nous rapporterons quels sont les gènes « candidats »
identifiés dans les principales formes de cancers héréditaires de l’ovaire, puis
nous exposerons quelles sont les anomalies génétiques récurrentes dans les
formes sporadiques de cancers de l’ovaire, et enfin, nous décrirons les modèles

murins élaborés récemment où sont analysées les différentes étapes impliquées
dans l’oncogenèse des cancers de l’ovaire.
Existe-t-il des lésions ovariennes tumorales
de différents stades de malignité ?
L’histoire naturelle des tumeurs épithéliales de l’ovaire explique en partie la
complexité de l’étude des mécanismes oncogénétiques. On distingue cinq types
histologiques distincts : les tumeurs séreuses papillaires, les tumeurs endomé-
trioïdes, les tumeurs mucineuses, les tumeurs à cellules claires, les carcinomes
à cellules transitionnelles.
Par ailleurs, on peut également distinguer plusieurs catégories de tumeurs
de l’ovaire correspondant à des lésions de différents stades de malignité : les
tumeurs bénignes, les tumeurs « borderline » et les tumeurs malignes. Une filia-
tion entre une prédisposition à des lésions pré-cancéreuses ou à faible degré de
malignité et des lésions malignes invasives n’a jamais été démontrée. Resta et al.
ont étudié une cohorte de 200 patientes opérées de cancers ovariens unilaté-
raux et observé la présence de lésions hyperplasiques ou métaplasiques de
l’épithélium de surface des ovaires controlatéraux dans 92% des cas, suggérant
la possibilité de l’existence de lésions prédisposant aux cancers ovariens (2).
L’analyse comparative des remaniements génétiques des tumeurs ovariennes
de différents stades de malignité pourrait permettre l’identification des anoma-
lies communes aux différentes entités nosologiques. Cette approche pourrait
orienter la recherche des altérations génétiques impliquées dans l’oncogenèse
des cancers ovariens.
Ainsi, l’étude génétique des cancers ovariens à l’échelle chromosomique par
technique d’hybridation génomique comparative (CGH) a mis en évidence des
gains ou des pertes de matériel génétique récurrents dans les grandes entités des
tumeurs épithéliales.
Cheng et al. ont montré qu’il existait une perte d’hétérozygotie affectant le
bras q du chromosome X, dans les tumeurs « borderline ». L’étude de la méthy-
lation de l’ADN a montré que cette perte d’hétérozygotie affectait le
chromosome X inactivé (3). Ce profil de CGH différait des observations élabo-
rées à partir de l’analyse de tumeurs épithéliales invasives, suggérant que ces
entités ont des histoires naturelles distinctes. Ainsi, les techniques d’analyse des
remaniements chromosomiques n’ont pas abouti à l’identification d’altérations
génétiques communes aux tumeurs ovariennes de différents stades de mali-
gnité. Les mécanismes de l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire sont
longtemps restés méconnus.
La caractérisation des mécanismes physiopathologiques des cancers ovariens
a nécessité la synthèse de données émanant de trois axes différents :
– l’étude des anomalies génétiques germinales prédisposant aux cancers de
l’ovaire ;
48 Les cancers ovariens

– l’observation anatomo-pathologique par immuno-histochimie ou
biologie moléculaire des altérations moléculaires récurrentes, dans les tumeurs
sporadiques ;
– les données apportées par les modèles murins.
Les formes héréditaires de cancers ovariens.
L’étude des cancers ovariens familiaux permet d’identifier des candidats impli-
qués dans l’oncogenèse de ces tumeurs. En effet, si 90% des tumeurs
épithéliales de l’ovaire sont sporadiques, 10% d’entre elles sont héréditaires.
On distingue, parmi ces dernières, deux maladies héréditaires à transmission
autosomique dominante.
Syndrome des cancers héréditaires du sein et de l’ovaire.
Les cancers du sein et de l’ovaire héréditaires sont associés le plus souvent à des
mutations des gènes BRCA1 (Breast Cancer 1) et BRCA2 (respectivement
dans 65% et 75 % des cancers ovariens héréditaires). BRCA1 (chromo-
some 17q) et BRCA2 (chromosome 13q) sont deux gènes suppresseurs de
tumeurs. La probabilité de développer un cancer de l’ovaire pour des patientes
porteuses de mutations de ces gènes est de 10 à 63%. La variabilité de cette
pénétrance rend compte de l’importance de facteurs environnementaux,
hormonaux ou de l’acquisition d’événements génétiques supplémentaires (4).
Des mutations de BRCA1 sont aussi identifiées dans les formes sporadiques de
cancer de l’ovaire, suggérant une fonction suppressive de tumeur dans ce
contexte (5). BRCA1 et BRCA2 ont majoritairement une activité d’activateur
transcriptionnel et de régulateur de la réparation de l’ADN. BRCA1 est une
protéine impliquée dans la détection des anomalies nucléotidiques, des cassures
simple-brin et double-brin. BRCA1 intègre le complexe de l’ARN polymérase
II pour identifier précocement les anomalies de la réplication de l’ADN.
BRCA2 pourrait interagir avec la protéine RAD51 impliquée également dans
la réparation de l’ADN.
Le syndrome des cancers colorectaux non polypoïdes hérédi-
taires (HNPCC)
Le syndrome HNPCC (hereditary non polyposis colorectal cancer) est caractérisé
par l’apparition de cancer du cadre colique droit, de l’endomètre et des ovaires.
Ce syndrome implique des anomalies des gènes codant pour le système de
réparation des mismatch (MMR) (6). La plupart des cancers ovariens de ces
Hypothèses physiopathologiques dans les tumeurs épithéliales de l’ovaire 49

syndromes héréditaires sont des tumeurs séreuses. Les tumeurs « borderline »
et mucineuses sont rarement observées dans ce contexte. Ces données suggè-
rent encore une distinction dans l’initiation de l’oncogenèse entre ces
différentes entités. Le syndrome HNPCC implique une anomalie germinale
d’un gène impliqué dans la réparation de l’ADN comme MSH2, MLH1,
MSH6, PMS1 ou PMS2. La perte de fonction de ces gènes est associée à une
instabilité du génome tumoral, caractérisée par l’insertion ou la délétion de
nucléotides dans des loci du génome comprenant des séquences répétées. Cette
instabilité génétique favorise l’accumulation de mutations favorables à l’évolu-
tion maligne des processus tumoraux. L’altération des fonctions contrôlées par
ces gènes pourrait être importante pour l’oncogenèse ovarienne.
Anomalies génétiques observées dans les cancers
sporadiques de l’ovaire
D’une manière générale, l’oncogenèse associe des remaniements génétiques
permettant la perte de la fonction d’un gène suppresseur de tumeur, l’activa-
tion d’un oncogène et l’apparition d’un phénotype d’instabilité génétique
favorisant l’accumulation de mutations au sein de certains gènes qui peuvent
conférer aux cellules tumorales les capacités de prolifération, d’invasion, de
migration, d’angiogenèse et de résistance à l’apoptose.
Perte de gènes suppresseurs de tumeur
L’étude de marqueurs polymorphiques permettant l’analyse de la perte d’allèles
dans les tumeurs a révélé de fréquentes pertes d’hétérozygotie affectant les
régions chromosomiques 6p, 11p, 13q, 14q, 17p, 17q, 18q, 22q et Xp. Cela
peut signifier l’implication de nombreux gènes suppresseurs de tumeurs dans
l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire ou une instabilité chromoso-
mique (3, 7). On note la fréquence des altérations du bras court du
chromosome 17 dans la séquence codant pour p53 dans les tumeurs épithé-
liales de l’ovaire à fort potentiel de malignité, contrairement aux formes
bénignes ou « borderline » (8). De même, les altérations du locus 17q22-23
codant pour BRCA1 sont fréquentes. Pieretti et al. ont montré que l’absence
du chromosome 17 dans des tumeurs épithéliales séreuses de l’ovaire était asso-
ciée à un haut grade nucléaire. Ces données suggéreraient que la perte du
chromosome 17 pourrait conférer aux cellules tumorales un avantage sélectif
lors de la progression tumorale correspondant à un phénotype tumoral plus
agressif (9). A l’inverse, les pertes du chromosome 17 ne sont pas fréquentes
dans les tumeurs mucineuses de l’ovaire.
50 Les cancers ovariens

Les pertes d’hétérozygotie observées sur d’autres chromosomes ont permis
de suspecter que la perte d’autres gènes suppresseurs de tumeur pourrait être
impliquée dans l’oncogenèse des tumeurs épithéliales de l’ovaire. Ainsi, PTEN,
une phosphatase codée par un gène sur le locus 10q23.3, est mutée dans un
certain nombre de cancers endométrioïdes. PTEN contrôle négativement l’ac-
tivation de la voie AKT/mTOR.
On a également observé des mutations des gènes codant pour les protéines
contrôlant négativement les cyclines, qui permettent la progression du cycle
cellulaire. Ainsi, il est possible d’observer des délétions homozygotes de P16
dans 15% des tumeurs épithéliales de l’ovaire (10). P16 est une protéine de la
famille INK4 (cyclin-dependent kinase-4 inhibitor genes), qui contrôle négative-
ment la progression du cycle cellulaire. D’autres inhibiteurs du cycle cellulaire
comme P15, P18 et P19 peuvent être altérés dans les cancers ovariens.
Disabled homolog 2 (DAB2) est une protéine impliquée dans l’organisation
des cellules épithéliales ovariennes. Des études immuno-histochimiques ont
montré la perte de l’expression de DAB2 dans 80% des cancers ovariens (11).
Gain d’un oncogène
Les oncogènes codent pour des molécules favorisant la transformation et la
progression des cellules cancéreuses. Ces molécules peuvent être des peptides
ou protéines interagissant avec des récepteurs aux facteurs de croissance, des
molécules de signalisation intracellulaire ou des facteurs de transcription favo-
risant la prolifération, la survie ou la migration des cellules tumorales.
Le récepteur c-erb2 est surexprimé dans moins de 25% des cancers de
l’ovaire. Cependant, une étude comparant les tumeurs primitives et les lésions
obtenues au décours de la progression de ces cancers sous forme d’ascite,
montre que la majorité des maladies évolutives expriment c-erb2 (12). Ceci
peut signifier que l’acquisition de c-erb2 est corrélée à un avantage sélectif pour
la prolifération de certaines cellules tumorales. Néanmoins, l’implication de
l’expression de c-erb2 dans le pronostic et la prédiction de la réponse théra-
peutique est toujours un point controversé.
La protéine RAS est une protéine intracytoplasmique liée à la membrane
plasmique. RAS a une activité GTPasique. Certaines mutations de RAS indui-
sent une activation constitutive de cette molécule qui engendre la
phosphorylation de la sérine thréonine kinase sous-jacente et l’activation chro-
nique des voies de signalisation intracellulaire. Des mutations activatrices des
gènes de la famille RAS ont été observées dans les tumeurs mucineuses de
l’ovaire (13). Ortiz et al. ont étudié les mutations survenant dans le gène
codant pour K-RAS dans une cohorte de tumeurs à faible potentiel de mali-
gnité et de tumeurs épithéliales séreuses invasives survenant secondairement.
Ces auteurs décrivent des mutations de K-ras différentes dans ces deux entités.
Ces données suggèrent que l’oncogenèse des tumeurs séreuses « borderline » et
Hypothèses physiopathologiques dans les tumeurs épithéliales de l’ovaire 51
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%