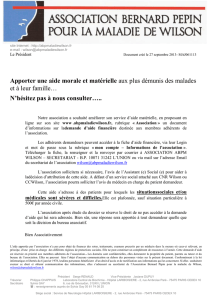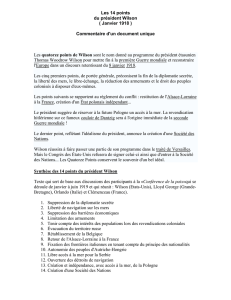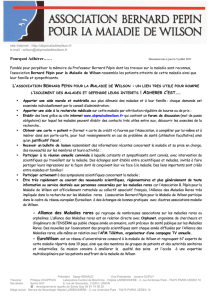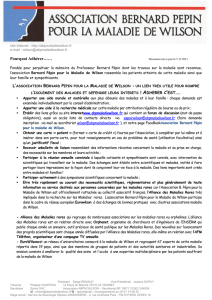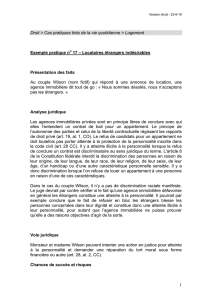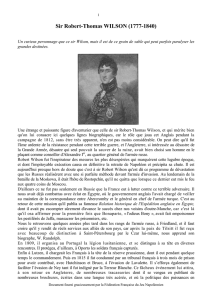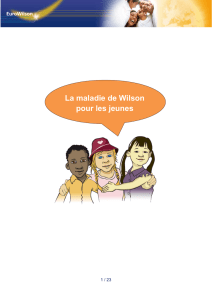LA MALADIE DE WILSON A PROPOS DE 4 CAS

Médecine du Maghreb 1996 n°60
RÉSUMÉ
La maladie de Wilson est une affection métabolique
héréditaire liée à l’accumulation de cuivre dans l’orga-
nisme. Notre étude concerne 4 malades, 3 garçons et
1 fille avec un âge moyen de 21,75 ans. Tous nos patients
ont une forme évoluée de la maladie de Wilson. Le
diagnostic est posé par la confrontation anatomo-clini-
que et biologique (cuprémie, cupriurie et céruloplasmi-
ne sanguine).
Le traitement est basé sur la D-penicillamine. L’ é v o -
lution a été marquée par le décès de 3 malades dans un
tableau d’HTP sur cirrhose hépatique. Ceci souligne
l’intérêt du diagnostic précoce par le dépistage chez les
membres de la famille.
s’exprime cliniquement qu’à l’état homozygote, alors que
les hétérozygotes ne développent jamais la maladie.
Dans cette affection, il existe 2 anomalies probables dans le
métabolisme du cuivre : (3, 10, 12, 20).
• Diminution du taux de cérulo plasmine
• Diminution de l’élimination biliaire de cuivre.
On rapporte 4 cas de maladie de Wilson diagnostiqués tar-
divement, ce qui souligne l’intérêt du dépistage surtout des
formes familiales.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
L’étude porte sur 4 malades hospitalisés dans le Service de
Médecine C (Pr. M.F. Sebti) (Hôpital Ibn Sina) entre 1992
et 1995.
Tous nos malades ont bénéficié d’un examen clinique
complet, et paraclinique, notamment un examen ophtalmo-
logique à la lampe à fente, un bilan cuprique, une endosco-
pie haute, une laparoscopie et une ponction biopsie hépati-
que lorsque le bilan de crase le permet.
LA MALADIE DE WILSON
A PROPOS DE 4 CAS
I. SASSENOU, R. AFIFI, I. BENBELBARHDADI, A. AOURAGH, M. BENAZZOUZ, A.E. ESSAID, M.F. SEBTI.
Adresse : Dr I. SASSENOU, Clinique Médical C, Centre hospitalier
Universitaire Ibn Sina. Rabat. MAROC. Adresse personnelle : Mr Ismail SASSENOU : Im. 10, Appt. 2, Hay Al
Mountazah, C.Y.M. Rabat Maroc.
INTRODUCTION
La maladie de Wilson est une affection métabolique,
héréditaire, à transmission autosomique récessive, elle ne
LES OBSERVATIONS : (Voir tableau)
Tableau récapitulatif des observations des malades
Obs. Manifestations Manifestations Manifestation Cuprémie Cupriurie Ceruloplasmine Traitement Evolution
Hépatiques Neurologiques Oculaire (V.N : 090- (V.N : sanguine (V.N. :
1,20 mg/l) 0-1,06 mg/j) 200-400 mg/l)
N°1 Cirrhose du foie avec Syndrome (-) 0,56 0,100 mg/j 169 mg/l D- Décédé 1 an
HTP en décompensation extra- penicillamine après le début
hémorragique pyramidal du traitement
(PBF non faite)
N°2 Cirrhose du foie avec HTP (-) (-) 0,36 mg/l 1,398 mg/j 70 mg/l D- Evolution station-
en décompensation œdémato- penicillamine naire après 6 mois
ascitique (BPF faite) de traitement
N°3 Cirrhose du foie avec HTP Syndrome Anneau de 0,95 mg/l 0,12 mg/j 80 mg/l D- Décédé
en décompensation œdémato- extra- keiserfleisher penicillamine
ascitique pyramidal
N°4 Cirrhose du foie avec HTP Syndrome (-) 0,14 mg/l 0,07 mg/j 80 mg/l D- Décédé
en décompensation extra- penicillamine
œdémato-ascitique pyramidal
(PBF :cirrhose hépatique)

Médecine du Maghreb 1996 n°60
Observation n°1 :
C’est un patient de 27 ans, issu d’un mariage consanguin
(1er degré) qui a présenté 6 ans auparavant une hématéme-
se de moyenne abondance, le bilan fait était en faveur
d’une cirrhose du foie avec une hypertension portale, l’Ag
Hbs (+), l’Ac Hbs (-), l’Ac Hbc (+), et l’Ac antiHCV (-).
L’évolution était bonne sous sclérothérapie, après le mala-
de a développé des troubles neurologiques faits de pertur-
bation de la marche, tremblement et syndrome extrapyra-
midal. Le bilan cuprique orientait vers une maladie de
Wilson, et le malade a été mis sous D-pénicillamine. Le
patient est décédé 1 an après le début du traitement dans un
tableau hémorragique.
Observation n°2 :
C’est un jeune de 15 ans, issu d’un mariage non consan-
guin sans antécédents pathologiques, qui a présenté il y a 3
mois un syndrome oedèmato-ascitique, l’examen neurolo-
gique est normal.
L’échographie abdominale, la fibroscopie haute, la lapa-
roscopie et la ponction biopsie du foie sont en faveur d’une
cirrhose hépatique avec hypertension portale, le bilan
cuprique a orienté vers une maladie de Wilson. Le malade
prend alors de la D-pénicillamine, et l’évolution est
station-naire, après 6 mois de traitement.
Observation n°3 :
Patient de 22 ans, issu d’un mariage consanguin de 2ème
degré. Dans ses antécédents on note une crise d’épilepsie à
l’âge de 12 ans, avec un frère décédé d’une cirrhose du foie
dont l’origine n’a pas été étiquettée.
Le début remonte à 1 mois par l’apparition d’un syndrome
oedèmato-ascitique, l’examen neurologique retrouve un
syndrome extrapyramidal. Le bilan conclue à une maladie
de Wilson dans sa localisation hépatique, neurologique et
ophtalmologique. Le patient est décédé d’une encéphalo-
pathie sur infection du liquide d’ascite.
Observation n°4 :
Patiente de 23 ans, sans antécédents pathologiques, hospi-
talisé pour syndrome oedèmato-ascitique, le bilan biologi-
que est en faveur d’une maladie de Wilson dans sa forme
hépatique et neurologique. La malade est mise sous D-
pénicillamine mais décédé après 1 an de traitement dans un
tableau infectieux et encéphalopathique.
DISCUSSION
Dans les condition,s normales, après son absorption par la
partie proximale du tube digestif, le cuivre est transporté
dans le sang sous plusieurs formes :
- Dans les hématies, 50% du cuivre est lié à la superoxyde
dismutase, le reste du cuivre érythrocytaire soluble est
e n
partie lié à des aides aminés.
- Dans le plasma, 90% du cuivre est lié à la céruloplas-
mine, les 10% restants sont liés soit à l’albumine soit à
des acides aminés. Après sa captation hépatique, le
cuivre est lié de façon prépondérante à la métallothio-
néine, cette forme est ensuite rapidement dégradée et
utilisée dans la synthèse de certaines enzymes et dans la
céruloplasmine. L’excrétion du cuivre est biliaire. (9)
Notre étude a intéressé 4 malades dont l’âge moyen est de
21,75 ans avec des extrêmes allant de 15 à 27 ans, en effet
(9) la maladie de Wilson est une affection de l’enfant et de
l’adulte jeune. On a recensé 3 garçons pour 1 fille. Il n’y a
pas de prédominance de sexe (9, 11).
Sur le plan clinique le foie est l’organe qui est le premier
atteint (14). Les 4 malades sont vus au stade de cirrhose du
foie, 3 d’entre eux avec décompensation oedémato-asci-
tique, 1 cas avec hémorragie haute.
Dans 3 cas, il y avait une atteinte neurologique qui s’est
exprimée par un syndrome extrapyramidal. Cette mani-
festation est variable (2, 13) dominée essentiellement par
l’atteinte extra-pyramidale, aussi on peut avoir un syndro-
me cérébelleux, un syndrome pyramidal, des crises d'épi-
lepsies, et parfois des troubles psychiques.
L’atteinte oculaire est notée dans 1 cas sous forme d’un
anneau de Keiser fleisher. Il s’agit d’une précipitation de
sels de cuivre en granules irréguliers à la face postérieure
de la membrane de Descemet (2). Une cataracte peut être
notée (9).
Dans notre étude, aucun cas d’anémie hémolytique n’a été
rapporté. Le mécanisme de cette anémie est mal connu
tantôt il est assimilé aux grandes hémolyses observées chez
les cirrhotiques dont le caractère est à la fois corpusculaire
et extra-corpusculaire, tantôt cette anémie est liée aux
anomalies du métabolisme du cuivre (8).
I. SASSENOU, R. AFIFI, I. BENBELBARHDADI, A. AOURAGH,
M. BENAZZOUZ, A.E. ESSAID, M.F. SEBTI.
22

Médecine du Maghreb 1996 n°60
1 cas d’hypersplénisme, avec un syndrome de consomma-
tion. Le TP est effondré dans tous les cas. Ces anomalies
sont décrites dans la littérature (8, 19).
Le bilan cuprique montre une baisse de la cuprémie chez
3 malades, dans 1 cas la cuprémie est normale, la cérulo-
plasmie sanguine est basse dans tous les cas, la cupriturie
quand à elle est augmentée chez les 4 malades. Ces pertur-
bations du métabolisme du cuivre ne sont pas constantes
voire non spécifiques, en effet la céruloplasmine plasma-
tique est normale, parfois élevée dans 5% des cas (9). De
même la cuprémie peut être normale. Le dosage de la
cupriurie seule ne permet pas de différencier la maladie de
Wilson des autres hépatopathies (9).
La PBF faite dans 2 cas n’a pas montré d’aspect spécifique
de la maladie de Wilson, cependant au cours de cette mala-
die on a uniquement des aspects de fibrose et de stéatose.
La certitude n’est faite que par le dosage de cuivre hépati-
que qui est augmenté (19). Cependant pour des raisons
techniques, ce dernier n’a pu être dosé, à noter qu’il peut
être normal dans certains cas (15).
Chez nos malades, on n’a pas d’atteinte rénale, ni ostéo-
articulaire, ni cutanéo-muqueuse. Ces manifestations peu-
vent être représentées par une tubulopathie, une lithiase
urinaire (18), une ostéoporose une ostéomaladie, des frac-
tures spontanées, une chondrocalcinose et une hyperpig-
mentation cutanée (9).
Tous nos malades sont vus à un stade évolué de la maladie.
Le traitement proposé est la D-pénicillamine.
En effet dans les formes graves de cette pathologie, le
traitement médical garde sa place, (16), puisqu’il permet la
stabilisation et même la régression de l’atteinte neuro-
psychiatrique et ophtalmique.
L’instauration précoce de la D-penicillamine permet d’évi-
ter la cirrhose du foie (14, 16), mais si celle-ci est déjà ins-
tallée, la chirurgie par la greffe hépatique reste la meilleure
alternative chirurgicale (17).
L’évolution était jugée surtout sur les troubles neurolo-
giques, qui se sont amendés avec disparition du tremble-
ment et diminution des autres troubles extrapyramidaux,
cependant on a déploré 3 décès, dont 1 par décompensation
hémorragique et 2 par encéphalopathie sur infection du
liquide d’ascite.
Pepin dans un travail comportant 30 cas, traités par la D-
penicillamine, l’évolution de signes neurologiques a été
favorable chez 21 sur 24. Sur 18 patients sans atteinte
hépatique notable, 2 sont décédés du fait de l’évolution
cirrhogène,e, après 5 et 15 années de traitement, 3 des 8
cas de cirrhose d’emblée évoluée sont décédés moins d’un
an après la mise en route du chélateur. L’anneau de Keiser
fleisher a disparu chez 11 patients, en moyenne en 5 ans.
Les manifestations hématologiques et rhumatologiques
n’ont pas été influencées par la pénicillamine (16).
Cependant le traitement par la D-penicillamine peut s’ac-
compagner d’effet secondaire à type d’exagération des
troubles neurologiques, thrombopénie ou manifestation
allergique (5). D’autres alternatifs thérapeutiques existent à
type de triéthylène tétramine dihydrochloride (TETA) ou
sulfate de Zinc (8, 10).
CONCLUSION
Le pronostic de la maladie de Wilson dépend de la précoci-
té du traitement, aussi faut-il penser au Wilson devant tout
syndrome extra pyramidal du jeune mais aussi devant un
ictère récidivant sans étiologie évidente.
L’idéal serait d’instaurer le traitement à un stade asympto-
matique, ce qui permet d’éviter toutes ses complications.
De ce fait apparaît l’intérêt du dépistage et des enquêtes
LA MALADIE DE WILSON… 23
familiales systématiques devant un cas de Wilson.
BIBLIOGRAPHIE
1. AL. MOFLEH, AL. RASHED, AYOOLA.
Hepatic manifestations of Wi l s o n ’s disease. Frequency and pattern in
Saudi patients.
Trop. Gastro. Enterol. 1993 Juil. Sep. 14 (3). P. 91-8.
2. K. ALZEMMOURI, M. ELALAOUI FARIS.
Manifestations neurologiques de la Maladie de Wilson.
Maroc medical, tome VII, n°4 dec. 1985.
3. S.V. BELLARY, DH. VAN THIEL.
Wi l s o n ’s disease : a diagnosis made in two individuals greater than 40
years of age.
J. Okla state Med. Assoc. 1993, Sep.86 (9). P. 441-4.
4. J.G. BREWER, MD. ROBERT, D. DICK.
Treatment of Wilson’s disease with ammonium tetrathiomolybdate.
Arch. Neurol. Vol 51, June, 1994, 545-54.
5. J.G. BREWER, M.D.
Development of neurologic symptoms in a patient with asymptomatic
Wilson»s disease treated with penicillamine.
Arch. Neurol. vol 51, Mar, 1994, 304-305.
6. G.J. BREWER, V. YUZBAZIYAN-GURKAN.
Wilson disease.
Medicine (Baltimore). 1992 May. 71 (3). P. 139-64.
7. L. CONDAMINE, O. HERMINE, P. ALVIN.
Acquired sideroblastic anaemia during treatment of Wilson’s disease with
triethylene tetramine dihydrochloride.

Médecine du Maghreb 1996 n°60
24 I. SASSENOU, R. AFIFI, I. BENBELBARHDADI, A. AOURAGH,
M. BENAZZOUZ, A.E. ESSAID, M.F. SEBTI.
British Journal of Hematology 1993, 166-168.
8. J. DEBRAY, M. KRULIK, R. BLANCHON.
Les désordres hématologiques au cours de la maladie de Wilson (à propos
de 2 observations personnelles).
Ann. Med. Interne, Juin-Juillet, 1971, 122 n°6-7, 737-742.
9. F. DURAND, J.P. BENHAMOU.
Maladie de Wilson.
EMC (Paris) 7037. A10, 1992.
10. A. FAVIER.
Métabolisme du cuivre.
EMC-Glandes nution (Paris) 1990, 10359 C10 (8p).
11. H.H. GILL, SHANKARANK.
Wilson’s disease : Varied hepatic presentations.
Indian. J. Gastroenterol. 1994, Jul. 13 (3) p.95-8.
12. SP. HORSLEN, MS. TANNER, TD. LYON.
Cooper associated childhood cirrhosis.
GUt, 1994 Oct. 35 (10) P. 1497-500.
13. LE GOZ.
Maladie de Wilson.
EMC (Paris) 17060 A10, 1992.
14. M. ODIEVRE, J. VEDRENNE, P. LANDRIEU.
Les formes hépatiques «Purs» de la Maladie de Wilson chez l’enfant, à
propos de 10 observations.
Arch. Franc. Ped, 1988, 45, 565-7.
16. B. PEPIN, B. GOLDSTEIN, C. LIDY.
Le traitement de la Maladie de Wilson à propos de 30 cas.
Ann. Med. Interne, 1980, 131, n°1, 23-27.
17. M. RELA, ND. HEATON, V. VOUGAS.
Orthotopic liver transplantation for hepatic complication of Wi l s o n ’s
disease.
Br. J. Surg. 1993, Jul. 80 (7). P. 909-11.
18. Y. STEPHEN, NAKADA, R. MARILYN.
Wilson’s disease presenting as symptomotic urolithiasis : a case report and
review of the litterature.
The journal of Urology : Vol 152, 978-979, September 1994.
19. STREMMEL, M.D. WOLFGANG.
Wilson disease : clinical presantation, treatment and survival.
Annals of interna medicine, 1991, 115-720-726.
20. STREMMEL, M.D. WOLFGANG.
Pathogenisis of Wilson’s disease.
Z Gastro. Enterol. 1992 Mar. 30 (3) P. 199-201.
21. J.M. WALSHE.
Treatment of Wi l s o n ’s disease with trientine (trienthylène tetramine)
dihydrochloride.
1
/
4
100%