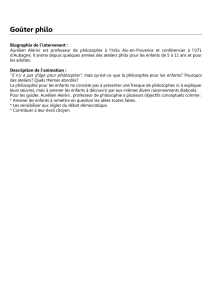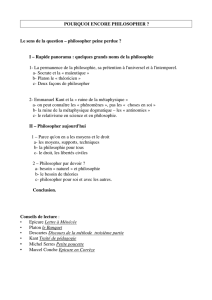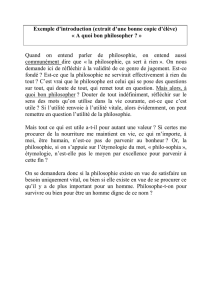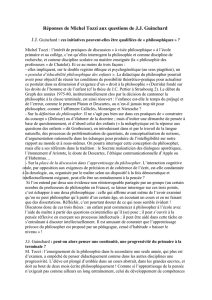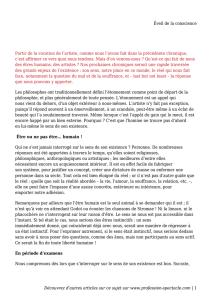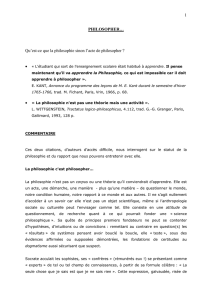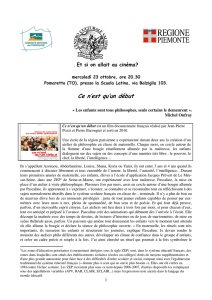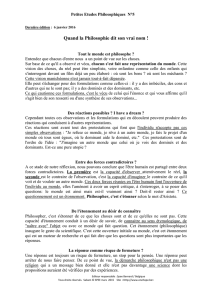« Philosopher » : Une nouvelle pratique philosophique et ses

1
N.Frieden, Université de Fribourg
« Philosopher » : Une nouvelle
pratique philosophique et ses enjeux
pour les professeurs
Quelques éléments introductifs à la situation suisse
1. Le PEC et les programmes
J’enseigne à Fribourg et Genève la didactique spécifique de la
philosophie. Bien que chaque canton ait une formation un peu
différente, tout futur prof doit avoir suivi une formation à
l’enseignement dans lequel il y a un cours de didactique spécifique.
Le cadre dans lequel nous travaillons est d’une part la nouvelle loi
scolaire pour les cantons romands, le PEC
1
, et d’autre part les Pecs
cantonaux différents. Je forme les futurs profs à enseigner dans tous
les cantons donc je dois construire une didactique de programmes
différents. Or dans certains cantons la philosophie s’enseigne au
lycée, pendant 3 ans, d’autres 2 ans, dans certains la philosophie n’est
qu’une option et finalement dans certains, tels Fribourg la
philosophie est enseignée en cours de base et en option. Les
programmes sont plus ou moins contraignants. Mais, somme toute
en Suisse, les professeurs jouissent d’une grande liberté académique
car chaque professeur co-construit son bac. Donc enseigner une
didactique ne signifie pas enseigner une matière unifiante, ou
contraignante mais une diversité de méthodes pour une diversité de
visions de la philosophie que mes étudiants, futurs profs, ont et
veulent réaliser par leur enseignement. La didactique est dans ce
sens un service que je leur donne.
2. l’oralité et la discussion philosophique. L’oralité au sens large (et flou)
est une compétence transversale inscrite dans le PEC romand, dès le
plus jeune âge. Personne ne sait trop quoi en faire. Mais toutes les
écoles veulent la promouvoir. Une formation à l’oralité est comprise
d’une part, comme une formation de l’argumentation et de la logique
de la pensée par les profs de philo et de langue une. Par ailleurs elle
est comprise comme une formation des compétences à la vie en
société dans une démocratie telle que la Suisse où à tous les niveaux
1
PEC (Plan d’Etudes cadre) cf : http://edudoc.ch/record/17477/files/D30b.pdf. p. 81 à 85.

2
de la vie publique, il y a des lieux de concertation. Finalement c’est la
base la plus importante de la nouvelle façon d’enseigner les langues.
C’est pourquoi, il y a de une promotion de la discussion, et dès lors
l’organisation de diverses formations des professeurs à travailler
l’oralité dans les écoles, par exemple, pendant des semaines
thématiques dédiées à l’argumentation orale etc… sans que ces
formations soient nécessairement liées à la philosophie. Il se trouve
que les profs de philo sont les plus intéressés et les plus prêts pour
en assumer la responsabilité. Donc souvent ces cours sont donnés
par eux. C’est pourquoi dans ma didactique, il m’incombe la
responsabilité d’enseigner la didactique de l’oralité à tous les futurs
profs intéressés par la discussion (philosophie, lettres, histoire,
économie et droit, géographie, langues, sciences des religions, etc.).
3. La définition de la matière philosophique, de ses activités et de ses
compétences : Le PEC stipule que la discipline « Philosophie » a deux
finalités : enseigner la philosophie et philosopher. Il stipule aussi qu’il
y a trois activités scolaires dans lesquelles s’exerce la pensée : lire,
écrire et parler. Et finalement, influencé par les profs de philo de
Fribourg, eux-mêmes influencés par une formation faite par Tozzi, le
Pec dit qu’en philosophie on problématise, conceptualise et
argumente.
Introduction
J’enseigne la didactique de la philosophie donc je forme les futurs
enseignants à enseigner la philosophie. En conséquence, j’aborde les
thèmes que nous discutons à Arras du point de vue des besoins des
professionnels dans leur enseignement quotidien, et des besoins des
élèves dans leur formation à l’école et hors de l’école. D’un côté les
enseignants veulent être compétents et heureux dans leur métier, et
de l’autre les enfants, leurs parents et toute la société attendent de
l’école qu’elle réalise ses objectifs. Je suis là pour assumer, une partie
de la lourde responsabilité que cela ait lieu.
Cependant, tout ce dont nous parlons, la société, la didactique et la
philosophie, sont en progression constante pour des raisons qui sont
institutionnelles, sociales, et/ou spécifiques à la philosophie.
Institutionnelles parce que la Nouvelle maturité en Suisse, a modifié
l’institution en instituant le PEC et plus spécifiquement défini le
cadre de la philosophie comme discipline. Sociales parce que la
démocratisation des études a changé le public scolaire et donc les
défis de l’enseignement. Enseigner aujourd’hui cette matière est plus

3
difficile pour les profs. Finalement, la philosophie qui s’est confinée
pendant des siècles dans les limites de l’université puis dans celles
des lycées, est sortie de ses murs, a envahi des espaces publiques
originaux, a innové son approche et son contenu jusqu’à changer le
visage même de la philosophie, bien à son insu ! Et cette évolution a
déteint sur l’école et transforme l’approche du cours de philo.
Je situe ma réflexion au croisement de ces processus différents.
Ce qui change m’intéresse plus que pourquoi cela change. Pour
moi, l’expression la plus forte de ces changements est
l’avènement progressif, en philosophie du concept de
« philosopher » comme chez Kant. Même si ce n’est pas un
nouvel objectif de cours, il devient parfois prioritaire, voire
incontournable. C’est une nouvelle pratique, mais aussi un
nouvel ensemble de compétences mobilisées. Avant on
enseignait la philosophie, maintenant on « philosophe ». Qu’est
ce que c’est que cette pratique ? Qu’entend-on quand on utilise
ce mot ? Comment « philosopher »? Comment didactiser cette
activité?
Je propose de réfléchir ensemble sur les habiletés intellectuelles
mobilisées chez les élèves par cette pratique. Je travaillerai donc
d’avantage sur le « philosopher » que sur la discussion qui est un
outil du philosopher, comme tant d’autres. Et ensuite j’aborderai les
enjeux didactiques du philosopher. En effet, les professeurs évoluent
et changent. Cela demande d’eux de développer des méthodes, des
compétences, et des attentions nouvelles.
Habiletés intellectuelles développées
« Philosopher » est une activité qui se pratique pendant une
discussion philosophique (mais pas toujours) ainsi qu’en classe et
ailleurs, mais à certaines conditions. C’est un savoir faire. Il se
distingue donc du savoir et du savoir être, et il ne les implique pas
nécessairement. Il peut d’ailleurs, se développer presque
indépendamment du savoir. Alors que pendant longtemps,
modestement on limitait nos possibilités philosophiques au savoir
surtout, en enseignant et apprenant la philosophie des grands
penseurs qui, eux, avaient philosophé pour nous, aujourd’hui
l’activité de philosopher s’est démocratisée et a pénétré notre

4
société. On « philosophe » dans un café et à l’école ! Derrida en a fait
un droit.
Qu’est ce qui compose cette activité ?
Je parlerai de « philosopher » et non de discussion. En effet, il y a du
philosopher dans la discussion mais pas toujours, et il y a du
philosopher en classe sans qu’il y ait nécessairement de la discussion.
Mais il y a aussi beaucoup de choses en classe de philosophie sans
qu’il y ait de « philosopher » !
Philosopher consiste dans deux pratiques fondamentales :
problématiser et conceptualiser (et souvent argumenter). Cette
matrice de M.Tozzi n’est pas constitutive du « philosopher » parce
qu’on trouve ces activités dans bien des disciplines. Pour qu’elles
contribuent à du « philosopher », il faut d’une part, que la recherche
soit personnelle (se poser les questions à soi-même), d’autre part
qu’il y ait une certaine urgence existentielle à se poser ces questions,
finalement que ces réflexions se fassent sur une réalité (ou un
concept) qui pose problème alors qu’elle est connue (la justice,
l’amour, le vrai, le temps, le bien). L’enjeu didactique du
« philosopher » est de créer la situation propice à ce que cette
matrice de Tozzi s’expérimente philosophiquement en classe. Dans
un texte philosophique, le problème peut être posé sans que le
professeur ne réussisse jamais à y intéresser un élève. La
problématique philosophique dans ce cas (hélas) fréquent, continue
à rester dans le texte, et à appartenir au grand philosophe qui se la
garde précieusement. Le professeur doit sortir la problématique de la
forme que le philosophe lui a donnée, mais surtout il doit la retrouver
dans le réel du jeune à qui il enseigne. Si d’une façon ou d’une autre,
le professeur parvient à toucher la vie de ses élèves, « philosopher »
peut commencer. Le rôle des supports didactiques est donc très
grand : un bout de film, un texte de roman, une citation étrange, un
fait quotidien etc. peuvent intriguer, éveiller la curiosité, déranger, ou
secouer la torpeur de l’ennui scolaire. Une pièce de théâtre, un
roman, peuvent susciter plus de questionnement philosophique
qu’un texte philosophique scolaire. Dans un roman, le réel est
concentré, alors que dans le réalité, il semble parfois dilué. Comme
dit Bergson, Othello est la jalousie à l’état pur sans l’interruption du
téléphone ou de l’arrivée de l’électricien. Les ateliers que j’ai
construits à l’école sur les films qui font penser (on a travaillé de la
science fiction, Le vol au-dessus du niz d’un coucou, Apocalypse now.
Etc) ont permis à des élèves d’analyser quelques scènes pour
« trouver » les problèmes qu’ils se sont posés. A construire et définir

5
les concepts en jeu (la morale, la norme-alité, la liberté, le mal etc.), à
construire une problématique philosophie etc. Et donc à poser des
questions, découvrir des problèmes.
Philosopher peut ensuite consister aussi dans le raisonnement qui se
refait continuellement pour mettre en ordre, justifier et fonder ce
que l’on pense, ce que l’on comprend, les questions que l’on se pose.
Ces raisonnements qu’on appelle « argumentation » mobilisent
beaucoup de compétences telles que diviser, organiser, douter,
questionner, abstraire, généraliser, fonder, prévoir, critiquer,
discuter… L’évolution de la discussion en classe a permis de
découvrir combien l’argumentation s’apprend mieux quand chacun
veut défendre sa propre opinion, dans une discussion. Mais, d’une
part argumenter peut se faire hors de tout « philosopher » et
philosophie, et parfois, « philosopher » peut se faire sans nécessité
d’argumenter.
Finalement, dans le « philosopher », il y a un imprévu de la pensée,
que les profs nomment kairos, parce qu’ils ne savent pas en dire
beaucoup plus, que le fait qu’ils ont été surpris et parfois pris au
dépourvu, souvent autant que l’élève qui l’a produit et les élèves qui
l’ont écouté. Cela pose problème à l’animateur qui voudrait en faire
« quelque chose ». Il existe une diversité de kairos. Et ils représentent
tous un vrai enjeu pour l’animateur, ou prof. Mais aussi pour les
élèves. Pourquoi ces kairos surgissent-ils ? D’où viennent-ils ? Qu’en
faire ? Je vais donc donner un exemple de kairos et tenter d’en
proposer des analyses différentes.
Prenons un exemple tiré d’une discussion avec des enfants de 10
ans, animée suivant la méthode Lipman, par Véronique Delille. à
l’Unesco en novembre 2012. La discussion était partie d’un début
d’histoire: un avion tombait sur une île déserte, laissant un groupe
d’enfants seuls. La question posée portait sur s’ils avaient besoin
d’un ensemble de lois ou non. Les jeunes s’accordaient sur ce
besoin et discutaient ensemble comment le fonder et le justifier. Ils
pensaient au problème: pourquoi faisons-nous des lois. Une
question est née : mais les lois, doivent-elles venir après ou avant
que les personnes ne fassent quelque chose de mal ? Cette question
n’est pas surprenante car l’homme pense facilement aux
conséquences de ses idées, aux conséquences des hypothèses que
ces questions posent. Et la question de la posteriorité/antériorité
de la poule ou de l’œuf est assez spontanée. Mais soudain, un
enfant a dit : « Mais avant qu’un groupe ne fasse de lois, il existe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%