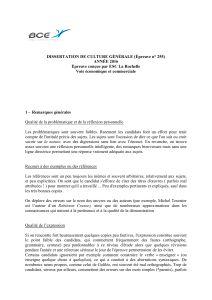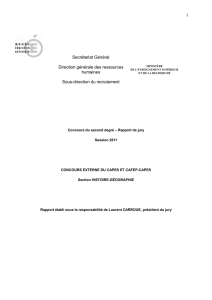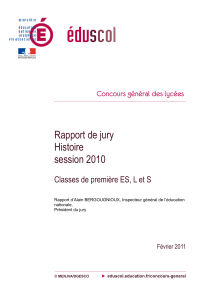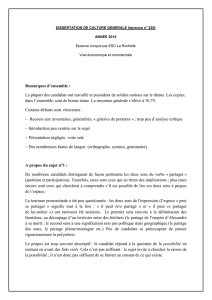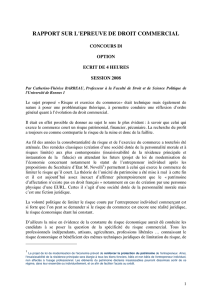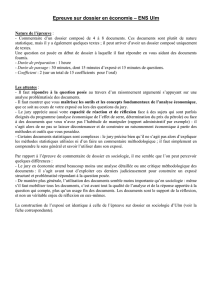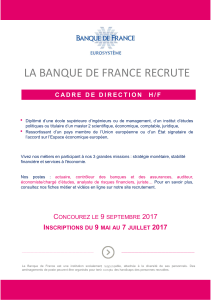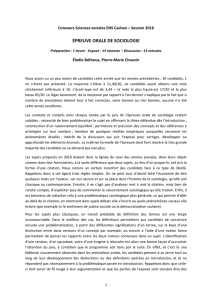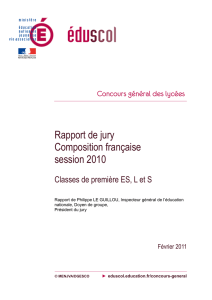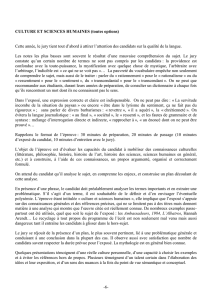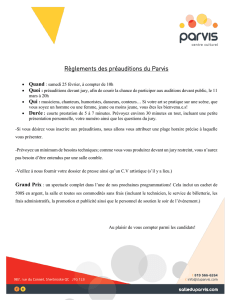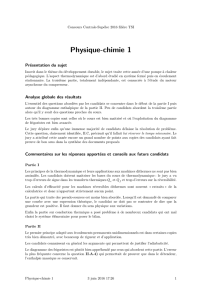Histoire de l`Art

1A Design_2016
Rapport de l’épreuve d’Histoire de l’Art
Programme :
« Graphisme et design, de la crise moderne aux diktats du marché (1953 – 2000) »
Sujet :
En 1965, le designer Gui Bonsiepe (né en 1934) écrivait dans la revue Ulm (n°12/13) :
« … Le passage d’une économie de pénurie à une économie d’abondance plaçait la publicité au centre du
design, en en faisant une nouvelle institution de contrôle social. »
Texte paru en français dans le catalogue L’école d’Ulm : textes et manifestes, Paris, Centre Georges Pompidou,
1988.
Vous analyserez et discuterez cette citation en relation avec le programme.
21 copies ont une note supérieure ou égale à 10 dont 1 supérieure à 15
37 copies ont une note inférieure à 10 dont 2 inférieure à 5.
Le sujet de cette année ne devait pas surprendre le candidat, puisque la citation proposée
reprenait un problème en liaison directe avec l’intitulé du programme « Graphisme et design, de la
crise moderne aux diktats du marché (1953 – 2000) », qui invitait à penser l’interaction entre le
design et le graphisme, ici autour de la notion de publicité. Il était révélateur des préoccupations de
l’après-guerre dans le domaine du design. Cependant le propos du designer Gui Bonsiepe avait sa
singularité, il était émis dans un cadre spécifique la revue Ulm et à une date, elle aussi, précise
1965. Ainsi, le cours de l’année de classe préparatoire in extenso, quelle que soit sa qualité, ne
pouvait tenir lieu de réponse.
Le jury salue ici le travail de préparation qui a été mené. On le retrouve dans la pertinence
des exemples et dans une certaine ampleur des questionnements proposés par les candidats.
Cependant, dans l’ensemble, le jury constate un relatif tassement de la qualité des copies. Peu sont
véritablement indigentes, peu se dégagent comme particulièrement réussies. Il semble que les
problèmes soient avant tout méthodologiques. C’est pourquoi le jury souhaite revenir sur ses
attentes et rappeler quelques uns des attendus de l’épreuve.
Importance de l’analyse du sujet
Cette année, le sujet était extrait d’un texte de Gui Bonsiepe, designer formé à l’École d’Ulm,
paru une première fois dans la revue Ulm en 1965 et publié, cette fois dans une traduction française,
au sein du catalogue intitulé L’école d’Ulm : textes et manifestes en 1988. Ces informations devaient

aider le candidat à analyser la citation et à la situer dans son contexte de production. Le lien avec
l’École d’Ulm (Hochschule für Gestaltung) devait être souligné, et le contexte économique de la
période des années 1950-60 rappelé en quelques lignes. L’expression « société de consommation »
devait apparaître en introduction ou au début du développement.
L’analyse de la citation ne peut en aucun cas consister en quelques lignes évasives, autrement
dit, elle ne peut consister en une vague paraphrase. Elle demande au contraire rigueur et précision. Il
ne s’agit pas non plus de la « découper » en plusieurs sections de manière artificielle et
caricaturale — ici « le passage d’une économie de pénurie à une économie d’abondance » / « la
publicité au centre du design » / « nouvelle institution de contrôle social ». Ainsi, certains candidats
se sont emparés seulement de l’un de ces termes : les uns ont donné l’impression au jury de faire
une dissertation sur « La publicité » en général ; d’autres se sont interrogés directement et
uniquement sur la différence entre graphisme et publicité – un point qu’il était possible d’aborder
mais qui n’était pas le cœur du sujet. Les hors-sujets sont souvent le résultat d’un défaut d’analyse
de la citation : ils ont été sanctionnés par les correcteurs.
Au contraire, l’enjeu de la phase d’analyse du sujet est de parvenir à saisir la citation dans son
ensemble et à en tirer un questionnement. Autrement dit, cette problématisation doit provenir
d’une compréhension fine de la citation, d’un examen précis de sa nature, d’une réflexion sur les
termes utilisés et de leur mise en résonance avec les préoccupations de la période. Le jury insiste sur
la nécessité de ce questionnement : une dissertation ne peut se construire sans problématique, au
risque de sombrer dans la récitation du cours ou dans le hors sujet. C’est ce problème, isolé par
l’analyse du sujet, qui instaurera la dynamique argumentative du devoir. De cette problématique
découle le plan du développement et les articulations entre les parties. Rappelons-le, la dissertation
est avant tout un raisonnement.
Dans le cas présent, certains éléments du sujet étaient plus porteurs que d’autres. Ainsi
s’interroger sur la définition du terme «institution» pouvait s’avérer infructueux : certains candidats
se sont demandés si l’école ou le mariage étaient des institutions. Là n’était pas la question.
En revanche, le triangle de notions – design, publicité et contrôle social – formait le cœur de la
question : il fallait interroger ces notions les unes par rapport aux autres. Gui Bonsiepe dressait un
constat qu’il fallait discuter : la publicité était-elle vraiment au centre du design dans les années
soixante (ici il aurait fallu relever les faits montrant son importance ou au contraire la nuançant et
s’interroger sur cette idée de « centralité », par rapport à celles de marge ou de périphérie) ? Etait-ce
légitime de penser que ce phénomène et son corollaire – l’emprise accrue de la publicité sur les
esprits et la société - étaient le résultat d’une mutation économique ?
La forme de la dissertation
Le jury attend que le devoir prenne la forme de la dissertation – un exercice qui nécessite un
effort aussi bien dans l’expression écrite que dans la structuration de la pensée. On ne peut admettre
un développement au fil de la plume, une pensée qui fonctionnerait sous la forme de l’association
d’idées, sans véritable construction. La dissertation est une démonstration argumentée : les
jugements de valeur non justifiés et les déclarations à l’emporte-pièce n’y ont pas de place. Les
thèses avancées doivent être étayées, l’ensemble donner l’impression d’un cheminement organisé,
raisonné, structuré en parties.

Les phrases doivent être construites, rédigées, compréhensibles. Le candidat doit faire la
preuve de sa maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe. Les articulations à l'intérieur ou entre les
différentes parties doivent être travaillées. Un effort est manifestement fait sur ces points, mais
beaucoup de copies présentent encore des lacunes, voire une absence totale de transition. Le jury
attend aussi des candidats la maîtrise du vocabulaire de la discipline, et la capacité à utiliser la
terminologie la plus adaptée.
Cette année, certains ont glissé vers des propos très généraux, type « café du
commerce », usant de lieux communs et d’anachronismes. L’actualité de la question a peut-être
induit certains candidats à se comporter de cette manière. Ce n’est pas ce qui est attendu. Au
contraire, il est demandé un discours argumenté d’un point de vue théorique, précis
chronologiquement et cultivé. Rappelons-le, l’épreuve intitulée « épreuve d’histoire de l’art » exige
des candidats la production d’une dissertation de nature historique, qui prête attention à la
chronologie et aux éventuelles ruptures, « moments » historiques : il n’est pas acceptable, comme
certaines copies l’ont fait, de traiter la période 1953-2000 d’un bloc. Aucune copie n’a d’ailleurs
proposé un plan chronologique – qui aurait pu fonctionner ici. Plus grave, de nombreuses copies sont
incapables de situer le propos en terme de date, semblant confondre les deux guerres mondiales, la
crise de 1929 et l’économie des années 1945-1950… De même, il n’est pas admissible de confronter
sans précaution, ni précision chronologique des positions et des temps différents : Walter Gropius et
Ron Arad par exemple.
S’il convenait dans un premier temps de discuter et analyser les propos de Gui Bonsiepe
sur la période s’étendant de 1953 au milieu des années 1960, il était légitime de rechercher, au-delà
de la date du propos, des pratiques ou des cas qui nuanceraient voire contrediraient la pérennité de
cette affirmation : des pratiques de design émancipées de la publicité ou des tentatives pour
échapper au contrôle social. Mais dans tous les cas, il était nécessaire de préciser au lecteur qu’il
s’agissait là de conséquences postérieures à cette mutation évoquée par Bonsiepe. C’est cette
rigueur nécessaire dans la chronologie qui fait que cette épreuve est une épreuve d’histoire de l’art.
Apports théoriques
Les meilleures copies ont souvent fait référence à des ouvrages ou essais théoriques comme
ceux de Gilles Lipovetsky, de Jean Baudrillard, de Marshall MacLuhan, de Guy Debord, etc. Leur
connaissance permettait de nourrir le propos, tant sur la place de la publicité au cœur du design que
sur l’émergence des nouveaux médias, comme la télévision. Les candidats étaient également libres
de faire référence à l’art contemporain des années soixante, au Pop Art par exemple, ou à des
œuvres plus précises comme la Supermarket Lady de Duane Hanson. D’une manière générale, le jury
a apprécié que les exemples viennent aussi de la culture personnelle des candidats. En effet, les
mêmes exemples reviennent très fréquemment. C’est un peu inévitable en classe préparatoire mais
chaque candidat devrait aussi développer ses propres exemples, en plus du cours, grâce à ses
lectures ou visites.
De même, le fait que ce propos ait été formulé par un ancien élève de l’École d’Ulm était une
piste intéressante, lorsque l’on sait que c’est précisément ce type de débat qui a agité l’école durant
toute son existence. Certains ont saisi cette opportunité pour décrire l’école comme le lieu d’une
transition des idéaux modernes de l’objet standard à la situation de consommation qu’inaugurent les

années cinquante, le lieu aussi de débats sur le design et les moyens contemporains de
communication.
Du rôle de l’exemple
L’exemple doit être compris de manière intime : il ne peut être plaqué tel qu’il a été vu en
cours. Il ne suffit pas de l’énoncer ; il doit être analysé et prouver son efficacité pour la
démonstration. Au sens large, il peut s’agir d’une production visuelle ou plastique, d’un artefact,
mais aussi d’un ouvrage ou d’un essai, d’un manifeste, voir d’un passage de tel ou tel texte, etc., etc.
Le traitement de l’exemple doit être précis. Cela suppose des qualités particulières : il convient à la
fois de décrire en quelques mots au lecteur l’exemple en question, de le rendre vivant et surtout de
le rattacher au point soulevé. Le jury a pu l’apprécier dans quelques copies qui ont su utiliser à bon
escient telle affiche de Josef Müller-Brockmann ou tel objet de Dieter Rams. C’est loin d’être le cas
dans l’ensemble des copies. Pourtant les candidats ont, semble-t-il, de bons exemples à employer,
mais ils sont parfois mal compris ou pas assez reliés à la réflexion.
Les exemples de rupture, de mouvement ou de personnalités essayant de contredire le fait
que la publicité et le design étaient désormais du côté du contrôle social étaient intéressants, par
exemple en troisième partie. Non, la publicité n’est pas forcément au cœur du design. Il y a des
possibilités pour le créatif dès les années soixante et au-delà de revendiquer une pratique hors des
schémas dominants. Des exemples alors sont venus étayer cela depuis le manifeste First Things First
de Ken Garland (écrit en 1963 et publié en 1964) jusqu’à Enzo Mari et son Proposta per
un’autoprogettazione (1974) ou au texte de Sottsass « Tout le monde dit que je suis méchant »
(1973). Au-delà, la déconstruction des moyens mêmes du conditionnement publicitaire pour éviter la
récupération étaient une voie de libération, ainsi que l’inscription du « consommateur » lui-même
dans le processus de conception. Et là, le candidat avait des exemples utilisables en réserve. En
conclusion, les candidats pouvaient utiliser, cette fois, des questions d’actualité pour réfléchir aux
nouveaux modes de production dans le domaine du design – le design pour l’image - ou bien la
nécessaire éducation aux images.
1
/
4
100%