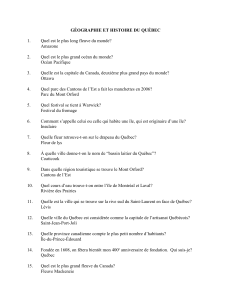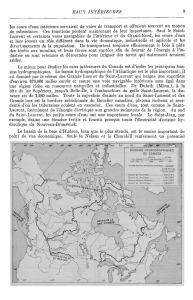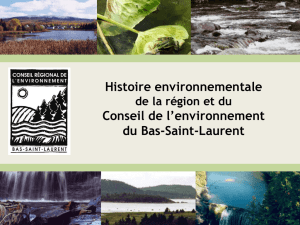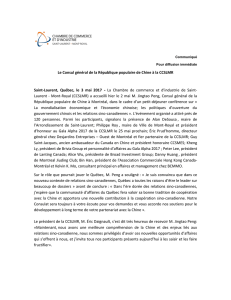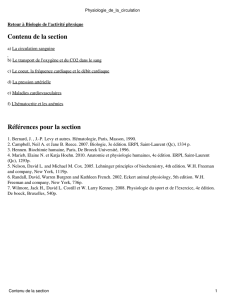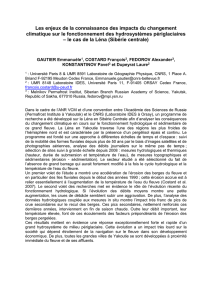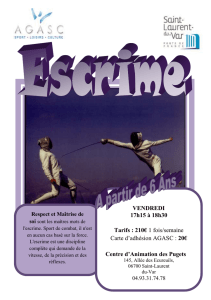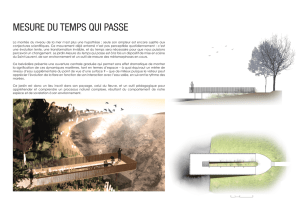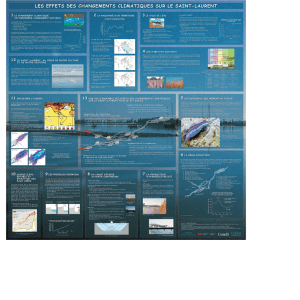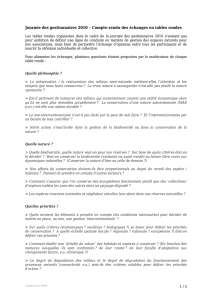RÉSISTER AUX PERTURBATIONS

1
RÉSISTER AUX PERTURBATIONS
FICHE 2-08
Dès le début de la colonisation du territoire, le développement s’est concentré
sur les abords du Saint-Laurent. Au cours du 20e siècle, cette concentration s’est
amplifiée sur les rives du fleuve et de ses tributaires, résultat du développement
économique, agricole, résidentiel et industriel du territoire. L’activité industrielle
et portuaire, la construction et la navigation sur la voie navigable du Saint-
Laurent et l’aménagement de barrages sur certains de ses tributaires ont créé de
nombreuses perturbations sur les écosystèmes liés au fleuve.
Les pressions exercées sur le Saint-Laurent ont eu pour impact l’altération et la destruction de grandes
superficies de milieux naturels terrestres, riverains et aquatiques, affectant ainsi l’intégrité écologique du
Saint-Laurent. On remarque toutefois que malgré les pressions passées, le Saint-Laurent maintient une
intégrité écologique que d’autres grands fleuves ont perdue.
L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DU SAINT-LAURENT
L’intégrité écologique est définie comme la capacité d’un écosystème à supporter et à maintenir une
communauté équilibrée, intégrée et capable de s’adapter aux changements qui sévissent dans le milieu
(MDDEFP, 2012). Une communauté dite en santé aura, pour une écorégion donnée, une composition
d’espèces, de diversité et d’organisation fonctionnelle comparable à un écosystème naturel.
L’intégrité biologique est un des éléments de l’intégrité écologique, qui constitue une combinaison des
intégrités chimique, physique et biologique (figure 1). La dégradation d’une ou de plusieurs de ces
composantes se reflète généralement dans les communautés biologiques.
Figure 1 : le concept de l’intégrité écologique (tiré de Moisan et Pelletier, 2008)

2-08
2
Des données précises permettant de connaître le degré d’intégrité écologique du territoire d’étude ne
sont pas disponibles. Elles le sont toutefois pour le tronçon fluvial et plus particulièrement pour le lac
Saint-Pierre, qui présente une dynamique particulière justifiant de plus amples analyses. Bien que le
fleuve soit un écosystème complexe dont les propriétés physiques changent d’amont en aval, il s’avère
tout de même intéressant d’explorer les données d’autres tronçons ainsi que des indicateurs potentiels
de cette intégrité à travers l’évolution de différentes populations au cours des dernières années.
Il serait pertinent d’obtenir ce type de données, spécifiques à la zone d’étude. Outre l’indice d’intégrité
biotique et le suivi des macroinvertébrés benthiques, de l’information sur l’état des berges naturelles du
fleuve (superficie, proportion de rives naturelles, degré d’altération, etc.) serait particulièrement pertinente
à obtenir.
L’INDICE D’INTÉGRITÉ BIOTIQUE
Un indice d’intégrité biotique (IIB) a été développé par Environnement Canada pour le fleuve Saint-
Laurent et ses tributaires
1
. Bien qu’il présente un portrait partiel de l’état des communautés, ce dernier
permet de déceler les effets globaux et cumulatifs des diverses perturbations touchant les poissons et
leurs habitats et ainsi de juger la qualité du milieu aquatique par le niveau d’intégrité ou de santé des
communautés de poissons qu’on y retrouve.
Depuis 1995, l’indice est généralement de faible à moyen, mais varie considérablement selon les
secteurs. L’indice étant mesuré du lac Saint-François jusqu’au secteur Bécancour–Batiscan, il n’est pas
mesuré pour le territoire d’étude. L’indice du secteur Bécancour–Batiscan, le plus rapproché de la zone
d’étude, montre une amélioration sur la rive sud (Bécancour) et s’établit à environ 40 (moyen-bon) pour la
période de 2007 à 2012. Toutefois, l’indice de la rive nord (secteur Batiscan) montre une dégradation et
s’établit à environ 30 (faible-moyen) pour la période de 2007 à 2012.
LE SUIVI DES MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES
Le suivi des macroinvertébrés benthiques (vers, crustacés, mollusques et insectes habitant le fond des
lacs et des cours d’eau) permet d’évaluer les répercussions engendrées par la pollution et la dégradation
des habitats riverains.
Cette communauté a été étudiée dans 130 cours d’eau du Québec entre 2003 et 2011; les changements
au sein des communautés de benthos ont ainsi été étudiés afin de déterminer un indice de santé du
benthos pour les cours d’eau à substrat grossier (ISBg) ou meuble (ISBm). Il s’agit donc d’un bon
indicateur d’intégrité écologique du Saint-Laurent et de ses tributaires.
Cette étude a permis d’identifier les bassins versants qui ont les proportions les plus importantes de
stations ayant des communautés de benthos altérées. Dans le territoire d’étude, les bassins versants à
forte vocation agricole, tels que les rivières Boyer, Chaudière et Etchemin, ainsi que ceux traversant des
zones fortement urbanisées, telles que les rivières Saint-Charles et Beauport, hébergent des
communautés altérées. Les cours d’eau dans lesquels les communautés sont en bon état sont ceux où
l’on retrouve une plus forte proportion de couvert forestier.
Les stations effectuant ces mesures pour le Saint-Laurent sont situées entre les lacs Saint-François et
Saint-Pierre. Des résultats propres au territoire d’étude ne sont donc pas disponibles.
1
Environnement Canada a adapté sa méthode, initialement élaborée pour de petits cours d’eau, à de grandes rivières telles que
le fleuve Saint-Laurent.

2-08
3
L’ÉVOLUTION DE POPULATIONS FAUNIQUES
L’évolution des différentes populations fauniques au cours des dernières années est un indicateur
d’intégrité écologique. De façon générale, environ 82 % des 379 espèces fauniques associées aux
écosystèmes aquatiques et aux milieux humides sont considérés « en sécurité », c’est-à-dire qu’il y a peu
de risques que ces espèces disparaissent du territoire québécois.
Concernant la faune aviaire, l’évolution des différentes populations d’oiseaux du Saint-Laurent diffère
grandement selon les espèces; certaines sont en abondance et en évolution, d’autres se maintiennent
alors que d’autres sont en déclin. D’abord, la plupart des espèces de sauvagine sont en croissance dans
le secteur d’étude : la grande oie des neiges (1 000 000 d’individus au Québec), la bernache du Canada
(721 000 individus au Québec) et le canard noir (558 000 individus au Québec) en sont des exemples.
Des problématiques de surpopulation peuvent alors survenir et certaines espèces échappent ainsi à la
régulation naturelle, c’est-à-dire le contrôle par la capacité de support du milieu, la compétition ou la
prédation. C’est le cas de la population de grandes oies des neiges, dont la croissance soutenue ces
dernières décennies a causé une forte explosion démographique. La population de grands hérons du
Saint-Laurent connaît, quant à elle, une hausse plus lente, mais constante. On trouve d’ailleurs une
trentaine de héronnières dans l’axe et le golfe du Saint-Laurent, dont la plus grande héronnière au monde
qui se trouve à Grande-Île, au lac Saint-Pierre (à l’extérieur du territoire d’étude). Finalement, certaines
populations d’oiseaux sont faibles ou en déclin, telles que les populations de petit blongios (vulnérable) et
du râle jaune (menacé), dont la principale menace à la survie de ce dernier est la perte des habitats
humides riverains du Saint-Laurent (Gouvernement du Québec, 2014). Du côté des oiseaux aquatiques,
au moins six espèces auraient complètement disparu du territoire québécois, dont le grand pingouin et
l’eider du Labrador. Ce nombre pourrait en réalité être beaucoup plus grand, mais le manque de données
sur certains groupes laisse croire que des espèces auraient pu disparaître sans jamais avoir été
identifiées ni observées.
Concernant la faune ichtyenne, des indices d’amélioration de l’état de certaines populations de poissons
permettent de croire à une amélioration de l’intégrité du fleuve. Par exemple, le bar rayé est de retour
dans le fleuve Saint-Laurent quarante ans après sa disparition, causée notamment par la surpêche, le
dragage et l’entretien de la traverse nord (pointe est de l’île d’Orléans) ainsi que la disposition des
sédiments de dragage dans le fleuve. Les travaux de réintroduction de l’espèce débutés en 2002 ont
ainsi porté des fruits : une première frayère a été découverte en 2011 dans la rivière du Sud à
Montmagny, puis une deuxième ce printemps dans la rivière Ouelle au Kamouraska. Aussi, des
populations d’esturgeon jaune sont observées sur le territoire d’étude en raison du retour de l’espèce en
2007 sur des frayères abandonnées de la section aval de la rivière Chaudière et de la confirmation en
2012 de l’existence d’une frayère à l’embouchure de la rivière Montmorency.
Diverses données sur l’évolution des populations fauniques sont disponibles et donnent des indications
d’ordre général sur l’état de santé du Saint-Laurent et de certains de ses secteurs. Toutefois, la majorité
des études et des suivis sont effectués dans le tronçon fluvial et en moindre ampleur dans l’estuaire
fluvial. Il y a donc un besoin en matière d’inventaires, de recherches et de suivis afin de suivre l’évolution
des populations floristiques et fauniques et déterminer le niveau d’intégrité écologique du secteur d’étude.
Bref, le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent lancé en 2003 effectue un portait d’ensemble
montrant qu’en dépit de nombreuses menaces et pressions subies par le Saint-Laurent, le fleuve
maintient ses fonctions écologiques essentielles et abrite des populations en santé.
PERTURBATEURS ET PRESSIONS ASSOCIÉES
Les perturbations subies par les écosystèmes du territoire d’étude sont de deux ordres. D’abord, des
causes naturelles ont pour effet de dégrader l’état de certains écosystèmes, soit l’érosion, la prédation
d’autres espèces, les maladies (telles que la maladie hollandaise de l’orme), la floraison d’algues

2-08
4
nuisibles
2
et les mauvaises conditions météorologiques. Toutefois, ce sont surtout les activités humaines
qui sont responsables de la dégradation des écosystèmes, principalement par la présence et
l’empiétement des activités urbaines, industrielles et agricoles sur les milieux naturels; l’érosion et le
dragage causés par la navigation maritime; les changements climatiques et l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes. La présente section fait état des principales pressions subies par les
écosystèmes de la zone d’étude et ne doit pas être considérée comme exhaustive.
Les empiétements et la destruction de milieux naturels
Causes
> Développement résidentiel et urbanisation du territoire
> Transport et expansion industrielle
> Activités agricoles
> Infrastructures et activités portuaires
> Activités récréatives et circulation de véhicules tout-terrain
Explication du
phénomène
> Ces activités, par l’empiétement et la destruction des milieux naturels, entraînent la
destruction et la dégradation des habitats de la faune et de la flore.
Impacts sur
l’écosystème
> Affectation du maintien d’une espèce établie
> Transformation des communautés végétales
> Contribution à la perte de biodiversité
Exemples
concrets sur le
territoire
d’étude
> Circulation de véhicules tout-terrain dans la zone intertidale représente l’une des
principales menaces à la survie d’espèces en situation précaire comme l’éricaulon de
Parker, la vergerette de Provancher et la cicutaire de Victorin.
> Situation précaire de certaines espèces de poissons sur le territoire d’étude : l’éperlan
arc-en-ciel, l’alose savoureuse et l’esturgeon jaune.
> Réduction de la capacité des écosystèmes à soutenir la chasse, la pêche et les
cueillettes commerciales et récréatives.
> Empiétements causés par la construction du boulevard Champlain et de l’autoroute
Dufferin-Montmorency ont occasionné la perte d’habitats naturels et de milieux humides.
Détérioration de la qualité de l’eau
Cause
> Érosion des berges
> Rejets d’eaux usées et ouvrages de surverse utilisés lors des débordements des réseaux
d’égouts lors de pluies abondantes
> Territoire fortement imperméabilisé par les routes, les stationnements et les bâtiments
> Apports d’eaux agricoles
Explication du
phénomène
> Apport accru de sédiments et de polluants dans le milieu aquatique.
> Pollution diffuse des activités agricoles amenée par le lessivage et la percolation d’eaux
usées ou contaminées et le ruissellement des eaux de surface qui entraînent un surplus
de matières nutritives (azote, nitrites-nitrates, phosphore, etc.) dans l’environnement
récepteur.
Impacts sur
l’écosystème
> Modification des conditions importantes pour la croissance des végétaux aquatiques, par
exemple en affectant la pénétration de la lumière, en diminuant la profondeur de l’eau et
en augmentant la température de l’eau.
> Contamination de chair de poissons d’eau douce ou des mollusques d’eau salée, limitant
leur consommation dans certains cas.
2
L’Alexandrium tamarense est une algue toxique dont le phénomène est connu sous le terme de « marée rouge ».
L’accumulation de différents facteurs naturels crée la prolifération de cette algue, ce qui occasionne des impacts sur les
espèces fauniques, tels que l’intoxication paralysante des mollusques et l’endommagement du tissu épithélial des branchies
des poissons (Levasseur, 1996). Bien que ce phénomène ne touche pas la zone d’étude (il se fait ressentir surtout dans la
région de la Côte-Nord), il est à surveiller.

2-08
5
Fluctuation des débits et des niveaux d’eau
Cause
> Les niveaux d’eau sont affectés, entre autres, par la régulation des débits du fleuve pour
les besoins de la navigation ou de la production hydroélectrique.
> Drainage en général
Explication du
phénomène
> Baisses prononcées du niveau d’eau
> Hausses du niveau d’eau provoquant un ennoiement prolongé, de forts courants ou de
l’érosion
> Dans ces cas où le niveau d’eau est régularisé, les milieux riverains ne sont plus soumis
à un régime hydrique naturel et les crues printanières peuvent être atténuées.
Impacts sur
l’écosystème
> Altération générale du régime en place causant des impacts sur les écosystèmes.
> Disparition d’espèces aquatiques
> Diminution des superficies d’habitats printaniers essentiels à la reproduction de certaines
espèces
> Le niveau d’eau très bas du fleuve Saint-Laurent lors des étés 2010 et 2012 a engendré
une mortalité massive des moules.
Navigation maritime commerciale – Érosion
Cause
> Le passage de grands navires causant le batillage, soit l’ensemble des vagues produites
par le sillage des bateaux qui déferlent sur les berges et entraînent une dégradation de
celles-ci. Le batillage augmente avec la hausse de la vitesse de déplacement des navires.
Explication du
phénomène
> La formation d’un talus d’érosion peut engendrer un recul du rivage ou déstabiliser le bas
d’une falaise. L’amplitude de l’érosion est variable et dépend étroitement de la nature du
substrat des rives.
> L’érosion peut entraîner une dégradation de la qualité de l’eau par l’augmentation de la
turbidité de l’eau et la libération de contaminants.
Impacts sur
l’écosystème
> Érosion des marais supérieurs entraînant une perte d’habitats et une baisse de la
biodiversité.
> Destruction des habitats de couvées et d’élevage de la sauvagine
> Destruction des frayères et des sites d’alimentation pour les poissons
> Diminution de la superficie des milieux humides en bordure du fleuve
> En résumé, baisse du potentiel écologique des rives en bordure du Saint-Laurent et de
ses tributaires.
Navigation maritime commerciale – Dragage
Cause
> Des travaux de dragage d’envergure ont eu lieu dans le Saint-Laurent afin de permettre la
navigation commerciale, notamment dans les secteurs du port de Québec, du chenal de
la Traverse du Nord de l’île d’Orléans et aux alentours de Sainte-Pétronille. À Québec,
une trentaine de dragages de capitalisation entre 1913 et 1975 ont nécessité le
déplacement de près de 13 M de m3 de sédiments dans le fleuve ou sur ses berges et le
dépôt en berge d’environ 5 M de m3 provenant de quelque 20 dragages d’entretien de
1942 à 1984.
> Des travaux de dragage d’entretien annuel ont toujours lieu, mais sont de moindre
ampleur que ceux susmentionnés.
Explication du
phénomène
> Ces travaux ont trait autant à l’excavation qu’à la mise en dépôt des déblais pour
l’approfondissement et l’élargissement du chenal.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%