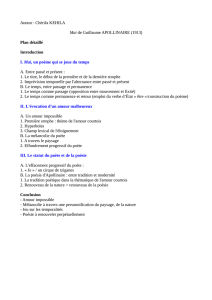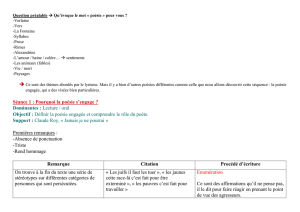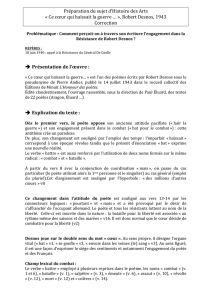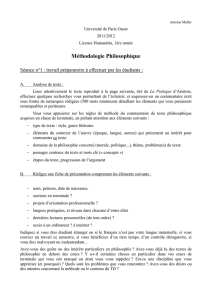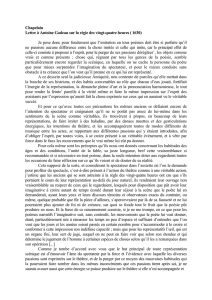À la rencontre d`Eluard

CONFÉRENCE DU FORUM DES SAVOIRS
“Plus l’être humain sera éclairé, plus il sera libre.”
Voltaire
À LA RENCONTRE D’ÉLUARD
CONFÉRENCE PAR HANS LEYMARIN
Association ALDÉRAN Toulouse
pour la promotion de la Philosophie
MAISON DE LA PHILOSOPHIE
29 rue de la digue, 31300 Toulouse
Tél : 05.61.42.14.40
Site : www.alderan-philo.org conférence N°1000-098

À LA RENCONTRE DE PAUL ÉLUARD
conférence de Hans Leymarin donnée le 10/12/2004
à la Maison de la philosophie à Toulouse
Conférence - lecture de textes autour de ce poète qui est plus complexe
que l’image d’Épinal de poète de la Résistance qui lui est associée.
Association ALDÉRAN © - Conférence 1000-098 : “ À la rencontre de Paul Éluard” par Hans Leymarin - 21/09/2004 - page 2

Document 1 : Aperçus biographiques concernant Paul Éluard.
PAUL Éluard (1895-1952)
Dans son avertissement à l’iconographie de Paul Éluard, Roger-Jean Ségalat juge
froidement les quelques ouvrages publiés jusqu’ici sur le poète : «Les quelques études
mi-biographiques, mi-littéraires concernant Paul Éluard ont été, pour la plupart, écrites de
son vivant ou immédiatement après sa mort. Inspirées par l’amitié, elles contiennent plus
de bons sentiments que de faits précis. Quelquefois Éluard les a personnellement
corrigées et a essayé de donner de lui-même, par le souci bien naturel qu’ont les demi-
dieux de préparer pour la postérité leur propre histoire idéale, une image simplifiée ou
conventionnelle.» Si l’ouvrage de Michel Sanouillet, Dada à Paris, nous éclaire les débuts
d’Éluard, tant s’en faut que nous sachions au juste à quoi nous en tenir sur la période
communiste, qui dure pourtant dix ans : les dix dernières années de la vie du poète.
Même si l’on pense que les sonnets écrits au cachot par Jean Noir, alias Jean Cassou,
sont plus achevés que les plus illustres poèmes d’Éluard pendant la guerre, son texte sur
la Liberté et son «lyrisme civique» l’ont mis, sociologiquement, au premier rang des
poètes de la Résistance. Néanmoins, c’est sans doute le poète de l’amour qui emporte
l’adhésion et qui unifie le divers de ses inspirations, car l’amour des hommes est aussi
vieux en lui que sa jeunesse et que l’amour des femmes.
Il est donc trop tôt pour écrire une vie d’Éluard, pour en ordonner les incidents, les plans,
les valeurs; mais il est possible, dès maintenant, d’en admirer les plus beaux effets: les
poèmes.
1. D’Eugène Grindel à Paul Éluard
En décembre 1916, une douzaine de personnes recevaient une minuscule plaquette de
poèmes polycopiés à dix-sept exemplaires, intitulée Le Devoir et signée Paul Éluard.
L’envoi venait d’un hôpital d’évacuation du front. L’auteur, dont le véritable nom était
Paul-Eugène Grindel, né à Saint-Denis le 14 décembre 1895, était à cette époque
infirmier militaire. Il était le fils d’un comptable et d’une couturière. Clément-Eugène
Grindel s’était «élevé» à la force du poignet, il était devenu marchand de biens et agent
immobilier prospère, sans renier jamais les opinions socialistes de sa jeunesse. La
fraîche fortune des Grindel avait d’abord permis au jeune Paul-Eugène de poursuivre de
bonnes études jusqu’au brevet, puis de soigner en Suisse, de 1912 à 1914, une assez
grave tuberculose. C’est au sanatorium que Paul-Eugène avait fait la connaissance d’une
jeune fille russe qu’il prénomma Gala et qu’il épousa en 1916. C’est au sanatorium qu’il
publiera à compte d’auteur sa première œuvre, signée de son vrai nom. Elle n’annonce
guère le singulier et grand poète qui, en 1916, avec Le Devoir, fait la plus timide des
entrées.
À la fin de sa vie, Éluard concevra deux longs poèmes, inséparables, qu’il intitulera
Poésie ininterrompue. Mais toute sa traversée de la terre aura été un long murmure de
poésie ininterrompue, une réponse poétique aux événements de l’histoire, de son destin
et de son temps. Les événements fondamentaux qui feront jaillir la source poétique en
Paul-Eugène, et du jeune Grindel feront surgir Éluard, c’est d’abord, et ce sera jusqu’au
bout, la guerre. Le jeune Éluard a lié des amitiés parmi les réfractaires anarchistes et
pacifistes, il a une grande admiration pour des poètes «sociaux» comme Whitman, le
groupe des unanimistes, André Spire... Mais ce sera l’expérience vécue de la guerre et
du front qui va déclencher en lui un étonnement sans terme, une indignation de voix
blanche, et cette douceur inextinguible de la stupeur indignée. Au moment de la guerre
coloniale du Rif, Éluard a participé à la grande aventure de contestation radicale qu’est
Dada, puis a été avec André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault un des fondateurs
du mouvement surréaliste . Mais c’est au lendemain de la reddition d’Abd el-Krim qu’il va
adhérer au Parti communiste, dont il s’éloignera bientôt. Toujours, chez lui, l’insurrection
de la sensibilité précède et vivifie la réaction intellectuelle. De même, de 1938 à 1942, la
guerre d’Espagne puis le déclenchement par Hitler de la guerre totale le décideront à
revenir, en 1942, au Parti communiste, qu’il ne quittera plus.
Éluard jouera un rôle très important dans l’élaboration des idées qui vont faire explosion
dans le dadaïsme, s’organiser dans le surréalisme, se continuer (et souvent diverger)
dans la volonté (ou les volontés) d’action révolutionnaire. Mais si vaste et si profonde que
soit la culture de Paul Éluard, si constante sa volonté d’être un poète qui veut lier l’activité
poétique à la réflexion philosophique et à l’action sur la société, ce qui frappe d’abord
dans sa poésie, c’est son caractère immédiat, la fraîcheur – parfois brûlante – de
l’émotion. Dès les premiers poèmes signés du nom d’Éluard, une inimitable simplicité
Association ALDÉRAN © - Conférence 1000-098 : “ À la rencontre de Paul Éluard” par Hans Leymarin - 21/09/2004 - page 3

s’affirme, une innocence souveraine, une candeur juvénile à travers les années, miroir où
vont se refléter, directement, perpendiculairement, les sentiments à leur naissance:
transparence du regard amoureux, opacité d’un univers de bitume et de sang. Il n’y a pas
d’abord de concepts dans l’œuvre d’Éluard: il y a ce qui arrive à un homme, comme s’il
était le premier homme, un homme qui dit ce qu’il ressent, comme une eau coule de
source. Il semble que ce soit l’émerveillement ou la stupeur anxieuse du premier venu,
traduite avec les mots premiers venus.
Les distinctions scolastiques entre la vie intérieure et l’histoire, entre la poésie lyrique et
la poésie engagée semblent absolument dérisoires à qui suit le cours naturel de l’œuvre
de Paul Éluard. Aucune épaisseur de miroir sans tain ou d’écorce protectrice n’a jamais
séparé l’univers intérieur d’Éluard de l’univers extérieur. On pourrait, sans scandale, mais
non sans erreur, parler de sa poésie comme d’une poésie métaphysique, comme le
compte rendu très précis des passages d’un esprit à travers des états qu’on pourrait sans
légèreté rapprocher des états mystiques: légèreté de l’homme libéré de sa pesanteur
dans l’effusion amoureuse, mouvements obscurs d’angoisses des «sommeils de la
raison». On pourrait dire que le développement dans le temps de sa poésie, du Devoir
(1916) à Poésie ininterrompue II (1953), de Mourir de ne pas mourir (1924) à Le temps
déborde (1947), est si «monotone» et entêté dans le naturel, si constant dans la
répartition des thèmes affectifs et vécus qu’Éluard n’a d’autre biographie que celle des
amours personnelles et des deuils: la séparation d’avec Gala en 1930, la rencontre avec
Nush, la mort brutale de celle-ci en 1946, la crise atroce qui va suivre et la vie ensuite
revenue grâce à Dominique, en 1949.
2. «Liberté, j’écris ton nom...»
Mais cette description de La Vie immédiate de Paul Éluard, sans être inexacte, ne serait
pas vraie du tout. Les catastrophes de son temps, les soubresauts de l’histoire auront
pour Éluard un caractère aussi immédiat que les accidents ou les clartés de son destin
individuel. Il a raconté lui-même que le poème qui devait le rendre célèbre au-delà des
cercles d’amateurs de poésie, Liberté, écrit en 1941, fut d’abord, dans la première
nébuleuse d’où émergeaient les mots, un poème d’amour; qu’il s’intitulait primitivement
Une seule pensée, que cette pensée était, à sa naissance, celle de la femme qu’il aimait;
et que c’est seulement au fur et à mesure que la litanie amoureuse s’élargissait que le
poète prit conscience que son poème ne concernait pas seulement un homme écrivant le
nom de son aimée, mais tous les hommes du monde, alors en proie à la servitude,
écrivant le nom de l’amour qui les résume toutes: celui de la liberté.
C’est qu’Éluard a eu des idées générales sur la condition des hommes, a beaucoup
réfléchi sur le travail du poète, sur l’histoire de la poésie (dans ses essais, Avenir de la
poésie, 1937 ; Donner à voir, 1939, comme dans ses importantes anthologies), sur la
politique (dans de nombreux articles et discours), sur la philosophie. Mais on peut dire de
lui qu’il n’a jamais eu d’opinions, au sens où on a une opinion comme on a une maison,
un stylo, ou une automobile. Ce poète qui se voulut, avec une obstination à la fois
admissible et parfois mal récompensée, un militant, un agitateur politique, n’a jamais
parlé que de ce qui le concernait profondément. Il souhaitait réhabiliter la «poésie de
circonstance», et il l’illustra de quelques chefs-d’œuvre. Mais c’est que, dans son cas au
moins, la circonstance historique n’a jamais eu une autre dimension ni ne s’est accomplie
dans un autre espace que celui du dedans. Dans un recueil comme Cours naturel (1938),
les poèmes d’amour et le poème intitulé «La Victoire de Guernica» n’apparaissent pas
comme différents d’inspiration, de source et de ton. C’est précisément parce qu’Éluard
sait de première vue, de première vie, de première main que l’accord des êtres est
possible, que l’harmonie est sensible, que, «si nous le voulions, il n’y aurait que des
merveilles», que le saccage de ces trésors par la bêtise-haine au front de taureau le
soulève de dégoût, qu’il n’a pas besoin de «se mettre à la place» des innocents qui
meurent sous les bombes de Guernica : il est à leur place. Il découvre «son bonheur
personnel dans le bonheur de tous», son malheur à lui dans le malheur de chacun.
L’eau limpide du bonheur, de la reconnaissance de soi-même par l’autre dans
l’illumination amoureuse, dans la fraternité des vivants court à travers toute l’œuvre
d’Éluard. Il parle d’une voix blanche comme un ciel pâle et doux de soleil et de légère
brume, enfantine dans le prime-saut des images et des sensations. Une voix qui semble
n’être la voix de personne en particulier, quasi adamique, le murmure du premier homme
et de tous les hommes tenant dans leurs bras la première femme et toutes les femmes.
Voix de l’existence à la crête de l’émerveillement d’être, dans l’illusion peut-être véridique
que le temps s’est suspendu dans la sensation presque physique de l’éternité :
Aujourd’hui lumière unique
Aujourd’hui l’enfance entière
Association ALDÉRAN © - Conférence 1000-098 : “ À la rencontre de Paul Éluard” par Hans Leymarin - 21/09/2004 - page 4

Changeant la vie en lumière
Sans passé sans lendemain
Aujourd’hui je suis toujours.
Cette poésie ne «parle» pas de la légèreté d’exister, de la grâce: elle la fait vivre parce
qu’elle la vit. Ce n’est jamais un discours didactique sur les possibilités radieuses de
l’homme ou sur les utopies du bonheur parfait des accomplissements, c’est une tentative,
réussie la plupart du temps, de recréer chez l’auditeur ces états, de les rendre
contagieux, de les donner à vivre.
Mais, quand cette respiration de soleil est brisée par le carnage, la fureur obtuse, l’avidité
rageuse de la destruction et du mal, la colère brise aussi ce murmure de cristal. Il y a un
Éluard fondamental, celui qui dit:
J’ai la beauté facile et c’est heureux
Je glisse sur le toit des vents
Je glisse sur le toit des mers.
Mais, dès ses vingt ans, il y a le réfractaire stupéfait, celui qui écrivait du front: «On a
honte d’être là» devant le spectacle d’un camarade agonisant; celui qui écrira plus tard:
«Le principal désir des hommes, dans la société où je vis, est de posséder [...]. Tout se
dresse, à chacun de nos pas, pour nous humilier, pour nous faire retourner en arrière [...].
La poésie véritable est incluse dans tout ce qui ne se conforme pas à cette morale qui,
pour maintenir son ordre, son prestige, ne doit construire que des casernes, des prisons,
des églises, des bordels.»
3. Éluard le violent
Éluard le voyant-transparent peut être, doit devenir aussi Éluard le violent, le rebelle. Il
projette, face à cette société qu’il veut contribuer à ruiner, l’image d’une contre-société qui
n’est pas simplement une «vue de l’esprit» dans la mesure où il a l’expérience immédiate
d’une autre façon d’être, d’un autre pacte des vivants avec les vivants, d’un autre état de
vie. À travers le dadaïsme, le surréalisme, le stalinisme, c’est la même démarche
obstinée, démentie souvent, mais jamais réfutée. «Si nous le voulions, il n’y aurait que
des merveilles.» Quand Éluard célébrera Joseph Staline, à l’occasion de l’anniversaire de
celui-ci, il n’écrira pas un de ces innombrables et sinistres péans flagorneurs qui
s’élèveront de la Russie écrasée et de la bouche des dupes ou des complices
occidentaux; il écrira un très beau poème qui ne fait pas le portrait d’un homme
historique, mais d’une terre promise et donnée. Un poème qui n’est tragique que par
l’écart entre la vision et ce que notre regard découvre.
Au cours des dernières années de sa vie (il devait mourir en novembre 1952, avant la
mort de Staline et le XXe Congrès), il arrivait aux admirateurs d’Éluard de regretter que le
sublime poète de l’amour sublime se fût «encanaillé» dans la politique et qu’Ariel se fût
«engagé» avec Caliban.
Quand on suit la longue respiration ininterrompue de la poésie d’Éluard, il semble au
contraire qu’on ne puisse séparer le poète «amoureux» du poète «pour tous», comme il
disait. Ce n’est pas malgré sa ressource inépuisable de révolte, sa perpétuelle
revendication «utopique» qu’Éluard a été un grand poète, le poète, aussi, de ce rapport
modèle entre les êtres, de cette relation étalon: l’amour. Ce n’est pas au détriment de sa
vision la plus radieuse des ressources de l’esprit humain qu’il aura manié les rames de
l’indignation, de la dénonciation.
Si le poète de L’Amour, la poésie (1929) et du Phénix (1951) n’a jamais laissé tarir son
ruissellement de mots limpides, c’est aussi, c’est d’abord grâce à sa ressource de
stupeur, de colère et de rage très raisonnable. On pressent ce qui aurait pu gâter cette
œuvre, en effet, si elle n’avait pas été soutenue et transportée par l’inapaisable violence
d’un perpétuel «jeune homme en colère». Il lui arrive d’effleurer la mièvrerie, de côtoyer
la puérilité et de risquer de tomber de l’innocence authentique dans l’imagerie d’Épinal de
la naïveté. Mais si Éluard évite la plupart du temps ces périls, c’est parce qu’il est en
même temps le témoin de la grâce d’exister et un démolisseur de ruines, un ange
expérimental et un archange combattant et furieux. Article Universalis 7.0
Association ALDÉRAN © - Conférence 1000-098 : “ À la rencontre de Paul Éluard” par Hans Leymarin - 21/09/2004 - page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%
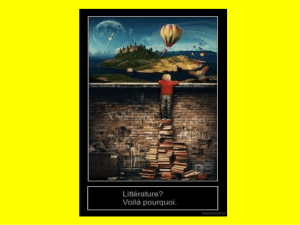


![[ici au format .doc]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008657352_1-dedb0b50c08a7425b295e7d51d8427da-300x300.png)