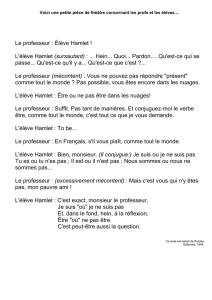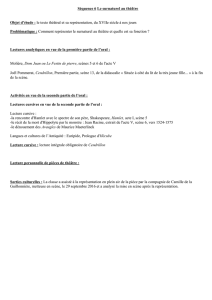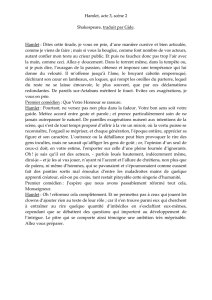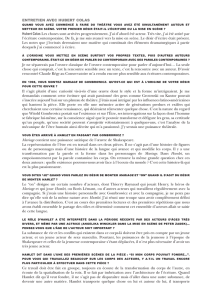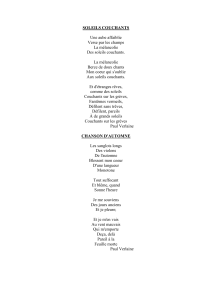Hamlet

Dirigé par Catherine Treilhou-Balaudé.
Textes de Leila Adham, Anne-Françoise Benhamou,
Pascal Collin, Maxime Contrepois, Rafaëlle Jolivet Pignon,
Catherine Treilhou-Balaudé, Gisèle Venet.
Hamlet
Énigmes du texte,
réponses de la scène

Remerciements
Les auteurs de l’ouvrage, Leila Adham, Anne-Françoise
Benhamou, Pascal Collin, Maxime Contrepois, Raphaëlle
Jolivet Pignon, Catherine Treilhou-Balaudé, Gisèle Venet.
Les agences Artcomart, Bridgeman Art Library, le CDDS
Enguerand, Marc et Armelle, la BnF (département des Arts
du spectacle) la Fondation Craig, Sophie Chandoutis, Frédéric
Schlotterbeck, Marcel Freydefont et l’ENSA de Nantes,
Enrique Diaz, Juliette Caron du service des archives à
l’Odéon/Théâtre de l’Europe, la bibliothèque Gaston-Baty
et tout particulièrement Claude Chauvineau, les éditions
théâtrales, Yves Bonnefoy, Richard Peduzzi, Yannis Kokkos.
Les photographes Hervé Bellamy (1-D photos), Déborah 70,
Éric Dydim, Brigitte et Marc Enguerand, Alain Fonteray,
Yves Guillotin, Pascal Victor (Artcomart).
Crédits photographiques
Page de titre
Angela Winkler dans Hamlet, mise en scène de Peter Zadek,
MC93, Bobigny, décembre 2000.
© Pascal Victor/Artcomart
Page 2
Portrait de Shakespeare vers 1610 par John Taylor.
© Bridgeman Art Library
1re de couverture
Lars Eidinger dans Hamlet, adaptation et mise en scène
de Thomas Ostermeier, Cour d’honneur du palais des Papes,
Festival d’Avignon, Avignon, 2008.
© Pascal Victor/Artcomart
4ede couverture
Robert Wilson dans Hamlet: A Monologue, mise en scène
de Robert Wilson, Festival d’automne, MC93, Bobigny, 1995.
© Marc Enguerand
Pilotage et coordination
Patrick Laudet, inspecteur général de Lettres, chargé
du théâtre
Jean-Jacques Arnault, CNDP
Bruno Dairou, directeur-adjoint, CNDP
Jean-Claude Lallias, chargé de mission théâtre, CNDP
Pierre Laporte, chargé d’études à la DGESCO
Claude Renucci, directrice de l’édition, CNDP
Édition et iconographie
Jean-Jacques Arnault, CNDP
Secrétariat d’édition
Véronique Le Dosseur, Julie Desliers-Larralde, CNDP
Maquette
Jacques Zahles, HEXA Graphic
© CNDP, 1er trimestre 2012
ISBN : 978-2-240-03261-4
ISSN : en cours

4 Avant-propos
5 Préface – Sur une ligne de faille
7 Énigmes du texte
7 Vivre en liberté le vers shakespearien
12 Faire ou ne pas faire
14 Hamlet, des énigmes à déchiffrer ou à représenter ?
17 L’énigme toujours recommencée d’Hamlet.
23 Du texte à la scène
23 Hamlet de la scène française à la scène européenne : omniprésence et diversité
40 Faire la lumière dans Hamlet…
43 Scénographier Hamlet : le mouvement perpétuel des pages de l’Histoire
46 Hamlet sur la scène contemporaine
46 Nouveaux enjeux d’Hamlet
51 À propos du spectre dans quelques mises en scène récentes d’Hamlet
56 La représentation comme « piège » du théâtre
61 Hamlet, l’acteur absolu de Thomas Ostermeier
64 Un cabaret Hamlet : Matthias Langhoff et le fantôme de la vieillesse
67 L’eau dans le spectacle de David Bobee : un miroir des âmes
70 Repères
71 Filmographie
71 Bibliographie
72 Sitographie
Sommaire
Sommaire des encadrés
11 La chanson d’Ophélie
15 Krzysztof Warlikowski : « Hamlet, c’est tout à fait moi. »
15 Antoine Vitez contre « l’optimisme de la lecture »
41 Dans l’enfermement d’un univers mental
44 Le bois et la pierre, matériaux d’une histoire en mouvement
45 Le cavalier de l’Apocalypse
48 Au moins j’aurai laissé un beau cadavre

Henri Suhamy estime que la tragédie d’Hamlet
« atteint le summum de la poésie aphoristique ».
C’est dire que, si la pièce est longue au temps de la
montre, elle est pourtant incroyablement condensée
et concentrée. « Chaque phrase en effet y reflète, dit-
il, l’expérience du monde et de la vie. »
Aphoristique, oui certainement, mais aporistique
non moins. Car cette pièce fatiguera toujours,
jusqu’au supplice, ceux qui entreprennent de la
jouer comme ceux qui voudraient la comprendre.
Ce n’est pas peu de chose que de confronter des
élèves à cette folie et à cet inceste – vrais, simulés,
fantasmés ? –, à ce non-meurtre du père, où l’on
aperçoit Oreste, Œdipe, Pyrrhus, mais où rien ni
personne, tel un spectre, ne se laisse identifier. Ce
n’est pas rien que de les embarquer dans l’écroule-
ment d’un royaume, dans l’empoisonnement général
par où il faut passer… peut-être. À moins que ce ne
soit pour rien, sauf au bénéfice de la mort – qui est
insondable.
« Words, words, words », penseront certains élèves
du grand fatras shakespearien et davantage encore
de nos laborieux efforts d’analyse. Ne nous en effa-
rouchons pas ! Ils auront donc capté l’essentiel.
Songeons seulement à leur offrir aussi, en guise
d’oxygène, l’étincelant To be or not to be d’Ernst
Lubitsch, qui n’oblitère rien du drame, porté au
contraire à l’échelle d’une guerre mondiale, mais
qui montre, et cela est éminemment shakespearien,
hamletien même, qu’on peut s’en sortir aussi avec le
sourire.
Une nouvelle saison scolaire se déroulera donc sous
le signe du grand Shakespeare, et sous l’horizon,
inquiétant et excitant, de l’énigme, de l’indécidable,
de la vérité qu’on n’attrape pas comme ça. Quelle
occasion ! Quel pied de nez à l’ordre du discours
environnant ! Nous serons alors délicieusement
consentants : c’est donc à un polar sans fin que nous
sommes invités… Pierre Bayard, dans une enquête
parue sous le titre Le Dialogue de sourds, nous a
récemment proposé son époustouflante résolution,
qu’il serait dommage de déflorer ici. Mais « résolu-
tion » au sens musical du mot : point où se rencon-
trent toute une série de résonances. Et non pas
solution, qui serait point final. Disons : étoile filante
dans l’obscure clarté du sens.
Mieux encore : nous sommes invités à l’acte théâtral
par excellence. « Énigmes du texte, réponses de la
scène. » Ce régime de l’aporie, auquel le texte
d’Hamlet nous soumet, est aussi une occasion de
nous confier davantage au plateau, au jeu, à tout
ce qui dispose les personnages et incarne les mots,
pour entendre mieux ce qu’ils disent vraiment. Ce
qu’ils disent aussi, ce qu’ils disent peut-être.
Une mise en scène résout, comme Jean-Sébastien
Bach résout la fugue ; elle ne résout pas comme le
gestionnaire prétend le faire d’une crise. Elle
découle d’une lecture, parfois remâchée des
dizaines d’années, ainsi qu’Edward Gordon Craig
nous le sermonne volontiers, sur Hamlet précisé-
ment. Il y a des lectures, impressionnantes au demeu-
rant, qui referment pourtant l’interprétation sur le
texte tandis que d’autres, préférables dans leur prin-
cipe, préservent sa qualité d’organisme vivant, où
s’inscrit sa propre négativité, où l’expiration assure la
prochaine inspiration.
« Énigmes du texte, réponses de la scène ? » Faisons
le pari que, chez nos élèves et leurs professeurs, la
question ouvrira de belles aventures herméneu-
tiques, et surtout humaines ! Une œuvre dramatique
est semblable à la mer, celle-là même qui bat les
fondations du château d’Elseneur et répand sur le
Danemark ses embruns. Nulle route n’y est par
avance tracée ; autrement dit, une infinité de routes
y est possible, qui ne mènent pas toutes quelque
part. Il s’agit toujours d’en prendre une. Cela récla-
mera de la « résolution », dans un sens du mot pas
complètement autre. Il y faudra, comme au gonfle-
ment de la voile, des énergies plurielles, favorables
ou contraires. Cela réclamera une haute modestie,
une sorte de savoir-mourir, car le chemin inventé
s’efface toujours derrière le passage du navire.
Nos apprentis comédiens apprendront, j’en fais le
vœu, qu’on ne surplombe pas le mystère du texte.
On y entre.
4
Avant-propos
Patrick Laudet,inspecteur général de l’Éducation nationale en charge de l’enseignement lettres-théâtre.
Nous dira-t-il le sens de ce spectacle ?
Hamlet, acte III, scène II.

Comme beaucoup de pièces de Shakespeare, Hamlet
est construit de sorte que même le spectateur le plus
naïf soit directement en contact avec son aspect énig-
matique : pourquoi, après avoir passé une bonne
part de la pièce à chercher la preuve de la culpabilité
de Claudius, une fois qu’il l’a obtenue sous nos yeux
de façon certaine, Hamlet sursoit-il à son acte ?
Comme l’a brillamment montré Lev Vygotski, si
Shakespeare « nous signale constamment et très clai-
rement la ligne droite que devrait suivre l’action,
c’est pour nous faire ressentir de manière aiguë les
écarts et les détours que cette action décrit »
1
. C’est
ce qu’on pourrait appeler une dramaturgie de l’ai-
guillage : en même temps que la pièce prend une
voie, Shakespeare nous rend conscients de la voie –
souvent bien plus logique – qu’elle n’emprunte pas.
L’espace toujours croissant qui sépare ces deux direc-
tions ouvre un champ problématique dans lequel
peuvent s’engouffrer toutes sortes de réponses
critiques et scéniques.
Si Hamlet est le parangon des œuvres énigmatiques
de Shakespeare, son cas n’est pas isolé ; beaucoup
de ses pièces plus célèbres sont fondées sur des
gouffres : pourquoi Lear – alors qu’il avait tout prévu
pour réserver la meilleure part à sa fille préférée – est-
il pris subitement d’une rage qui le fait la bannir ?
Pourquoi Othello, si confiant en sa femme, se laisse-
t-il en quelques phrases abuser par Iago ? Pourquoi
Lady Macbeth passe-t-elle entre deux actes, sans tran-
sition ni explication, du comble du cynisme à un délire
de culpabilité ? Et pourquoi, dans le même intervalle,
Macbeth a-t-il perdu toute angoisse ? Pourquoi
Angelo le pur se transforme-t-il sous nos yeux, en
quelques répliques, en violeur potentiel ? Pourquoi le
roi Léontès se persuade-t-il subitement, alors qu’il
vient de redire sa profonde amitié pour Polixénès,
que celui-ci est le père de l’enfant qu’attend la reine2?
Non seulement l’écriture de Shakespeare ne fait rien
pour justifier ces renversements paradoxaux, ces
abîmes soudains qu’ouvre l’intrigue au cœur des
personnages, mais au contraire son théâtre propulse
en pleine lumière, devant nous, ces fractures incom-
préhensibles et brutales. Souvent le dédoublement de
l’action en renforce la structure énigmatique :
qu’Edgar le banni soit victime du machiavélisme de
son frère Edmond ne fait que mieux apparaître que
la répudiation de Cordélia n’a pas de cause évidente ;
que Laërte et Fortinbras épousent si spontanément la
cause de leur père donne la mesure de ce qu’Hamlet
ne fait pas.
Œuvre intimidante par la place qu’elle occupe depuis
des siècles dans la culture européenne, Hamlet n’est
donc pas une machine écrasante : en exhibant ses
béances, ses incomplétudes, elle ouvre ardemment
le dialogue avec n’importe lequel de ses lecteurs,
de ses spectateurs, de ses metteurs en scène, de
ses acteurs. S’agit-il pour autant, pour le théâtre,
Hamlet Énigmes du texte, réponses de la scène 5
Préface – Sur une ligne de faille
Anne-Françoise Benhamou.
Dessin, encre et lavis d’Edward Gordon Craig pour l’acte
II scène II d’Hamlet, théâtre d’Art de Moscou, 1911, BnF,
Paris.
1. Lev Vygotski,
« La tragédie de Hamlet,
prince de Danemark »,
Théâtre/Public
,n°49
(« Shakespearomanie »),
janvier-février 1983, p. 35.
2. Respectivement dans
Le Roi Lear
,
Othello
,
Macbeth
,
Mesure pour
mesure
et
Le Conte d’hiver.
© Fondation Craig.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
1
/
72
100%