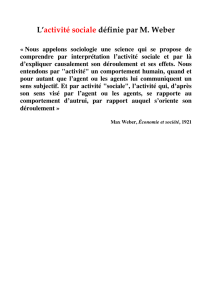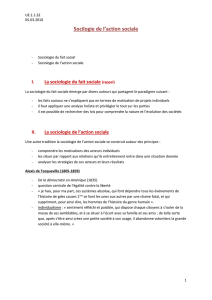COMPTE RENDU DU PETIT DÉJEUNER DU CSO Les marchés à l

COMPTE RENDU DU PETIT DÉJEUNER DU CSO
Les marchés à l’ordre du jour
27 janvier 2009
Ce petit déjeuner, qui a eu lieu à Sciences Po et qui était organisé autour de l’ouvrage de
Pierre François, Sociologie des marchés, (Armand Colin, collection U, 2008), réunissait trois
sociologues et une économiste : Pierre François, auteur de l’ouvrage, sociologue et chargé
de recherche CNRS au CSO, Jens Beckert, sociologue, directeur du Max Plank Institute for
the Study of Societies de Cologne, doyen de la section économique de la DGS (Association
allemande de sociologie), Hélène Tordjman, maître de conférences en économie à
l’université Paris XIII. Patrick Le Galès, sociologue et politiste, directeur de recherche CNRS à
Sciences Po, co-directeur de la collection U Sociologie, Armand Colin, assurait le rôle de
modérateur.
Le public, nombreux (une soixantaine de personnes) et diversifié était constitué de chercheurs,
enseignants-chercheurs et doctorants, issus de différentes disciplines (sociologie, science du
politique, économie, droit, gestion, finances) et de praticiens (consultants, cadres d’entreprises
ou d’administrations, chargés de mission sur des projets territoriaux, journalistes…).
Ø Patrick Le Galès présente les intervenants et ouvre le débat.
Ø Pierre François
Pour rendre compte de ce livre, Pierre François évoque d’abord la collection U qui l’accueille,
dont le projet est assez particulier dans le paysage de l’édition en sciences sociales, puisque
son cahier des charges demande aux auteurs de proposer des livres qui soient, simultanément,
(1) des manuels, présentant, de manière pédagogique et objective, l’état de l’art dans un
1

champ donné, en l’occurrence celui de la sociologie des marchés ; (2) des livres à thèse, qui
non seulement agencent ces travaux dans une perspective singulière mais qui, en plus, tentent
d’avancer une démarche spécifique sur l’ensemble du champ étudié.
Ce double impératif explique le caractère de l’ouvrage. D’un côté, sont présentés les principaux
travaux portant sur l’un des sous-champs les plus dynamiques de la sociologie économique, la
sociologie des marchés. D’un autre côté, l’auteur porte un regard spécifique sur les
phénomènes marchands en les replaçant dans une réflexion plus vaste sur l’hétérogénéité des
formes d’organisation des activités économiques. Le pari de l’ouvrage est qu’en tentant
d’identifier une plate-forme commune où puisse s’organiser l’ensemble des travaux traitant des
marchés, on parvienne simultanément à offrir de ces derniers une sorte de point de vue
synoptique.
Mais pourquoi un sociologue va-t-il traiter d’activités économiques, de marchés, domaine qui
traditionnellement était celui des économistes ? Pierre François, paraphrasant Clémenceau,
répond par cette boutade : « L’’économie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux
seuls économistes ». L’auteur présente deux lignes d’arguments : (1) L’objet : il est difficile de
distinguer une sphère d’activité économique qui serait parfaitement autonome et radicalement
distincte du reste de la société ; (2) la méthode, à savoir la science du modèle (mathématique)
pour l’économiste versus la science de l’enquête pour le sociologue qui constituent deux modes
de raisonnement assez distincts sur une même réalité.
En quoi un panorama de la sociologie des marchés ne va-t-il pas de soi ?
Depuis longtemps, la sociologie des marchés existe, mais ne se pense pas comme telle ; des
travaux passionnants, qu’on a regroupés, portent sur des phénomènes marchands, mais ne se
pensent pas comme s’agençant en sous-discipline (ces auteurs sont les « Jourdain » de la
sociologie économique). Ensuite, au milieu des années 70, un ensemble de travaux se sont
constitués en champ distinct, en sous-discipline, mais en s’inscrivant dans une démarche
plutôt polémique que cumulative. Comment procéder ? Pour Pierre François, le mieux serait
d’avancer une perspective, de dégager une plate-forme, à partir de laquelle les résultats (mais
aussi les querelles) de ces travaux puissent s’organiser et, éventuellement, se cumuler un peu.
Pierre François a emprunté cette perspective à Weber, et plus précisément à une dimension
encore mal connue à ce jour de son œuvre, que l’on peut se risquer à qualifier de
morphologique. Il présente quelques éléments d’explication, en forme d’hypothèses :
(1) Le monde économique n’est pas indifférencié, ce qui peut paraître dans un premier
temps paradoxal, étant donné que les transformations analytiques et empiriques vont dans le
sens d’une représentation indifférenciée du monde économique. En effet, les transformations
2

empiriques se traduisent par la prolifération de la forme en réseau, la mise en place
d’organisations très fortes pour faire tenir les marchés ainsi que de relations marchandes au
sein des organisations. Au niveau analytique, pour montrer que la réalité sociale n’a rien de
naturel, qu’elle est construite, on s’attache à la déconstruire. Derrière la bureaucratie, sont mis
en place des ordres locaux ; derrière les marchés, des relations bilatérales, parfois triadiques,
mais rarement plus, ou des jeux d’interaction stabilisés.
(2) Pour décrire la différenciation interne du monde économique, il est possible de
s’appuyer sur de vieilles catégories classiques des sciences sociales : le marché,
l’organisation, la profession.
Là encore, cette hypothèse ne va pas de soi. Beaucoup de sociologues, en un geste classique,
refusent de faire du monde un espace social indifférencié et rejettent ces catégories parce
qu’elles épuiseraient leur sens dans des considérations de sens commun : ils leur substituent
un autre vocabulaire, celui du champ (cf. Bourdieu) ou du monde. Si malgré tout, on adopte
cette démarche, alors on voit ce que cette hypothèse comporte comme risque : ces catégories
classiques sont précisément celles qui ont été déconstruites. Donc, il ne s’agit pas de les
restaurer, mais de les travailler à nouveau frais en en précisant le sens. Mais de quelle
manière ?
(3) Pour Pierre François, on peut tenter de repenser ces catégories en les replaçant
dans un horizon de pensée morphologique, i.e. en se recentrant sur les acteurs qui
composent une forme, sur les relations entre les acteurs de cette forme, ainsi que
sur la stabilité (et le fondement de cette stabilité) de leurs relations. Avec cette
approche, comment comprendre ce qu’est le marché ? Pour Weber, il s’agit de
l’agencement de deux jeux d’interaction – l’échange et la concurrence. Pierre François
prend ici un pari méthodologique ; cette compréhension, que Weber travaille dans le texte
Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive (1913) et dans le chapitre II
d’Economie et Société n’a pas eu de postérité explicite, mais il tente de remplir sa démarche
en rassemblant les travaux de sociologie sur les marchés de plusieurs manières : (1) En
travaillant sur les frontières du marché (échange marchand/non marchand ;
marché/organisation ; marché/politique). (2) En identifiant la manière dont les acteurs
interviennent sur un marché ; souvent est sous-jacent un postulat de rationalité. Or, les
travaux anciens (Weber) montrent que ces capacités à agir rationnellement ne vont pas de soi,
qu’elles ont une histoire. D’autres travaux remettent au goût du jour un vieux thème, celui de
la performativité. Il s’agit d’un programme de recherche à part entière que de comprendre les
multiples voies par lesquelles ce comportement est progressivement façonné. (3) Les marchés
ne sont pas des entités abstraites, ils s’appuient sur un ensemble de repères partagés, de
règles, de catégories de pensée collective, que Pierre François a proposé de saisir comme des
3

institutions, qui sont bien décrites dans la sociologie économique française. Trois problèmes se
posent à ce sujet : a) quels sont les grands types de catégories partagées : marques, labels,
certifications ? b) Comment comprendre l’efficacité qui leur est reconnue (la marque Jean-Paul
Gaultier, par exemple) ? c) Comment comprendre la genèse de ces catégories de pensée
collective ?
S’intéresser au marché, c’est aussi s’intéresser aux phénomènes concurrentiels, présents sur
les différents marchés. A côté de compréhensions qui la replacent sur un fond de pensée
morphologique, Pierre François s’appuie sur une tradition qui remonte notamment à Simmel et
Weber et qui fait de la concurrence une forme particulière de conflit, à savoir une lutte
indirecte pour des opportunités d’échanges. Mais il reste à progresser dans la formalisation
analytique de ces formes de lutte.
Ø Hélène Tordjman
Economiste, Hélène Tordjman apprécie de pouvoir discuter avec un sociologue sur un objet
aussi riche, difficile à cerner, que constitue le marché, qui est une des institutions centrales de
notre société capitaliste moderne, mais qui, paradoxalement, a été très peu étudié par la
science économique. Celle-ci en donne une représentation très simplifiée, la simple
intersection d’une courbe d’offre et d’une courbe de demande. Elle n’en donne qu’un modèle
formel mais qui ne permet pas de comprendre la réalité concrète du marché, la manière dont
les prix se forment, dont les acteurs se rencontrent et échangent. Il faudrait que les
économistes aient un autre point de départ pour parvenir à une analyse des marchés plus
réaliste et satisfaisante. L’ouvrage de Pierre François opère un large tour d’horizon d’auteurs
que les économistes connaissent généralement peu ; il donne chair à la notion de marché, très
pauvre chez les économistes.
Hélène Tordjman souligne trois points qui lui ont paru particulièrement intéressants et
convaincants : (1) Le fait de partir de Weber lui semble très pertinent, de manière générale
et, plus précisément, par sa définition du marché qui fait intervenir deux dimensions :
l’échange et la concurrence. L’exposé est clair et permet à des néophytes de se familiariser
avec Weber. (2) La « fabrique sociale » de la rationalité économique est une notion très
intéressante. Les économistes se donnent cette hypothèse sans la discuter et devraient
réfléchir sur la manière dont la rationalité économique se forme, contrairement à la vulgate
économique partant d’Adam Smith, à la fin du XVIIIe siècle, qui souligne la propension
naturelle chez l’homme à acheter, à vendre, à marchander. On peut s’interroger à ce
sujet, comme le fait Albert O. Hirschman dans son ouvrage, Les passions et les intérêts :
Justifications politiques du capitalisme avant son apogée (PUF, 1977) : la catégorie d’intérêt,
4

de recherche de son propre intérêt, privé, matériel, est historiquement datée, elle est née avec
le capitalisme. (3) Pierre François, se référant à Weber, montre que le marché est une forme
de socialisation, une manière de faire société. H. Tordjman adhère à cette idée qu’elle juge
essentielle ; avec d’autres économistes, elle pense également que le marché est une
institution ou un ensemble d’institutions. Cependant, certaines institutions fondamentales ne
sont pas évoquées dans l’ouvrage de Pierre François.
Selon H. Tordjman, trois niveaux institutionnels permettent au marché d’exister : (1) Celui
qui permet de définir une marchandise qui n’existe pas à l’état naturel, mais qui est construite
socialement (labels, marques qui rendent compte de la qualité de la marchandise). Cependant,
elle fait remarquer que les droits de propriété, importants dans la construction marchande,
sont un peu absents de l’ouvrage. (2) L’identité des acteurs qui ont le droit d’intervenir sur un
marché : par exemple, la réglementation de la concurrence contrôle l’identité des acteurs qui
interviennent sur tel marché. (3) Les mécanismes d’échanges, auxquels les économistes
s’intéressent presque exclusivement : des règles organisent la transaction (règles bilatérales
ou faisant intervenir une institution centralisatrice, par exemple le commissaire-priseur). La
manière dont les prix se forment (rôle des enchères) est également à considérer.
Une convergence des travaux des sociologues et des économistes hétérodoxes serait
souhaitable et doit être approfondie.
Cependant, Hélène Tordjman souligne quelques points de désaccord qui n’enlèvent rien à
l’intérêt de l’ouvrage :
1. Le choix des auteurs retenus - même s’il s’agit d’une littérature très riche – le choix de
ceux laissés dans l’ombre, est à son avis, un peu injuste. Pierre François s’est concentré
essentiellement sur les travaux des économistes orthodoxes alors que les travaux des
économistes hétérodoxes, institutionnalistes, évolutionnistes, régulationnistes auraient pu
présenter un apport intéressant (les travaux de North sur les droits de propriété et les
marchés, ceux de Schumpeter sur la concurrence comme processus dynamique (la
« destruction créatrice »), et ceux de Marx sur la concurrence comme lutte, comme conflit.
2. La tendance (sans doute liée au choix des auteurs) à se centrer un peu trop sur des
explications cognitives du lien social et à sous-estimer des structures sociales plus
lourdes, notamment les rapports de force capital-travail qui se cristallisent dans des
institutions comme les régimes de droit de propriété, qui eux-mêmes se durcissent (plus de
pouvoir aux actionnaires). Ces changements institutionnels reflètent des évolutions des
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%