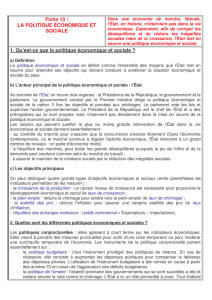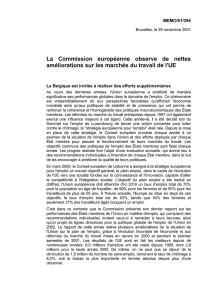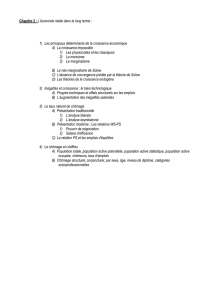EMPLOI - Le Monde

France, ton industrie
fout-elle le camp ?
EMPLOI
bLe gouvernement et les partenaires sociaux
veulent faire de la formation continue
le remède miracle contre le chômage.
Les expériences de nos voisins montrent
les limites de cet espoir p. VII
bL’affaire Enron n’en finit pas de recomposer
le paysage de l’audit et du conseil p. VIII
C
ela fait maintenant
une quinzaine de
jours que les politi-
ques ont entonné
l’air de la désindus-
trialisation. D’abord
une petite musique, puis avec plus
de coffre lorsque Jacques Chirac
décida de recevoir le 10 septem-
bre, à l’Elysée, neuf grands
patrons français pour « discuter du
maintien des activités industrielles
en Europe ». Ce fut ensuite au tour
de Jean Arthuis, ancien ministre de
l’économie et président de la com-
mission des finances du Sénat, de
donner de la voix : « La France se
désindustrialise, et ne doit pas deve-
nir un supermarché de produits
fabriqués ailleurs. » Avec les affai-
res Pechiney et Alstom, c’est désor-
mais la fanfare qui a pris le relais.
En visite vendredi 19 septembre à
l’usine Snecma de Corbeil-Esson-
nes, Jean-Pierre Raffarin, interpel-
lé sur Alstom, a appelé « les entre-
prises et les salariés à mener le com-
bat contre la désindustrialisation ».
Tour à tour, donc, deux de nos
fleurons industriels sont attaqués.
Le premier fait les frais d’une OPA
par le canadien Alcan et ces noces
d’aluminium pourraient, même si
Alcan s’est engagé à ne pas fermer
de sites industriels supplémentai-
res, se traduire par des réductions
d’effectifs. Le second, qui espère
aujourd’hui un ultime plan de sau-
vetage après le veto de Bruxelles
au renflouement du groupe par
l’Etat français, risque ni plus ni
moins qu’un dépôt de bilan met-
tant à terre 118 000 salariés dont
23 000 dans l’Hexagone. Bref, la
rentrée est au déclin. Et les livres
de Nicolas Baverez La France qui
tombe (Perrin) et de Jean-Marie
Rouart Adieu à la France qui s’en
va (Grasset), pour ne citer que ces
deux-là, tout juste placés dans les
rayons des libraires, ne peuvent
que renforcer ce pessimisme
ambiant. On voit bien le bénéfice
secondaire qui se dégage à hurler
avec les loups : l’Etat se trouverait
désemparé face à la mondialisa-
tion et donc réduit à l’inaction.
«Quand j’entends le mot
“désindustrialisation”, analyse à
contre-courant Jean-Pierre
Aubert, le nouveau patron de la
mission interministérielle sur les
mutations économiques, je sais
qu’il faut immédiatement prôner la
prudence. Il ne me semble pas que
le moteur industriel français soit
enrayé. Nous faisons plutôt face à
des mouvements incessants de redis-
tribution et de régénération. »
Redistribution ? Certainement.
En 2002, l’industrie française a per-
du près de 90 000 emplois et
depuis janvier 2003 il faudrait en
rajouter, selon la CFDT, 60 000
autres. « Un mouvement structurel
qui touche l’ensemble des pays
industrialisés soumis à une concur-
rence mondiale, qui pousse à des
gains de productivité de plus en
plus forts », insiste-t-on au ministè-
re de l’industrie, qui rappelle que
l’emploi industriel direct a recom-
mencé (seulement) à décroître au
printemps 2001, après huit trimes-
tres de croissance continue. Le
poids des délocalisations n’est pas
majeur dans cette équation. L’ana-
lyse des investissements directs
français à l’étranger (52,4 mil-
liards d’euros en 2002) reflète, en
effet, davantage l’internationalisa-
tion croissante des grands grou-
pes français plutôt qu’une envo-
lée des délocalisations d’activités
productives.
«Certes, convient un haut fonc-
tionnaire au ministère de l’écono-
mie, les annonces en cascade de
plans de restructuration [dernier
en date, celui du groupe métallur-
gique et minier Eramet] alimen-
tent l’angoisse.Bien sûr que les sec-
teurs du textile, de l’habillement
souffrent beaucoup, mais d’autres
se défendent admirablement. Ne
faisons surtout pas d’amalgame. »
STMicroelectronics ferme son site
de Rennes ? A des centaines de
kilomètres de là, André Péronet,
président d’Eurodec, groupe fran-
çais et numéro un mondial dans la
fabrication des petites pièces
mécaniques pour automobiles,
rachète l’une des unités de produc-
tion de GiatManuRhin, et ne dou-
te pas des atouts qui sont désor-
mais les siens : « Nous sommes au
cœur du marché européen et les
260 salariés que nous avons repris
ont le savoir-faire dont nous avions
besoin. Avec un peu plus d’automa-
tisation et des salaires qui ne doi-
vent pas dépasser 20 % du chiffre
d’affaires, nous sommes prêts à
affronter nos concurrents. »
La France, attractive ? C’est aus-
si le pari qu’a fait Seiichiro Adachi,
aujourd’hui président de Toyota
France, et maître d’œuvre en 1997
de l’implantation de l’usine japo-
naise à Valenciennes : « Nous
avons un principe de base : fabri-
quer où nous vendons. Cela dit, trois
raisons majeures nous ont fait préfé-
rer la France au Royaume-Uni : la
situation géographique, l’infrastruc-
ture performante et des ressources
humaines de qualité, disponibles. »
Les 35 heures ? Les coûts sala-
riaux ? « On s’adapte. Il n’y a pas
que des inconvénients et ce ne sont
pas des éléments déterminants. »
Comment savoir de quel côté
penche la balance ? A étudier de
près les statistiques, l’industrie
française n’est pas à l’agonie.
Compétitivité-prix stabilisée,
coûts salariaux dans la moyenne
européenne… Jean-Pierre Aubert
araison d’évoquer la prudence.
Si la contribution – en valeur – du
pôle industriel à la richesse natio-
nale est passée de 20,5 % du PIB
en 1980 à 14,3 % en 2002, en volu-
me, on part de 15,6 % pour arri-
ver à 16,7 %. Les fondements sont
là. Mais il est vrai que l’automati-
sation et la concurrence « consti-
tuent un mouvement irréversible,
consubstantiel à nos sociétés indus-
trialisées, constate-t-on au minis-
tère de l’économie. La question
est de savoir s’il nous faut lutter
contre ce mouvement – pour le
ralentir – ou si nous décidons de
nous y adapter ».
Face à l’urgence d’un dossier
comme Alstom, les solutions ne
peuvent être que pragmatiques.
Comme le sont les pistes régulière-
ment proposées à l’instar de la
baisse des charges sur les emplois
peu qualifiés, par exemple : « C’est
un pis-aller, puisque de toute façon
ces emplois sont appelés à disparaî-
tre petit à petit », reconnaît Jean-
Pierre Aubert. Mais face à un mou-
vement de fond, la réflexion doit
porter sur le long terme.
Marie-Béatrice Baudet
OFFRES
D’EMPLOI
pechiney sous
drapeau canadien,
alstom en péril…
et pourtant
le tissu économique
résiste mieux qu’on
ne le laisse croire
EUROPE
Calamité en Europe
ou moteur de la reprise
de l’activité
aux Etats-Unis ? La
relance de l’économie
par le déficit budgétaire
est affaire de…
crédibilité politique p. V
Sophia Spiliotopoulos,
vice-présidente
des Femmes de l’Europe
méridionale, veut que
l’égalité entre hommes
et femmes soit inscrite
dans la Constitution
de l’Union p. IV
FOCUS
bDirigeants bFinance, administration,
juridique, RH bBanque, assurance
bConseil, auditbMarketing, commer-
cial, communication bSanté bIndus-
tries et technologies bCarrières inter-
nationales bMultipostes bCollectivi-
tés territoriales p. IX à XIV
Conjuguer
haut niveau académique
et compétences
professionnelles
ADMISSION BAC+4 /+5
• Des formations opérationnelles • Une ouverture internationale
• Des partenariats entreprises actifs • La puissance d’un réseau d’anciens
Pour tout renseignement :
Isabelle NONIS - Tél. 01 40 03 15 69
www.groupe-igs.asso.fr
- International MBA
proposé par IGS et Temple University (accrédité AACSB)
- International Management
- Management de la Relation Client
- Stratégie et e-Management
développés en partenariat pédagogique avec l’IMD de
l’Université de Lille 2 - Grade européen Master
- Management des Industries de la Santé
Titre homologué par l’Etat niveau I
www.groupe-igs.asso.fr/imba
www.esamparis.com
www.icdparis.com
www.igscampus.com
www.imis.fr
- Expertise DIRCOM
- Communication et Management
- Management de Projet Multimédia
www.institutdesmedias.com
LES 3èmes CYCLES
DU GROUPE IGS
P A R I S • L Y O N • T O U L O U S E
- Management et Développement
des Ressources Humaines
Titre homologué par l’Etat niveau I
- Management Stratégique et Juridique des Entreprises
- Audit et Management Stratégique des Organisations
développés en partenariat pédagogique avec l’Université de
Lille 2, DESS Juriste d’Entreprise options Juridique / Audit
« Trois raisons majeures nous ont fait préférer
l’Hexagone : la situation géographique,
l’infrastructure performante
et des ressources humaines de qualité »
,
Parts de marchés relativesen valeur des produits manufacturés
par rapport au 24pays de l'OCDE,en %
UNE COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE STABILISÉE
Source : Direction de laprévision
Emploi salarié dansl'industrie dansles principaux pays de l'OCDE
France
Allemagne
Italie
Espagne
Etats-Unis
Japon
En millionsde personnes, en fin d'année
Champ: emploi salarié directde la branche
industrie, ycomprisagroalimentaire
eténergie
DE MOINS EN MOINS D'EMPLOIS
0
5
10
15
20
25
010099989796959493929190
5
10
15
8,1 7,2
20
01009998979695949392
France
Allemagne
Italie
Roy.-Uni
Etats-Unis
Japon
LA PEUR DES DÉLOCALISATIONS
Infographie : LeMonde
ECONOMIE
MARDI 23 SEPTEMBRE 2003

Sophie la girafe fait de la résistance
Une trame d’espoir pour le textile, en dépit des saignées successives
« que j’ai étudié la possibilité de
fabriquer Sophie en Chine ! » Jean-Claude Stras-
bach, PDG de Vulli, l’entreprise qui fabrique la gira-
fe ainsi prénommée, jouet le plus vendu en France,
a fait ses calculs ; ils lui ont fait choisir de conserver
àRumilly (Haute-Savoie) la fabrication de ce sympa-
thique animal en latex aux yeux noirs, aux sabots
orange et aux joues roses qui, depuis quarante-
trois ans, couine sous les dents des bébés.
Les raisons de cette résistance aux sirènes asiati-
ques et à leurs bas coûts salariaux ne tiennent pas
au patriotisme, mais à l’intérêt bien compris de Vul-
li et de ses soixante-trois salariés. « Sophie, c’est
notre produit phare, explique M. Strasbach ; sa tech-
nologie est très particulière et très artisanale. Je ne
veux pas la sortir en Asie, où elle pourrait être
copiée, d’autant que je ne serais pas gagnant sur ce
produit plutôt volumineux, à cause des coûts de
transport. Mais ce qui m’a décidé, c’est que la pro-
duction de 600 000 girafes fait travailler vingt per-
sonnes toute l’année. »
Vulli délocalise en Extrême-Orient, mais plutôt
les jouets en textile. « Nous développons directe-
ment en Asie nos nouveaux produits, conclut son
PDG, c’est-à-dire lorsque nos coûts deviennent un
handicap et que nous ne possédons pas le savoir-
faire ; car notre métier, c’est le thermoformage. »
C’est un crève-cœur pour Anne-Marie Vullierme,
directrice générale d’Eligor, de devoir sous-traiter
en Chine la fabrication de ses voitures miniatures,
mais comment résister ? « Nos donneurs d’ordres
ne nous laissent plus le choix, car tous nos concur-
rents fabriquent en Chine, et le prix de la main-
d’œuvre est déterminant, explique-t-elle. Un salarié
français coûte autant que quinze Chinois qui tra-
vaillent, eux, dix heures par jour et six jours par
semaine. La main-d’œuvre entre pour 40 % dans le
coût de nos voitures et de nos camions, qui sont
fabriqués à la main. Nous essayons pourtant de
demeurer une industrie de main-d’œuvre dans un
pays où il n’y en a plus. »
Comment tenir ? « Nos cinquante salariés conti-
nuent à fabriquer à Oyonnax, dans l’Ain, les petites
quantités, entre 150 et 500 pièces, par exemple les
modèles réduits de camions et de voitures destinés
aux concessionnaires de Renault, d’Iveco ou de Nor-
bert Dentressangle ; mais c’est en Chine que nous
commandons les séries pour le grand public. »
La position de Jean-Louis Berchet, PDG de l’en-
treprise Berchet (mille salariés) et président de la
Fédération française des industries du jouet, est
balancée, quoique exprimée de façon peu conven-
tionnelle. « Pendant des années, on nous a bassinés
avec la nouvelle économie qui s’est cassé la gueule,
râle-t-il ; aujourd’hui, on recommence avec la délo-
calisation. Or la délocalisation, c’est un moyen et
pas une fin. Evidemment, nous sommes obligés de
faire faire en Indonésie les poupées et leurs vête-
ments, mais en s’assurant qu’ils ne font pas tra-
vailler des enfants pour d’autres enfants. En revan-
che, restent en France les produits impossibles à
délocaliser pour un ensemble de raisons technologi-
ques et de volume. »
C’est ainsi que la dernière-née, la poupée qui
reconnaît sa petite « maman », vient de Chine avec
son électronique embarquée, ses puces et ses électro-
aimants, alors que son landau, sa nursery, sa cuisine
sortent de l’usine d’Oyonnax. Car « il ne faut jamais
perdre son âme de créateur », insiste Jean-Louis Ber-
chet. Nom de Dieu, on ne va pas tout de même pas fai-
re de la France une réserve d’Indiens ! »
Alain Faujas
S
inous voulons vendre des
satellites et des Airbus, il
faut accepter de compren-
dre qu’ils seront payés en
meubles, en vêtements et
en bimbeloterie. » Le
16 novembre 1993, la déclaration de
Gérard Longuet, alors ministre de
l’industrie et du commerce exté-
rieur, enfonce des aiguilles au cœur
de la filière textile. La « vieille indus-
trie » a, une fois de plus, le senti-
ment d’être bradée, simple mon-
naie d’échange dans les transac-
tions internationales.
En 1993, le textile français a déjà
derrière lui dix ans de déclin. Malgré
l’Accord multifibres signé en 1973
dans le cadre du GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade),
qui limitait les volumes d’exporta-
tion, la concurrence internationale,
celle des pays émergents mais égale-
ment les pratiques « inamicales »
de certains voisins européens ont
ruiné des régions comme la Cham-
pagne, le Nord ou encore les Vos-
ges avec l’effondrement en 1978 de
l’empire Boussac. La tendance ne
s’inversera jamais.
La filière textile-habillement, qui
employait, il y a trente ans, près de
un million de salariés, n’en compte
plus aujourd’hui que 198 000. De
nombreux sites ont fermé dans l’in-
différence la plus totale. Seuls des
conflits comme Cellatex ou la fin de
marques connues du grand public
rappellent les difficultés d’un sec-
teur qui reste le troisième
employeur industriel en France.
Face à la concurrence, les indus-
triels nationaux ont dès le début des
années 1980 pris le chemin des délo-
calisations. « 80 % des entreprises du
secteur font fabriquer toute ou une
partie de leur production à l’étran-
ger », explique Jean-Claude
Hazouard, secrétaire de la fédéra-
tion CFDT habillement, cuir et texti-
le (Hacuitex). « Certaines choisissent
d’ouvrir des sites de production dans
des pays où la main-d’œuvre est
moins chère, c’est la délocalisation
pure et dure, d’autres s’approvision-
nent à l’étranger via la sous-
traitance, l’externalisation ou encore
en pratiquant le négoce. »
Cette compétitivité accrue n’a pas
ruiné totalement la filière. « Il est
indiscutable que des pans de notre
industrie ont disparu et que certaines
transformations ne sont pas ache-
vées, convient Elizabeth Ducottet,
PDG de la société Thuasne, leader
européen du textile médical. Mais le
textile-habillement n’est pas en perdi-
tion, il n’y a pas de naufrage collec-
tif. » Résolument optimiste, Eliza-
beth Ducottet représente, d’une cer-
taine façon, l’avenir du textile.
Créée en 1847, Thuasne, spécialisée
àl’origine dans la fabrication de tis-
sus élastiques étroits, n’a pas hésité
àmiser à fond dès le début des
années 1980 sur le textile technique.
«Sans ce virage, nous serions peut-
être morts », estime-t-elle. Aujour-
d’hui, son entreprise de 800 salariés,
qui a réalisé en 2002 un chiffre d’af-
faires de 100 millions d’euros, peut
se targuer de produire à 90 % en
France et de n’avoir jamais procédé
à un plan social.
En jouant la carte de l’innovation
mais aussi du réseau, le « techni-
que » tranche dans le paysage gris
du textile-habillement. En cinq ans,
le secteur est passé de 250 à
400 entreprises, et affiche un chiffre
d’affaires de 6 milliards d’euros, en
progression en moyenne de 5 % à
7 % par an dont 22 % pour le médi-
cal. Surtout, il a su jouer à fond la
carte de la mutualisation des
moyens et des compétences. En
2002, à l’initiative du ministère délé-
gué à l’industrie, le Réseau indus-
triel d’innovation du textile et de
l’habillement (R2ITH), aujourd’hui
présidé par Elizabeth Ducottet, qui
associe industriels de la filière, pou-
voirs publics régionaux, nationaux
et européens, centres de recherche
et centres de formation, a vu le jour
avec pour mission de monter des
projets porteurs pour la conquête
de nouveaux marchés. Une premiè-
re qui tranche avec l’état d’esprit de
la plupart des industriels du secteur.
Car la saignée du textile n’est pas
seulement due à la mondialisation
accrue des échanges. « L’histoire de
notre secteur est faite d’opportunités
manquées », estime Jean-Claude
Hazouard. Les aides d’abord.
«Depuis 1981, époque du plan
Dreyfus, on a vu défiler deux autres
plans d’allégements de charges : Lon-
guet et Borotra, s’enflamme Chris-
tian Larose, secrétaire général de la
fédération textile-habillement-cuir
CGT. Au total, il y a eu pour 1,2 mil-
liard de francs d’allégements sur dix
ans. Dans le même temps, on a perdu
50 % des emplois. A quoi a servi l’ar-
gent ? A délocaliser. »
Autre carence : les employeurs
français ont toujours joué la carte
individuelle. La disparition d’un
concurrent c’était, dans l’esprit de
beaucoup de chefs d’entreprise, des
opportunités de marché supplémen-
taires. A l’inverse, les industriels ita-
liens ont su travailler ensemble et
ont réussi ainsi à traverser plus tran-
quillement les tempêtes. Enfin la for-
mation a été complètement négli-
gée. Une hérésie dans un secteur
qui emploie près de 60 % des
ouvriers (qualifiés ou non), avec un
niveau de formation assez faible.
Pour Guillaume Sarkozy, prési-
dent de l’Union des industries texti-
les, le textile doit pourtant arrêter
de regarder en arrière. Les gains de
productivité, la délocalisation et les
35 heures ajoutés à une mauvaise
conjoncture expliquent selon lui la
dégradation du secteur. « La seule
question à se poser est celle des
moyens pour s’adapter à cette évolu-
tion. La suppression de la taxe profes-
sionnelle, l’aide aux investissements
et la création d’une zone de libre-
échange euro-méditerranéenne éten-
due aux abords de la Méditerranée
sont des pistes qui permettront de fai-
re barrage à la concurrence interna-
tionale et plus particulièrement
chinoise. » Il reste, en tout cas, peu
de temps car un nouveau danger
menace le textile français. En 2005,
le démantèlement de l’Accord multi-
fibres risque, si les erreurs du passé
sont réitérées, d’étioler un peu plus
l’industrie textile française.
Catherine Rollot
la concurrence
des pays
en développement
n’est pas seule
responsable
du déclin
de la filière
L
adésindustrialisation de
la France ? Mais à quels
chiffres faites-vous réfé-
rence ? Il n’y a pas que les
délocalisations, vous
savez… » Que ce soit
chez Francis Mer, au ministère de
l’économie, ou chez Nicole Fontai-
ne, à celui de l’industrie, la ques-
tion a le don d’énerver statisticiens
et experts. Les chiffres ? Effective-
ment. Une première série disponi-
ble sur vingt-deux ans (de 1980 à
2002) montre comment la contribu-
tion de l’industrie à la richesse
nationale ne cesse de baisser.
En 1980, la valeur ajoutée (VA)
brute de l’industrie manufacturière
non alimentaire, en francs/euros
courants, représentait 20,5 % du
produit intérieur brut (PIB). En
2002, ce résultat n’atteint plus que
14,3 %. La chute libre ? « C’est une
conclusion facile, commente un
haut fonctionnaire. Bien sûr que le
poids de l’industrie mesuré en valeur
courante diminue. La concurrence –
européenne d’abord, mondiale
désormais – et les gains de producti-
vité ont entraîné une baisse des prix
industriels. Ce mouvement structurel
est irréversible. Mais il ne reflète pas
la réalité. La production industrielle
ne faiblit pas. » A l’appui de cette
thèse, dans la même série statisti-
que, mais cette fois-ci en euros
constants, on part en 1980 de
15,6 % pour arriver à 16,7 % en
2002 (après une pointe d’activité en
2001 à 17 %).
Que dire aussi concernant l’em-
ploi ? Si l’on regarde les données
du Service des études et des statisti-
ques industrielles (Sessi), on consta-
te un déclin important : entre 1980
et 2001, l’emploi industriel est pas-
sé de 21 % du total à 14 %. La faute
aux délocalisations ? Là encore,
pas si simple. Impossible de mesu-
rer précisément leur importance en
termes macroéconomiques, mais la
prudence s’impose en dépit des
annonces qui désormais touchent
l’ensemble des secteurs, de l’aéro-
nautique – EADS a délocalisé une
partie de ses activités de mainte-
nance et de réparation d’avions
civils et militaires au Maroc et en
Tunisie – aux services informati-
ques ou financiers.
Il faut déjà faire la part entre
emplois perdus en raison de la
hausse des gains de productivité
et ceux qui disparaissent en raison
des délocalisations. Jean-Luc Bia-
cabe, secrétaire général du centre
d’observation économique et l’un
des contributeurs au dossier de
Regards sur l’actualité (La Docu-
mentation française) sur « La Com-
pétitivité de la France », analyse
ainsi les flux d’investissements
directs entrants et sortants de
France.
En 2002, la France a accueilli
pour 52,4 milliards d’euros d’inves-
tissements directs étrangers (IDE)
–en retrait par rapport à 2001
(58,8 milliards) – et symétrique-
ment les ID français à l’étranger
ont atteint 70,9 milliards d’euros
(contre 92,5 milliards en 2001). La
France, indique l’auteur, « investit
davantage à l’étranger que ne le font
les non-résidents sur son territoire ».
Selon lui, ce décalage « est le reflet
àla fois de l’internationalisation
accélérée des grands groupes fran-
çais et de la vague d’investissements
liés à la bulle dans les télécoms. Plus
qu’une envolée des délocalisations
d’activités productives, ce mouve-
ment marque plutôt un rattrapage
français par rapport aux grands pays
industriels ».
Reste évidemment posée la ques-
tion de la compétitivité française,
en termes de coûts salariaux ou de
niveau des prix. Concernant le pre-
mier point, les données, qu’elles
viennent d’Eurostat, l’office statisti-
que de l’Union européenne, ou de
l’OCDE, placent la France dans « la
moyenne européenne », malgré la
réduction du temps de travail, et
derrière le Japon et les Etats-Unis si
l’on s’intéresse au « coût salarial
horaire d’un ouvrier de l’industrie ».
Concernant le second, selon les
experts, la compétitivité des prix de
l’industrie française semble s’être
stabilisée, après une « forte » aug-
mentation entre 1996 et 2000. Ces
statistiques d’une froideur absolue
ne reflètent pas, évidemment, les
réalités violentes vécues par tel ou
tel secteur en particulier. On se sou-
vient ainsi des malheurs des entre-
prises sidérurgiques françaises qui
ont assisté impuissantes, après la
chute du mur de Berlin en 1989, au
dumping des prix de l’acier des
pays de l’Est, qui a anéanti en quel-
ques mois des gains de producti-
vité grignotés année après année.
«Au final, résume-t-on au minis-
tère de l’économie, il est faux d’affir-
mer que l’industrie française va mal.
Cette généralisation ne veut absolu-
ment rien dire ». En revanche, il
existe une certitude, « la structure
de notre industrie s’est profondé-
ment modifiée ».
Les cathédrales industrielles ont
fait place à des unités flexibles qui
emploient de moins en moins de
personnes par unité produite. Mais
cette photographie en cache une
autre qui touche à ce que l’on appel-
le dans le jargon des experts « la ter-
tiarisation de l’industrie », une « réa-
lité majeure », insistent-ils en
chœur. Le secteur des services à l’in-
dustrie – maintenance, restaura-
tion, service après-vente, emballa-
ge, logistique, etc. – a « explosé ».
Autant d’activités externalisées,
non comptabilisées dans les statisti-
ques purement industrielles, diffici-
les à isoler en macroéconomie, et
qui font dire aux spécialistes que
«le moteur de l’industrie française
tourne encore ».
Marie-Béatrice Baudet
1
Comment se situe
l’industrie française
dans le monde ?
En 2001, la France était le quatriè-
me producteur industriel mondial
au sein de l’OCDE, loin derrière les
Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne,
et juste devant l’Italie et le Royau-
me-Uni. Le poids de l’industrie
française se mesure aussi à celui
de ses groupes industriels. On
compte ainsi 45 groupes français
parmi les 1 000 premiers mon-
diaux (dont Total, Peugeot,
Renault, etc.) qui ont réalisé
550 milliards de dollars de chiffre
d’affaires en 2001, contre
3300 milliards de dollars pour les
groupes américains. En 2002, l’in-
dustrie française a dégagé un excé-
dent commercial de 22,2 milliards
d’euros.
Les groupes étrangers implantés
dans l’Hexagone via leurs filiales
jouent un rôle important, puis-
qu’ils contribuent pour un tiers
aux ventes et à la valeur ajoutée
de l’industrie manufacturière. Ils
représentent 36 % des exporta-
tions réalisées et emploient 30 %
de la main-d’œuvre industrielle.
Principaux investisseurs : les Etats-
Unis (un tiers du chiffre d’affaires
des entreprises industrielles étran-
gères), l’Allemagne (14 %), les Pays-
Bas (11 %) et le Royaume-Uni (9 %).
2
Comment
se compose le tissu
industriel français ?
En 2002, l’industrie française
comptait 141 000 entreprises de
moins de 20 salariés et
22 000 entreprises de plus de 20.
Le rôle des petites et moyennes
industries (PMI) s’est renforcé
depuis les années 1980. Les cathé-
drales industrielles sont plus rares.
Les activités tertiaires ont été
externalisées et les activités de pro-
duction filialisées. Les PMI (moins
de 500 salariés), dont la contribu-
tion à la production est de 39 %,
sont surtout nombreuses dans les
industries dites de main-d’œuvre,
notamment dans les biens de
consommation (habillement, édi-
tion, imprimerie) où elles totali-
sent un quart des emplois (3,8 mil-
lions d’emplois directs en 2002).
Les grands groupes sont concen-
trés dans les secteurs très capitalis-
tiques, où le montant des investis-
sements nécessaires à la produc-
tion ne peut être que de leur res-
sort : automobile, aéronautique,
construction ferroviaire, chimie de
base, verre, etc.
3
Comment évolue
l’emploi industriel
en France ?
Après huit mois de croissance
continue, l’emploi industriel a com-
mencé à décroître au cours du prin-
temps 2001. L’essentiel de l’ajuste-
ment s’est d’abord concentré sur
l’intérim industriel – important
dans le secteur de l’automobile –
qui a baissé de 62 000 emplois en
un an. Fin 2001, l’industrie, y com-
pris les industries agroalimen-
taires et l’énergie, employait
4,1 millions de salariés.
La tendance ne s’est pas améliorée
en 2002. L’industrie, essentielle-
ment l’industrie manufacturière, a
accentué les suppressions de pos-
tes (88 000 sur l’année, soit 2,1 %
de l’ensemble). Les difficultés de
l’industrie se traduisent égale-
ment, contrairement au tertiaire
qui l’utilise peu, par un recours
important au chômage partiel.
En 2002, les industriels français
ont utilisé 2,3 millions de journées
de chômage partiel, soit 16 % de
plus qu’en 2001. La métallurgie a,
par exemple, demandé un demi-
million de journées, soit trois fois
plus qu’en 2001.
la photographie
change si l’on
prend en compte
l’explosion
des services
a l’industrie
POUR EN SAVOIR PLUS
QUESTIONS-RÉPONSES
Tableau de bord
DOSSIER
La « désindustrialisation », un mot
souvent employé à mauvais escient
> Des lions menés par des ânes,
de Charles Gave (Ed. Robert Laffont,
2003, 195 p., 18 ¤).
> L’Industrie française,
édition 2002-2003, ministère
de l’économie, des finances
et de l’industrie, 243 p., 25 ¤).
> Compétitivité, rapport de Michèle
Debonneuil et Lionel Fontagné
(La Documentation française,
253 p, 12 ¤).
> La France est-elle compétitive,
dans Problèmes économiques
(no2 817 du 9 juillet 2003, 32 p, 3 ¤,
disponible sur demande
à la Documentation française).
Coût salarial horaire d'un ouvrierde l'industrie en 2000, en dollars
LE COÛT DU TRAVAIL,UN OBSTACLE ?
Source : OCDE
05 1015 20
Allemagne
Japon
Belgique
Danemark
Suède
États-Unis
Finlande
Autriche
Pays-Bas
Luxembourg
France
Royaume-uni
Italie
Irlande
Espagne
Portugal
II/LE MONDE/MARDI 23 SEPTEMBRE 2003

De nombreuses voix s’élèvent
en France dénonçant la désin-
dustrialisation du pays. Qu’en
pensez-vous ?
La perte d’emplois industriels
n’est pas un phénomène nouveau
et touche tous les pays, tant les
Etats-Unis que l’Europe. L’auto-
matisation, qui fut l’un des pre-
miers facteurs de réduction d’ef-
fectifs, progresse plus lentement.
En revanche, les délocalisations
vers les pays émergents s’accélè-
rent. Les industriels savent que
l’on peut y fabriquer avec une
très bonne productivité des pro-
duits de très bonne qualité.
Chez Saint-Gobain, nous avons
ainsi fermé une usine d’abrasifs
au Luxembourg et l’avons transfé-
rée en Pologne. Ce phénomène
touche un grand nombre d’indus-
tries classiques et n’a aucune rai-
son de ne pas se poursuivre. Ne
sont néanmoins pas menacées les
installations industrielles fabri-
quant des produits coûteux à
transporter, comme les bouteilles
ou la laine de verre.
Certains disent que la perte
d’emplois de production peut
être compensée par des emplois
àplus forte valeur ajoutée.
Qu’en pensez-vous ? L’essor de
la recherche et développement
en Chine, ou dans les pays de
l’Est, ne risque-t-il pas d’empê-
cher que cet objectif soit
atteint ?
Certaines activités tertiaires à
haute valeur ajoutée (services
financiers, sociétés de logiciels,
ingénierie) ou certaines industries
de pointe (armement, aéronauti-
que, pharmacie, télécommunica-
tions) peuvent effectivement com-
penser la diminution de l’emploi
industriel d’un pays.
Le problème est que la France
et plus généralement l’Europe ne
sont pas bien placées pour garder
des emplois hautement qualifiés
dans ces secteurs avancés de l’éco-
nomie. Parce qu’elles n’ont pas
assez d’entreprises vedettes dans
ces domaines.
Pourquoi en est-on arrivé là ?
Pour deux raisons. Primo, parce
que l’industrie a rarement été une
priorité politique. Contrairement
àce qui se passe aux Etats-Unis
ou au Japon, les arbitrages euro-
péens se font fréquemment
contre l’industrie. Qu’il s’agisse
de la politique de la concurrence,
plus souple aux Etats-Unis, et
plus encore au Japon ; ou de la
politique de protection de l’envi-
ronnement. Ainsi, on demande à
l’industrie de réduire ses émis-
sions, mais on ne demande pas
aux particuliers de réduire leur
consommation d’énergie en iso-
lant mieux leurs logements, par
exemple.
Les Américains ne veulent pas
signer le protocole de Kyoto, ce
qui nous met dans une position
très désavantageuse. La Commis-
sion de Bruxelles vient de publier
de nouveaux textes sur les pro-
duits chimiques, qui rendent la
vie des industriels européens
encore plus difficile. Il est vrai
que le poids du commissaire à la
concurrence, Mario Monti, est
bien supérieur à celui du commis-
saire aux entreprises, Erkki Liika-
nen. Chaque directive est souvent
un fardeau supplémentaire impo-
sé aux industriels. L’industrie
n’est pas suffisamment défendue
àla Commission.
Secundo, et ce point est le plus
important, il n’y a plus de budget
pour les grands programmes et
nous manquons de soutien pour
de grands projets dans la recher-
che et développement. C’est un
handicap de plus par rapport aux
Etats-Unis et au Japon. Je suis
tout à fait favorable au program-
me franco-allemand de projets
industriels communs mais je ne
vois pas où on va trouver les
fonds, vu les arbitrages envisagés.
En France, on prépare une loi sur
l’innovation qui va conduire à
une dispersion des efforts, et
empêcher les rattrapages néces-
saires dans les domaines où nous
sommes déjà en train de perdre
du terrain, comme l’électronique,
le médical, ou les bio et les nano-
technologies.
La dépense publique de recher-
che en France est pourtant plus
élevée qu’ailleurs ?
C’est la raison pour laquelle
nous avons les meilleurs cher-
cheurs fondamentaux. Mais cette
dépense doit être également tour-
née vers des applications indus-
trielles. Au Japon, c’est l’industrie
qui est le moteur de la recherche
technique. Une industrie euro-
péenne faible ne peut rattraper
ses confrères japonais et nord-
américains qu’avec un soutien
public de recherche et développe-
ment puissant.
Les industries nouvelles améri-
caines ne se sont-elles pas déve-
loppées grâce à la croissance ful-
gurante de PME, comme Micro-
soft, et non par l’aide apportée à
des grands groupes ?
Le contexte français n’est pas
favorable à ce type de développe-
ment à partir de PME. On ne déve-
loppera l’Europe qu’à partir de
champions européens sur un cer-
tain nombre de secteurs concen-
trés et avec des soutiens publics.
Vouloir singer la Silicon Valley
mène à l’échec. On développe cet-
te voie parce qu’elle n’est pas bud-
gétairement coûteuse.
Nous allons payer cette absen-
ce de priorité politique donnée à
l’industrie par un appauvrisse-
ment général de la France, sauf si
nous inversons la vapeur, par un
mouvement politique volontaris-
te, national et européen.
La tâche à accomplir pour ce rat-
trapage technologique sur la base
de champions européens est pour-
tant plus facile qu’elle ne l’était
quand il a fallu bâtir Ariane, Air-
bus ou les programmes nucléai-
res. Mais il y avait une volonté
politique forte.
Cette paupérisation que vous
pressentez pour l’Europe est-elle
inéluctable ? Est-il possible d’in-
verser la tendance ?
Anouveau, les hommes politi-
ques semblent prendre conscien-
ce du problème. C’est le moment
de leur proposer des voies pour
sortir de l’impasse dans laquelle
on est en train de s’engager.
Il s’agit d’arrêter la sur-régle-
mentation de l’industrie et de
défendre la constitution de grou-
pes puissants. Si on laisse faire le
marché, on assistera à un affai-
blissement des groupes euro-
péens et à la paupérisation de
l’ensemble de l’Europe. Regardez
les investissements directs en
France : il s’agit essentiellement
d’acquisitions de firmes françai-
ses par des groupes étrangers. La
France est attractive… pour
qu’on lui prenne son marché et
ses entreprises.
Je regrette aussi que l’argent
public soit donné en priorité aux
PME. Les grands groupes, je le
répète, ne reçoivent plus rien,
alors qu’ils sont les véritables
moteurs de la croissance. Je prô-
ne ainsi le retour du soutien au
développement, dans le cadre
d’une aide remboursable en cas
de succès. A Saint-Gobain, nous
avons créé notre plus récent labo-
ratoire de recherche sur le sol
français. Mais c’est sûrement en
Asie que se situeront nos pro-
chains laboratoires de développe-
ment.
L’inflexion de ce mouvement
ne peut venir que d’une inversion
des arbitrages politiques.
Propos recueillis par
Annie Kahn
L
es chiffres du chômage
britannique pour le mois
d’août publiés mercredi
18 septembre ont illustré
avec force l’un des para-
doxes de l’économie du
Royaume-Uni. Malgré une industrie
en perte de vitesse, sa santé est
excellente. Selon l’Office national
de la statistique (ONS), le nombre
de chômeurs indemnisés a baissé de
6900, pour s’inscrire à 930 800, le
nombre le plus faible depuis septem-
bre 1975.
Selon les modes de calcul rete-
nus, le taux de chômage est ressorti
à 3,1 % ou 5,1 %. Cette amélioration
spectaculaire et historique est inter-
venue malgré des destructions d’em-
plois massives dans le secteur manu-
facturier : 125 000 de juin à août,
ramenant l’effectif global à 3,5 mil-
lions, le niveau le plus bas depuis le
début du calcul de cette statistique,
en 1984. « Cela fait de nombreuses
années que l’emploi industriel perd
du terrain au Royaume-Uni », rappel-
le Omar Habache, économiste au
Crédit agricole. « Alors que le secteur
manufacturier représentait 18 % de
la population active en 1990, il n’en
représentait plus en 2002 que 13 %. »
Plusieurs raisons sont générale-
ment avancées pour expliquer ce
phénomène de désindustrialisation
qui, s’il touche tous les grands pays
développés, est particulièrement
prononcé outre-Manche.
La première est celle de la concur-
rence exercée par la City, le centre
de services financiers de Londres,
qui drainerait à son profit et au détri-
ment de l’industrie les capitaux, les
énergies et les talents. La deuxième
est la surévaluation de la livre ster-
ling depuis le milieu des années
1990, qui a porté un coup très dur
aux exportations britanniques. La
principale demeure toutefois l’orien-
tation économique très libérale des
gouvernements britanniques succes-
sifs depuis vingt ans. Ces derniers,
d’abord, ont accepté facilement la
déroute des industries traditionnel-
les, symboles de la vieille Angleter-
re, et dans lesquelles, de surcroît, les
syndicats étaient très puissants.
Les dirigeants politiques, qu’ils
soient conservateurs ou travaillis-
tes, ont aussi considéré qu’il était
inutile et coûteux de tenter de pré-
server des industries condamnées
par la concurrence de pays à bas
coûts de main-d’œuvre.
Cet ancrage libéral a favorisé le
passage sous contrôle étranger de
nombreux fleurons de l’industrie bri-
tannique ou l’installation d’entrepri-
ses étrangères concurrentes (Ford,
General Motors). La combinaison
de ces facteurs a provoqué des
dégâts sociaux considérables, avec
des régions entièrement sinistrées.
Pour autant, l’idée, répandue sur
le continent, selon laquelle le Royau-
me-Uni serait devenu un désert
industriel mérite d’être nuancée.
Même si le secteur tertiaire est en
plein boom (78,5 % de la population
active), les emplois industriels res-
tent à des niveaux comparables à
ceux observés en France. Selon une
étude comparative réalisée par le
ministère français de l’industrie, l’in-
dustrie britannique avait, par
ailleurs, créé en 2000 un petit cin-
quième de la valeur ajoutée totale,
un pourcentage équivalant à celui
constaté dans le reste de l’Europe.
Si certains pans de l’industrie bri-
tannique ont été très durement tou-
chés, comme la construction navale
ou l’automobile, où ne survit que
MG Rover, d’autres ont su s’adap-
ter – modernisation de la sidérur-
gie – ou prospérer. Le Royaume-
Uni possède de nombreuses très
grandes entreprises industrielles,
parmi les plus puissantes au monde,
que ce soit dans le pétrole (BP,
Shell), la chimie (ICI), la pharmacie
(GlaxoSmithKline, AstraZeneca), la
grande distribution (Tesco, Sainsbu-
ry, Dixons), l’agroalimentaire (Dia-
geo, Cadbury Schweppes), l’aéros-
patiale (BAE Systems), le tabac (Bri-
tish American Tobacco, Imperial
Tobacco) mais aussi les nouvelles
technologies (Cable & Wireless,
Vodafone, B Sky B, Amersham).
Le problème de l’industrie britan-
nique reste celui de son manque de
productivité, lié à l’insuffisance des
efforts en recherche et développe-
ment, ce qui a amené le premier
ministre, Tony Blair, à mettre en pla-
ce, depuis trois ans, de nombreuses
mesures, principalement fiscales,
afin d’y remédier.
Pierre-Antoine Delhommais
CHRONIQUE
Un timide
mea culpa
les emplois
industriels restent
à des niveaux
comparables
à ceux observés
en france
Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain
«Il nous faut une politique volontariste,
nationale et européenne »
fAncien élève de l’Ecole
polytechnique, ingénieur en chef
des Mines, Jean-Louis Beffa, 62 ans,
est également diplômé de l’Institut
d’études politiques de Paris.
fIl est entré chez Saint-Gobain en 1974,
et en a été nommé PDG en janvier 1986.
Il est également vice-président de BNP
Paribas, administrateur du Groupe
Bruxelles Lambert et membre du conseil
de surveillance du Monde.
Le désert britannique ? Une image
à manier avec précaution…
JEAN-LOUIS BEFFA
ministé-
rielle de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) ses dates de
référence et ses mises en cause.
1999 et Seattle pour la mondialisa-
tion des échanges et ses premiers
dérapages, Gênes deux ans plus
tard et son premier manifestant
mort par balles. Cancun, qui vient
de s’achever sur un échec, et son
premier hara-kiri, celui d’un paysan
sud-coréen, désespéré de voir « son
destin lui échapper ».
Une autre globalisation, celle des
mouvements de capitaux, a aussi
ses victimes et ses dates de commé-
moration. 1994-1995 et la crise
mexicaine, 1997 et la débâcle asiati-
que, 1998 et la Berezina russe, 1999
et la déconfiture du Brésil et de
l’Equateur, 2001-2002 et les désas-
tres financiers de la Turquie et de
l’Argentine.
Si, sur le plan du commerce inter-
national, les pays du Sud, réunis
dans ce qu’il faut appeler mainte-
nant le groupe G21, ont encore du
mal à persuader leurs « amis » du
Nord que la libéralisation des
échanges et des marchés exige
davantage de sur mesure que de
prêt-à-penser, les leçons tirées des
crises financières qui ont secoué le
système et les institutions de
Bretton Woods depuis une dizaine
d’années, relayées par les critiques
acerbes des altermondialistes et
d’une partie de la société civile à
l’encontre des excès d’un libéralis-
me longtemps débridé, commen-
cent à se traduire dans les faits.
Longtemps tenue pour quantité
négligeable au regard de l’attention
qu’il convenait de porter plutôt au
Brésil, la plus importante économie
d’Amérique du Sud, ou encore à la
Turquie, fidèle allié de Washington,
la petite Argentine, terrassée par
une crise financière sans précédent,
vient de marquer des points. Après
de vives discussions avec l’équipe
du nouveau président, Nestor Kirch-
ner, le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a finalement accepté le
11 septembre un plan de redresse-
ment qui tient bien plus des reven-
dications argentines que des exi-
gences initiales du Fonds.
Ce n’est là que l’un des derniers
épisodes d’une « compréhension »
qui doit beaucoup aux remises en
cause dont le FMI fait régulière-
ment l’objet. L’institution explique
qu’elle fait siens les appels à une
meilleure prise en compte de la
dimension sociale liée aux crises à
traiter et à la nécessité de réorien-
ter sa politique et celle de la Ban-
que mondiale dans un sens plus
favorable aux pays endettés. Il res-
te que les commentaires acerbes
du Prix Nobel Joseph Stiglitz et de
quelques autres économistes issus
de l’intérieur des institutions de
Bretton Woods ont donné du crédit
à certains des propos les plus criti-
ques formulés par les adversaires
du Fonds.
Si certains échecs sont reconnus
dans cette communauté long-
temps orthodoxe, celle-ci écarte
pour autant « les recommandations
tranchées », souligne cependant Jac-
ques Mistral, le ministre conseiller
financier à l’ambassade de France à
Washington, en tirant les enseigne-
ments d’une enquête réalisée par
ses services auprès de trente écono-
mistes de renom travaillant dans
les « réservoirs à idées » washingto-
niens, dans la presse financière, au
Congrès ou dans des organisations
non gouvernementales.
Aux deux extrêmes, les écono-
mistes considérés comme des radi-
caux de « gauche » mais aussi de
«droite » appellent à une importan-
te révision du rôle et du fonctionne-
ment de ces institutions, avec des
avis contraires. Mais la majorité de
leurs collègues, très pragmatiques,
préconisent, au mieux, des réfor-
mes en pointillé.
Un espoir demeure cependant.
Il réside dans l’ouvrage After the
Washington Consensus que vient
de publier l’Institute of Internatio-
nal Economics sous la plume de
John Williamson, l’inventeur, il y a
dix ans, de cette formule synony-
me de pensée unique.
Sans renier ses écrits, l’auteur
considère qu’ils doivent être « com-
plétés » pour intégrer à présent
une meilleure appréciation des
politiques fiscales contracycliques
ou un accroissement bienvenu de
l’épargne nationale.
On pourrait ainsi envisager une
certaine flexibilité des taux de chan-
ge et même une réforme du mar-
ché du travail dans le sens d’une
plus grande équité, assure-t-il. Une
audace qui désarçonne !
par Serge Marti
DOSSIER
Selon les calculs,
le taux de chômage
du Royaume-Uni
atteint en août
3,1 % ou 5,1 %
« Je regrette que l’argent soit donné
en priorité aux PME. Les grands groupes
ne reçoivent plus rien, alors qu’ils sont
les véritables moteurs de la croissance »
LE MONDE/MARDI 23 SEPTEMBRE 2003/III

ATHÈNES
de notre correspondant
A
vocate au Conseil
d’Etat et à la Cour de
cassation helléniques,
Sophia Spiliotopoulos
est sûre de son pro-
pos : la Convention
présidée par Valéry Giscard d’Es-
taing a commis une grosse erreur
en n’inscrivant pas noir sur blanc
«l’égalité entre les femmes et les hom-
mes » dans l’article 2 de son projet
de Constitution.
« L’Union est fondée sur les valeurs
de respect de la dignité humaine, de
liberté, de démocratie, d’égalité, de
l’état de droit, ainsi que de respect
des droits de l’homme. Ces valeurs
sont communes aux Etats membres
dans une société caractérisée par le
pluralisme, la tolérance, la justice, la
solidarité et la non-discrimination »,
stipule cet article intitulé « Les
valeurs de l’Union ».
Il faut que « l’égalité entre les fem-
mes et les hommes apparaisse claire-
ment comme valeur identitaire de
l’Union, et non seulement comme
objectif ; son respect, dans le droit et
la pratique, doit conditionner la can-
didature et l’adhésion d’un Etat à
l’Union », souligne Mme Spiliotopou-
los, tout à la fois vice-présidente de
l’Association des femmes de l’Euro-
pe méridionale (AFEM) et de l’As-
sociation européenne des femmes
juristes (EWLA), qui combinent
leurs efforts sur ce sujet.
L’argument selon lequel la men-
tion serait « superflue » sous pré-
texte que la notion d’égalité englo-
be l’égalité de l’homme et de la
femme « ne vaut pas, poursuit-elle.
L’histoire prouve le contraire, la
notion d’égalité ne suffit pas, elle ren-
voie à des discriminations envers des
groupes ou des minorités ; mais les
femmes ne sont ni un groupe ni une
minorité, elle sont une des deux com-
posantes du genre humain ». Les
Constitutions nationales des Etats
membres de l’Union européenne
(UE) garantissent d’ailleurs l’égali-
té de l’homme et de la femme.
«Notre proposition est soutenue par
toute la société civile, y compris le
Mouvement européen, l’Act’Europe,
qui regroupe les plus grandes organi-
sation non gouvernementale (ONG)
européennes, et la Convention des
jeunes. Elle a même été proposée
par le groupe « Europe sociale » de
la Convention. » La dynamique
juriste grecque, experte auprès de
la Commission européenne, estime
que cet ajout « est particulièrement
nécessaire au moment où le dévelop-
pement des intégrismes religieux
–tous très fortement misogynes –
constitue le plus souvent une compo-
sante des communautarismes qui se
développent dans certains pays d’Eu-
rope et sont à la base du terrorisme
international ».
L’AFEM soutient par ailleurs un
amendement soumis par l’Italien
Giuliano Amato au nom du Parti
des socialistes européens (PSE),
l’Allemand Elmar Brok pour le Par-
ti populaire européen (PPE) et le
Britannique Andrew Duff pour les
Libéraux, démocrates et réforma-
teurs du Parlement européen, qui
veulent que les lois de l’UE pour
combattre les discriminations
soient adoptées à la majorité quali-
fiée. Cette proposition « est déci-
sive, car les décisions à l’unanimité
bloqueront tout progrès dans le
domaine social », commente
Mme Spiliotopoulos.
La très active AFEM, ouverte
aux personnes physiques et mo-
rales (associations, plates-formes
d’ONG, etc.), recrute ses membres
en Espagne, en France, en Grèce,
en Italie, au Portugal. Chacun de
ces pays détient deux sièges à son
conseil d’administration. Des asso-
ciations chypriotes, maltaises et slo-
vènes devraient bientôt les y rejoin-
dre. Son site web (www.afem-euro-
pa.org) publie une lettre d’informa-
tion sur la situation des femmes
dans l’UE et un annuaire des orga-
nisations féminines.
L’AFEM jouit du statut consulta-
tif auprès du Conseil de l’Europe ;
elle est membre du Lobby euro-
péen des femmes et de l’Alliance
internationale des femmes, organe
consultatif auprès du Conseil éco-
nomique et social des Nations
unies. Devant toutes ces instances,
l’AFEM défend des conceptions qui
vont au-delà du seul droit des fem-
mes. « Nous ne sommes pas satisfai-
tes de l’orientation sociale de l’Euro-
pe telle qu’elle ressort du projet de
Constitution, qui ne parle ni de la
qualité de la vie, ni de la qualité des
conditions de travail – objectifs
actuels de l’Union – tandis qu’il évo-
que le plein-emploi et la compéti-
tivité ; l’acquis social communautai-
re n’y est pas entièrement intégré »,
proteste Mme Spiliotopoulos.
L' AFEM rejette aussi « le rabota-
ge » de la charte des droits fonda-
mentaux proclamée au sommet de
Nice en décembre 2000. La Conven-
tion a intégré dans son projet cette
charte mais après avoir procédé à
«des adaptations rédactionnelles
qui tentent de restreindre sa por-
tée », selon l’avocate. « Nous allons
lancer une campagne pour affirmer
que les droits fondamentaux doivent
être appliqués dans leur totalité. Nos
propositions ne touchent pas à l’ar-
chitecture de la Constitution », assu-
re-t-elle, reconnaissant « la qualité
du travail mené par les conven-
tionnels. C’était un véritable tour de
force d’obtenir ce résultat en dix-
sept mois, mais il faut maintenant
l’améliorer ».
Didier Kunz
EN DIRECT DE BRUXELLES
La « modestie »
chinoise
la vice-présidente
de l’association
des femmes
de l’europe
méridionale
souhaite que
l’égalité entre
les deux sexes
conditionne
l’adhésion d’un
état à l’union
f2001 Sophia Spiliotopoulos
est vice-présidente de l’Association
européenne des femmes juristes (EWLA).
f2000 Elle est vice-présidente
de l’Association des femmes de l’Europe
méridionale (AFEM).
f1983 Elle est nommée experte
indépendante de la Commission
européenne.
f1980 Elle est avocate auprès
du Conseil d’Etat et de la Cour
de cassation hellénique.
L
’Europe des quartiers
est lancée ! De Madrid à
Berlin en passant par
Rotterdam et Le Havre,
des centaines d’expé-
riences tentent, grâce
au programme d’initiative commu-
nautaire Urban initié en 1994, de
dynamiser les territoires urbains
défavorisés. 118 villes ont été
concernées par le premier volet
Urban I, sur la période 1994-2000,
et 70 le sont pour Urban II, qui
s’étend de 2001 à 2006. Mais qui le
sait, et qui profite de ces initiati-
ves, hormis les habitants de ces
sites ?
C’est pour développer les échan-
ges de bonnes pratiques de politi-
que de la ville en Europe et
au-delà, et capitaliser les connais-
sances, qu’a été lancé un nouveau
programme, Urbact, mis en œuvre
sur la période 2003-2006. Le coup
d’envoi a été donné le 20 février, à
l’initiative de la Commission euro-
péenne. Un seul pays s’était préala-
blement porté candidat pour prési-
der le comité de pilotage d’Urbact,
la France, sous l’impulsion du
ministre de la ville de l’époque,
Claude Bartolone.
Actuel ministre français délé-
gué à la ville et la rénovation
urbaine, Jean-Louis Borloo hérite
donc de cette fonction, avec
enthousiasme. « Le drame urbain
met en cause la cohésion européen-
ne et peut faire exploser la démocra-
tie, s’inquiète-t-il. Les réponses
sont différentes selon les pays.
Echanger est donc crucial. » Le
ministre est épaulé par la Caisse
des dépôts et consignations, auto-
rité de paiement, et par un secréta-
riat permanent.
Doté d’un budget de 24,76 mil-
lions d’euros, dont 15,9 millions
d’euros de contribution commu-
nautaire, le reste des fonds prove-
nant des pays participants, ce pro-
gramme consiste à appeler les vil-
les, en priorité celles ayant bénéfi-
cié des programmes Urban – mais
aussi des Projets pilotes urbains
(PPU) de la fin des années 1980 –
(soit 216 villes au total), à se consti-
tuer en réseaux thématiques trans-
nationaux, sur l’un des douze
sujets retenus : l’exclusion sociale,
la régénération du tissu urbain, les
transports et l’environnement, l’ac-
tivité économique et l’insertion
par l’emploi, etc.
Chaque réseau doit compter un
minimum de cinq villes d’au moins
trois pays différents et désigner
ensuite une collectivité chef de
file, qui animera les travaux
durant deux ans. « Les villes sont
très demandeuses », se félicite Jean-
Loup Dubigny, directeur du secré-
tariat d’Urbact. Pour l’heure, « une
centaine est réunie dans les pre-
miers réseaux, une seconde série,
regroupant 70 à 100 villes devant
être sélectionnée le 5 novembre ».
Des villes situées dans des pays
accédant à l’Union européenne ou
de pays méditerranéens en sont
membres, comme Zarzis, en Tuni-
sie. Au total, on devrait compter
une quinzaine de réseaux.
Parmi les thèmes les plus por-
teurs figure « la participation
citoyenne ».« C’est une préoccupa-
tion majeure des élus qui craignent
tous une rupture avec la popula-
tion », observe Jean-Loup Dubi-
gny. Le thème de l’« intégration
des populations étrangères » rem-
porte aussi un certain succès.
Tous les six mois, ces réseaux
doivent produire un compte rendu
sur leurs actions et leurs princi-
paux résultats, avant un rapport
final. Ils doivent aussi réaliser
notes de synthèse et fiches d’expé-
rience qui alimenteront une ban-
que de données sur un site Inter-
net (www.urbact.org), accessible
aux professionnels comme au
grand public. « Les conclusions des
travaux des réseaux permettront de
cerner les conditions de base pour
réussir les politiques urbaines »,
escompte Jean-Loup Dubigny.
Elles devraient aussi permettre de
développer « une culture commu-
ne » sur ces questions et définir le
cadre de la future politique de la
ville européenne.
L’enjeu n’est pas mince au
moment où Bruxelles est secoué
par le rapport d’André Sapir,
conseiller du président de la Com-
mission européenne Romano Pro-
di, qui préconise une refonte des
fonds structurels, dont dépend
Urban. Dans cette réorganisation,
qui doit avoir lieu en 2006, il s’agi-
rait, selon ce rapport, de réserver
ces fonds non plus aux régions ou
aux sites en difficultés mais aux
pays les plus faibles de l’Union.
Urban est donc menacé.
Dans ce contexte, Jean-Louis
Borloo entend aussi faire jouer à
Urbact « un rôle de lobby urbain
auprès de la Commission européen-
ne, afin que les fonds consacrés à la
cohésion urbaine soient considéra-
blement amplifiés ».
Francine Aizicovici
Sophia Spiliotopoulos combat
pour les droits des femmes
SOPHIA SPILIOTOPOULOS
EUROPE
un programme
de près de
25 millions d’euros
va permettre
aux cités
européennes
d’optimiser
leur politique
L’ENTRAIDE DES NEUF ZONES FRANÇAISES
,la Chine a fait preuve
d’une surprenante modestie. Nou-
veau membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
depuis décembre 2001, elle a fait
ses premiers pas avec discrétion,
pour n’inquiéter personne,
confiante dans son formidable
potentiel commercial et économi-
que. Ses négociateurs ont soute-
nu leurs positions sans faiblesse
mais sans arrogance, préférant
laisser le Brésil et l’Inde occuper le
devant de la scène de cet assem-
blage hétéroclite des pays du Sud
qu’est le G21.
La Chine ne voulait pas de la
vaste libéralisation prônée par les
pays du Nord, parce qu’elle a déjà
suffisamment de défis à relever
depuis son entrée à l’OMC. Com-
me les autres grands acteurs éco-
nomiques de la planète, elle est
repartie de Cancun les mains
vides, privée d’une réduction signi-
ficative des subventions agricoles
accordées par l’Europe et les Etats-
Unis à leurs agriculteurs, sans
obtenir non plus d’autres pays
émergents une ouverture de leurs
marchés comparable à celle à
laquelle elle a consenti depuis
deux ans.
Mais, outre que les exporta-
tions agricoles chinoises ont pro-
gressé de 13 % en 2002, la Chine a
les moyens de s’accommoder
d’une telle déconvenue. Si le pro-
cessus de négociations commer-
ciales devait s’écarter du multila-
téralisme, elle n’est pas, contrai-
rement à d’autres pays du Sud,
en position de faiblesse pour
conclure des accords de libre-
échange avec les géants économi-
ques que sont les Etats-Unis et
l’Europe.
Son taux de croissance devrait
dépasser 8 % cette année, son
commerce extérieur comme ses
réserves de change ne cessent de
progresser, les secteurs automo-
bile et informatique connaissent
un boom impressionnant, et elle
dépasse désormais les Etats-Unis
comme deuxième destination
mondiale des investissements
étrangers.
Ce dynamisme est perçu de
façon mitigée par l’Union européen-
ne (UE). Certes, les potentialités du
marché chinois se confirment, mais
l’excédent commercial de Pékin
avec l’UE atteint 47 milliards
d’euros, les délocalisations des acti-
vités industrielles et de services
vers l’empire du Milieu se multi-
plient, et les contrefaçons affluent
sur le Vieux Continent.
Les Quinze partagent, en outre,
les préoccupations de Washing-
ton et du Fonds monétaire inter-
national (FMI) en ce qui concerne
la sous-évaluation du yuan, qui
favorise les produits chinois sur
les marchés internationaux. Ils
ont cependant compris que, pour
demeurer un partenaire respecté
de la Chine, les relations bilatéra-
les devaient passer à une vitesse
supérieure.
C’est tout le sens de la nouvelle
stratégie chinoise de l’UE, récem-
ment annoncée par Chris Patten,
commissaire européen chargé des
relations extérieures. « Nous
avons un intérêt politique et écono-
mique majeur dans la transition
réussie de la Chine en un pays sta-
ble, prospère et ouvert qui a nette-
ment choisi la démocratie, les prin-
cipes du libre-échange et de l’Etat
de droit », a souligné l’ancien gou-
verneur de Hongkong.
De profonds changements sont
intervenus depuis que l’UE a adopté,
en septembre 2001, une première
«stratégie de partenariat renforcé »
avec la Chine : l’UE s’est dotée d’une
monnaie unique et s’est élargie à
vingt-cinq membres, tandis qu’une
nouvelle génération de responsables
politiques a pris les commandes à
Pékin et que la Chine a rejoint l’OMC.
Parallèlement, les nouvelles
menaces que sont le terrorisme et
la prolifération des armes de des-
truction massive dominent l’envi-
ronnement international.
Conscients que le partenariat
euro-chinois doit tenir compte de
cette nouvelle donne, les Euro-
péens souhaitent « engager » la
Chine dans tous les domaines,
tout en se déclarant prêts à soute-
nir le processus de réformes en
cours. Approfondir le dialogue
politique, cela signifie que des
questions comme la non-proliféra-
tion, la lutte contre le trafic d’ar-
mes et de drogue, l’immigration
clandestine, devraient être abor-
dées à l’avenir.
S’agissant du respect des droits
de l’homme, les préoccupations
de l’Europe demeurent la peine
de mort, les conditions de déten-
tion, les libertés d’expression, d’as-
sociation et de religion, les droits
politiques et ceux des minorités.
Sur le plan économique, l’Union
européenne souhaite compléter
les dialogues existants (environne-
ment, énergie, science et techno-
logie, société de l’information,
etc.) par une coopération portant
sur la politique industrielle, la
concurrence, l’éducation, les nou-
velles technologies, mais aussi la
propriété industrielle et les contre-
façons, et elle est prête à exami-
ner positivement la demande
chinoise de bénéficier du statut
d’« économie de marché ».
La Chine a répondu d’autant
plus favorablement aux ouvertu-
res européennes que les respon-
sables de Pékin élaborent un
document stratégique allant
dans le même sens. Lors du pro-
chain sommet bilatéral, qui se
tiendra le 30 octobre à Pékin, les
deux parties confronteront leurs
approches, mais il ne fait guère
de doute que la volonté européen-
ne de renforcer ce partenariat
rencontre les souhaits d’une
Chine résolument pragmatique,
qui a fait du développement éco-
nomique sa priorité absolue.
«S’enrichir est glorieux », disait
Deng Xiaoping.
par Laurent Zecchini
Les quartiers des grandes villes de l’Union
mettent leurs expériences en réseau
« Le drame urbain met en cause la cohésion
européenne et peut faire exploser
la démocratie. Les réponses sont différentes
selon les pays. Echanger est donc crucial »
- ,
Bastia (20), Bordeaux/Cenon/Floirac (33), Clichy/Montfermeil (93), Greno-
ble (38), Grigny/Viry-Chatillon (91), Le Havre (14), Le Mantois (78), Les
Mureaux/Val-de-Seine (78), Strasbourg (67). Les neuf zones urbaines françai-
ses en difficulté bénéficiant du programme européen Urban II se sont consti-
tuées en réseau en novembre dernier. Présidé par Agathe Cahierre, premier
maire adjoint du Havre et doté d’un budget de 2,12 millions d’euros sur six
ans, dont 1,06 million d’euros du Fonds européen de développement régio-
nal (Feder), Urban France entend diffuser et capitaliser les expériences, per-
mettant ainsi aux villes les plus avancées en termes de politique urbaine
d’entraîner celles qui sont en retrait.
Des séminaires thématiques tous les deux mois, incluant formations et
visites de sites sont au programme. Urban France dispose d’un site Internet
(http ://www.urban-france.org) depuis le 1er février, où l’on peut accéder à
des forums, des questions-réponses et des annuaires de contacts.
«Approfondir le dialogue
politique, cela signifie
que des questions
comme la non-prolifération,
la lutte contre le trafic d’armes
et de drogue, l’immigration
clandestine devraient être
abordées à l’avenir »
IV/LE MONDE/MARDI 23 SEPTEMBRE 2003

PENSÉE ÉCONOMIQUE
Malthus
et la surpopulation
S
elon une enquête de la
conférence des Nations
unies sur l’enfance qui
paraîtra en décembre pro-
chain, 123 millions d’en-
fants en âge d’être scolari-
sés ne rejoindront pas les bancs de
l’école cette année. 46 millions en
Afrique, la même chose en Asie du
Sud. Un exemple parmi d’autres qui
vient illustrer l’étendue de la distan-
ce qu’il reste à parcourir pour attein-
dre « les objectifs du millénaire »
que se sont fixés les pays riches lors
du sommet des Nations unies
consacré au financement du déve-
loppement qui s’est tenu à Monter-
rey en 2002 : « réduire la pauvreté
de moitié d’ici à 2015 et accroître de
façon substantielle le développement
humain ».
Tout n’est pourtant pas perdu. La
Banque mondiale relève, en effet,
dans son « Rapport sur le dévelop-
pement 2004 : mettre les services
de base à la portée des pauvres »,
rendu public le 21 septembre dans
sa version définitive, que compte
tenu des dernières tendances obser-
vées, la pauvreté au sens technique
–définie comme le nombre de per-
sonnes vivant avec moins de 1 dol-
lar par jour – aura effectivement
diminué en 2015. La planète ne
compterait alors plus qu’un milliard
de pauvres contre 1,4 milliard à
l’heure actuelle… Le constat est plus
mitigé quant aux autres critères de
développement humain, en particu-
lier ceux qui concernent l’éducation
et la santé, auxquels s’intéresse
directement l’étude de l’institution
internationale.
«Trop souvent, les pauvres n’ont
pas accès, en termes de quantité et de
qualité, aux services de base que sont
l’éducation et la santé », diagnostique
Shanti Devarajan, principal auteur
du rapport. En outre, de fortes dispa-
rités sont observées au sein même
des pays en développement en rai-
son des politiques « pro-riches », à la
limite du « copinage », qui y sont
souvent pratiquées. « Alors que les
gouvernements consacrent environ le
tiers de leur budget à des dépenses de
santé et d’éducation, une large part de
ces sommes est destinée aux plus
riches. »
Ainsi, en Guinée, 48 % des dépen-
ses publiques de santé sont consom-
mées par les riches, contre 8 % par
les pauvres. En Bolivie, en raison
d’une répartition inégale des instal-
lations sanitaires, la mortalité infan-
tile des 5 % les plus pauvres s’éta-
blit à 125 décès pour 1000 naissan-
ces alors qu’elle est de 20 pour 1000
pour les 5 % de la population la
plus fortunée. Au Niger, seuls 6 %
des enfants pauvres achèvent leur
cursus primaire pour un taux de
55 % chez les mieux nantis.
«Cette situation est de nature à
rendre vains les efforts visant à attein-
dre les objectifs de développement
pour le millénaire. Il nous faut agir
maintenant. » Mais quels leviers
employer ? La croissance ? C’est
une « condition nécessaire mais non
suffisante ». D’ailleurs, elle est fai-
ble cette année dans les pays en
développement, hormis en Asie du
Sud, qui fait figure d’exception.
Shanti Devarajan insiste par
conséquent sur le rôle de l’aide
publique au développement (APD)
et sur l’utilisation efficiente des res-
sources budgétaires disponibles. En
termes d’APD, il faudrait que les
pays riches, conformément à leurs
engagements pris à Monterrey, dou-
blent le montant annuel actuel de
50 milliards de dollars – soit 0,22 %
de leurs revenus – qu’ils allouent
aux pays pauvres. La conjoncture
étant défavorable, les choses appa-
raissent mal engagées sur ce plan.
C’est donc vers l’efficacité du cadre
institutionnel que la Banque mon-
diale conseille de se tourner.
Le rapport stipule, en effet, que
l’échec de l’accès des plus pauvres
aux services de santé et d’éduca-
tion repose avant tout sur un pro-
blème de gouvernance interne,
vis-à-vis duquel « gouvernements
et citoyens peuvent mieux faire ».
Lorsque les pouvoirs publics
échouent dans leur obligation de
fourniture des infrastructures de
base, il serait alors judicieux,
selon la Banque mondiale, de délé-
guer cette mission à des prestatai-
res privés, sans en conclure, pour
autant, que la solution réside dans
un mouvement de privatisations
tous azimuts de ces services. Ces
prestataires peuvent être locaux
ou étrangers. La libéralisation du
commerce des services, dont les
négociations demeurent en cours
àl’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) après l’échec de la
conférence de Cancun, participe
ainsi de ce nouveau consensus sur
le développement.
Par ailleurs, pour instaurer
«une réforme des institutions et des
relations de pouvoir » adéquate,
M. Devarajan estime qu’il est pri-
mordial pour les pays en dévelop-
pement de s’inspirer des réussites
et des échecs passés. Ainsi cite-t-il
l’expérience réussie du gouverne-
ment cambodgien de la fin des
années 1990, où la délégation de
la fourniture des services de santé
àdes organisations non gouverne-
mentales dans certaines régions a
conduit à une augmentation de
30 % de l’utilisation de ces services
pour la moitié de la population la
plus pauvre. Dans les régions non
concernées par cette organisation,
l’augmentation n’aurait été que
de 14 %.
Quentin Domart
E
xisterait-il de bons et de
mauvais déficits ? Y
aurait-il des trous budgé-
taires favorables à la
croissance économique,
et d’autres qui met-
traient en péril l’expansion, pénalise-
raient la consommation des ména-
ges, menaceraient l’investissement
des entreprises et la production ? A
la lumière des faits récemment
observés de part et d’autre de l’Atlan-
tique, la question peut se poser.
Alors que le déficit des comptes
publics est, en Europe, présenté
comme une calamité économique, il
est généralement considéré comme
un des moteurs de la reprise de l’acti-
vité aux Etats-Unis. Tandis que la
France provoque un tollé en annon-
çant que ses finances publiques pré-
senteront un solde négatif de 4 % du
produit intérieur brut (PIB) en 2003,
personne ne s’émeut quand Geor-
ge Bush réclame une rallonge budgé-
taire de 87 milliards de dollars afin
de financer l’effort de guerre en
Irak, portant le déficit budgétaire
américain à 5 % du PIB.
L’histoire récente, notamment
celle du Japon, a sérieusement mis
àmal les certitudes keynésiennes
selon lesquelles le meilleur moyen
de faire redémarrer une économie
en panne était d’accroître les
dépenses publiques : malgré une
douzaine de plans de relance, mal-
gré le dérapage des comptes
publics – passés d’un excédent de
1 % du PIB en 1992 à un déficit de
plus de 7 % en 2003 –, l’économie
nippone est restée en panne pen-
dant plus de dix ans.
Dans leur livre 18 leçons sur la poli-
tique économique (Seuil, 2003), Fran-
çois Villeroy de Galhau et Jean-
Claude Prager observent que « la
plupart des relances budgétaires ne
se comportent plus aussi simplement
que prévu dans les manuels ». Ils rap-
pellent que « le florilège des “erreurs
de tir” de l’impulsion budgétaire est
important et concerne tous les pays ».
Selon une étude réalisée par le
Centre d’études prospectives et d’in-
formations internationales (Cepii),
sept épisodes récents de restrictions
budgétaires sur dix-neuf se sont avé-
rés « anti-keynésiens », avec des
expansions au lieu de récession, et
six relances sur dix-huit se sont
accompagnées de récession, au lieu
de croissance comme attendu. « Les
études empiriques modernes conver-
gent pour inciter à une grande cir-
conspection face à la doctrine de la
relance », notent MM. Prager et Vil-
leroy de Galhau.
«La désuétude des politiques bud-
gétaires dites keynésiennes de régula-
tion conjoncturelle de l’activité pro-
vient en majeure partie de leur ineffi-
cience, prouvée en théorie et expéri-
mentée dans les faits », note pour sa
part Alexandre Siné, élève à l’école
normale supérieure de Cachan,
dans une thèse, L’Ordre budgétaire.
Plus une économie est ouverte,
c’est-à-dire plus la part des importa-
tions est importante dans son PIB,
moins l’instrument budgétaire est
efficace. La hausse des produits
importés limite l’impact positif de la
relance, qui fait au final plus de bien
aux pays voisins qu’à celui qui en
est l’initiateur. Dans cette perspecti-
ve, l’économie américaine, bien
moins ouverte que ne l’est l’écono-
mie française, apparaît plus réactive
à la stimulation budgétaire.
Une autre grande différence
entre les Etats-Unis et la France
tient à la crédibilité de la politique
de relance. Outre-Atlantique, celle-
ci s’appuie depuis trois ans sur une
étroite coopération entre le volet
budgétaire et le volet monétaire,
sur l’action parfaitement coordon-
née et concertée du secrétaire
d’Etat au Trésor et de la Réserve
fédérale, le premier baissant les
impôts, tandis que le second rédui-
sait les taux d’intérêt.
Rien de tel en Europe, où la Ban-
que centrale européenne (BCE) a
longtemps rechigné avant d’assou-
plir sa politique monétaire et dénon-
ce publiquement et régulièrement
le manque de rigueur budgétaire
des grands pays et leur incapacité à
mener des réformes structurelles.
Cette ambiance houleuse et polémi-
que n’est pas faite pour rassurer les
ménages et les investisseurs, et leur
inspirer confiance face au creuse-
ment des trous budgétaires. Les pre-
miers, confrontés au risque d’une
augmentation future des impôts
pour financer les déficits actuels,
peuvent être amenés à constituer
une épargne de précaution, attitude
qui freine l’effet de relance. Les
seconds choisissent d’exiger des
taux d’intérêt plus élevés sur la det-
te de l’Etat dépensier, là encore
dans la perspective d’un effet boule
de neige lié à l’accumulation des
déficits.
«Au-delà de la vision mécaniste
d’antan, l’arme budgétaire n’a pas
pour autant disparu, expliquent
MM. Villeroy de Galhau et Prager.
Mais elle n’est efficace que si elle est
crédible, d’une part en apparaissant
comme soutenable dans la durée,
d’autre part en étant utilisée de façon
symétrique tout au long du cycle, en
fonction de la conjoncture. » Une
relance budgétaire en période de
récession ne pourra présenter d’im-
pact positif que si l’Etat a précédem-
ment prouvé sa capacité à dégager
des excédents en période de prospé-
rité. C’est le cas aux Etats-Unis, qui
étaient en situation de surplus il y a
trois ans à peine, et qui ont fait pas-
ser le curseur du solde budgétaire
de + 1 % à - 5 %, provoquant ainsi
un choc économique violent.
Rien de tel en France, où la situa-
tion endémique de déficits – la Fran-
ce n’a plus connu d’excédent depuis
1974 – enlève l’essentiel de son effi-
cacité à toute politique de stimula-
tion budgétaire. Celle-ci est perçue
par les acteurs économiques com-
me une façon de maquiller un déra-
page supplémentaire et involon-
taire des comptes publics plutôt
que comme une stratégie délibérée
de relance.
Pierre-Antoine Delhommais
la banque
mondiale pointe
du doigt
la défaillance
des états dans
son rapport sur
le développement
l’a
souligné, la démographie consti-
tue, malgré ses aspects objectifs,
une source de controverses.
D’ailleurs, l’économiste dont on a
le plus usé et abusé au point
d’avoir tiré une épithète courant de
son nom, est Thomas Robert Mal-
thus dont la gloire vient de ses
théories sur la population.
Il naît le 14 février 1766 dans le
comté anglais du Surrey. Son père,
Daniel Malthus, est un excentri-
que, représentatif de la « gentry »
de la « Mery Old England » du
XVIIIesiècle. Il joue les philosophes,
fréquente le philosophe David
Hume et rencontre Rousseau dont
il se veut le disciple et l’ami. En
1788, Robert devient pasteur angli-
can. Comme son père, il aime le
débat d’idées mais, handicapé par
un zézaiement prononcé, man-
quant d’esprit de répartie, il privilé-
gie l’écrit.
En 1798, il publie l’Essai sur le prin-
cipe de population qui marque sa
rupture avec le progressisme pater-
nel. Pour lui, le monde est menacé
de surpopulation : chaque naissan-
ce amorce une lignée qui concourt
àl’accroissement potentiellement
infini du nombre de bouches à
nourrir, alors que l’augmentation
des surfaces cultivées fournit des
récoltes supplémentaires fixes. Il
exprime mathématiquement le
danger de cette évolution discor-
dante entre besoins alimentaires
et ressources en disant que la pro-
gression de la population est géo-
métrique, et celle de la production
arithmétique. En langage moder-
ne, on dirait que la croissance de la
population est exponentielle et cel-
le des ressources linéaire. En langa-
ge usuel, on peut dire que les hom-
mes se multiplient alors que les
champs s’additionnent.
Malthus examine, ensuite, les
obstacles qui freinent la croissance
démographique. Il classe ces obsta-
cles en deux types. Les premiers,
qualifiés de préventifs, limitent la
natalité. C’est d’abord ce qu’il
appelle la contrainte morale, dont
la traduction est le mariage tardif
et la chasteté hors mariage. C’est
ensuite le vice individuel qui corres-
pond à toute sexualité non fécon-
de. Les seconds, dits destructifs,
augmentent la mortalité. Ce sont
d’abord les facteurs naturels com-
me la maladie. C’est ensuite le vice
social que symbolise la guerre.
Bien que l’impossibilité d’une
population infinie soit un truisme,
la thèse de Malthus suscite une
opposition virulente. Marx le trai-
te de « sycophante des classes diri-
geantes ». Trois reproches lui sont
faits. D’abord, il sous-estime les
capacités productives de la terre.
Le progrès technique améliore les
rendements agricoles si bien que
les récoltes peuvent croître davan-
tage que ce qu’il postule. Ensuite,
il heurte de front l’idée dominante
qui, du « croissez et multipliez »
des Ecritures au « il n’est de riches-
se que d’hommes » de l’économis-
te et philosophe Jean Bodin, asso-
cie puissance, richesse et popula-
tion nombreuse.
Si les utopistes fixent souvent à
leur Cité idéale un nombre précis
d’habitants (5040, par exemple,
pour Platon), avant lui rares sont
les économistes qui, comme Jean
Botero, un mercantiliste piémon-
tais du XVIesiècle, ont affirmé que
la misère est directement liée à la
surpopulation. Enfin, sa démarche
autant morale qu’économique a
des conséquences radicales. S’il sou-
haite que l’Etat favorise la contrain-
te morale, il demande également la
suppression de l’assistance sociale
car elle permet aux pauvres d’en-
fanter sans retenue une progénitu-
re vouée à l’oisiveté et au crime.
Malgré les critiques, Malthus
persiste et signe lors des réédi-
tions de son essai et, en 1807, dans
sa Lettre à Samuel Whitbread, il
accuse la construction de loge-
ments sociaux d’aider les indi-
gents à se marier prématurément.
En 1805, il devient professeur
d’économie. En 1809, il noue avec
le Britannique David Ricardo une
amitié solide et intellectuellement
stimulante. En 1820, il publie Princi-
pes d’économie politique. L’origina-
lité de ce livre, notamment par rap-
port à ceux de Ricardo, réside dans
l’analyse de la demande.
Malthus conteste la loi de Jean-
Baptiste Say selon laquelle l’offre
crée sa propre demande. Pour lui,
l’investissement conduit à un man-
que de demande. L’entrepreneur
qui investit cherche non pas à
accroître sa consommation propre
mais à évincer ses concurrents. Il
ne dépense donc pas nécessaire-
ment immédiatement le profit
qu’il tire de son investissement. De
ce fait, il crée une offre sans créer
la demande correspondante. Cette
distorsion entre l’offre et la deman-
de se traduit par la déflation.
Pour corriger cette tendance à la
déflation, l’Etat dispose de deux
moyens. Le premier est le main-
tien de groupes sociaux qui, quoi-
que vilipendés comme improduc-
tifs, tels les dignitaires de la Cou-
ronne ou les prêtres, garantissent
des débouchés stables. Le second
est l’investissement public. Pour
montrer l’utilité de la demande
publique, Malthus prend l’exem-
ple de la récession de 1817 : après
la victoire sur Napoléon, le gouver-
nement a cru bon, par démagogie,
de baisser les impôts. Simultané-
ment, il a diminué les dépenses
pour ne pas alourdir la dette publi-
que. Or, comme la demande pri-
vée n’a pas pris le relais, il a, en
fait, précipité l’économie dans la
crise.
Ala mort de Malthus, en décem-
bre 1834, ses détracteurs ne se pri-
vent pas d’évoquer, en ricanant,
ses trois enfants. Pour l’époque,
c’était pourtant assez peu : son
ami Ricardo en avait eu quatorze…
Jean-Marc Daniel est professeur
à l’ESCP-EAP.
par Jean-Marc Daniel
La relance par le déficit,
une affaire de crédibilité… politique
moins ouverte
aux importations
que l’économie
française,
l’économie
américaine
est plus réactive
aux stimulations
budgétaires
L’accès des plus pauvres aux services
d’éducation et de santé reste très limité
FOCUS
Malgré le dérapage des comptes publics – passés
d’un excédent de 1 % du PIB en 1992
à un déficit de plus de 7 % en 2003 –, le Japon
est resté en panne pendant plus de dix ans
0,7
99 00 0102 03*04**
-1,6
-1,3
-0,5
-1,4
-3,1
-3,1
-3,7
-4,0
-4,7
-4,0
1,4
Source : OCDE **prévisions*estimations
UNE ÉVOLUTION PARALLÈLE
Solde budgétaire, en pourcentage duPIB
Etats-UnisFrance
En Guinée,
48 % des dépenses
publiques de santé
sont consommées
par les riches, contre
8 % par les pauvres
LE MONDE/MARDI 23 SEPTEMBRE 2003/V
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%