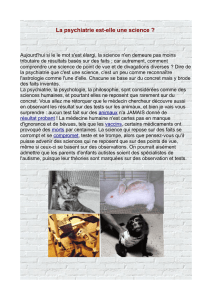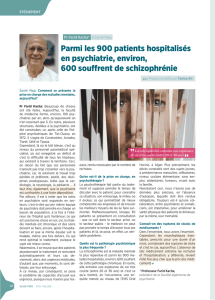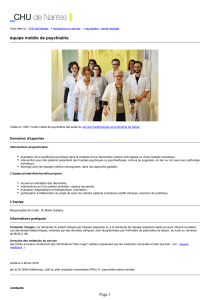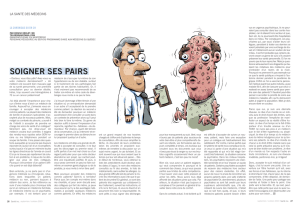Deux méthodes d`évaluation des pratiques en psychiatrie :

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 83, N° 4 - AVRIL 2007
341
L’Information psychiatrique 2007 ; 83 : 341-7
Séminaire de formation médicale continue
Deux méthodes d’évaluation
des pratiques en psychiatrie :
Les groupes d’analyse de pratiques entre psychiatres
Les staffs-EPP des équipes hospitalières de psychiatrie
Marc-Edmond Bétremieux*
SÉMINAIRE DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
Les psychiatres et les soignants en psychiatrie ont inscrit dans leurs formations initiales ainsi que
dans leur pratique quotidienne la nécessité d’une analyse constante de leur travail clinique sous
forme collective. Les équipes de psychiatrie publique ont développé différentes pratiques de soins
s’appuyant sur le concept de secteur de psychiatrie. Ce modèle intègre autour du patient et de sa
famille différents niveaux d’intervention, étapes, lieux et temps de soins. Nos équipes accompagnent
ces patients par des modalités très diverses comme les prises en charge intensives en hospitalisation, le
recours à des outils alternatifs ou le suivi en consultations ambulatoires. L’espace du soin se construit
sur les questions de la continuité des soins et du travail psychothérapeutique institutionnel.
* Chef de Service, CHG, 62110 Hénin-Beaumont
Ce travail institutionnel de groupe est formalisé dans nos
services selon l’histoire sous diverses formes : réunions de
service, groupes de supervision ou d’intervision, synthèses,
staffs, cartels… Ces différents modèles permettent une
véritable analyse institutionnelle s’appuyant sur un appro-
fondissement des contenus et des processus développés dans
ces réunions. Les réfl exions sont complétées d’analyses des
situations complexes, de problèmes cliniques particuliers,
des recherches bibliographiques… Ces différents niveaux
de recherche permettent à chacun de se situer dans une
élaboration de son rapport aux savoirs.
Les médecins sont tenus, depuis la loi du 13 août 2004,
à une obligation d’évaluation des pratiques profession-
nelles (EPP) qui a été précisée par le décret n° 2005-346
du 14 avril 2005.
D’après la Haute autorité de santé (HAS), « l’évaluation
des pratiques d’un médecin ou de tout autre professionnel
de santé est l’analyse que celui-ci (avec ou sans ses pairs)
peut faire de son activité clinique. Cette analyse se fait
évidemment par rapport aux recommandations professi-
onnelles disponibles existantes. De cette comparaison doit
résulter une amélioration des pratiques, au bénéfi ce du
service rendu au patient ».
Différentes méthodes existent permettant la mise en
place d’une démarche d’évaluation et la poursuite du
dévelop pement d’une démarche qualité. Ces programmes
amènent également à une validation dans un deuxième
temps de l’obligation légale selon des procédures indivi-
duelles ou collectives ou encore dans le cadre de la certi-
fi cation des établissements de santé.
Parmi ces formes d’organisation d’EPP, deux apparaissent
pouvoir s’appuyer dans leur forme et leur contenu sur les
modèles de travail d’analyse déjà institués par certaines
réunions dans nos services, ce sont les groupes d’analyse
de pratiques entre pairs et les staffs-EPP des équipes hospi-
talières. Ces méthodes ont fait l’objet d’un travail de synthèse
que l’on retrouvera sur le site de la HAS, et une adaptation
à la pratique en psychiatrie a été proposée en séminaire
d’EPP de l’Association pour les congrès et la formation
continue des psychiatres (ACFCP) au congrès de la Société
de l’Information Psychiatrique à Marseille en octobre 2006
par Nicole Garret-Gloanec et Marc Bétrémieux.
doi : 10.1684/ipe.2007.0188
jleipe00407_cor3.indd 341jleipe00407_cor3.indd 341 4/27/2007 6:33:52 PM4/27/2007 6:33:52 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 83, N° 4 - AVRIL 2007
342
Séminaire de formation médicale continue
d’organisation de groupes ont été développées telles que
les groupes d’échange des pratiques de MG Form ou les
groupes qualité de l’URML Bretagne.
Cette méthode de formation et d’évaluation a été reconnue
par la HAS en 2006 comme un des moyens collectifs de
répondre à l’obligation d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (EPP) en ambulatoire et qui en a fait une fi che
technique disponible sur son site.
Défi nitions
Le critère premier de cette méthodologie concerne la
nécessité d’égalité de statuts des différents participants au
groupe : les pairs sont des personnes égales en situation
sociale et semblables quant à la fonction. Tous les profes-
sionnels occupant le même rang dans l’organisation du
groupe, l’absence de hiérarchie permet de faciliter la libre
parole de chacun.
Un groupe de pratique entre pairs doit être constitué de prati-
ciens d’une même spécialité. Il fonctionne en s’appuyant
sur des modalités de travail interactives. D. Davis et al.
ont montré que seules les formations médicales continues
qui utilisent des méthodes interactives ont une certaine
effi cacité.
Objectifs
Les auteurs M. Arnould et C. Cohendet de la SFMG,
dans un débat publié dans la Revue du Praticien, rappel-
lent que les groupes d’analyse de pratiques entre pairs ont
comme fi nalité l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
Cela se fait à travers divers objectifs comme celui de favo-
riser les échanges entre médecins ou encore d’analyser et
de critiquer la pratique telle qu’elle est, la confronter aux
données de la science.
Les groupes d’analyse de pratiques entre
psychiatres
L’analyse de la pratique en groupe est un mode extrême-
ment répandu de reprise du travail clinique entre psychia-
tres. Les équipes ont développé dans le cadre institutionnel
de leur pratique de secteur de psychiatrie diverses formes
de réunion de présentation de situations.
Cette approche permet à chaque professionnel de situer son
intervention clinique dans les différentes dimensions que
sont l’analyse séméiologique, l’élaboration de la démarche
diagnostique et la construction d’un projet de soins.
Le recours institué au groupe oblige chaque praticien à
confronter sa pratique individuelle à un cadre théorique
scientifi que partagé, à interroger son savoir mais, surtout,
lui permet de mettre à l’épreuve son rapport aux patients et
à la maladie, dimensions centrales d’une pratique de clini-
cien en psychiatrie.
La HAS a formalisé une démarche d’amélioration de la
qualité, à partir de l’expérience développée à l’initiative de
plusieurs associations de médecins : les groupes d’analyse
de pratique entre pairs.
Le groupe d’analyse de pratique entre
pairs peer review
Ce modèle a été élaboré par les associations de médecins
généralistes ayant une pratique essentiellement ambula-
toire et en particulier par la Société française de médecine
générale (SFMG) dont l’expérience acquise par plusieurs
années de pratique fait référence : « Les groupes de pairs
sont nés de la volonté de structurer une étude de la
pratique de la médecine générale en groupes de travail ».
Ces médecins généralistes ont soutenu l’idée primordiale
de valoriser leur pratique effective et quotidienne. Ils ont
souhaité l’analyser au travers de modalités de travail en
groupe afi n de permettre l’expression et le débat. Ce travail
d’élaboration est complété par une confrontation aux
données de la science.
Historique
Le terme de « groupes de pairs », utilisé par la SFMG a été
inspiré par R. Grol et son équipe néerlandaise de Nimègue
dont l’article Peers review in general practice, édité en
1985 dans la revue Family Practice, s’intéresse aux moti-
vations des médecins généralistes à participer à des audits
cliniques.
En France, dès 1987, la SFMG impulse les premiers
groupes comme méthode d’étude critique de la pratique
et de la formation d’une personnalité professionnelle. La
SFMG fait le dépôt légal du terme « groupe de pairs® » en
1994. La méthodologie du groupe de pairs® a été validée en
2003 lors du 2e symposium à Annecy. D’autres modalités
L’ACFCP (Association pour les congrès et la forma-
tion continue des psychiatres) regroupe les instances
professionnelles du Syndicat des psychiatres des hôpi-
taux (SPH) et les instances scientifi ques de la Société
de l’information psychiatrique (SIP). Cette association a
pour un de ses objets l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles telles que prévues par le code de la Santé. Le
comité pédagogique développe son activité d’évaluation
dans quatre registres : des actions ponctuelles pendant
les journées nationales, des programmes continus à la
demande de groupes de professionnels, un accompagne-
ment d’établissements ou structures et l’élaboration de
référentiels sur des thèmes non traités par la HAS et sur
lesquels la SIP et le SPH sont en mesure d’apporter une
expertise.
L’ACFCP a été agréée le 29 novembre 2006 par la Haute
Autorité en Santé pour l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles des médecins salariés et hospitaliers.
jleipe00407_cor3.indd 342jleipe00407_cor3.indd 342 4/27/2007 6:33:54 PM4/27/2007 6:33:54 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

343
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 83, N° 4 - AVRIL 2007
Séminaire de formation médicale continue
La dynamique du groupe permet de renforcer l’identité
professionnelle, d’améliorer le travail en équipe et la coor-
dination des soins.
Ces différents objectifs constituent la base d’une démarche
visant à améliorer la qualité des soins.
Les groupes d’analyse de pratique
entre psychiatres
Méthodologie : le groupe
Les psychiatres, praticiens d’un même exercice, doivent
constituer un groupe homogène, volontairement restreint
de six à dix praticiens afi n de permettre l’expression
de chacun.
Ce groupe peut se créer à partir d’une confi guration déjà
existante comme certaines réunions institutionnelles
que les praticiens décident de faire évoluer en reprenant
les critères de formalisation des « groupes d’analyse de
pratique entre pairs » tels que défi nis par l’HAS. D’autres
modalités de constitution de groupes peuvent également
être utilisées et s’appuyer sur différents statuts informels
ou encore associatifs.
Le groupe centre son analyse sur la pratique quotidienne et
ordinaire de chaque psychiatre qui compare sa pratique à
celle des autres sur des cas réels. L’absence de hiérarchisa-
tion dans la communication aboutit à ce que le groupe fasse
fonction d’une certaine façon de référentiel où il n’y a pas
d’individu en place d’expert.
La discussion entre les participants conduit à la mise en
évidence de divergences dans l’analyse, aboutissant à
consulter les recommandations existantes, les données de
la science et de la littérature. Chaque praticien et, à un autre
niveau, l’ensemble du groupe est amené à comparer sa
pratique, à observer les écarts, à les réduire ou à les justi-
fi er par rapport à un référentiel de pratique. L’évaluation de
la pratique ainsi organisée aboutit à un premier objectif de
formation continue interactive.
Le groupe d’analyse de pratique entre pairs constitue un
moyen d’évaluation collective et continue des pratiques
s’appuyant sur une démarche personnelle volontaire. Les
règles du groupe se doivent de respecter l’identité profes-
sionnelle, ainsi que les formes et les modalités habituelles
développées dans le quotidien de notre travail. Par ailleurs,
il se doit d’être un lieu d’auto-évaluation non sanctionnant
Méthodologie : les réunions
Pour fonctionner chaque groupe d’analyse de pratique entre
psychiatres se doit de respecter différentes règles et aura à
en justifi er pour la démarche de validation de l’EPP.
L’ACFCP a organisé à Marseille en 2006 un séminaire EPP
consacré aux groupes d’analyse de pratiques entre psychia-
tres. Différents critères retenus par la HAS ont été validés
dans des fi ches protocoles. Les réunions doivent être régu-
lières et avoir une fréquence suffi sante : le rythme d’une
par mois permet d’obtenir une démarche d’amélioration
continue. La présence des membres du groupe doit être
certifi ée par la signature sur une liste d’émargement, chaque
médecin ayant à participer à au moins six de ces réunions
pour une validation de son EPP.
L’animation du groupe s’appuie sur la désignation d’un
modérateur et d’un secrétaire à chaque réunion. Le modéra-
teur a comme responsabilité de faciliter la dynamique, de
répartir le temps de parole, d’aider chacun à se maintenir
dans les objectifs du groupe. Afi n de garder la confi den-
tialité des débats, il n’y a pas par principe d’observateur
extérieur. De façon volontaire et concertée, le groupe peut
faire appel à un animateur extérieur qui peut apporter dans
certains cas son expertise.
Un compte rendu de séance rédigé par le secrétaire
témoigne du contenu de la séance, il résume les problèmes
posés et les réponses apportées par le groupe, les références
et les prises de décisions consensuelles. Chaque membre du
groupe exerce tour à tour le rôle de secrétaire de séance.
Chaque réunion est organisée autour de trois temps distincts :
l’étude de cas, l’analyse du parcours et de la coordination
des soins, des thématiques spécifi ques. L’ensemble de la
réunion dure entre deux et trois heures (encadré 1).
Processus d’analyse et d’amélioration de la pratique
Au cours de la réunion, les problèmes cliniques sont présentés
et analysés, les références sont consultées, chaque psychi-
atre argumente ; des pistes d’amélioration consensuelles
et référencées sont éventuellement défi nies et proposées.
L’appropriation par chacun de praticiens accompagne
l’effort d’amélioration de l’exercice quotidien de la
pratique et de la continuité des soins par réduction des
écarts observés et évaluation régulière de l’impact.
Les staffs-EPP des équipes hospitalières
de psychiatrie
De nombreuses équipes de psychiatrie en établissement de
santé ont développé des réunions de service appelées staffs
réunissant les différents soignants de manière pluriprofes-
sionnelle, ce qui est d’un intérêt majeur pour la prise en
charge des patients de notre discipline. Le staff désigne
la réunion d’un service ou d’une unité de soins instituée
dans un but organisationnel ou pour évaluer et résoudre
des problèmes des prises en charge médicales. La plupart
de ces staffs hospitaliers affi chent un objectif associé de
formation des participants.
La HAS a souhaité valoriser ces modalités d’exercice
clinique qui portent en elles-mêmes un volet d’évaluation
et permettent aux équipes d’analyser les données de leurs
pratiques. Le principe retenu pour le staff-EPP des équipes
jleipe00407_cor3.indd 343jleipe00407_cor3.indd 343 4/27/2007 6:33:54 PM4/27/2007 6:33:54 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 83, N° 4 - AVRIL 2007
344
Séminaire de formation médicale continue
1re étape - Etude de cas
Chaque psychiatre présente le cas d’un patient choisi de
façon aléatoire parmi ceux qu’il a vus récemment : par
exemple sera retenu la troisième consultation du mardi
précédent la réunion du groupe d’analyse. Cette modalité
de tirage au sort permet de centrer la discussion clinique
sur ce qui représente la majorité des situations rencon-
trées dans la pratique. La présentation aléatoire favorise
une analyse et une évaluation d’un dossier ordinaire. A
ces dossiers choisis de manière aléatoire doivent être
associés, dans le cadre de la démarche de validation de
l’EPP, un ou plusieurs thèmes qui seront suivis et évalués
périodiquement.
Chaque médecin expose un cas clinique en utilisant
différents registres défi nis préalablement par le groupe
comme la description séméiologique, la dynamique de
la consultation, les antécédents et informations utiles, les
hypothèses diagnostiques, les éléments de la discussion
bénéfi ces/risques, l’élaboration des décisions prises à
partir de l’analyse de la consultation et des autres déter-
minants, etc.
Cette phase de présentation clinique va s’appuyer sur
l’utilisation d’un outil commun aux membres du groupe :
une grille de présentation. Les objectifs d’utilisation
de cette grille sont de faciliter la présentation du cas,
de permettre au praticien d’argumenter et de justifi er
ces décisions avec plus de précision, de permettre au
groupe un travail collectif reposant sur un outil partagé,
d’évaluer sa pratique et de la confronter aux données de
la science, de documenter dans le cadre d’une procédure
de validation de l’EPP, d’ouvrir la possibilité de travaux
de recherche exploitant les données recueillies.
2e étape - Analyse de la continuité des soins
Ce temps du groupe se centre sur l’analyse globale et
par plan de l’organisation du projet de soins. Celui-ci
doit permettre de développer la notion de continuité
des soins avec le patient et les différents partenaires,
entourage familial, professionnels de santé, ou ceux de
son contexte social. Ce temps est tout particulièrement
sensible en psychiatrie où le projet de soins ne peut être
pensé que dans une dimension continue et plurifocale
telle que pensée par le concept de secteur.
La continuité relationnelle désigne la relation thérapeu-
tique entre un patient et un ou plusieurs soignants. Elle
offre au patient une meilleure reconnaissance de ses trou-
bles et du diagnostic, une meilleure observance et lui per-
met de mieux faire face à sa maladie. Cette dimension,
analysée en partie dans le premier temps de discussion,
va être formalisée dans ce deuxième temps à travers dif-
férents critères qui concernent la qualité des informations
délivrées, la qualité de l’organisation des soins, la recher-
che de relations continues entre patient et soignants ainsi
qu’entre les professionnels partenaires, la stabilité du per-
sonnel, etc.
La continuité va également s’appuyer sur le deuxième
plan qui concerne la continuité informationnelle, c’est-
à-dire la disponibilité et l’utilisation de renseignements
sur les éléments antérieurs de l’histoire permettant
d’adapter le projet de soins : éléments issus du recueil
d’informations écrites, éléments du dossier du patient,
courriers entre les différents intervenants. Le transfert
d’information écrite lie les éléments du soin dans le
temps et constitue un prérequis pour la coordination des
soins. Le groupe analysera les courriers, l’organisation
du dossier patient, etc.
Un troisième axe concerne la continuité du plan
d’intervention, particulièrement importante en psychiatrie,
qui s’appuie sur la cohérence temporelle et fonctionnelle
entre les diverses actions de soins et les différents plans
d’interventions : soignant, social, économique, judiciaire,
éducatif, etc. Le groupe d’analyse de la pratique procède
à l’examen des modalités de coordination internes
au service, à l’établissement, avec les professionnels
extérieurs : médecins libéraux, mais aussi l’ensemble des
professionnels institutionnels.
3e étape - Approfondissement de thèmes
spécifi ques
Le groupe d’analyse de pratique entre psychiatres s’appuie
sur des données qui sont référencées : recommandations,
données de la littérature, niveau de preuve, evidence
based medecine. Par ailleurs, le groupe peut au préalable
choisir une ou plusieurs thématiques particulières qu’il
souhaite approfondir et suivre au cours des différentes
séances à travers plusieurs critères ou paramètres
cliniques. Ces données seront discutées au sein du groupe,
lors de chaque séance et comparées aux références. Le
choix préparatoire de thématiques facilite le travail de
recherche bibliographique et de mise à disposition de
données référencées.
Ce temps pourra être également l’occasion de parler des
cas complexes.
Réunions des groupes d’analyse de pratique entre psychiatres
jleipe00407_cor3.indd 344jleipe00407_cor3.indd 344 4/27/2007 6:33:54 PM4/27/2007 6:33:54 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

345
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 83, N° 4 - AVRIL 2007
Séminaire de formation médicale continue
hospitalières est de formaliser certaines de ces réunions
afi n d’enclencher une démarche d’amélioration continue
de la qualité.
Staffs médicaux hospitaliers « protocolisés »
L’arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles
de validation de la formation médicale continue considère
que les staffs protocolisés sont intégrés dans la catégorie 3
qui regroupe un ensemble de situations professionnelles
formatrices.
Dans sa réfl exion sur le développement de l’EPP, la HAS a
mis l’accent sur les formes émergentes de pratiques médi-
cales et d’évaluation où l’analyse de dossiers, base de travail
des staffs médicaux, apparaît comme forme d’évaluation
des pratiques professionnelles. La mise en place d’un
protocole a été retenue comme objectif afi n de permettre
de valider une démarche d’amélioration des pratiques pour
un staff.
Historique
La Fédération des spécialités médicales a mis en place un
groupe de travail, coordonné par Jacques-Henri Barrier
(interniste) et Nicole Garret-Gloanec (pédopsychiatre),
qui a rédigé des fi ches de protocole de staff. Deux fi ches
de staff ont été différenciées, une pour la formation et une
autre pour l’EPP. La fi che technique d’un protocole de
staff élaborée par la FSM a été examinée par le Conseil
national de formation médicale continue des hospitaliers
(CNFMCH) qui a confi rmé les deux niveaux de partici-
pation à un staff, le premier étant formatif et le second
éval uatif. Ces fi ches ont fi nalement été adoptées par le
CNFMCH le 21 avril 2006.
Le modèle de staff pour la formation médicale continue
est présenté sur le site de la Fédération des spécialités
médicales.
Cette séparation est relativement artifi cielle et les staffs
ont en général une double fonctionnalité formative et
évaluative.
Staff protocolisé pour l’EPP : groupe de décision
et d’évaluation professionnelle (GDEP)
Groupe de professionnels
Le groupe de staff-epp va réunir différents professionnels
d’une même structure : médecins spécialistes, généralistes,
autres professionnels de santé. La dimension pluripro-
fessionnelle est possible, voire recommandée. L’équipe
comporte rarement plus de dix praticiens.
La composition du groupe doit être stable au cours des diffé-
rentes réunions afi n de maintenir une certaine dynamique.
La possibilité de confrontation à d’autres équipes, à des
formes d’exercices interdisciplinaires ou à des échanges
sur les pratiques public-privé sont également des expéri-
ences encouragées.
Objectifs
L’analyse des pratiques professionnelles dans les staffs-
EPP doit permettre le développement de la formation des
praticiens et l’amélioration de la qualité des soins. Chaque
groupe staff-EPP identifi e un ou plusieurs thèmes, par
exemple un symptôme, une technique, un examen complé-
mentaire, une organisation ou parcours de soins, un chemin
clinique, un traitement, un axe de prévention ou d’éducation
thérapeutique/de santé et met en place une analyse et une
recherche.
Organisation
Différentes fonctions sont défi nies et occupées par les
membres du staff-EPP :
- un responsable du programme de staff-EPP ;
- un modérateur ayant une expertise dans le ou les thèmes
choisi désigné avec pour fonction de permettre la circula-
tion de la parole ;
- un expert, qui peut être aussi le modérateur, choisi au
préalable si le thème est préétabli ou en début de séance si
les travaux portent sur les cas cliniques en cours ;
- un secrétaire de séance qui est en charge des différents
comptes rendus : résumé de séance, de discussion, etc.
L’organisation s’appuie également sur des modalités
pratiques que le groupe aura programmées :
- une feuille d’émargement qui sera datée et signée ;
- la régularité des séances : la date du staff est déterminée
ainsi que sa fréquence avec un suivi sur une durée qui est
variable de 6 à 12 mois (action ponctuelle) ou sans limite
(programme continu) ;
- les supports sont les dossiers des patients des membres
du groupe ;
- les références sélectionnées que sont les données de la
littérature, les travaux d’autres équipes ; les référentiels
d’EPP et ceux à créer s’ils n’existent pas par les sociétés
savantes.
La HAS précise que le déroulement du staff-EPP est une
démarche entre professionnels qui associe successivement :
- une revue de dossiers préalablement sélectionnés de
manière explicite par l’équipe et qui fait émerger un ques-
tionnement sur des domaines variés (modalités de prise en
charge, diagnostic, traitement, pronostic, iatrogénie, qualité
et effi cience des soins, cas clinique, etc.) ;
- une revue bibliographique sélectionnant les meilleures
références (niveau de preuve) qui permettent d’apporter des
réponses aux questions posées par la revue de dossiers ;
- une discussion entre professionnels lors d’une réunion
appelée staff-EPP afi n d’apprécier la validité, l’utilité et
l’applicabilité des références sélectionnées pour répondre
aux questions posées. Pour cela on utilise une démarche
jleipe00407_cor3.indd 345jleipe00407_cor3.indd 345 4/27/2007 6:33:54 PM4/27/2007 6:33:54 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%