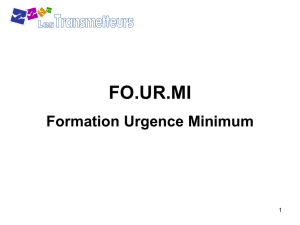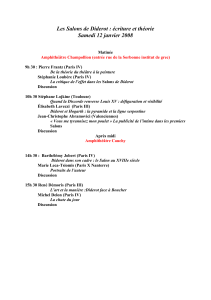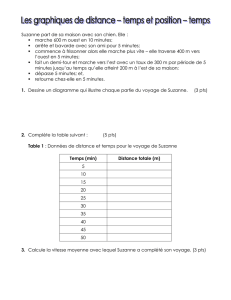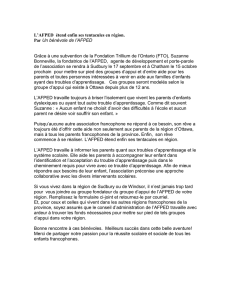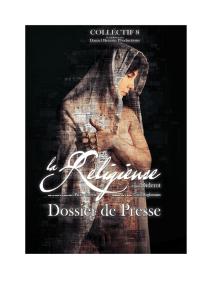La Religieuse

LA RELIGIEUSE
de Diderot
Contact Presse : Christophe MERIGOUT
Chargé de communication et des relations publiques
Théâtre Le Forum - 06.38.95.53.49 - c.merigout@theatre-le-forum.fr

!
"!
!
!

!
#!
!
!
!
!
$%!&'$()('*+'!
,-!,./-012!
!
%/34232.15!6!780.92-::-!&-;1<:!-2!=30.->$3<0-5?-!@30239!
!
=.9-!-5!9?A5-!6!B.?1:39!C3</-!
!
%D-?!6!!
780.92-::-!&-;1<:!
+<E355-!+.F15.5!
!
=30.->$3<0-5?-!@30239!
$3!=A0-G!$3!+<4H0.-<0-!+3.52->780.92.5-G!=3/3F-!I!
!
J0H/H0.?!%5/03<!
$K3D1?32!=L=351<0.G!$-!MA0-G!$-!)035/!C.?3.0-G!$-!715N-99-<0!
!
780.92.5-!M:<;-3<!
!C.1:-!/-!)3F;-!!
!
!
L’anecdote raconte qu’un de ses amis, M. d’Alainville, l’ayant surpris
« le visage inondé de larmes » et le questionnant sur son état, Diderot
aurait répondu « je me désole d’un conte que je me fais », il travaillait
alors à sa Religieuse.

!
O!
Résumé de l’histoire!
Suzanne Simonin, enfant adultérin, est contrainte et forcée par sa mère de rentrer au
couvent de Longchamp afin de taire le scandale de sa naissance et de préserver ainsi la
bienséance bourgeoise.
Dans ce couvent elle doit faire face à la Mère Sainte Christine. Véritable sadique, elle
stigmatise Suzanne qui tente une action en justice pour faire résilier ses vœux.
Considérée comme une apostate par toute la communauté, Suzanne subira de multiples
sévices (enfermement dans un cachot, simulacre d’exorcisme…)
Après l’échec de son procès, son avocat, Maître Manouri, lui trouve une place au
couvent d’Arpajon. Couvent aux allures libertaires, il est en apparence tout l’opposé
de Longchamp. Mais Madame***, la supérieure, jette son dévolu amoureux sur
Suzanne. Suzanne résiste alors à une manipulation sourde, à un harcèlement incessant,
à une tentative de viol. Madame***, rejetée par Suzanne sombre dans une folie qui la
mènera à la mort.
Suzanne se réfugie dans son espoir de sortir un jour, alors que son cauchemar continue
avec l’arrivée de la prochaine Supérieure…
Extrait
LE GRAND VICAIRE
Pourquoi votre cellule ne ferme-t-elle pas ?
SUZANNE
C’est que j’en ai brisé la serrure.
LE GRAND VICAIRE
Pourquoi l’avez-vous brisée ?
SUZANNE
Pour ouvrir la porte et assister à l’office le jour de l’Ascension.
LE GRAND VICAIRE
Vous vous êtes donc montrée à l’église ce jour-là ?
SUZANNE
Oui, monsieur...
SAINTE CHRISTINE
Monsieur, cela n’est pas vrai ; toute la communauté...
SUZANNE
Assurera que la porte du chœur était fermée ; qu’elles m’ont trouvée prosternée à cette porte, et que vous leur
avez ordonné de marcher sur moi, ce que quelques-unes ont fait.

!
P!
Adapter La Religieuse de Diderot
« Je ne crois pas qu’on ai jamais écrit une plus effrayante satire des
couvents » dit Diderot de sa Religieuse.
Ce texte, mis sous cellophane pendant nombre d’années, encore interdit lors de
son adaptation cinématographique par Jacques Rivette en 1967, dérange parce
qu’il démonte la perversité du système catholique et celle d’une société toute
entière fondée sur le faux semblant bourgeois, mais il dérange aussi parce qu’il
met en scène un personnage (Suzanne Simonin) perdu au plus profond de son
identité. C’est cette quête identitaire qui nous semble avoir toute sa légitimité
sur une scène de théâtre, qui nous semble théâtrale déjà dans le roman de
Diderot.
La peur d’une adaptation est bien sûr de trahir. Comment passer du roman de
Diderot au théâtre ? De sa narration à l’action et au dialogue ? De son « passé »
au présent du théâtre ? Comment donner à voir l’enfermement, l’impuissance,
l’oppression de Suzanne ? Comment répondre à toutes ces questions en gardant
l’esprit de Diderot ?
Roger Lewinter dans son analyse de La Religieuse dit :
- « Le roman (La Religieuse) ne se situe non pas dans le temps mais dans
l’instant. Les différents épisodes se jouent non pas successivement mais
simultanément : ils se superposent, comme différents plans d’un seul tableau. »
- « Diderot fait appel à la technique théâtrale et ordonne le récit en une
succession ininterrompue de « tableaux » dont la « présence », instantanée,
empêche toute réflexion, distanciation, et transforme le lecteur en spectateur :
témoin, impliqué dans la représentation. La religieuse est la pièce idéale, dont
rêve Diderot : une galerie de tableaux qui s’exposent devant l’œil captivé et
captif du spectateur ; le tableau étant (…) un instant parfait : une cristallisation
de sens, où la matière est sémantisée en emblème. Cette technique, inspirée du
théâtre, lui-même inspiré de la peinture, de Greuze en particulier, fait de la
Religieuse un roman absolument nouveau, quasi expressionniste. »
- La Religieuse est « une analyse des mouvements du corps, une clinique des
passions. L’âme est toujours signifiée par le corps ».
Suzanne Simonin, au début du roman de Diderot s’est évadée de son
couvent, elle est clandestine et écrit au marquis de Croismare pour lui demander
secours. C’est ainsi qu’elle raconte son histoire. Au passé donc. Mais un passé
très actualisé, comme si le fait de le raconter le rendait à nouveau présent. Elle
revit plus qu’elle ne raconte. C’est-à-dire que le récit ne bénéficie pas de ce
recul, de cette distance propre au temps et qui permet de raconter avec une
maturation, avec sans plus d’émotions. Suzanne est tout le contraire de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%