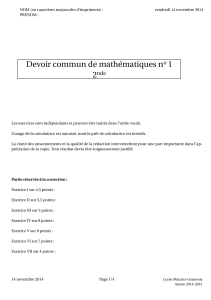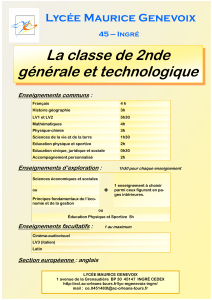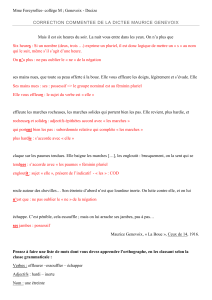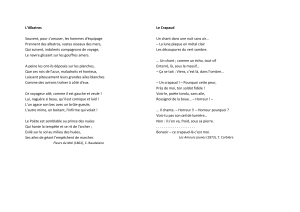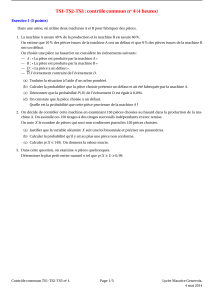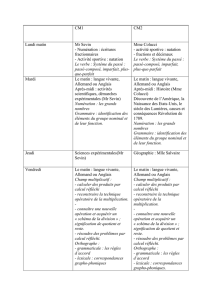document 1 - ItsLearning

Séance 5 : évocation de l’horreur et registre pathétique
Compétence visée : Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court
5
10
15
A mes camarades du 106,
En fidélité à la mémoire des morts
Et au passé des survivants.
Il fait tout à fait nuit maintenant. Des voix montent de l'entonnoir. Des voix
gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Je me suis
allongé près du commandant Sénéchal et j'ai jeté sur moi une loque noire que j'ai
ramassée, la pèlerine d'un mort sans doute. Ce n'est pas une nuit très sombre ; pluvieuse
et blafarde, elle est bien la nuit des jours que nous vivons : chaque fois que j'ouvre les
yeux, je retrouve près de moi la forme écroulée de Sénéchal, et près de lui celle de
Carrichon.
«Demain, murmure le commandant, je vous garde. Puisque Chabredier et Rolland
sont montés avec Rebière, et que votre tranchée est vide, je ne veux pas vous y envoyer
seul. J'ai besoin de vous pour une reconnaissance : je ne connais plus mon secteur ; il y a
de tout, sur cette crête, du 132, du 67, du 2ème bataillon, du 3ème, tout ça disloqué,
éparpillé je ne sais plus où... Vous irez voir, vous tâcherez de comprendre, et vous
reviendrez me dire... Reposez-vous cette nuit ; ne vous faites pas tuer demain. »
Il parle posément, chaque fois que sa plainte chevrotante veut bien le laisser parler :
Maurice Genevoix (1890-1980) : cet écrivain français est l’auteur d’un
recueil Ceux de Quatorze rassemblant cinq récits de guerre écrits de
1916 à 1923 : Sous Verdun, Nuits de guerre, Au seuil des guitounes, La
Boue, Les Eparges. Précision des observations, authenticités des faits,
ce témoignage des tranchées est l’un des meilleurs de la Grande Guerre.
Sans jamais céder à une quelconque licence de l’imagination, Genevoix
s’applique à dire la vérité avec objectivité. L’horreur des combats y est
rapportée sans fard. Il se consacre ensuite à la peinture de la vie rurale,
à l’expression de la saveur de la vie. Son roman "Raboliot » a été
couronné par le prix Goncourt en 1925.
Attaché à retranscrire
avec fidélité ce que ses
camarades et lui vivent,
Genevoix tient des
carnets de guerre à
partir desquels il
rédigera Ceux de 14.
Le 17 février 1915, le régiment du lieutenant Genevoix monte à l’assaut de la crête des Eparges. Au quatrième
jour d’un combat acharné, Genevoix occupe toujours sa position malgré les assauts allemands et un
bombardement effroyable. Sa section a été décimée. L’horreur atteint son comble quand un obus tue ou blesse
onze des vingt survivants. A la nuit tombée, alors qu’il lui est impossible de quitter sa tranchée, il entend ses
hommes l’appeler.

20
25
30
35
40
un mot, et puis un autre mot ; entre chaque mot, son souffle fait grelotter ses lèvres d'une
même chanson traînante et lugubre. Il ne parle plus ; il demeure sans mouvement, aspire
l'air qui siffle dans sa gorge, et le renvoie par saccades chantantes, sur la même note
depuis des heures.
Les voix gémissent toujours ; les cris montent et tremblent dans la nuit, tous les cris
autrefois entendus :
« Brancardiers ! Les brancardiers !
- Pousse-toi !... Pousse-toi ! Oh ! Il me tue... Mais poussez-le à la fin, qui m'écrase ! »
Carrichon s'agite sur place ; sa voix murmure caverneuse :
« Ce qu'on peut s'emmerder, quand même !
- ou-ou-ou-ou-ou... » chantonne toujours Sénéchal.
Il fait très froid, une froidure d'après la pluie terrible aux pauvres chaires lacérées. Ils
crient, maintenant ; ils clament la souffrance de leur corps :
« Mon pied coupé !
- Mon genou !
- Mon épaule !
- Mon ventre ! »
Il y en a un autre qui gémit doucement :
« Oh ! Partout... Regardez... j'en ai compté dix-sept déjà... Plus de pouce... quatre ou
cinq dans la cuisse... et ma joue... Retournez-moi, vous verrez... j'en ai partout... ».
Sous la loque noire qui me couvre, une odeur de caoutchouc rance me colle au visage
comme un tampon. Mes mains brûlées me cuisent et leur peau gonflée se détache ; la
fièvre bat mon front à grands chocs martelés ; mes pieds gèlent … je ne sens rien, tant les
voix crient autour de moi, tant l'entonnoir empli de nuit blafarde vacille et hurle de
souffrance.
« Lieutenant Genevoix !... Mon lieutenant ! »
Ils m'appellent à présent. Qu'est-ce que je peux ? Descendre, monter, m'accroupir
près d'eux ou m'asseoir, et toute la nuit dire des mots inutiles, puisqu'il fait froid, puisqu'ils
sont seuls, puisque les brancardiers ne viendront pas.
« Mon lieutenant, vous me couperez bien la jambe, vous ? »
Maurice Genevoix, Ceux de Quatorze, 1916-1923
Enrichir son vocabulaire
■ Par son origine grecque, pathétique, tiré de pathos (« ce qu’on éprouve »), signifie « qui
suscite la douleur ou la pitié ». Le compositeur Beethoven a écrit une « Sonate pathétique ».
Employez cet adjectif dans une phrase en liaison avec le texte de Genevoix où
vous ferez clairement apparaître son sens.
Cherchez dans le dictionnaire trois mots dérivés de la racine grecque pathos.
■ Quels sont le sens et la formation (préfixe, radical, suffixe) du mot indicible ?
Questionnaire
1. Ce texte est-il autobiographique ?
2. Définissez les conditions dans lesquelles vit le narrateur.
3. Relevez les différentes sensations perçues par le narrateur (visuelles, auditives
tactiles…). Laquelle domine le récit ?
4. « Des voix gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. »
(l. 4-5) : comment se nomme la figure de style employée dans cette phrase ? Quel
effet ce procédé vise-t-il à produire ?
5. Dans le deuxième paragraphe, observez le vocabulaire, la construction des phrases,
la ponctuation. Comment Genevoix fait-il comprendre le désordre, le chaos qui
règnent dans les premières lignes françaises ?
Pourquoi l’auteur rapporte-t-il les paroles au discours direct ? Pourquoi, selon vous,
les « voix » ont-elles autant d’importance dans cet extrait ? Qu’expriment-elles ?
6. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il à la fin de l’extrait ?
7. Pourquoi peut-on dire que ce témoignage rend hommage à « Ceux de Quatorze » ?

Document complémentaire
http://centenaire.org/fr/meuse/interview/les-eparges-travers-loeuvre-de-maurice-genevoix-et-
le-memorial-de-verdun
« J'ai quelques instants pour vous parler un peu des heures que nous venons de vivre. Je
me borne à un récit très bref, qui vous donne une idée sommaire de ce que nous avons fait.
Le 17, à 2 heures, les mines creusées par le génie sautaient. Puis c'était un bombardement
d'une heure, bombardement effroyable qui faisait trembler le sol, emplissait les crânes de
tumulte et donnait une étrange impression de surnaturel et de prodigieux. Puis l'assaut. Nous
avons pris la côte des Eparges, presque sans coup férir. Mais nous marchions sur une terre
bouleversée, calcinée, puante semée de débris de fils de fer, de piquets, de vêtements
hachés et sanglants, de paquets de chair humaine. A cinq heures le bombardement
allemand commençait. Jusqu'à minuit, les gros calibres : 150, 210, et 305. Pendant le même
temps, des mitrailleuses qui tiraient de flancs combinaient leurs effets avec ceux de
l'artillerie. De minuit à 6 heures, bombardement moins intense. Mais, dès 6 heures, la danse
a recommencé, épileptique jusqu'à 9 heures ; et à 9 heures, l'infanterie allemande attaquait.
Nous avons reçu des grenades, des bombes, un tas d'engins infernaux qui affolent nos
hommes. Je me suis lancé en avant, le revolver à la main. J'en ai tué 3 à bout portant. Deux
caporaux m'avaient suivi : ils ont été tués tous les deux. Nous avons perdu les tranchées
conquises. Mais le soir, à 4 heures, nous y retournions et les occupions de nouveau. Nous y
restions malgré les contre-attaques. Nous y restions malgré le bombardement incessant et
formidable. Le plus affreux fut le quatrième jour au soir. Il restait à ma section 20 hommes : 3
dans un petit élément de tranchée, en liaison avec une autre compagnie, 17 avec moi dans
la grande tranchée. Un 305 est tombé dedans devant moi. Mes deux voisins ont été tués net
; celui de droite est resté dans l'attitude qu'il avait au moment où l'obus est arrivé ; il avait à la
main, encore, le morceau de pain qu'il était en train de manger. Deux autres sont morts une
heure après. Sept autres qu'on avait pu emmener, sont restés jusqu'au lendemain matin
dans un entonnoir de mine, m'appelant, moi, me demandant à boire, me réclamant mon
revolver, si je ne voulais pas les achever moi-même, me décrivant leurs blessures, me
demandant d'écrire à leur femme, à leur mère, de leur couper le bras, tout de suite, si je ne
voulais pas qu'ils meurent. J'ai passé une nuit de cauchemar. Porchon avait été tué le matin.
Je restais avec trois hommes, ceux qui étaient séparés de moi. Les 17 autres étaient morts
ou blessés. Moi j'avais la tête douloureuse, la poitrine serrée, le front ensanglanté par un
éclat. Je me suis évanoui dans les bras du commandant. Quand je suis revenu à moi mon
capitaine était parti, le tympan crevé, toute son énergie à bout. J'ai pris le commandement de
la compagnie. Je ne sais pas ce qu'on va faire de nous maintenant. Porchon est mort : il
avait été blessé légèrement ; il allait se faire panser ; un éclat d'obus lui a ouvert la poitrine
au moment même où il arrivait aux abris. Cette guerre est ignoble ; j'ai été pendant 4 jours
souillé de terre, de sang, de cervelle. J'ai reçu au travers de la figure des paquets d'entrailles,
et sur une main une langue, à quoi l'arrière-gorge était attachée. Je suis écœuré, saoul
d'horreur. Je sais que je resterai ; il faut que je reste. J'accepte la responsabilité qui m'échoit.
Je ne sens pas ma force entamée… »
D'après une lettre de Maurice Genevoix à Paul Dupuy, 23 février 1915.
http://crid1418.org/espace_pedagogique/documents/eparges.htm

Synthèse : Comment Genevoix, dans cet extrait, témoigne-t-il de l’horreur de la guerre ?
Critères de correction
notes
Reprise des termes de la consigne. Exemple : « Maurice Genevoix
témoigne de l’horreur de la guerre en » (+ verbe au gérondif)
/1
L’analyse est précise et pertinente. Elle montre les conséquences
physiques et morales de la guerre en mettant en exergue les procédés
utilisés par l’auteur : anaphore, utilisation du discours direct,
accumulation, allitérations, référence aux sens, etc.
/5
L’analyse s’appuie sur des citations précises et pertinentes.
1
Orthographe
/2
Correction de l’expression
/1
Synthèse : Comment Genevoix, dans cet extrait, témoigne-t-il de l’horreur de la guerre ?
Critères de correction
notes
Reprise des termes de la consigne. Exemple : « Maurice Genevoix
témoigne de l’horreur de la guerre en » (+ verbe au gérondif)
/1
L’analyse est précise et pertinente. Elle montre les conséquences
physiques et morales de la guerre en mettant en exergue les procédés
utilisés par l’auteur : anaphore, utilisation du discours direct,
accumulation, allitérations, référence aux sens, etc.
/5
L’analyse s’appuie sur des citations précises et pertinentes.
1
Orthographe
/2
Correction de l’expression
/1
Synthèse : Comment Genevoix, dans cet extrait, témoigne-t-il de l’horreur de la guerre ?
Critères de correction
notes
Reprise des termes de la consigne. Exemple : « Maurice Genevoix
témoigne de l’horreur de la guerre en » (+ verbe au gérondif)
/1
L’analyse est précise et pertinente. Elle montre les conséquences
physiques et morales de la guerre en mettant en exergue les procédés
utilisés par l’auteur : anaphore, utilisation du discours direct,
accumulation, allitérations, référence aux sens, etc.
/5
L’analyse s’appuie sur des citations précises et pertinentes.
1
Orthographe
/2
Correction de l’expression
/1
1
/
4
100%