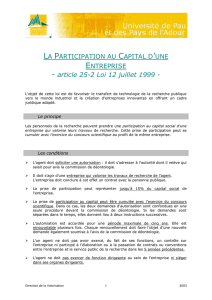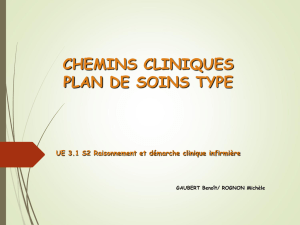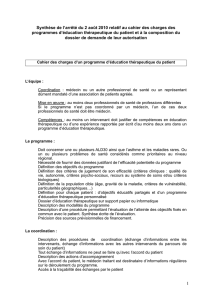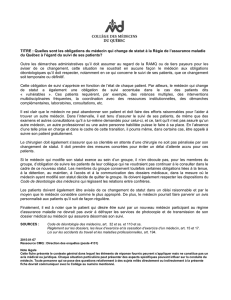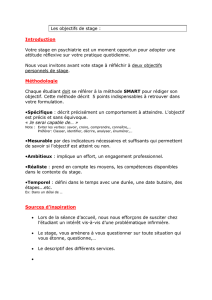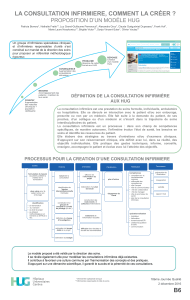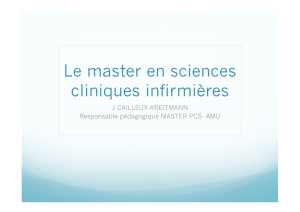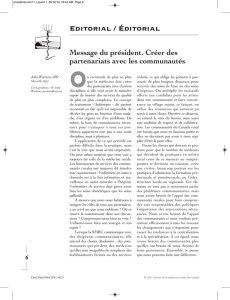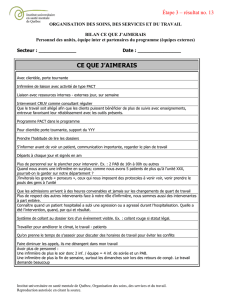Principes universels de déontologie infirmière

Droit, déontologie et soin
Mars 2005, vol. 5, n° 1
4
C
AHIER
SPÉCIAL
:
DÉONTOLOGIE
INFIRMIÈRE
Principes universels
de déontologie infirmière
De la Déclaration universelle des droits de l’Homme au code
déontologique du Conseil international des infirmières
Gilles D
EVERS
Avocat au Barreau de Lyon.
Le soin prend toute sa dimension avec le respect du droit ; le droit se nour-
rit des valeurs du soin. Droit et soin sont étroitement liés, car tous deux placent
au cœur de leurs préoccupations l’être humain, pris dans sa fragilité, à travers
les notions d’égalité, de liberté et de dignité. La rencontre entre le soin et le
droit, naturelle, s’exprime à travers la déontologie infirmière, qui est un univer-
salisme, d’où l’intérêt d’un rapprochement entre deux textes de portée univer-
selle : la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le code déontologique
du Conseil international des infirmières.
La déontologie, science des devoirs, doit s’imposer dans les consciences
comme le langage commun qui permet d’articuler les différences et nourrir le
progrès.
Avant propos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5-9
Première partie : Les piliers du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 10-27
La loi. La solidarité. La compétence. Le devoir. La responsabilité.
Deuxième partie : L’approche déontologique de l’être humain
. . p. 28-44
La vie. Le corps. Avant la naissance. L’enfance. La vieillesse et la mort.
Troisième partie : Les valeurs de la déontologie infirmière
. . . . . p. 45-62
La liberté. La dignité. L’intimité. Le consentement. Le secret.
Le code déontologique du Conseil international des infirmières est repro-
duit en annexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 63-64

Mars 2005, vol. 5, n° 1
Droit, déontologie et soin
5
Avant propos
Créé en 1899, le Conseil international des infirmières s’est imposé, par la
constance de son action, comme le défenseur universel des soins infirmiers, en
conciliant recherche de la qualité et innovation. Progressivement, s’est dégagé
un modèle commun de compétences, capable de répondre au défi du marché
global et de la circulation des infirmières à travers le monde.
L’infirmière et le soin infirmier
En 1987, le Conseil international des infirmières a adopté deux défini-
tions – l’infirmière et le soin infirmier – qui désormais structurent la matière
sur le plan mondial.
La clé universelle est un diplôme qui autorise l’exercice.
« L’infirmière est
une personne qui a suivi un programme d’enseignement de base, et qui est habi-
litée par l’autorité de réglementation à exercer dans son pays la profession
infirmière. L’enseignement infirmier de base est un programme d’études officiel-
lement reconnu qui donne les connaissances étendues et solides nécessaires pour
permettre l’exercice général des soins infirmiers, assumer un rôle de direction,
et suivre un enseignement supérieur conduisant à une spécialisation ou la pra-
tique des soins infirmiers approfondis. »
Ceci posé, vient la portée de l’autori-
sation que donne le diplôme :
« L’infirmière est préparée et autorisée : (1) à
s’engager dans le cadre général de l’exercice de la profession infirmière qui inclut
la promotion de la santé, la prévention de la maladie, les soins aux personnes
physiquement ou mentalement malades et handicapées de tous âges, et ce, dans
tous les établissements communautaires et de soins de santé ; (2) à mener à bien
l’enseignement des soins de santé ; (3) à participer pleinement à l’équipe de
santé ; (4) à superviser et former les aides-soignantes et auxiliaires de santé ; (5)
à s’engager dans la recherche. »
Le Conseil international des infirmières a également adopté une définition
des soins infirmiers :
« Ce sont des soins prodigués, de manière autonome ou en
collaboration, aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux
communautés – malades ou bien-portants quel que soit le cadre. Les soins infir-
miers englobent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi que
les soins dispensés aux personnes malades, handicapées et mourantes. Parmi les
Gilles D
EVERS

C
AHIER
SPÉCIAL
:
DÉONTOLOGIE
INFIRMIÈRE
Droit, déontologie et soin
Mars 2005, vol. 5, n° 1
6
rôles essentiels relevant du personnel infirmier, figure la défense et la promotion
d’un environnement sain, la recherche, la participation à l’élaboration de la poli-
tique de santé et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que l’édu-
cation. ».
Les infirmières doivent évaluer les réponses en fonction des besoins de
santé, pour aider les patients dans le maintien ou le rétablissement de leur santé,
pour accompagner les mourants dans la dignité, et pour les aider, chaque fois
qu’il est possible, à reconquérir tout ou partie de leur indépendance, le plus
rapidement possible
1
.
L’affirmation d’une déontologie infirmière
Le droit s’inscrit dans une démarche fondamentale : il identifie les valeurs
sociales et en organise la protection par un ensemble de règles. Forgé au fil du
temps, le droit offre un fécond corpus de références humaines et sociales.
Chaque pays, chaque culture, chaque époque façonne à sa manière les grands
modèles juridiques : dignité, intimité, confiance, consentement secret… Le droit,
à l’issue d’une construction réfléchie, affirme sa pensée, et cherche à créer l’har-
monie dans la diversité. Sa richesse fournit les éléments du doute, de ce doute
méthodique qui confère qualité aux décisions prises.
S’agissant du soin, le droit dépasse la technicité pour apporter des éléments
de réponses aux questions les plus essentielles. Qu’entendre par le respect de
l’être humain ? Quel contenu à la dignité ? Qu’est-ce que la vie ? Quelle garantie
pour les personnes âgées, privées de ressources ? Quelle protection pour celui
qui, atteint par la souffrance psychique, ne peut assumer sa liberté ? Quelle pro-
tection pour les derniers jours ? Aussi, le droit ne peut rester la très utile tech-
nique commune qu’il est. Il doit avancer vers la réflexion morale, et inclure le
sens du devoir. C’est là qu’intervient la déontologie, indispensable complément
du droit. Pour les infirmières, c’est la contrepartie d’une véritable reconnaissance
fonctionnelle, et un nouveau domaine d’expertise.
Dans tous les pays du monde, l’infirmière est aux avant-postes dans la
pratique des soins, et très souvent, du fait des réalités économiques et sociales,
elle est le principal professionnel rencontré par le malade dans l’accès aux soins.
Au cœur de la technique, c’est elle qui préserve la part d’intimité du malade,
qui sait parler de la souffrance, qui est garante de la protection de la pudeur.
Actrice de la vie sociale, elle rayonne dans la prévention et l’éducation à la santé,
construisant pas à pas un véritable droit à la santé. Experte dans la relation à
autrui, elle sait entendre le non-dit, et confrontée aux situations humaines les
plus préoccupantes, elle garde le cap de la dignité, alliant compassion et tech-
nique, au service de la meilleure thérapie.
Qui sont les véritables garants du droit ? Les juristes jouent le premier rôle,
élaborant une réflexion fondamentale et ajustant les procédés de contrôle. Mais
1. En ce sens, V. H
ENDERSON
,
Basic principles of nursing care
, Conseil international des infirmières, Genève, 1977.

Gilles D
EVERS
Mars 2005, vol. 5, n° 1
Droit, déontologie et soin
7
au quotidien, les soignants sont les garants de l’application du droit, par leur
capacité à intégrer les principes du droit dans la pratique du soin. Sans doute,
décident-ils d’abord en fonction des données scientifiques et techniques, et de
leurs convictions personnelles, morales, philosophiques ou religieuses. Mais ils
ont aussi la plus grande attention pour respecter le droit, alors même qu’ils ne
l’ont pas étudié, ou si peu. C’est une remarquable réussite : le droit intègre la
vie sociale et structure les comportements individuels en pénétrant les conscien-
ces, sans l’intervention des juristes. C’est toute la force de la déontologie : allier
professionnalisme et citoyenneté.
Le droit, œuvre de civilisation
Pourquoi le droit, ses normes, ses sanctions et sa complexité ? Parce que
l’existence humaine est fragile. L’intervention du droit est légitime si elle
conforte le destin humain, dans une double démarche de libération et de pro-
tection. Sans doute, le droit résulte-t-il de mécanismes stricts qui s’affirment dans
une logique de sanction. Ceci est vrai, mais l’essentiel est ailleurs : l’objet du
droit n’est pas la sanction des comportements, mais l’intériorisation de la règle,
cette règle qui permet de vivre ensemble.
À la formule « raide comme la justice », il faut ajouter « doux comme le
droit ». La civilisation du rapport humain va de pair avec l’affirmation du
droit, lequel cherche à concilier le libre arbitre et les valeurs collectives. Les
règles et formalités du droit défendent les valeurs autour desquelles s’organise
la vie en société, et la première d’entre elles est la considération pour l’être
humain. Lorsque les relations sociales sont suffisamment respectueuses du
droit des plus faibles, le droit doit s’abstenir, car il n’a pas à se mêler de tout.
Quand sa fonction émancipatrice et protectrice est attendue, il doit s’affirmer,
et sans faiblesse.
Le droit est sans doute une science complexe, faite de principes et de
règles, mêlant lois et jurisprudence, difficilement accessible aux non-initiés,
et il doit sans relâche se perfectionner, pour mieux répondre aux attentes de
la société. Mais avant d’être une technique, le droit est une œuvre de civili-
sation, un fonds culturel. Aussi, s’agissant de la protection de la santé, il faut
affirmer sans réserve que le droit est co-substantiel au soin. Loin d’être un
obstacle, il en est le premier allié. Sans le droit, le soin serait embryonnaire.
Dès qu’il dépasse la dimension interpersonnelle, de type compassionnel, le
soin suppose des appuis collectifs, notamment en termes d’organisation et de
financement. La solidarité est un idéal, qui pour prendre forme, suppose le
recours aux procédés du droit. S’agissant de la pratique des soins, rien n’est
envisageable sans le sens du devoir, mais le droit est irremplaçable quand il
faut organiser les systèmes, définir les compétences, et mettre en œuvre les
responsabilités.

C
AHIER
SPÉCIAL
:
DÉONTOLOGIE
INFIRMIÈRE
Droit, déontologie et soin
Mars 2005, vol. 5, n° 1
8
Deux références universelles
Dans la recherche de références universelles, s’imposent deux textes : la
Déclaration universelle des droits de l’Homme
2
et le Code déontologique du
Conseil international des infirmières
3
. L’humanisme qui se dégage de ces textes
témoigne d’une conscience commune, capable d’éclairer la pratique des soins
sur l’ensemble de la planète. Bien sûr, il n’est pas besoin d’insister sur la marge
qui existe entre la proclamation d’un droit et l’effectivité de son application,
surtout lorsqu’il s’agit de droits fondamentaux. Mais ces textes constituent une
remarquable référence pour chaque infirmière, dans ses décisions et ses actes.
La portée de ces deux textes apparaît dès leurs préambules. Chaque mot compte.
• Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
« L’assemblée générale de l’ONU proclame la présente Déclaration comme
l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent par l’enseignement et l’éducation, de déve-
lopper le respect de ces droits et libertés, et d’en assurer, par des mesures pro-
gressives d’ordre national ou international, la reconnaissance universelle et
effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction ».
• Code déontologique du Conseil international des infirmières
« Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la
santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les
besoins en soins infirmiers sont universels.
« Le respect des droits de l’homme, et notamment du droit à la vie, à la
dignité et à un traitement humain fait partie intégrante des soins infirmiers. Ces
derniers ne sont influencés par aucune considération d’âge, de couleur, de
croyance, de culture, d’invalidité ou de maladie, de sexe, de nationalité, de poli-
tique, de race ou de statut social ».
La référence aux droits de l’Homme, dès le préambule du code Déontolo-
gique, légitime le rapprochement avec la Déclaration universelle. Les droits de
l’Homme, tels que définis par la Déclaration universelle, sont la matrice de la
déontologie infirmière. Le code déontologique marque sa sagesse en se présen-
tant comme une continuité des droits fondamentaux. Aussi, comprendre la
déontologie, science des devoirs, suppose de savoir se situer parmi les principes
2. Adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948, ci-après dénommée « la Déclaration
universelle ».
3. Adopté en 2003, au sein du CII, qui regroupe les associations infirmières de 130 pays, texte ci-après
dénommé « le Code Déontologique », reproduit en annexe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
1
/
61
100%