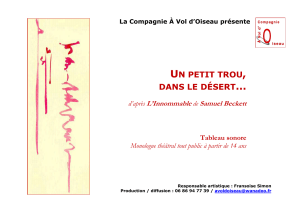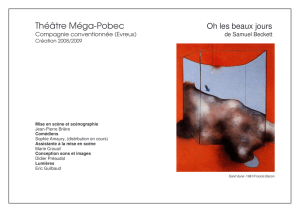Oh les beaux jours

Dossier de presse
Comédie de Genève
www.comedie.ch
Christine Ferrier
+4122 809 60 83
Ana Regueiro
+4122 809 60 73
aregueir[email protected]
mardi, vendredi 20h,
mercredi, jeudi,
samedi 19h,
dimanche 17h.
Lundis et dimanche 9 mars
relâche.
du 04 au 22 mars 2014
Oh les beaux jours
de Samuel Beckett
mise en scène Anne Bisang
avec Christiane Cohendy

2
25 mars - 06 avril 2014
Cabaret
de Hanokh Levin
mise en scène Nalini Menamkat
avec Ahmed Belbachir, Camille Figuereo, Michel Kullmann, Brigitte Rosset.
plein tarif CHF 30.-
tarif réduit CHF 23.-
tarif abonnés CHF 18.-
08-11 avril 2014
Yvonne, princesse de Bourgogne
de Witold Gombrowicz
mise en scène Geneviève Guhl
avec Elidan Arzoni, Julia Batinova, Greta Gratos, Geneviève Guhl, Ilil Land-Boss, José Lillo,
Frédéric Lugon, Olivia Seigne, Joël Hefti.
plein tarif CHF 40.-
tarif réduit CHF 30.-
tarif étudiant CHF 20.-
Mars-avril à la Comédie

3
Avec :
Christiane Cohendy
Vincent Aubert
dramaturgie : Stéphanie Janin
scénographie et costumes : Anna Popek
lumières : Colin Legras
son : Andres Garcia
maquillage et coiffure : Arnaud Buchs
production : Comédie de Genève
avec le soutien de la Fondation Leenaards
et le concours d’Arc en Scènes,
Centre neuchâtelois des arts vivants - TPR
Oh les beaux jours
© 1963 Les Éditions de Minuit
Oh les beaux jours
de Samuel Beckett
mise en scène Anne Bisang

4
Une femme, Winnie, « la cinquantaine, de beaux restes », recouverte jusqu’à la taille d’un monti-
cule de terre, qui, au cours de la pièce, l’absorbera jusqu’au cou. À l’arrière-plan, Willie, son mari,
le plus souvent caché aux yeux du public... C’est Winnie qui parle. Elle évoque le passé, manipule
des objets, lutte contre le temps. Des mots qui font entendre l’increvable désir d’exister. La soli-
tude, la difficulté d’être, d’être deux face au vieillissement et à la mort. L’instinct de vivre, dans sa
force et sa splendeur.
Oh les beaux jours
La pièce

5
Au fil des créations
Happy Days est créée à New York en 1961 par Alan Schneider1, et codirigée l’année suivante par
George Devine et Tony Richardson au Court Theater à Londres. En 1963, Roger Blin y met en
scène Madeleine Renaud à l’Odéon, sous le titre Oh les beaux jours – que Beckett emprunte au
Colloque sentimental de Verlaine. Dès lors le texte ne cesse d’être joué, traversant les décennies
et les frontières. En 1996, Michael Colgan décide de graver dans la pellicule dix-neuf œuvres de
l’auteur irlandais, et c’est à la réalisatrice canadienne Patricia Rozema qu’il confie la réalisation
de ce texte avec Rosaleen Linehan (Winnie), dans Beckett on Film. Les innombrables indications
scéniques du dramaturge qui jugulent tout élan d’adaptation personnelle ne découragent pas de
grands metteurs en scène tels que Peter Brook, Deborah Warner ou Bob Wilson, ni même le pari
d’une distribution « cross-gender » en 2012 de Blandine Savetier avec Yann Collette dans le rôle
de Winnie. [...]
Un couple dissymétrique
Chez Beckett, le propos se définit par son absence plus que par sa présence, à la façon d’un trou
noir existant par la masse vertigineuse du vide qu’il provoque. Dire de Oh les beaux jours que
le texte parle du couple peut sembler paradoxal, et pourtant c’est bien un couple que l’auteur
met en scène : un couple dissymétrique, à une voix, celle de Winnie essentiellement, qui révèle
l’isolement, la solitude, le besoin d’exister aux yeux de l’autre, et la difficulté « d’être deux » face
au vieillissement et à la mort. Ce flot de souvenirs heureux et de reproches de Winnie à Willie, de
questions rhétoriques sur le sens des choses adressées à un partenaire dont on ignore s’il les
entend ou les comprend est un monologue sans fin.
Cette voix inextinguible retrace ainsi l’épopée des stratégies de survie dans cette solitude du
couple, tels que les rituels pour donner sens à cette relation qui s’étiole au fil des heures. On
pourrait croire qu’on assiste à la descente aux enfers d’un Adam et d’une Ève de fin du monde, ou
comme dit Winnie, des « derniers humains à s’être fourvoyés ici ». Cependant, ce texte, rythmé de
peurs, de joies, de déceptions, de rires et de reconnaissance célèbre l’instinct de vie dans toute la
force irrationnelle de son optimisme et la splendeur de sa fragilité : « malgré tout, jusqu’ici. »
Une partition tyrannique
Ses didascalies tyranniques rythment les corps, les paroles et les gestes à la façon d’un chef
d’orchestre ou d’un chorégraphe. On peut se demander alors où est la place pour l’individualité du
metteur en scène dans la partition. Et pourtant, même si ces derniers doivent renoncer à apposer
explicitement leur griffe personnelle, chaque production témoigne d’une rencontre particulière
entre un metteur ou une metteuse en scène et une actrice, puis entre le texte, l’actrice, et son jeu :
Brook et Parry, Warner et Shaw, Wilson et Asti. On aurait tort de prendre Beckett pour un intellec-
tuel. Sa matière, atrocement humaine, passée au crible d’un maniaque du contrôle, n’a cependant
rien de conceptuel.
Évoquant la difficulté du processus de répétition, Fiona Shaw répondait au New York Times
qu’après avoir « mélangé du béton » pendant plusieurs semaines, la solution vint du réalisateur,
Roger Michel, assistant de Beckett sur la production au Royal Court en 1979. Il leur rappela com-
bien la partition de Oh les beaux jours était autobiographique : « C’est en fait une œuvre remplie
d’émotion. Une fois que nous avons compris cela tout a changé. »
1 Alan Schneider réalisera trois ans plus tard le scénario de Beckett Film, avec Buster Keaton.
Oh les beaux jours
Note de travail par Stéphanie Janin, dramaturge
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%
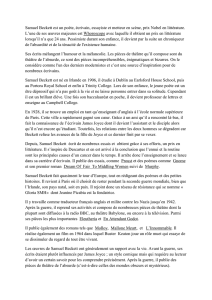
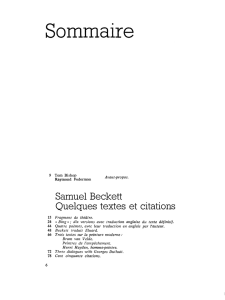
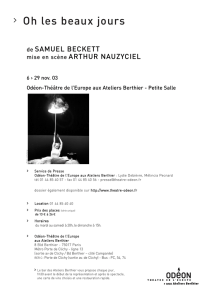
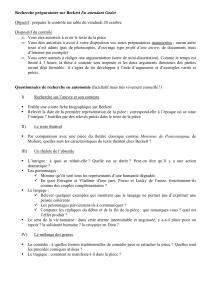
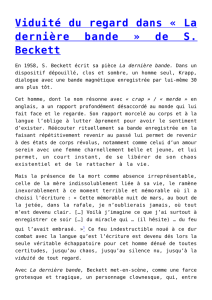
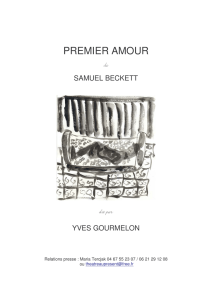

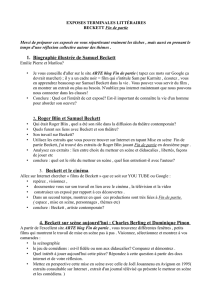
![[de théâtre] sont-ils [nécessairement] des corsaires](http://s1.studylibfr.com/store/data/004068383_1-6811f6f320fa32dbc5abe94406f33351-300x300.png)