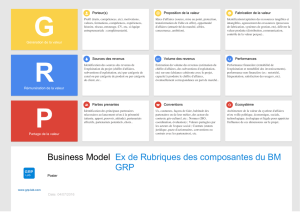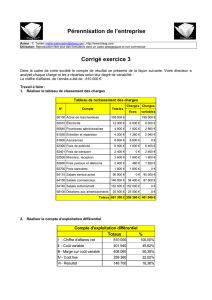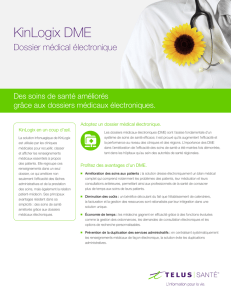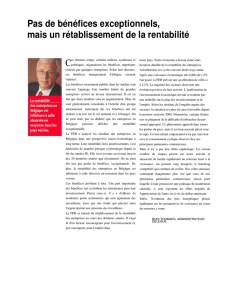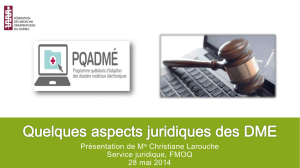Les sociétés immobilières de l`outre-mer - Quelles

d m e
d m e
ddidacticiels et modélisation économiques
Les sociétés immobilières de l’outre-mer
Quelles contributions au développement des économies ultramarines ?
Volume 1
Cahier de synthèse
Juillet 2013

d m e
d m e
ddidacticiels et modélisation économiques
Evaluation de l’impact économique des SIDOM
1
L’Agence française de développement (le département Outre-mer et la division
collectivités locales et développement urbain) a confié au cabinet DME la
mission de procéder à une évaluation de l’impact économique des sept sociétés
immobilières d’outre-mer, les SIDOM, qui rassemblent : la SIG en Guadeloupe,
la SIGUY et la SIMKO en Guyane, la SIMAR en Martinique, la SIDR à La Réunion,
la SIM à Mayotte et la SIC en Nouvelle-Calédonie.
L’objectif principal de cette étude est de mesurer l’impact économique de
l’activité des opérateurs de logements sociaux. Les termes de référence
détaillés de la consultation figurent dans le cahier méthodologique.
Ce rapport fait suite à une étude de faisabilité commandée par l’AFD à DME qui
avait pour objectif de définir une méthodologie permettant d’évaluer l’impact
macro-économique et social des SIDOM en s’appuyant sur le cas particulier de
la SIC (Nouvelle-Calédonie). Cette étude a fait l’objet d’un rapport en janvier
2012. La présente étude s’appuie sur cette méthodologie, rappelée dans le
cahier réservé à cet effet.
Le rapport d’étude est constitué de trois cahiers :
- Un cahier de synthèse (ce document). Volontairement court et
synthétique, ce rapport est destiné à un large public ;
- Un cahier méthodologique : plus technique, ce document décrit en détail
les méthodes et modèles utilisés pour parvenir aux résultats figurant dans le
cahier de synthèse. Il contient également une revue des études d’impact
économique des opérateurs métropolitains ;
- Un cahier des résultats (confidentiel) : celui-ci rassemble l’ensemble des
données chiffrées de l’étude.
Avant-propos
Cette étude a été réalisée sous la direction d’Olivier Sudrie et avec la participation d’Audrey Aknin.
Les consultants remercient vivement l’ensemble des personnalités qu’ils ont pu rencontrer dans le cadre
de cette mission et qui leur ont consacré un temps précieux. Ces remerciements s’adressent plus
particulièrement encore aux Directeurs des SIDOM pour les données qu’ils nous ont transmises, et
singulièrement à Alain Mounouchy (SIMAR) et Thierry Cornaille (SIC) pour l’accueil qu’ils ont réservé lors
de nos déplacements en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Cette étude n’aurait pu être menée à bien
sans l’appui statistique de l’INSEE.
Les propos et commentaires contenus dans ce rapport n’engagent que leurs auteurs et ne constituent pas
une position officielle de l’Agence Française de Développement.
AFD
Agence Française de Développement
BTP
Bâtiment et travaux publics
CA
Chiffre d’affaires
DCOM
Départements et communautés d’outre-mer (dont Nouvelle-Calédonie)
DME
Didacticiels & Modélisation Économiques
LBU
Ligne budgétaire unique
LODEOM
Loi pour le développement économique des Outre-mer
M€
Millions d’euros
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
VA
Valeur ajoutée
SEM
Société d’économie mixte
Sigles & acronymes

d m e
d m e
ddidacticiels et modélisation économiques
Evaluation de l’impact économique des SIDOM
2
Un poids économique bien supérieur à celui de leur propre activité
Une démarche en trois temps
La problématique du logement social, et en particulier dans les départements et
collectivités d’outre-mer (DCOM,) ne laisse que rarement indifférent, tant ses enjeux
politiques, sociaux, économiques et financiers sont importants1. Et les sociétés
immobilières d’Outre-mer (SIDOM) se trouvent placées, parfois malgré elles, au centre
de ces débats. Mais, faute de disposer des outils méthodologiques nécessaires,
l’appréciation portée sur les SIDOM peut être tronquée, sinon biaisée :
• - D’un côté, l’analyse financière permet de repérer très précisément les
coûts du logement social ainsi que leurs modalités de financement, au travers
notamment des différentes contributions publiques dont bénéficient ces SEM ;
• - Mais, de l’autre côté, les avantages économiques et sociaux pour la
collectivité publique, induits par l’activité des SIDOM, ne font pas l’objet d’une
évaluation économique rigoureuse qui pourrait être mise en regard de l’analyse
financière portant sur les coûts. La plupart du temps, les performances économiques
et sociales sont estimées au travers d’indicateurs physiques concernant le volume des
investissements réalisés (offre de logement exprimée en m²) et le nombre de
bénéficiaires (faisant apparaître le gap avec la demande insatisfaite).
L’objectif de la présente étude est d’évaluer l’impact économique et social des SIDOM
en distinguant :
Les effets d’induction macro-économiques (notamment sur la valeur ajoutée et
l’emploi local) de leurs programmes d’investissement et de leur fonctionnement.
Ces impacts sont appréciés au moyen de modèles macro tels que ceux utilisés
dans la méthode des effets ;
Les effets externes des SIDOM, qui sont appréciés au travers, notamment, de leur
contribution au bien-être collectif, de leur participation à la réduction des
inégalités monétaires ou encore du « bénéfice social » qu’elles génèrent pour la
collectivité.
1 IEOM-IEDOM, L’habitat dans les outre-mer français : progrès, enjeux et disparités, Les notes de l’Institut
d’émission, Paris, février 2010.
Problématique et objectif
Ce rapport apporte des éléments de réponse à trois questions principales :
Quel est le poids économique des SIDOM ?
Ces SEM emploient du personnel et créent de la valeur ajoutée (VA). Mais elles ont
aussi des effets d’induction dans toute l’économie. Quel est le montant total de cette
VA induite ? Combien d’emplois sont concernés ?
Quelle est la rentabilité économique des SIDOM ?
Comment apprécier la richesse créée (VA) au regard des investissements réalisés ?
Est-ce que la Collectivité, entendue ici au sens macro-économique comme l’ensemble
des agents économiques2, trouve avantage aux investissements réalisés par les
SIDOM ? (relativement à d’autres usages qu’elle aurait pu faire des fonds)
Les SIDOM bénéficient de subventions d’investissement prodiguées par les
collectivités publiques (État, régions, provinces…). Mais, quel est le coût net de ces
subventions sachant que ces SEM induisent aussi des recettes fiscales ? Ces
subventions sont-elles économiquement « rentables » ?
Quelle est la rentabilité sociale des SIDOM ?
Les SIDOM font profiter à leurs locataires, sous forme de loyers modérés, des aides
publiques qu’elles perçoivent. Ce transfert est-il socialement efficace ? Participe-t-il à
l’amélioration du « bien-être » social ?
Les Outre-mer sont caractérisés par de fortes inégalités de revenu. Les SIDOM
participent à la réduction de ces inégalités en permettant à leurs locataires de se
loger à des prix inférieurs au marché. Quelle est l’importance de ce rééquilibrage ?
2. le terme « agents économiques » désigne l’ensemble des ménages, des entreprises et des collectivités
publiques
Les trois temps de la démarche

d m e
d m e
ddidacticiels et modélisation économiques
Evaluation de l’impact économique des SIDOM
3
Les réponses synthétiques aux trois questions principales :
- Quel est le poids économiques des SIDOM ?
- Quelle est la rentabilité économique des SIDOM ?
- Quelle est la rentabilité sociale des SIDOM ?
Synthèse
Evaluation économique
Evaluation sociale

d m e
d m e
ddidacticiels et modélisation économiques
Evaluation de l’impact économique des SIDOM
4
Quel est le poids économique des SIDOM ?
Comment évaluer le poids économiques des SIDOM ?
Les SIDOM exercent des effets d’entraînement sur la valeur
ajoutée et l’emploi dans les géographies où elles opèrent. Ces
effets passent par trois canaux :
1) Ils passent en premier lieu par le canal de leurs
investissements dans la construction de logements, la
réhabilitation lourde, l’aménagement. Ces investissements
constituent une demande à laquelle répond l’appareil de
production local : le secteur du BTP bien sûr, mais aussi tous les
fournisseurs impliqués directement et indirectement ;
2) Les effets d’entraînement passent, ensuite, par le canal de
leur activité de gestion. Ces sociétés immobilières entraînent
l’activité par leurs besoins en fournitures courantes et autres
services extérieurs ;
3) Enfin, les effets d’induction des SIDOM passent par le canal
de la consommation des ménages. Les VA induites gonflent la
masse salariale et le revenu des entrepreneurs individuels
(notamment celui des artisans). Ces revenus seront
partiellement consommés. L’appareil de production répondra à
la demande de consommation des ménages en créant de
nouveaux flux de valeur ajoutée. C’est ce que l’on appelle
l’effet multiplicateur.
Investissements
440 M
€
(4%
*
)
Fonctionnement
CA =
360 M
€
Emplois
**
13 800
VA
980 M
€
VA induite =
480 M
€
VA induite =
260 M
€
VA SIDOM=
240 M
€
2,5%
*
2,2%
*
Emplois SIDOM=
1 050
(*) en % de l’ensemble des géographies concernées
(**) emplois créés directement ou indirectement par les SIDOM
Près d’un milliard d’euros de Valeur Ajoutée (VA) induite et 14 000 emplois concernés
7
SIDOM
Synthèse
Evaluation économique
Evaluation sociale
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%