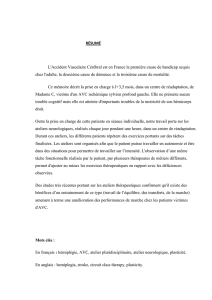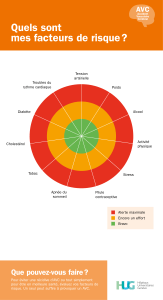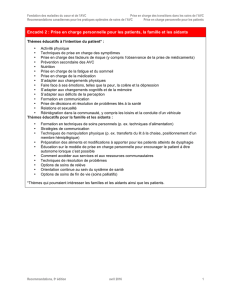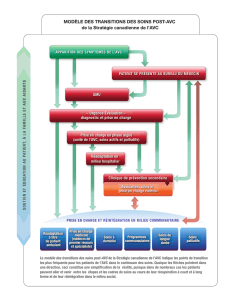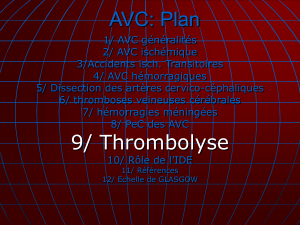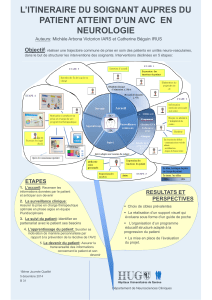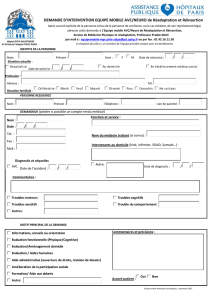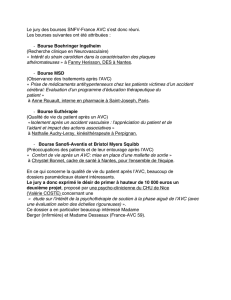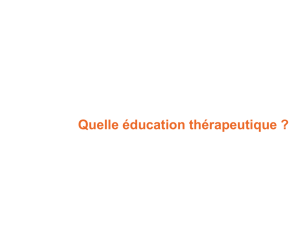Télécharger

1/50
Secteur Sanitaire 2
Rhône-Alpes
C
C
C.
.
.E
E
E.
.
.O
O
O.
.
.R
R
R.
.
.
Centre d’Evaluation, d’Orientation et de Réflexion
Soins de Suite et de Réadaptation - Secteur 2
L
L
La
a
a
p
p
pr
r
ri
i
is
s
se
e
e
e
e
en
n
n
c
c
ch
h
ha
a
ar
r
rg
g
ge
e
e
d
d
de
e
es
s
s
A
A
Ac
c
cc
c
ci
i
id
d
de
e
en
n
nt
t
ts
s
s
V
V
Va
a
as
s
sc
c
cu
u
ul
l
la
a
ai
i
ir
r
re
e
es
s
s
C
C
Cé
é
ér
r
ré
é
éb
b
br
r
ra
a
au
u
ux
x
x
R
R
Re
e
en
n
nc
c
co
o
on
n
nt
t
tr
r
re
e
e
e
e
en
n
nt
t
tr
r
re
e
e
l
lle
e
es
s
s
p
p
pr
r
ro
o
of
f
fe
e
es
s
ss
s
si
i
io
o
on
n
nn
n
ne
e
el
lls
s
s
d
d
de
e
es
s
s
é
é
ét
t
ta
a
ab
b
bl
lli
i
is
s
ss
s
se
e
em
m
me
e
en
n
nt
t
ts
s
s
e
e
et
t
t
d
d
de
e
es
s
s
S
S
So
o
oi
i
in
n
ns
s
s
d
d
de
e
e
S
S
Su
u
ui
i
it
t
te
e
e
e
e
et
t
t
d
d
de
e
e
R
R
Ré
é
éa
a
ad
d
da
a
ap
p
pt
t
ta
a
at
t
ti
i
io
o
on
n
n
(
(
(S
S
SS
S
SR
R
R)
)
)
-
-
-
1
1
15
5
5
j
j
ju
u
ui
i
in
n
n
2
2
20
0
00
0
04
4
4
à
à
à
L
L
L’
’’A
A
AD
D
DA
A
AP
P
PT
T
T
C
C
CM
M
MP
P
PR
R
R
L
L
Le
e
es
s
s
B
B
Ba
a
au
u
um
m
me
e
es
s
s
O
O
Or
r
rg
g
ga
a
an
n
ni
iis
s
sé
é
ée
e
e
p
p
pa
a
ar
r
r
l
ll’
’’é
é
éq
q
qu
u
ui
iip
p
pe
e
e
d
d
du
u
u
C
C
CE
E
EO
O
OR
R
R,
,,
a
a
an
n
ni
iim
m
mé
é
ée
e
e
p
p
pa
a
ar
r
r
M
M
Mr
r
r
l
lle
e
e
D
D
Do
o
oc
c
ct
t
te
e
eu
u
ur
r
r
J
J
JO
O
OY
Y
YE
E
EU
U
UX
X
X,
,,
C
C
Ch
h
he
e
ef
f
f
d
d
du
u
u
S
S
Se
e
er
r
rv
v
vi
iic
c
ce
e
e
d
d
de
e
e
N
N
Ne
e
eu
u
ur
r
ro
o
ol
llo
o
og
g
gi
iie
e
e
a
a
au
u
u
C
C
Ce
e
en
n
nt
t
tr
r
re
e
e
H
H
Ho
o
os
s
sp
p
pi
iit
t
ta
a
al
lli
iie
e
er
r
r
d
d
de
e
e
V
V
Va
a
al
lle
e
en
n
nc
c
ce
e
e
e
e
et
t
t
P
P
Pr
r
ré
é
és
s
si
iid
d
de
e
en
n
nt
t
t
d
d
du
u
u
C
C
Co
o
ol
lll
llè
è
èg
g
ge
e
e
d
d
de
e
es
s
s
N
N
Ne
e
eu
u
ur
r
ro
o
ol
llo
o
og
g
gu
u
ue
e
es
s
s
d
d
de
e
es
s
s
H
H
Hô
ô
ôp
p
pi
iit
t
ta
a
au
u
ux
x
x.
..
CEOR - Centre Hospitalier Valence - 179, Bd Maréchal Juin - 26953 Valence Cedex 9
Tél : 04 75 75 73 48 - Email ceor@ch-valence.fr - http://www.ceor.org

2/50
PROGRAMME
Introduction de la journée par Dr JOYEUX
Dr CHARLE Christine, Médecin MPR, Service MPR Saint-Vallier,
et Médecin CEOR
“Filière AVC : le projet national”
Mr DURAND, Cadre Kinésithérapeute,
Mme CLAVEAU, Mme PELLETIER Kinésithérapeutes, Centre Hospitalier Romans,
«Un exemple de fiche bilan de l’AVC en court séjour»
Mme COSTE, Ergothérapeute, Service MPR Saint-Vallier,
«Installation de l’hémiplégique»
Mme ROILLET, Mme BONNET Orthophonistes, L’ADAPT CMPR Les Baumes,
«Troubles de la déglutition»
Mme CUTIVEL, Cadre Infirmier, Mme TRIBOUT, Assistante Sociale,
Mme LYONNAIS, Mr HERNANDEZ, Infirmiers, Service MPR Saint-Vallier,
«Accompagnement des familles»
Mme VERNET, Ergothérapeute, Service SSR Saint-Marcellin,
«Prévention des chutes chez le patient hémipléqigue»
Dr REMY, Médecin MPR, Mme CHALMETON, Ergothérapeute, Pôle de
Coordination en Réadaptation - Secteur 3,
«Les troubles cognitifs et affectifs chez la personne hémiplégique, en
particulier chez la personne hémiplégique gauche»
Mme FRAISSE, Kinésithérapeute, Centre Hospitalier Valence,
«Appareillage du membre supérieur : écharpe de Holst»
Mme BASSEN, Orthophoniste, Service MPR Saint-Vallier,
«La prise en charge de l’aphasie»
Mme DELTOSO, Ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Les Baumes,
«Quel fauteuil roulant pour la personne hémiplégique»
Mme JEAN, Ergothérapeute SSIP, L’ADAPT CMPR Les Baumes,
Mr BOUCHARD, Référent Professionnel, L’ADAPT SPASE,
« Difficultés de la réinsertion professionnelle pour une personne hémiplégique»

3/50
L
L
La
a
a
p
p
pr
r
ri
i
is
s
se
e
e
e
e
en
n
n
c
c
ch
h
ha
a
ar
r
rg
g
ge
e
e
d
d
de
e
es
s
s
A
A
Ac
c
cc
c
ci
i
id
d
de
e
en
n
nt
t
ts
s
s
V
V
Va
a
as
s
sc
c
cu
u
ul
l
la
a
ai
i
ir
r
re
e
es
s
s
C
C
Cé
é
ér
r
ré
é
éb
b
br
r
ra
a
au
u
ux
x
x
INTRODUCTION
Ouverture de la journée par le Docteur O. JOYEUX
Le Dr Joyeux est chef de service de Neurologie au Centre Hospitalier de
Valence et Président du Collège des Neurologues des Hôpitaux.
Il présente rapidement la Circulaire AVC parue en novembre et précise qu’il
s’agit de recommandations données aux ARH pour la mise en œuvre de filières
AVC sur l’ensemble du territoire.
L’AVC est un enjeu majeur de Santé Publique et un enjeu économique
Avec 145 000 nouveaux cas par an, dont 20% décèderont dans le mois, l’AVC est
la 3ème cause de mortalité, mais aussi la 1ère cause de handicap en France.
La circulaire précise bien tous les maillons de la filière, qui doit être continue et
prendre en compte toutes les phases, de la prévention à la réinsertion.
A Valence, on dénombre 400 nouveaux patients AVC par an.
Le CH de Valence a le projet de créer une unité neuro-vasculaire de référence,
projet soutenu par l’ensemble des neurologues de Drôme Ardèche. Ce projet
s’inscrit dans l’élaboration de la filière AVC dans notre secteur.
Il existe une différence de mortalité et de morbidité chez lez patients
présentant un AVC selon que la prise en charge a été effectuée par des
neurologues au sein d’une équipe pluridisciplinaire ou non . Cela soulève
l’importance du savoir-faire de l’équipe soignante et de la précocité des prises en
charge rééducatives (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste…). C’est
ce qui fait la différence.
En Drôme/Ardèche, il y a beaucoup d’attente par rapport à ce projet (4 à 6
patients sur 1000 habitants font un AVC). A l’avenir, il y aura de nombreux
patients à prendre en charge. Comment éviter la saturation de cette unité
spécialisée ? Il faut que la filière fonctionne et tout doit être coordonné.
L’orientation doit être établie en fonction de critères médicaux, et non de
considérations d’opportunités et d’âge.
Le 3e schéma régional d’organisation sanitaire de la région Rhône-Alpes (SROS 3)
va pouvoir estimer le besoin attendu sur notre région en lits pour améliorer la
situation.
Dr JOYEUX Médecin Chef du Service de Neurologie
Centre Hospitalier - 26953 VALENCE Cedex 04.75.75.75.63

4/50
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Direction générale de la santé
Sous-direction pathologies et santé
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des personnes handicapées
Sous-direction des âges de la vie
Circulaire DHOS/DGS/DGAS n° 2003-517 du 3 novembre 2003 relative
à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux
SP 3 313
3602
NOR : SANH0330609C
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence
régionale d'hospitalisation, Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales
des affaires sanitaires et sociales (pour information), Mesdames et Messieurs les préfets de
départements, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information
et diffusion) L'accident vasculaire cérébral (AVC) constitue un enjeu majeur de santé
publique par le nombre de personnes qui en sont atteintes et les conséquences médicales,
sociales et économiques qui en résultent, ainsi que par la mise en jeu obligatoire de l'ensemble
de la filière de soins.
Il s'agit d'une maladie « traceuse », car elle concerne l'ensemble du système de santé : la
prévention, la prise en charge en urgence, l'accès au plateau médico-technique, aux soins en
hospitalisation aiguë, aux soins de suite et de réadaptation (SSR), la réinsertion à domicile.
L'objectif de ce parcours est d'abord la qualité des soins, gage de réduction du handicap. Le
retour à domicile du patient victime d'un AVC suppose une démarche de réinsertion et
implique une articulation entre les secteurs sanitaire, médico-social et social.
A ce jour nous disposons de prises en charge efficaces dépendant d'une bonne organisation du
système de soins, notamment la création d'unités neurovasculaires et le traitement par la
thrombolyse, mais un nombre insuffisant de malades y ont accès.
La présente circulaire a pour objet de proposer des recommandations afin d'améliorer
l'organisation de l'ensemble de la filière de soins des patients atteints d'un AVC. Elle s'inscrit
en complémentarité des travaux et des recommandations de l'ANAES (1) concernant la prise
en charge médicale et paramédicale des patients AVC dans leur phase aiguë et dans leur phase
de retour à domicile.
Vous veillerez à intégrer l'organisation de la prise en charge des AVC dans les SROS. Ce
schéma doit privilégier une filière de prise en charge graduée et coordonnée des patients
présentant un AVC, afin de concilier au mieux qualité et proximité des soins. Il doit couvrir
l'ensemble de la filière de prise en charge.
I. - NOTIONS GÉNÉRALES
Définition
Un AVC se manifeste par des signes et symptômes neurologiques dus à l'atteinte du cerveau
causée par un défaut de circulation sanguine.
Il s'agit le plus souvent d'une occlusion artérielle pouvant aboutir à un « infarctus cérébral »,
moins souvent d'une rupture vasculaire provoquant une « hémorragie ». Si les AVC atteignent
préférentiellement les personnes âgées, 25 % des patients ont moins de 65 ans et 20 %

5/50
exercent une activité professionnelle au moment de l'accident.
Ils représentent une urgence médicale demandant un diagnostic et des traitements en urgence
au même titre que l'infarctus du myocarde. Compte tenu de la présence fréquente de facteurs
de risque artériel évoluant de longue date (hypertension artérielle, diabète, maladie cardiaque,
etc.), les malades atteints d'un AVC ont très souvent une polypathologie.
Données épidémiologiques
Selon les études épidémiologiques disponibles, l'incidence des AVC est de l'ordre de 1,6 à 2,4
/1 000 personnes par an tous âges confondus et leur prévalence de 4 à 6/1 000 personnes par
an tous âges confondus.
On considère que le nombre d'AVC survenant en France est de l'ordre de 100 000 à 145 000
par an. Au terme du premier mois, environ 15 % à 20 % des patients sont décédés tandis que
75 % des survivants ont des séquelles définitives.
L'AVC est ainsi la troisième cause de mortalité et la première cause de handicap acquis de
l'adulte dans les pays occidentaux.
Le rôle de l'âge et le vieillissement de la population laissent envisager une augmentation du
nombre de patients AVC et du poids de cette pathologie pour la société.
Données thérapeutiques actuelles
Les soins spécialisés et la compétence sont des éléments reconnus dans la prise en charge des
AVC : la spécialisation et l'expérience améliorent la précision du diagnostic, la qualité des
soins et, en conséquence, le pronostic du patient.
Les soins ne peuvent atteindre leur pleine efficacité que s'ils s'inscrivent dans une filière de
soins structurée.
Cette filière de soins et la mise en place d'unités neurovasculaires sont déterminantes dans le
pronostic d'un AVC et s'adressent à tous les patients.
Certains médicaments peuvent améliorer de façon majeure le devenir de certains patients tels
le rt-PA (2), s'il est administré dans les trois heures après le début des signes cliniques.
Ce court délai d'intervention est actuellement un facteur limitant, une meilleure organisation
de la filière de soins permettrait d'augmenter sensiblement le nombre de patients pouvant en
bénéficier, ainsi que l'accès à l'IRM en urgence qui pourrait permettre d'allonger la fenêtre
thérapeutique en milieu spécialisé. Néanmoins, l'utilisation du rt-PA (2) est délicate car elle
comporte un risque d'hémorragie cérébrale parfois mortelle. Ce risque est d'autant plus grand
que le rt-PA(2) est utilisé en dehors du cadre strict de la compétence neurovasculaire, ce qui
nécessite de limiter son administration à des unités neuro-vasculaires identifiées dans le «
volet AVC » du SROS.
Le parcours des malades au sein de la filière comporte la phase pré-hospitalière,
l'hospitalisation (soins aigus et soins de suite et réadaptation) et la réinsertion. La fluidité des
patients tout au long de ce parcours nécessite l'organisation de relations et de collaboration
étroites entre les différentes structures (centre 15, Samu, pompiers, UNV, MPR, SSR, etc.)
L'objectif est de permettre à un nombre croissant de patients d'être pris en charge dans la
filière spécialisée, ce qui suppose la mise en place d'un travail en réseau au niveau régional.
La montée en charge du réseau sera progressive, dans la durée, mais il est nécessaire d'ores et
déjà d'appliquer le dispositif sans attendre que l'ensemble des recommandations suivantes
soient mises en oeuvre.
II. - DESCRIPTION DE LA FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE
1. La phase pré-hospitalière
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%