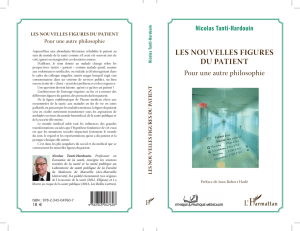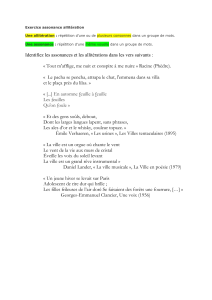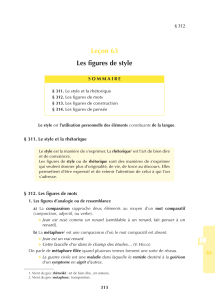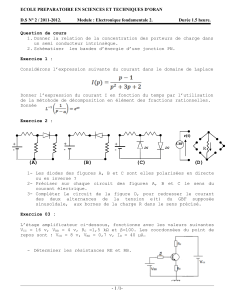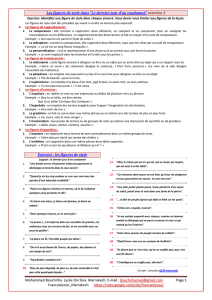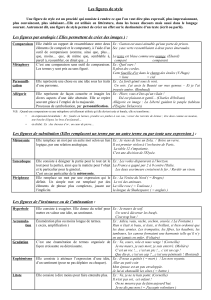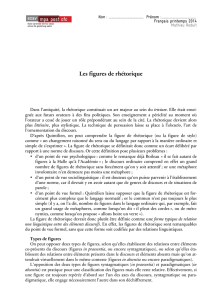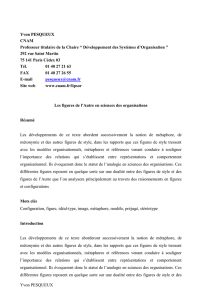Les figures de style

Les figures de style
Les figures de style appartiennent à la science du langage : la
rhétorique. Ces tours d’expression permettent d’obtenir des
effets de sens particuliers intervenant sur le caractère
esthétique du texte. On distingue les figures lexicales - qui
portent sur les mots - des figures syntaxiques - de
construction.
I. Les figures lexicales
!"
Celles qui fonctionnent par analogie
• La comparaison qui établit une analogie entre deux
éléments à l’aide d’un outil comparatif. Ex. : « La Terre est
bleue comme une orange » P. Eluard.
• La métaphore établit une identification en n’utilisant pas
d’outil comparatif. Elle consiste à désigner une chose en
utilisant un terme qui en désigne une autre dans son sens
littéral. Ex. : « O belle Loreley aux yeux pleins de pierreries »
Apollinaire.
• La personnification présente une entité ou un objet comme
doué de raison ou d’attitude humaines.
• L’allégorie représente une idée abstraite par une série
d’images qui fonctionnent les unes avec les autres. Elle prend
souvent valeur de symbole. Par exemple l’allégorie de la
caverne de Platon (La République) qui explique de façon
imagée le parcours du philosophe.
• L’allitération et l’assonance, qu’il convient de distinguer, car
elles jouent toutes deux sur la forme des termes (le
signifiant). L’allitération étant la répétition d’un même son
consonantique, l’assonance, d’un même son vocalique.
Ex : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes » de
Racine est une allitération.
« Je pleure mes ennuis où, pour le dire mieux, en pleurant je
les chante, si bien qu'en les chantant souvent je les
enchante » Du Bellay Assonance en [en] qui sous-tend le mot
chant dans l'ensemble du poème.
!"
Celles qui fonctionnent par opposition
• L’antithèse souligne l’opposition de deux idées ou deux
choses en les rapprochant.
Ex. : « Etre ou ne pas être, voilà la question » Hamlet,
Shakespeare.
• L’oxymore est le rapprochement grammaticalement étroit de
deux termes évoquant des réalités incompatibles.
Ex. : « Cette obscure clarté » Corneille, Le Cid, IV, 3.
• L’antiphrase emploie une expression pour faire entendre son
contraire. Elle est fréquemment utilisée dans l’ironie.
• Le paradoxe rapproche ou combine des mots ordinairement
opposés de façon à rendre plus frappante une affirmation.
!"
Figures de substitution
• La métonymie désigne une chose par un terme qui en
désigne habituellement une autre : désigner la cause par
l’effet, le contenant pour le contenu, le physique pour le
moral… et vice-versa. Ex. : Boire un verre.
• La périphrase désigne une chose de façon détournée ou
imagée. Ex. : La ville lumière pour Paris.
• La synecdoque est le remplacement d’un terme par un autre
employant avec le premier un rapport nécessaire
(objet/matière, tout/partie). Ex. : Un Harpagon pour un avare.
!"
Figures d’amplification
• L’hyperbole est une exagération qui permet de mettre en
relief une idée ou une réalité par une expression qui la
dépasse. Ex. : Elle brille de mille feux.
• La redondance est fondée sur un redoublement excessif de
termes de sens proche. Ex. : Il est calme et tranquille.
!"
Figures d’atténuation
• La litote consiste à en dire le moins pour en suggérer le plus.
Au lieu d’affirmer positivement une chose, on nie la chose
contraire ou on la diminue. Ex. : « Va, je ne te hais point ! »
pour un Je t’aime interdit dans Le Cid de Corneille.
• L’euphémisme (le préfixe grec
ευ
signifiant « bien »)
consiste en l’atténuation d’une notion déplaisante ou
choquante. Ex : partir pour l’autre monde plutôt que mourir.
II. Les figures syntaxiques
!"
Celles qui fonctionnent par accumulation
• Le parallélisme est une forme de répétition qui porte sur la
structure des phrases qui ont exactement la même
construction pour en renforcer le sens.
• La gradation est une énumération de termes dans un ordre
d’intensité croissante.
• L’anaphore est la répétition d’un ou de plusieurs mots en tête
de phrase, de proposition, de vers ou de paragraphe.
!"
Celles qui fonctionnent par association
• Le chiasme est une figure qui croise deux termes là où le
parallèlisme serait appelé par le sens. Ex : « Les soirs
illuminés par l’ardeur du charbon » Baudelaire.
• Le syllogisme est le mise en rapport de deux prémisses, une
majeure et une mineure, dont on tire une conclusion. Ex :
Socrate est un homme. Tous les hommes sont mortels. Donc
Socrate est mortel.
• Le zeugma enchaîne syntaxiquement à un même énoncé
(généralement un verbe) deux syntagmes qui ne sont pas,
logiquement, sur le même plan.
!"
Les figures de rupture
• L’ellipse raccourcit une expression en faisant omettre des
mots sans obscurcir le sens.
• L’asyndète rapproche des mots de même catégorie
grammaticale sans mot de liaison.
• L’anacoluthe est une ellipse extrême qui consiste en une
rupture de construction.
MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Stéphane Fouénard
1
/
1
100%