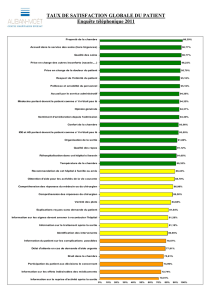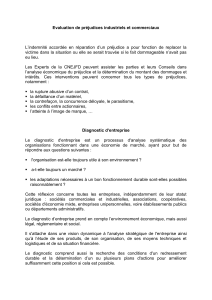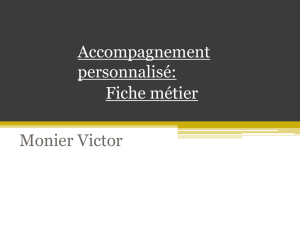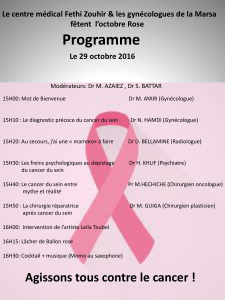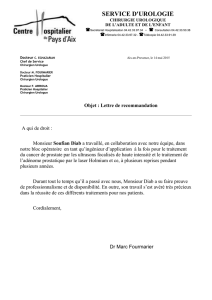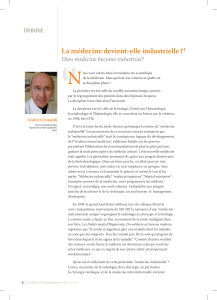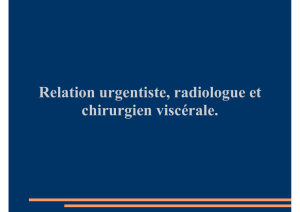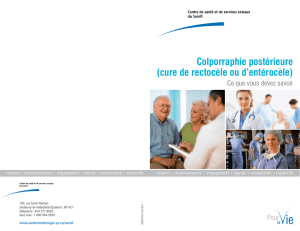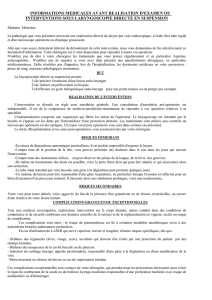n° 27 - Asspro

Des experts à vos côtés
réponses croisées
L’hyperspécialisation
de la chirurgie
de demain
Zoom sur
La jusrisprudence
LE MAGAZINE CONSEIL ET PRÉVENTION DES ADHÉRENTS D’ASSPRO
n°27
octobre2014
Mag
Asspro

ÉDITORIAL
Chers amis,
Je suis heureux de vous présenter
le n° 27 d’ASSPRO MAG et vous faire
part des éléments marquants de cette
année « universitaire » 2013-2014.
En 2013 :
• Élargissement du Conseil d’administration à 15 membres an d’accroître
la représentativité des différentes spécialités de nos adhérents et création d’un
bureau composé de 4 membres (président, vice-président, trésorier et secré
-
taire général) pour faciliter la mise en œuvre des actions votées en conseil.
•
Colloque sur le risque chirurgical, organisé conjointement avec l’UCDF
le 12 octobre 2013 à Paris. Cette première édition, qui a réuni près de
300 chirurgiens, s’est achevée par une table ronde avec le Pr Jean-Luc
Harousseau, Philippe Cuq et moi-même (la vidéo de synthèse de cet évè-
nement réalisée par l’UCDF est visualisable via la rubrique « actualités » de
notre site www.asspro.fr). La journée avait débuté par l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre association et avait été introduite par une intervention
du Pr Guy Vallancien sur sa vision de la chirurgie de demain et dont vous
trouverez une interview dans ce numéro.
En 2014:
• La 2e édition de ce colloque se tiendra le 11 octobre prochain à Paris
sur le thème de la chirurgie ambulatoire. Notre association se mobilise pour
réaliser une enquête auprès de ses adhérents et faire un « état des lieux »
de cette pratique. Je remercie d’avance ceux d’entre vous qui prendront
le temps de répondre à notre questionnaire.
•
Publication de la 1
re
cartographie des risques opératoires en partenariat
avec le Cabinet Branchet. Cette étude a porté sur près de 10 000 dossiers
de sinistres, déclarés entre 2008 et 2012*. Le résultat positif de cette car-
tographie démontre que les actions de prévention organisées par Asspro
sont corrélées avec une diminution de 20 % de la probabilité de survenance
d’un sinistre. L’étude a aussi révélé plusieurs points à améliorer, qui vont
amener Asspro à proposer de nouvelles actions de formation pour l’année
à venir : l’information des patients et l’organisation au sein de l’équipe en
péri opératoire. Ces deux thèmes sont développés dans ce numéro.
•
Tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire au mois de juillet à Lyon :
suite à l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 qui a fait le bilan de l’année
passée, celle-ci a permis l’extension de l’objet de l’association à la défense
et protection du système d’assurance RCP des praticiens libéraux du plateau
technique lourd. Une mission a été donnée au Conseil d’Administration de
se rapprocher du courtier en vue de vérier la validité de l’offre assurantielle,
dans le respect du concept de défense Asspro/Cabinet Branchet.
Les statuts modiés ont également permis de favoriser le partage et la coo-
pération internationale, voire de fédérer les Asspro « étrangères » existantes
actuellement en Espagne et en Suisse et peut-être dans l’avenir en Italie.
Après un rapide bilan des actions entreprises, je vous souhaite une bonne
lecture de votre magazine et une excellente rentrée malgré le climat morose
et les nuages qui assombrissent le ciel de notre profession !
Très amicalement
•
Dr Antoine Watrelot
Président
Disparition de
Bernard Garo
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
brutal de notre ami, survenu le 1er septembre.
Cette nouvelle a bouleversé nos équipes d’as-
sistants-conseils, d’avocats ainsi que les colla-
borateurs du Cabinet Branchet.
Bernard, membre de la Société Française de
Pathologie Infectieuse et Praticien Hospitalier
au CHU de Brest, était l’un des piliers du sys-
tème de défense de nos adhérents.
Il dirigeait le pôle infectiologie qu’il avait créé
en 2006 et intervenait, toujours avec un franc
succès, lors des journées de prévention
Asspro.
Toujours disponible, chaleureux et passionné
par sa spécialité, il laisse un très grand vide au
sein d’Asspro et du Cabinet Branchet.
Nous tenons à adresser à son épouse et à ses
enfants toutes nos condoléances dans cette
terrible épreuve. •
Liste des membres du CA d’Asspro
• Dr Arnaud Christian-Michel,
anesthésiste-réanimateur,
président du SNARF.
• Pr Bouaziz Hervé,
anesthésiste-réanimateur.
• Pr Boubli Léon,
chirurgien gynécologue-obstétricien.
• Dr Chauvin Géraldine,
chirurgien gynécologue.
• Dr Cuq Philippe,
chirurgien vasculaire, président de l’UCDF.
• Dr Dreyfus Jean-Michel,
gynécologue-obstétricien.
• Dr Droguet Jean,
anesthésiste-réanimateur, trésorier.
• Dr Gounot Nicolas,
chirurgien plasticien.
• Pr Mertens Patrick,
neurochirurgien.
• Dr Reynaud Jean-Pierre,
chirurgien plasticien (retraité).
• Dr Serwier Jean-Marie,
chirurgien orthopédiste.
• Dr Timsit Georges,
chirurgien viscéral (retraité).
• Dr Travers Vincent,
chirurgien orthopédiste, vice-président.
• Dr Watrelot Antoine,
chirurgien gynécologue, président.
• Dr Yavordios Patrick-Georges,
anesthésiste-réanimateur,
secrétaire général.
* Tous ces résultats sont consultables en ligne sur le site www.asspro.fr et des versions papiers
peuvent vous être adressées sur simple demande auprès de l’équipe de notre siège social.

Interview
L’hyperspécialisation de la chirurgie de demain
Chirurgien urologue, Professeur à l’Université Paris Descartes,
Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie, fondateur et président
de l’École Européenne de Chirurgie, Guy Vallancien nous livre sa vision
de la chirurgie de demain.
L’hyperspécialisation de la chirurgie
est-elle inéluctable ?
G. V. L’hyperspécialisation en chirurgie est, en
effet, un évènement inéluctable qui ne fera que
s’amplier parce que les techniques sont de
plus en plus complexes et les instruments
de plus en plus divers. Le chirurgien ne peut
plus opérer comme il le faisait auparavant.
Au sein de sa spécialité, il devra développer
des compétences dans un domaine précis. Si
l’on prend l’exemple de l’urologie, certains pra-
ticiens prennent en charge les cancers, d’autres
les incontinences urinaires ou le traitement
des calculs. Ils sont de plus en plus focali-
sés sur un nombre restreint de pathologies
avec des moyens spéciques. Ce sont donc
de véritables équipes opératoires qu’il faut ras
-
sembler dans les blocs modernes.
L’hyperspécialisation passe
par des changements technologiques,
quels sont-ils ?
G. V. La chirurgie a largement bénécié des
progrès dans les domaines de l’informatique
et de la robotique. Nous allons voir émer-
ger de véritables «ingénieurs opérateurs»
qui seront des médecins totalement formés à
la technologie, et même pour certains actes
chirurgicaux spécifiques, à une machine
donnée. Il faut toutefois comprendre que la
valeur ajoutée du médecin réside dans la
décision de l’acte et dans la prise en charge
globale du patient, mais pas seulement
dans la réalisation du geste.
Quel nouveau rôle pour le chirurgien ?
G. V. La valeur ajoutée du médecin peut sembler
faible en quantité mais importante en qualité. Le
malade recherche aujourd’hui une forte capa-
cité d’écoute et d’empathie de la part de son
médecin pour lui permettre d’être mieux guidé
dans sa décision. C’est pourquoi le praticien
doit retrouver une certaine disponibilité pour
se concentrer sur les actes pour lesquels sa
valeur ajoutée est forte. Aux USA ou au Japon,
par exemple, ce sont les Inrmiers Anesthésistes
qui se chargent des sutures nes et, dans le cas
de la chirurgie coronaire, des prélèvements de
la veine saphène, et non le chirurgien.
Comment cette hyperspécialisation
s’intégrera-t-elle dans les structures
de soins ?
G. V. L’évolution dans le temps se fera vers
le regroupement des acteurs. Les chirur-
giens devront se regrouper pour atteindre
une taille critique permettant d’assurer la
totalité de la prestation liée à la spécialité.
Toutefois cela ne signie pas la mise en place
d’un cloisonnement de la chirurgie comme
certains le craignent. Ces équipes hyperspé-
cialisées auront ainsi la possibilité d’évoluer
plus facilement vers d’autres techniques. Les
salles d’opération seront alors redistribuées
en plates-formes interventionnelles dans les-
quelles les différents spécialistes (radiologues,
chirurgiens, anesthésistes…) pourraient œuvrer
avec leur matériel spécique (scanner, IRM).
On devrait assister à une révolution consi-
dérable de la structure même des hôpitaux
et des cliniques qu’il faudrait concevoir dif-
féremment. Parallèlement, des écoles de for-
mation appropriées aux nouveaux outils infor-
matiques et d’ingénierie vont se développer. La
simulation commence d’ailleurs à s’implanter
dans les universités avec la mise à disposition
de simulateurs anatomiques.
Quelle va être la place du patient
dans ce système de soins ?
G. V. Le patient est aujourd’hui au cœur du
système de soins. Ses attentes évoluent.
Il ne se contente plus d’être fataliste
et reconnaissant. L’évolution des tech-
niques et l’amélioration constante des
résultats le poussent à espérer le risque
«zéro». Pour faire évoluer un système de
santé, il nous faut nous intéresser avant tout
au «résultat patient» qui va nous guider
vers la bonne réforme. Certains retours
d’information lors de réunions « médecin/
patient» que l’on avait organisées, nous ont
fait modier nos pratiques. Un des exemples
a été l’angoisse de la sortie, que l’on mesurait
mal, et que nous avons prise en compte. Par
ailleurs, de nombreuses mises en cause
sont dues à des comportements ou à une
relation médecin/patient de mauvaise qua-
lité. Pour exemple, annoncer un cancer ou
une complication ne s’invente pas mais doit
s’apprendre. La mise en place de média trai-
ning serait d’ailleurs très utile pour limiter les
mises en cause.
Quelle est la principale conséquence de
cette hyperspécialisation en matière de
responsabilité ?
G. V. La responsabilité devient nécessai-
rement une responsabilité par équipe et la
formation spécique de chacun amènera à plus
de sécurité. L’évolution des praticiens se fera
vers des compétences médicales plutôt que
chirurgicales. •
Actualités
La valeur ajoutée
réside dans sa
décision de l’acte
et dans la prise
en charge globale
du patient.
Pour faire évoluer
un système de
santé, il nous faut
nous intéresser avant
tout au « résultat
patient » qui va
nous guider vers
la bonne réforme.
Guy Vallancien
Chirurgien urologue
Colloque
du 12 octobre
2013
De gauche à droite: Frédéric Bizard,
Économiste de la Santé. Dr Antoine
Watrelot, Président d’Asspro. PrJean-
Luc Harousseau, Président de la HAS.
DrPhilippe Cuq, Président de l’UCDF.

RubriqueRubriqueRéponses croisées
Des experts à vos côtés
Asspro Mag va à la rencontre de spécialistes pour vous apporter
des informations et des moyens en matière de prévention
des risques.
Interview
Défaut d’information du patient :
principale cause de condamnation
des médecins !
Les résultats de la cartographie des
risques opératoires ont mis en évidence
l’insufsance (voire l’absence) de
consentement dans 45% des casde mise
en cause. Comment expliquez-vousce
pourcentage aussi élevé ?
V. E. Certains praticiens ont du mal à faire
coexister une information formelle et détaillée
avec la relation de conance nécessaire à leur
prise en charge. Malheureusement, pour les
juges, ce qui ne peut être prouvé est considéré
comme inexistant. L’information écrite trans
-
mise au patient doit être considérée comme
un moyen complémentaire d’explication de
l’acte de soin qui n’entache en rien la qualité
de la relation établie lors des consultations.
Doit-on comprendre qu’en dépit d’une
prise en charge médicale de bonne
qualité, le praticien peut être condamné ?
V. E. C’est un constat quotidien. Pour se pré-
munir d’une telle condamnation, le praticien
doit pouvoir fournir la preuve d’une infor-
mation complète faite au patient: possibi-
lités thérapeutiques, tous risques inhérents à
l’intervention, absence éventuelle de résultat.
De plus, le dossier médical du chirurgien doit
impérativement comporter une che d’infor-
mation spécique sur l’intervention réalisée.
Cette che doit être signée par le patient.
Quelles sont les conséquences du défaut
d’information ?
V. E. Elles permettent au patient d’obtenir
une indemnisation. Celle-ci est basée, sur la
perte de chance (celle d’avoir pu renoncer à
son projet chirurgical suite à une information
complète des risques encourus). Le défaut
d’information permet au patient d’obtenir
une indemnisation partielle de tous ses préju-
dices. À cela s’ajoute le recours des Caisses
(CPAM) pour les dépenses de soins liés à la
complication (frais déjà exposés et à venir).
L’addition peut être très lourde notamment en
cas de réanimation, d’hospitalisation prolongée
ou d’appareillage.
Est-il aisé de quantier la perte de chance
liée au défaut d’information ?
V. E. Les Juges ou la CCI* procèdent à une
évaluation liée au cas d’espèce. Pour des
interventions de chirurgie esthétique, ou des
interventions de confort, le taux de perte de
chance peut atteindre 95%. Pour la chirurgie
fonctionnelle, il est plutôt de l’ordre de 50%.
En cas de survenue de complication grave,
bien que non fautive, le défaut d’information
aboutit à des condamnations importantes.
Maître Véronique Estève,
Avocat au barreau de Nice
En cas de survenue
de complication
grave, bien que non
fautive, le défaut
d’information aboutit
à des condamnations
importantes.
* Commission de Conciliation et d’Indemnisation

Réponses croisées
La perte de chance
de renoncer à
l’intervention
et d’en éviter
les conséquences
dommageables et
le préjudice moral
peuvent se cumuler.
En cas de nécessité opératoire, le patient
peut-il quand même invoquer une perte de
chance ?
V. E. Non, mais en revanche il peut être indem-
nisé sur la base d’un préjudice moral. Depuis
un arrêt de la Cour de Cassation du 3juin 2010,
les juges estiment que le patient peut rece-
voir une indemnisation pour atteinte à la
dignité humaine. Cela équivaut au préjudice
«d’impréparation» des dommages surve-
nus, même en cas d’intervention indispen-
sable. La Cour de Cassation reste intraitable
sur ce point et a conrmé sa jurisprudence en
2012. Les dommages-intérêts sont souveraine-
ment xés par les tribunaux. Ils sont de l’ordre
de 1 500 à 5 000€ mais peuvent parfois aller
bien au-delà ! Si les montants d’indemnisation
pour préjudice moral sont moins élevés, leur
fréquence est croissante.
La perte de chance et le préjudice moral
sont-ils alternatifs ?
V. E. Pas du tout, la perte de chance de
renoncer à l’intervention et d’en éviter les
conséquences dommageables et le préju-
dice moral peuvent se cumuler. Un patient
peut obtenir une indemnisation partielle de tous
ses préjudices patrimoniaux (indemnisation
des pertes nancières), et extra patrimoniaux
(indemnisation des préjudices liés à la personne
tels que les préjudices esthétiques, d’agrément
ou les souffrances endurées). Il peut également
solliciter des dommages-intérêts pour son pré-
judice moral.
Quels sont les préjudices qui coûtent le
plus cher en matière d’indemnisation et
pourquoi ?
V. E. Les préjudices patrimoniaux sont incon-
testablement les plus lourds, notamment le
poste «assistance tierce personne» et le
préjudice économique lié à la perte de reve-
nus futurs. C’est surtout le cas pour un patient
jeune ou un cadre supérieur.
Les condamnations ont-elles un impact
sur les primes d’assurances ?
V. E. Oui, car l’assureur calcule la prime en
fonction du niveau de risque. Les risques du
plateau technique lourd sont difciles à
assurer, c’est pourquoi chacun doit les pré
-
venir an de limiter les mises en cause. Il est
toujours dommage d’être condamné à régler
des sommes importantes sur le seul défaut
d’information. Les praticiens doivent donc être
rigoureux sur la traçabilité de l’information qu’ils
donnent aux patients. •
Les préjudices patrimoniaux sont incontestablement les plus lourds,
notamment le poste « assistance tierce personne » et le préjudice
économique lié à la perte de revenus futurs.
www.assproscientifique.fr
Le site d’Asspro Scientique met à la disposition des praticiens de nombreuses ches
d’information préopératoire ainsi qu’un modèle de consentement éclairé.
En dépit d’une prise
en charge médicale
de bonne qualité,
le praticien peut être
condamné.
45 %
Pourcentage de cas où
le défaut d’information
est retenu (sur les
9 894 dossiers
desinistres étudiés
dans la cartographie
desrisques).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%