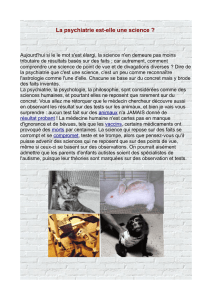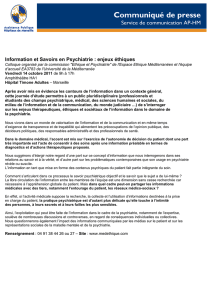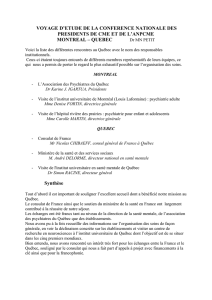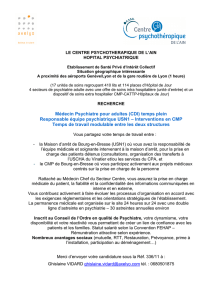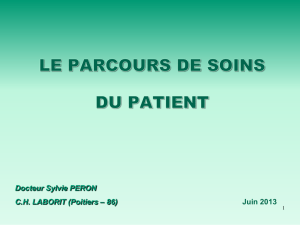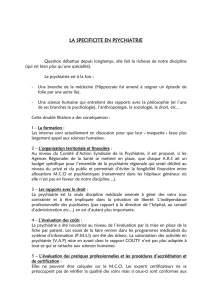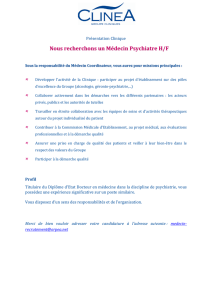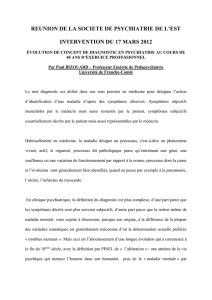Séminaires de formation médicale continue

615
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 84, Supplément au N° 6 - JUIN-JUILLET 2008
Séminaires de formation médicale continue
SÉMINAIRE 1
Douleur et Santé Mentale
Personnes concernées. psychiatres, médecins généralistes, pharma-
ciens, professionnels de la psychiatrie (plus particulièrement infi rmiers).
Objectifs. mieux connaître la douleur, expérience sensorielle et
émotionnelle, tour à tour symptôme et syndrome, aux déterminants et
signifi cations variables. Mieux dépister, mieux évaluer, mieux traiter la
douleur physique chez les personnes soufrant de troubles psychiatriques.
Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des troubles somati-
ques en santé mentale. Améliorer la qualité des soins prodigués dans les
établissements de santé en cas d’hospitalisation pour trouble psychia-
trique. Proposer des modèles d’organisation pour les établissements
d’hospitalisation psychiatrique et pour les secteurs de psychiatrie.
Méthodes pédagogiques. diaporama sur la douleur, son évaluation
et son traitement. Échanges sur douleur et vie psychique, et sur la place
de la douleur en médecine. Diaporama sur l’organisation de la lutte
contre la douleur avec rapport d’expériences spécifi ques à la psychia-
trie. Échanges d’expériences.
Responsables scientifi ques et animation. Éric Serra, psychiatre
des hôpitaux, responsable consultation douleur CHU Amiens Picardie ;
Christian Muller, psychiatre des hôpitaux, chef de service de psychiatrie
EPSM Lille Métropole.
SÉMINAIRE 2
Organiser l’EPP
dans un établissement
Personnes concernées. psychiatres, médecins hospitaliers, assistants.
Objectifs. maîtriser le contexte réglementaire des EPP, qu’il s’agisse
des EPP à réaliser dans le cadre de la certifi cation ou de l’obligation indi-
viduelle d’EPP pour les médecins. Connaître les enjeux et les impéra-
tifs liés à la certifi cation, savoir argumenter les choix de thèmes d’EPP
et appréhender les différentes méthodologies applicables. Concevoir
comment articuler EPP certifi cation et EPP individuelle au sein d’un
établissement. Envisager l’EPP (place dans la pratique) au-delà des obli-
gations réglementaires.
Méthode pédagogique. sur chaque point précédemment cité, rappels
et apport d’informations à travers des présentations suivies de débats.
Discussion des problèmes posés par l’EPP dans le cadre de la certifi cation
et par l’EPP individuelle, à partir des expériences personnelles des parti-
cipants. Exercice pratique d’élaboration d’un programme EPP. Chaque
participant disposera à l’issu de la formation d’un CD comportant tous
les éléments réglementaires et méthodologiques ainsi que diverses docu-
mentations relatives aux EPP.
Responsables scientifi ques et animation. H. Brun- Rousseau,
psychiatre hospitalier, coordonnateur EPP/FMC de l’ACFCP ;
Chantal Bergey-Cassy, psychiatre des hôpitaux, responsable de pôle,
CH Charles-Perrens.
SÉMINAIRE 3
Le corps souffrant
dans les populations marocaines
La sinistrose correspond à l’état mental de certains sinistrés ou
accidentés qui développent des idées fausses sur la forme de la répara-
tion du préjudice qui devient fi xe, accapare toute l’activité psychique,
entraîne une conviction inébranlable alors même que les blessures ont
guéri, et prend un aspect obsédant. Les sinistrés peuvent avoir recours à
des interprétations à partir de manifestations fonctionnelles, et en parti-
culier de douleurs physiques. Certains aspects cliniques pourraient être
spécifi ques à la culture maghrébine. En effet, le patient maghrébin a
le plus souvent recours au corps pour essayer d’atteindre l’autre et de
communiquer avec lui.
Personnes concernées. psychiatres, médecins, assistants, internes,
psychologues, paramédicaux, soignants, étudiants.
Objectifs. mettre en évidence les spécifi cités culturelles liées à la
représentation du corps chez le marocain. Montrer la place du corps souf-
frant dans l’expression clinique d’un tableau de sinistrose.
Méthodes pédagogiques. présentation diaporama. Étude d’un cas
clinique : nous décrirons le cas clinique d’une patiente marocaine âgée
de 56 ans qui présenta, suite à un grave accident de la voie publique, un
trouble dépressif majeur associé à un délire de revendication construit
autour de l’idée prévalente d’une réparation. Sa demande d’être reconnue
passe par le biais d’une somatisation extrême. Discussion sur des expé-
riences partagées.
Expert. Fatima-Zohra Sekkat, professeur de psychiatrie, Hôpital
Ar-Razi de Rabat -Salé, Maroc.
Animateur. Paul Bonnan, psychiatre des hôpitaux, responsable Pôle de
psychiatrie générale, centre hospitalier, 33410 Cadillac.
SÉMINAIRE 4
Obligations réglementaires en matière
de certifi cats pour les HO et HDT
Personnes concernées. psychiatres, internes, médecins généralistes,
professionnels de la psychiatrie.
Objectifs. dans un contexte législatif mouvant, il s’agit de faire le
point sur les dernières évolutions réglementaires concernant l’établis-
sement et le contenu des certifi cats médicaux lors des hospitalisations
d’offi ce et sur demande d’un tiers. Les participants devront notamment
approfondir ou acquérir les notions de réfl exion « bénéfi ces-risques » et
de nécessité de traçabilité des informations données au patient et/ou à
son entourage.
Méthodes pédagogiques. rappel des obligations réglementaires,
diaporama, échange interactif, réfl exions prospectives.
doi : 10.1684/ipe.2008.0362
jleipe00598_cor3.indd 615jleipe00598_cor3.indd 615 7/29/2008 3:53:20 PM7/29/2008 3:53:20 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

XXVIIes Journées de la Société de l’Information Psychiatrique
616
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 84, Supplément au N° 6 - JUIN-JUILLET 2008
Responsable scientifi que. Yves Hémery, psychiatre des hôpitaux,
Centre hospitalier des Pays de Morlaix, 29672 Morlaix.
Animation. Michel Verpeaux, psychiatre des hôpitaux, CHS la
Chartreuse, 21000 Dijon.
Documents délivrés. CD-ROM récapitulatif, questionnaire d’évalua-
tion des acquis.
SÉMINAIRE 5
Adolescents… corps… passage à l’acte
Personnes concernées. psychiatres, pédopsychiatres, pédia-
tres, psychologues, professionnels du domaine de la psychiatrie de
l’adolescent, médecins généralistes, médecins de santé scolaire et tout
intervenant auprès des adolescents.
Objectifs. repères cliniques et théoriques à propos du corps pour
améliorer la prise en charge des passages à l’acte à l’ adolescence.
Méthodes pédagogiques. diaporama, vignettes cliniques, échange
interactif.
Responsable scientifi que. Dr Patrick Ayoun, praticien hospita-
lier, pédopsychiatre, médecin responsable du Centre de crise et de soins
spécialisés pour adolescents du CH Charles-Perrens à Bordeaux (33).
Animation. Dr Pierre Faraggi, praticien hospitalier, responsable Pôle
de psychiatrie générale Bordeaux Rive Droite et Entre-deux-Mers au CH
de Cadillac, président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH),
président de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH).
SÉMINAIRE 6 (ANNULÉ)
SÉMINAIRE 7
Les staffs-EPP protocolisés :
comment les mettre en place
Personnes concernées. psychiatres et l’ensemble des professionnels
des équipes de psychiatrie – psychologues, infi rmiers, cadres de santé,
médecins généralistes, etc.
Objectifs. contribuer à la mise en place de groupes d’analyse de prati-
ques professionnelles sur le modèle des staffs-EPP protocolisés dans les
établissements gérant des équipes de psychiatrie. Pour ce faire, les anima-
teurs expliciteront une méthode permettant d’étudier et de critiquer la
pratique, de favoriser les échanges entre professionnels et de confronter
les savoirs.
Méthodes pédagogiques. première synthèse des protocoles utilisés
par les participants lors des réunions d’analyse de pratiques déjà en place
dans leurs structures de soins, cela à partir d’une grille de présentation
que chaque participant pourra remplir. Discussion sur ces méthodologies.
Présentation de la méthodologie des Staffs-EPP protocolisés sur la base
d’un diaporama et discussion de chaque étape. Confrontation des prati-
ques existantes en référence à la méthodologie et les critères de qualité
du modèle des Staffs-EPP protocolisés. Transmission de différents outils
(documents, grilles, etc..) permettant la mise en pratique suite à cette
session. Présentation du suivi dans le cadre de l’évaluation des pratiques
professionnelles des Staffs protocolisés par l’ACFCP.
Responsables scientifi ques et animation. N. Garret-Gloanec,
psychiatre des hôpitaux, présidente de la SIP ; M. Bétrémieux : psychiatre
des hôpitaux, président de l’ACFCP.
Documents délivrés. CD-ROM récapitulatif, questionnaire d’évalua-
tion des acquis.
Bibliographie. Bétrémieux M. Deux méthodes d’Évaluation des
Pratiques en Psychiatrie. Les groupes d’Analyse de Pratiques entre
Psychiatres, les Staff-EPP des Équipes Hospitalières de Psychiatrie.
l’Information Psychiatrique, 2007.
SÉMINAIRE 8
Psychotropes et sujet âgé
Personnes concernées. psychiatres, gériatres, généralistes, neuro-
logues, infi rmiers et autres professionnels concernés par le champ de la
psychiatrie du sujet âgé et de la gérontopsychiatrie.
Thématique. bien que communément employés dans le traitement
des affections psychiatriques du sujet âgé, à savoir délire, dépression,
anxiété, addictions, troubles psychologiques et comportementaux des
démences, les conditions de prescription des psychotropes demeurent
encore fl oues dans cette population en raison de l’hétérogénéité des
situations rencontrées et du manque d’études contrôlées. Les psycho-
tropes sont pourtant largement prescrits chez la personne âgée, parfois
de façon abusive comme dans les troubles de l’adaptation, au dépens
d’ actions non pharmacologiques. Cette « sur-prescription » constitue une
des premières causes d’iatrogénie. La prescription doit également tenir
compte des facteurs pharmacologiques et pharmacodynamiques liés à
l’âge, des coprescriptions liées à la polypathologie avec le risque d’inte-
ractions médicamenteuses, des modulations neurobiologiques cérébrales
corrélées à l’avancée en âge.
Objectifs. connaître le contexte de la prescription, les principales
modifi cations pharmacocinétiques liées à l’âge et l’impact du vieillisse-
ment cérébral, les données sur la polyprescription et les principales inte-
ractions médicamenteuses. Savoir cibler les indications et les conditions
de prescription et limites d’emploi des différentes classes de psychotropes
en incluant les médicaments symptomatiques de la démence qui ont une
action psychotrope. Apprendre à défi nir une approche dimensionnelle et
une hiérarchie de prescription. S’appuyer sur les travaux de consensus
existant et les recommandations de bonnes pratiques pour défi nir une
prescription éclairée et obérer au minimum l’autonomie, particulièrement
le fonctionnement cognitif du sujet âgé
Méthodes pédagogiques. présentation PowerPoint avec défi nition
d’organigrammes, étude de cas.
Responsable scientifi que. Dr G. Jovelet, psychiatre des hôpitaux,
responsable du Pôle psychiatrie du sujet âgé à l’EPSMD de Prémontré
Animation. Dr Marie-Pierre Pancrazi, psychiatre des hôpitaux,
responsable du pôle ambulatoire et du service de gérontopsychiatrie à
l’HPGM de Ballainvilliers. [email protected]
SÉMINAIRE 9
Neuroleptiques et allaitement
Personnes concernées. psychiatres, médecins généralistes, profes-
sionnels de la périnatalité, étudiants en médecine, infi rmiers.
Objectifs. donner un aperçu général des études épidémiologiques
dans ce domaine. Acquérir les connaissances des recommandations pour
la conduite à tenir face aux troubles et à leurs traitements en évaluant les
bénéfi ces obtenus et les risques encourus.
Méthodes pédagogiques. du côté du pharmacologue, les bénéfi ces
immunitaires nutritionnels et psychologiques de l’ allaitement maternel
sont bien connus. La question de l’allaitement d’un nouveau-né par une
jleipe00598_cor3.indd 616jleipe00598_cor3.indd 616 7/29/2008 3:53:23 PM7/29/2008 3:53:23 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

XXVIIes Journées de la Société de l’Information Psychiatrique
617
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 84, Supplément au N° 6 - JUIN-JUILLET 2008
maman traitée par un médicament psychotrope se pose-t-elle ? Est ce
une contre-indication ? Quelle attitude les laboratoires pharmaceutiques
adoptent-ils face à cette question ? Après avoir envisagé les mécanismes
qui régissent le passage des médicaments en général, et des psychotropes
en particulier, dans le lait maternel, on évaluera le risque de confronta-
tion quantitative de l’organisme du nourrisson à ces médicaments. En se
fondant sur les différentes études publiées, sur la conférence de l’Anaes
et sur les textes du traité de Th. Hale, on donnera les éléments d’une
possible conduite à tenir.
Du côté du clinicien, contrairement à ce qui a longtemps été dit, l’état de
bien-être apporté par la grossesse et la période périnatale n’a pas d’effet
lénifi ant sur l’évolution d’un trouble mental durable. Cette période est
même propice à l’éclosion et/ou à la décompensation d’un trouble de
l’ humeur et d’émergence de psychopathologie. La question se pose donc
de la mise en place, de la poursuite ou de l’interruption des traitements
psychotropes chez une future mère ou chez une femme allaitante par l’éva-
luation des risques et des bénéfi ces liés qui résultent de la décision prise. On
s’attachera à décrire les principales études menées dans ces circonstances
et à rapporter les recommandations qui en résultent. Si le pouvoir térato-
gène des psychotropes a longtemps été surestimé, on approfondira la ques-
tion du traitement par les sels de lithium et les antiépileptiques régulateurs
de l’ humeur, les risques étant réels pour l’embryon et pour le nouveau-né.
On discutera le risque lié à la prescription des « ISRS » au 3
e
trimestre de
la grossesse et pendant la période d’allaitement maternel. On donnera les
recommandations extraites de la littérature pour la conduite à tenir
Responsables scientifi ques et animation. J. Benyaya, docteur en
pharmacie et docteur en médecine ; G. Apter-Danon, MD, Respon-
sable du Laboratoire Recherche en Psychiatrie et en Psychopathologie,
et Pumma (Psychiatrie périnatale d’urgence mobile en maternité), EPS
Erasme, CRPM Université Denis-Diderot–Paris-VII.
Documents délivrés. exemple CD-ROM récapitulatif, questionnaire
d’évaluation des acquis.
SÉMINAIRE 10
Le réseau de santé mentale,
une manière facile de valider son EPP
Personnes concernées. psychiatres, psychologues, médecins
généralistes.
Objectifs. acquérir des outils méthodologiques facilitant la mise en
place de réseaux de soins en santé mentale. Détailler le volet évalua-
tion des pratiques professionnelles inhérent à l’ accréditation même du
réseau.
Méthodes pédagogiques. présentation (diaporama) comportant des
textes légaux actualisés, des techniques de défi nition des objectifs d’un
réseau et de ses outils d’évaluation. Nous détaillerons particulièrement
les méthodologies d’évaluation interne et externe du réseau constituant
une technique de validation régulière des pratiques professionnelles.
La discussion sera interactive à partir de l’exemple du réseau de santé
mentale Yvelines Nord.
Responsables scientifi ques et animation. C. Libert-Benyaya,
psychiatre des hôpitaux, responsable de pôle et membre du réseau de santé
mentale Yvelines Nord ; M. J. Cortes, psychiatre des hôpitaux et médecin
coordonnateur du réseau de santé mentale Yvelines Nord.
Documents délivrés. CD-ROM récapitulatif, questionnaire
d’évaluation.
Séminaires d’évaluation
des pratiques professionnelles (EPP)
SÉMINAIRE 1
Le secret professionnel
Responsable. Dr Michel Verpeaux.
Expert. Dr Yves Hémery.
Groupe de travail et instance de validation. groupe de coordination
EPP, conseil scientifi que et CA de la SIP.
Thème. Le secret professionnel en psychiatrie.
La législation évolue rapidement en matière de secret professionnel :
d’obligation totale, absolue, la notion de secret professionnel s’est large-
ment amendée depuis la rédaction du nouveau code pénal en 1994,
art.226-13 et 14, la publication du nouveau code de déontologie médi-
cale, décret du 6 septembre 1995, et la loi du 4 mars 2002. Issues autant
de jurisprudences que de sources juridiques et réglementaires, les préco-
nisations qui encadrent le SP et ses déclinaisons quotidiennes se doivent
d’être régulièrement interrogées au bénéfi ce des professionnels de
santé et des patients, dans le respect des dispositions déontologiques et
légales. En pratique hospitalière, et en psychiatrie, il importe de vérifi er
les usages et les bonnes pratiques. Il est en effet habituel de rencontrer
des attitudes défensives, ou au contraire laxistes, de la part des prati-
ciens comme de leurs collaborateurs. Sur le plan des principes, il faut
rappeler que le SP n’est pas opposable au patient, et que d’autre part, la
divulgation d’informations, sanctionnée par l’art. 226-13 du Code pénal,
constitue une infraction d’ordre public. Par ailleurs, de nombreuses déro-
gations aménagent les relations entre soignants et patients, comme entre
soignants et autorités publiques, ces dérogations ont pour fi nalité la
protection des individus, la sauvegarde de la santé publique, l’homéos-
tasie du corps social (état civil), et le maintien de l’ordre public (dénon-
ciation de crimes, enquêtes préliminaires, art. 60-1 du cpp), la continuité
institutionnelle (assurance maladie, information médicale, accréditation
et évaluation…). La notion de SP reste diffi cile à apprécier en pratique
quotidienne, relevant le plus souvent de la routine institutionnelle ou de
la question de principe. Il convient donc de tenter d’en évaluer la traduc-
tion concrète, non seulement dans la « culture du service », mais aussi
dans l’outil de recueil d’informations que constitue le dossier du patient.
Le dossier du patient demeure la principale source écrite « opposable »,
qu’il convient de renseigner en toutes circonstances, dans le respect des
normes en vigueur.
Objectifs. améliorer les pratiques cliniques et institutionnelles à partir
de la confrontation des textes législatifs et réglementaires aux pratiques
usuelles de chacun.
Méthode. évaluation de dix dossiers-sources et des dispositions insti-
tutionnelles (règlement intérieur, délibérations, notes de service…), puis
au terme d’un délai de six mois, nouvelle évaluation des pratiques par
examen de dix dossiers.
Public concerné. psychiatres des hôpitaux exerçant en secteur adulte
ou infanto-juvénile.
jleipe00598_cor3.indd 617jleipe00598_cor3.indd 617 7/29/2008 3:53:23 PM7/29/2008 3:53:23 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

XXVIIes Journées de la Société de l’Information Psychiatrique
618
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 84, Supplément au N° 6 - JUIN-JUILLET 2008
Références. essentiellement Code pénal, dont art. 226-13 et 226-14 ;
Code de déontologie médicale ; décret du 6 septembre 1995 ; loi du
4 mars 2002…
SÉMINAIRE 2
Prescriptions des thymorégulateurs
Responsable projet. Hélène Brun-Rousseau, psychiatre hospitalier.
Expert. Jacques Caron, pharmacien hospitalier.
Groupe de travail et instance de validation. groupe de coordination
EPP, conseil scientifi que et CA de la SIP.
Thème. évaluation du choix du produit, de la surveillance biologique
et des associations médicamenteuses des traitements thymorégulateurs
Objectif. améliorer la connaissance des critères de choix d’un normo-
thymique, la rigueur de la surveillance des traitements et la connaissance
des interactions médicamenteuses potentiellement préjudiciables.
Méthode. audit clinique ciblé. Analyse des pratiques à partir de l’éva-
luation de 10 dossiers.
Public concerné. psychiatres hospitaliers, assistants spécialistes ou
généralistes exerçant en psychiatrie, attachés, internes.
Références. recommandations de bonnes pratiques, AMM, revue de
la littérature française et internationale.
SÉMINAIRE 3
Prise en charge en psychiatrie
ambulatoire d’un épisode dépressif
de l’adulte
Responsable projet. Anne-Laure Simonnot.
Expert. Paul Bonnan.
Groupe de travail et instance de validation. groupe de coordination
EPP, conseil scientifi que et CA de la SIP.
Thème. la maladie dépressive constitue un problème préoccupant
de santé publique en raison de sa fréquence et des conséquences médi-
cales, sociales et économiques qu’elle induit. En psychiatrie, l’épisode
dépressif est souvent associé à d’autres troubles psychiatriques et soma-
tiques. Cette comorbidité est loin d’être facile à prendre en charge dans
toute sa globalité et nécessite pour les psychiatres de coordonner un
programme thérapeutique adéquat en partenariat avec tous les acteurs de
santé concernés. Les psychiatres sont aussi confrontés à la multiplicité
des traitements médicamenteux. La France, par ailleurs, est l’un des pays
au monde qui a la plus forte mortalité par suicide. Un effort de prévention
est donc un impératif sanitaire en psychiatrie, notamment dans les centres
médico-psychologiques.
Objectifs. améliorer la précision du diagnostic et de l’évaluation
initiale du patient. Inciter les psychiatres à coordonner un programme
thérapeutique sur le modèle d’un réseau de soins. Perfectionner les
conduites de prescription en tenant compte de la nécessaire information
du patient.
Méthode. grille de recueil des informations avec interprétation des
résultats à deux reprises, à neuf mois d’intervalle. Approche par compa-
raison à un référentiel.
Public concerné. psychiatres, assistants spécialistes.
SÉMINAIRE 4
Antipsychotiques et neuroleptiques :
prescription
Responsable projet. Chantal Bergey-Cassy, psychiatre hospitalier.
Expert. Marie-Christine Bret, pharmacien hospitalier.
Instance de validation. groupe de coordination EPP, conseil scienti-
fi que et CA de la SIP.
Thème choisi. depuis leur commercialisation, dans les années 1950,
les neuroleptiques représentent la principale intervention thérapeutique
envisageable pour traiter la schizophrénie. Ils deviennent désormais une
approche de première intention dans le traitement de la maladie bipolaire.
L’arrivée sur le marché de nouveaux neuroleptiques et/ou anti psychotiques
dans les années 1990 a eu un impact important sur les pratiques. Le profi l
pharmacologique particulier de ces nouvelles molécules leur conférant
une meilleure tolérance neurologique et semblant offrir une meilleure
effi cacité sur la symptomatologie défi citaire et les troubles cognitifs de la
maladie, la plupart des experts en recommandent l’utilisation en première
intention. Cependant, la commercialisation de ces neuro leptiques (et/
ou antipsychotiques) de 2e génération a eu également une incidence
non négligeable sur les budgets des établissements de soins en santé
mentale. Avec eux, la part consacrée aux dépenses pharmaceutiques a
connu une augmentation plus infl ationniste puisque, depuis, elle avoi-
sine les 5 % par an. Par ailleurs, si les effets extrapyramidaux des neuro-
leptiques de première génération se sont trouvés relégués au second plan,
d’autres effets, tout aussi défavorables au pronostic du patient, comme le
syndrome métabolique, la prise de poids ou les risques cardio vasculaires,
dominent désormais le tableau des effets indésirables induits par ces
nouvelles molécules. Ils s’ avèrent ainsi susceptibles d’altérer l’intégrité
physique, la qualité de vie du patient et indirectement l’observance des
traitements.
Objectifs. améliorer les pratiques de prescription au moment de l’ins-
tauration ou d’un changement de thérapeutique neuroleptique et/ou anti-
psychotique destiné à un patient souffrant de troubles schizophréniques
(F20.), schizo-affectifs (F25.) ou bipolaires (F31.), et en particulier en
termes de respect des recommandations de bon usage de ces médica-
ments et de surveillances clinique et biologique. Améliorer également
l’information donnée au patient au moment de la mise en place d’un tel
traitement.
Méthode. type d’EPP : individuel. Méthode d’évaluation des prati-
ques : audit clinique ciblé.
Professionnels concernés. médecins prescripteurs de psychotropes
(psychiatres publics et libéraux).
Recueil des données. rétrospectif par analyse de 10 dossiers patients.
SÉMINAIRE 5
Le dossier médical en psychiatrie
infanto-juvénile ambulatoire
Promoteur. association pour les congrès et la formation continue des
psychiatres pour la Société de l’Information Psychiatrique.
Responsable projet. Dr Isabelle Montet.
Expert. Dr Maria Squillante.
Groupe de travail et instance de validation. groupe de coordination
EPP, conseil scientifi que et conseil d’administration de la SIP.
jleipe00598_cor3.indd 618jleipe00598_cor3.indd 618 7/29/2008 3:53:23 PM7/29/2008 3:53:23 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

XXVIIes Journées de la Société de l’Information Psychiatrique
619
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 84, Supplément au N° 6 - JUIN-JUILLET 2008
Thème choisi. le dossier médical est un outil central pour l’exercice
professionnel en matière de traçabilité et de transmission des informa-
tions entre professionnels de santé. Son usage est régi par une importante
législation modifi ée par la loi du 4 mars 2002 dans les règles d’accès au
dossier. La majeure partie de l’exercice de psychiatrie infanto-juvénile se
fait de manière ambulatoire. L’importance d’une évaluation des pratiques
visant l’usage du dossier médical se justifi e par le rôle du dossier dans la
pratique de psychiatrie infanto-juvénile ambulatoire et la proportion de
professionnels concernés.
Objectif. aider les professionnels concernés à constituer et utiliser les
dossiers médicaux dans le respect de la réglementation et en référence
aux règles de bonnes pratiques en psychiatrie infanto-juvénile. Aider
les professionnels à appréhender la législation en vigueur relative au
dossier médical, en particulier en matière d’accès au dossier pour le
patient
Public concerné. psychiatres, assistants spécialistes, assistants
généralistes, attachés exerçant en établissements publics de santé et
établissements privés participant au service public hospitalier et assurant
une activité de psychiatrie infanto-juvénile.
Méthode. programme continu d’évaluation des pratiques profession-
nelles. Évaluation collective fondée sur la participation du groupe de
praticiens inscrits au module d’EPP à l’élaboration d’un référentiel « le
dossier médical en psychiatrie infanto-juvénile ambulatoire » construit
en conformité avec la méthodologie HAS (HAS - Bases méthodologiques
pour l’élaboration des recommandations professionnelles par consensus
formalisé – janvier 2006).
SÉMINAIRE 6
Évaluation clinique après une tentative
de suicide chez l’adolescent
Responsable projet. Bertrand Welniarz, praticien hospitalier, chef de
service de psychiatrie infanto-juvénile à l’EPSM Ville-Evrard, secteur
93I03.
Expert. Fabienne Roos Weil, praticien hospitalier, service de
psychiatrie infanto-juvénile du 19e arrondissement-Paris (EPSM Maison-
Blanche-Neuilly-sur-Marne-93).
Groupe de travail et instance de validation. groupe de coordination
EPP, conseil scientifi que et CA de la SIP.
Objectifs. aider les psychiatres à développer une stratégie d’évalua-
tion clinique, psychologique individuelle et relationnelle après une tenta-
tive de suicide chez l’adolescent. Améliorer l’évaluation clinique initiale
du patient, accompagné dans sa globalité et dans un contexte contenant
et protecteur. Mettre en place les éléments constitutifs d’une démarche
thérapeutique.
Méthodes pédagogiques. méthode d’évaluation des pratiques, audit
clinique ciblé. EPP individuelle à partir de grilles fondées sur les critères.
Présentation diaporama, discussion sur des expériences partagées. À
l’issue du travail collectif, chacun pourra individuellement confronter ses
propres résultats aux résultats globaux et discuter, individuellement, avec
le responsable ou les intervenants experts, des actions d’amélioration à
mettre en œuvre.
Personnes concernées. les psychiatres et assistants spécialistes en
psychiatrie, assistants généralistes, attachés exerçant une activité clinique
en psychiatrie infanto-juvénile et générale.
SÉMINAIRE 7
Prévention des troubles
cardiovasculaires chez les patients
hospitalisés en psychiatrie
Responsable Projet. Dr Françoise Frincard, praticien hospitalier,
CH Robert-Ballanger, 93600 Aulnay-sous-Bois
Expert. Dr Thierry Trémine, chef de service, CH Robert-Ballanger,
93600 Aulnay-sous-Bois.
Groupe de travail et instance de validation. groupe de coordination
EPP, conseil scientifi que et conseil d’administration de la SIP.
Thème. les patients hospitalisés en psychiatrie présentent souvent des
facteurs de risques cardiovasculaires auxquels se surajoutent les éven-
tuels effets secondaires des psychotropes.
Objectifs. réduction du nombre de complications cardiovasculaires
chez des patients hospitalisés recevant un traitement psychotrope.
Méthode. fi che de suivi cardiovasculaire regroupant les résultats
des examens cliniques et complémentaires correspondant aux différents
facteurs de risque et consultations spécialisées nécessaires au suivi des
patients traités par psychotropes. Cette fi che, outre les examens obliga-
toires, se doit d’être adaptable à chaque patient en fonction de son profi l.
Le bilan initial sert de référence pour pouvoir juger l’évolution d’un bilan
à l’autre. La périodicité et la spécifi cité du suivi sont établies par chaque
clinicien en fonction du bilan initial. Une première évaluation de la vali-
dité et de la faisabilité est faite trois mois après la mise en route puis tous
les 6 mois. EPP individuelle. Fiche individuelle.
Professionnels concernés. praticiens hospitaliers, assistants spécia-
listes, assistants généralistes.
jleipe00598_cor3.indd 619jleipe00598_cor3.indd 619 7/29/2008 3:53:23 PM7/29/2008 3:53:23 PM
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
1
/
5
100%