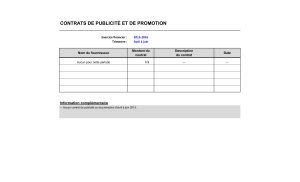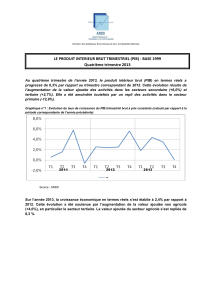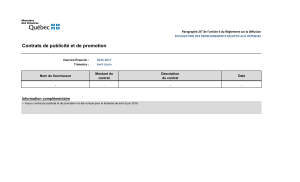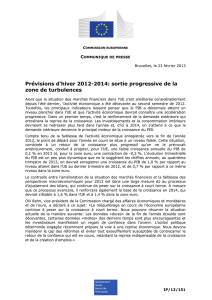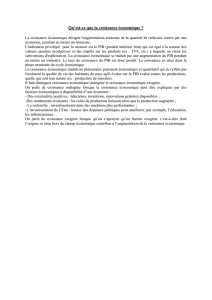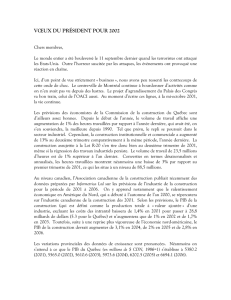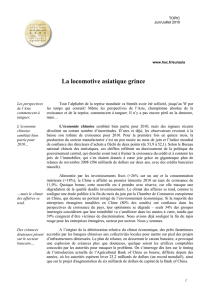Le Pari de Pascal - Credit Agricole, Etudes Economiques

Trimestriel – n°140 – 2e trimestre 2013
Le Pari de Pascal
Le marché américain des actions a retrouvé récemment les points hauts atteints par deux fois au cours des dernières années
(en 2000 au plus fort de la bulle internet) et en 2007 (juste avant l’enclenchement de la « Grande Récession »). Ne s’agit-il pas
d’un message important de normalisation de la situation économique et financière ?
Avant de tenter de répondre, la perspective doit être élargie, du côté des autres marchés d’abord. Les rendements obligataires
restent très faibles, pour beaucoup du fait de l’activisme des Banques centrales. Celui-ci influence évidemment le comportement
des investisseurs et il n’est donc pas possible de dire que les signaux envoyés par l’évolution du prix de tel ou tel actif est le
strict reflet des changements d’anticipation sur les perspectives économiques. De plus, le marché européen des actions ne se
comporte pas du tout comme celui des États-Unis. Le niveau actuel est inférieur de quelque 40% au point haut de 2007.
Du côté de l’environnement économique ou politique, le constat se partage entre déception et incertitude. La déception concerne
la croissance, avec une Europe toujours en récession, des États-Unis à la peine pour combler le retard accumulé tout au long
des dernières années et un monde émergent qui apprend un nouveau régime, plus lent que le précédent, car affecté par
l’affaiblissement du cycle manufacturier mondial.
Les incertitudes politiques restent fortes. Les doctrines en matière de politiques budgétaire ou monétaire sont mal établies.
Prenons un simple exemple du côté des comptes publics : dans un environnement caractérisé par une dette publique trop lourde
et une croissance économique trop faible, faut-il hâter ou ralentir le rééquilibrage ? Aucune réponse consensuelle n’apparaît.
Quant aux jeux des partis politiques, l’image envoyée par l’Italie ou les États-Unis est simplement inquiétante. Dans tous les cas,
les attentes en matière de politiques publiques ne sont pas atteintes.
Alors, normalisation ou pas ? Disons que retrouver au bout de plus de cinq ans un niveau d’indice actions envoie davantage un
message d’anticipation de sortie de crise, que de retour sur une dynamique de croissance observée par le passé. Le pire est
sans doute passé, mais la reprise sera vraisemblablement lente et chaotique. Le pari est raisonnable !
Sommaire
Croissance ou stabilité : l’un, l’autre ou les deux ? ................................. 2
Ne pas rouvrir la boîte de Pandore des risques extrêmes ...................... 5
La BCE et l’aléa moral, une question de dosage .................................... 6
Taux d’intérêt américains : la baisse n’est plus qu’un souvenir............... 7
Taux d’intérêt en zone euro : les risques et la stagnation économique
arrêtent la hausse des taux .................................................................... 8
Taux de change : le changement de comportement du marché
soutiendra le dollar ................................................................................ 9
Énergie : que fait donc l’Arabie saoudite ? ........................................... 10
Or : sous pression, mais pas sans soutien ........................................... 11
États-Unis : le frein budgétaire laissera place à une situation plus
confortable au second semestre .......................................................... 12
Japon : l’Abenomics soutient la confiance et la croissance .................. 14
UEM : occasion manquée .................................................................... 15
France : sur le fil .................................................................................. 16
Allemagne : à contre vent .................................................................... 17
Italie : gelée ......................................................................................... 18
Espagne : priorité à l’austérité .............................................................. 19
Portugal : la reprise s’éloigne ............................................................... 20
Grèce : en proie à la récession ............................................................ 21
Pays-Bas : à la limite du « centre » ...................................................... 21
Royaume-Uni : conservatisme budgétaire et activisme monétaire ....... 22
Australie : ralentissement de la croissance .......................................... 23
Nouvelle-Zélande : ré-accélération ...................................................... 23
Canada : ralentissement de l’immobilier résidentiel, l’endettement
inquiète les ménages ........................................................................... 24
Marchés émergents : la molle reprise .................................................. 25
Brésil : où va la BCB ? ......................................................................... 26
Russie : à la recherche d’une (meilleure) croissance ........................... 27
Inde : impression mitigée... .................................................................. 28
Chine : trajectoire stable ...................................................................... 29
Europe centrale : désendettement nécessaire, mais difficile ................ 30
Turquie : il faut confirmer en 2013........................................................ 30
Afrique du Sud : avancée poussive ...................................................... 31
Mexique : de la résilience, en attendant les réformes ........................... 31
Égypte : trois mois cruciaux ................................................................. 32
Qatar : la croissance hors hydrocarbures prend le pas ........................ 32
Taux d’intérêt ....................................................................................... 33
Taux de change ................................................................................... 35
Scénario économique du Groupe Crédit Agricole S.A. ......................... 36
Matières premières .............................................................................. 38
Comptes publics .................................................................................. 38
.
Zoom vidéo :
Encore au milieu du gué

Spécial
N°140 – 2e trimestre 2013 2
Croissance ou stabilité : l’un, l’autre ou les deux ?
Les éléments du débat entre croissance et stabilité sont assurément complexes, plongeant dans les relations internationales, la
qualité du dialogue social et politique et la façon de consolider les grands équilibres économiques. À l’horizon des prochaines
années, la préférence serait donnée à la recherche de davantage de croissance. La perspective est heureuse pour l’investisseur ;
attention toutefois à ne pas sous-estimer les risques induits.
Les investisseurs sont à la recherche si ce n’est d’une image stable de l’économie mondiale à aujourd’hui, au
moins d’une tendance perçue comme stable, permettant d’échafauder des anticipations à-peu-près raisonnables et
laissant à penser que l’ampleur des risques restera à l’intérieur de limites déjà observées et donc maîtrisables. Bien sûr,
il est facile de rétorquer qu’attendre de la stabilité de l’économie de marché (ou système ricardo-schumpétérien)
est un peu paradoxal. L’orientation n’est-elle toujours pas en faveur de l’innovation et du dynamisme, afin de créer de
nouveaux savoirs, de nouveaux produits et de nouveaux modes de production et de distribution ? Cette volonté de
changement, avec la dose d’instabilité qu’elle induit, est le prix à payer pour éviter la stagnation qu’un accent trop
marqué mis sur la stabilité amènerait
1
.
Il est évidemment possible de dire que durant deux ou trois décennies, la seconde moitié du vingtième siècle a envoyé,
au moins dans les pays occidentaux, un parfait contre-exemple à ce qui a pu apparaître au dix-neuvième siècle comme
une « loi d’airain ». De fait, au sortir de cette longue période de crise qu’ont été les années de « Grande Dépression »,
puis celles de la deuxième guerre mondiale, des systèmes très importants de protection sociale ont été mis en place. Le
but était triple : d’abord consolider des sociétés fragilisées par cette succession de crises, ensuite créer et
« solvabiliser » une demande intérieure et enfin prévenir au moins en Europe de la concurrence politique du système
communiste existant à l’Est du continent.
On le voit, la compatibilité entre dynamisme et stabilité économiques passe par la mise en place d’un cadre
politique (qu’il s’agisse d’institutions, de représentations, de régulations ou de politique économique) adéquat ; sachant
que toute inflexion majeure en faveur d’une nouvelle règle du jeu économique crée un porte-à-faux rendant de plus en
plus incompatible dynamisme et stabilité. Les deux sont malmenés et le système dans son ensemble se met à
fonctionner moins bien. N’en sommes-nous pas là aujourd’hui, avec des équilibres, tant internationaux qu’intérieurs à
chaque pays ou région, davantage sous tension ?
Une économie « globalisée » devrait appeler une gouvernance partagée au niveau d’un nouveau « Concert des
Nations », qui d’européen serait devenu mondial. Hélas, les progrès paraissent ralentir avec la formation de
nouveaux équilibres économiques, financiers et politiques autour de la planète ; comme si la règle du jeu
proposée initialement par les anciens pays du Nord ne convenait pas aux nouveaux pays du Sud. De plus, la difficulté à
dépasser le cadre de l’État-nation rend les progrès en termes de gestion commune d’une économie mondialisée difficiles
à atteindre. D’abord, le transfert de compétences du niveau national à un autre plus international ou transnational n’est
jamais évident ; les dirigeants politiques, responsables devant leurs électeurs, ont beaucoup de mal à abandonner ou à
partager une partie de leurs prérogatives. Il a fallu des circonstances historiques particulières (deux guerres mondiales)
pour que cela devienne possible en Europe à partir des années cinquante ; en Amérique, en Asie ou en Afrique, le
passé colonial freine encore toute volonté de transfert ou de partage. Ensuite, les expériences vécues ne font sans
doute pas vraiment envie : l’Union européenne traverse une crise grave et l’ONU pâtit de son incapacité à réformer son
Conseil de Sécurité, afin de refléter plus parfaitement les équilibres internationaux apparus ces dernières années.
France et Royaume-Uni : croissance du PIB réel
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Royaume-Uni
France
Source : Crédit Agricole CIB, Bloomberg
France et Royaume-Uni : taux de chômage
0
2
4
6
8
10
12
14
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Royaume-Uni
France
Source : Crédit Agricole CIB, Bloomberg
1
Le contrepoint à rechercher au couple stagnation-stabilité devrait donc être cet autre couple formé de la croissance et de l’instabilité ;
en crise, comme le montre la situation actuelle, on a à la fois la stagnation et l’instabilité ; le pire des deux mondes en quelque sorte !

Spécial
N°140 – 2e trimestre 2013 3
La création d’un cadre permettant d’ambitionner des relations internationales plus intégrées et à ce titre plus stables ne
paraît pas être en ligne de mire. La perspective participe-t-elle de l’espoir de davantage de croissance, grâce à un frein à
la créativité bureaucratique et réglementaire ? Doit-on plutôt considérer que ce blocage en termes de meilleure
intégration politique internationale est le signe de tensions entre les principaux acteurs ? Ainsi, les États-Unis et la Chine
ont bien du mal à se définir davantage comme partenaires (économiques, financiers et diplomatiques) que comme rivaux
(n’était-ce pas plus simple du temps de la Guerre Froide, avec la rivalité non remise en cause entre les États-Unis et
l’Union soviétique). Au final, il est à craindre que l’absence de progrès en matière de régulation internationale soit surtout
le reflet de relations bilatérales plus marquées du sceau de la concurrence stratégique que de la complémentarité. Dans
un monde devenant plus multipolaire, cette perspective n’est plus vraiment en faveur de davantage de
croissance par une intensification du commerce mondial ou des flux de capitaux transfrontières.
Au niveau de chaque pays, les déséquilibres sont aussi patents. Il y a d’abord la revendication des classes
moyennes des pays développés d’avoir à la fois plus d’emplois et moins d’inégalités. N’est-ce pas d’ailleurs à un
niveau individuel la translation parfaite de la revendication plus systémique de mêler dynamisme économique et
stabilité ? Il faut reconnaître deux choses : d’une part, si la mondialisation a bénéficié aux détenteurs du capital en
Occident et aux pays émergents, les classes moyennes d’Europe ou d’Amérique du Nord ont plutôt été « moins bien
servies » en termes d’augmentation de revenus (phénomène compensé en partie par la désinflation) ; d’autre part, la
crise a augmenté le chômage et rendu plus difficile l’accès à l’emploi. Sera-t-il possible de donner satisfaction aux
intéressés sur ces deux fronts ? La réponse est vraisemblablement négative et l’accent devrait être mis par les
gouvernants davantage sur les réformes de structure et donc sur l’emploi ; les inégalités persisteraient donc
encore pour un temps, dans l’attente que le retour à une croissance perçue comme solide et durable permette d’ouvrir
ce second chantier. Cette préférence donnée aux politiques d’offre sera-t-elle partout et toujours possible ? Sans doute
pas, tant le choix en faveur de la croissance par rapport à la stabilité ne peut être durablement un projet politique ou
social mobilisateur. Mais, à court terme et sous l’objectif de s’extraire le plus vite et dans les meilleures conditions de la
crise en cours, cette hiérarchie des priorités devrait être recherchée. Aux responsables politiques de faire preuve de
la pédagogie nécessaire pour que les peuples l’acceptent. Sinon se construira le troisième étage de la crise : de
financière, puis économique, elle deviendra politique. Les expériences récentes (grecque d’abord, italienne plus
récemment) montrent que le risque est réel. N’est-ce pas l’ancien président français, Jacques Chirac, qui rappelait que
« la politique n’est pas seulement l’art du possible. Il est des moments où elle devient l’art de rendre possible, ce qui est
nécessaire ».
Toujours pays par pays, il y a ensuite le débat austérité-croissance. Il fait aussi écho à la problématique dynamisme
économique versus stabilité. Pour certains, le retour rapide à la stabilité budgétaire est une pré-condition à de meilleures
perspectives de croissance ; pour d’autres, l’impératif de croissance conditionne le rythme du rééquilibrage des comptes
publics. Ce débat est très présent en Europe, avec sans doute l’Italie et la France en première ligne. Les tenants d’une
ligne critique des politiques d’austérité considèrent que celles-ci trouvent leur limite, quand les perspectives de
croissance deviennent si dégradées que cela enclenche un cercle vicieux entre resserrement budgétaire, un mix
« insuffisance de croissance/mécontentement social grandissant » et au final des objectifs de rééquilibrage des comptes
publics non atteints qui forceraient à davantage encore de serrage budgétaire.
Le raisonnement n’est évidemment pas dénué de sens, surtout à des moments de plus forte sensibilité de la conjointure
au réglage de la politique budgétaire (le fameux multiplicateur budgétaire qui aurait augmenté avec la crise en cours). Il
n’empêche que le débat ne peut pas être appréhendé uniquement sous un aspect normatif : voici ce qu’il faut
faire ! Même s’il est exact que la contrainte de réduire de concert les dettes privée et publique hypothèque d’autant les
perspectives de croissance et fait d’autant craindre l’enclenchement de ce cercle vicieux entre rééquilibrage des
comptes et insuffisance de croissance. L’existence de cette contrainte aurait toutefois dû « mettre la puce à l’oreille » sur
la réalité d’un jeu d’acteurs à absolument prendre en compte. Dans une perspective de court terme, ils ne sont pas
tous sur la même position (à moyen terme, le consensus se dégage plus facilement, avec l’idée qu’une gestion prudente
des finances publiques – pour faire simple, tendre à l’équilibre en moyenne sur le cycle conjoncturel – participe d’un bon
fonctionnement de l’économie).
Commerce mondial
-40%
-20%
0%
20%
40%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
%, a/a
Source : Crédit Agricole CIB, Bloomberg
Flux financiers mondiaux
0,5 1
4,9
11,8
2,2 1,7
6,1
4,6
0
2
4
6
8
10
12
14
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
% PIB
Source : McKinsey

Spécial
N°140 – 2e trimestre 2013 4
D’un côté, les créanciers des États souverains (du Hedge Fund à l’épargnant moyen, en passant par les fonds de
retraite) et les paires à l’intérieur de la zone euro (qui savent que plus d’intégration européenne passe par une
convergence par le haut des performances économiques et financières des pays-membres) ne peuvent que faire
pression pour que la remise en ordre des comptes publics se fasse à bon rythme. Et comme ils tiennent les « cordons de
la bourse », ils ont de vrais moyens de pression. De l’autre, les citoyens et les entreprises concernés, payeurs d’impôts
et récipiendaires de prestations et d’aides, ne voient pas d’un bon œil, soit d’être mis plus à contribution, soit de recevoir
moins. Et ils disposent de leviers pour se faire entendre des pouvoirs publics ; du bulletin de vote au lobbying, sans
oublier le simple travail de conviction sur la dangerosité du resserrement budgétaire en période de croissance anémique.
La synthèse entre ces forces contradictoires n’est pas facile à faire. Mais la vision largement partagée sur les objectifs
de moyen terme et l’insistance de ceux qui assurent refinancement et/ou assistance feraient plutôt pencher la balance
en faveur du nécessaire rééquilibrage des comptes publics, comme condition du retour à une croissance plus
équilibrée et donc plus soutenable.
On le voit, les éléments du débat entre croissance et stabilité ne paraissent pas se dénouer en faveur de la
stabilité. Tant les relations sociales que les relations internationales risquent d’être plus tendues à l’horizon des
trimestres et années à venir. Si la tension au niveau des premières peut être le prix à payer d’un retour progressif à
plus de croissance, les perspectives paraissent différentes avec les secondes. Un monde multipolaire, dans lequel les
« nouveaux entrants » que sont les grands pays émergents prendront de plus en plus toute leur place, se traduirait
surtout par la définition d’une nouvelle géographie des échanges ; le resourcing, qu’on observe déjà, se poursuivrait,
voire se renforcerait. Au-delà des raisons liées à l’évolution des coûts salariaux dans certains « Grands Émergents » et
aussi des coûts de transport, n’est-ce pas une des conséquences à attendre d’un monde moins harmonieux, moins
lisible et peut-être ressenti comme moins stable ?
Qu’est-ce que l’investisseur doit retenir ? En termes d’espérance de rendement, les actifs « risqués » comme les
actions devraient être privilégiés. Avec le retour progressif aux États-Unis et en Europe à des anticipations de croissance
plus confiantes, davantage guidées par un surcroît d’efficacité des systèmes productifs que par une meilleure orientation
de la demande du consommateur, on devrait aussi retrouver une meilleure relation entre la dynamique des indices
actions et celle du rendement des titres d’État : les deux, montant à nouveau de concert. Pour ce qui est de l’évolution
des taux d’intérêt à long terme, deux remarques s’imposent. D’abord et progressivement, l’activisme des Banques
centrales, sous la forme d’une expansion de leur bilan, s’atténuerait, puis se corrigerait ; ensuite, les anticipations
d’inflation resteraient modérées en Occident, en relation avec la modération persistante des dépenses des ménages.
Où se trouvent les risques liés à ce scénario ? D’une part, dans les relations sociales et les équilibres politiques de
chaque pays, comme déjà expliqué ; d’autre part, dans les relations entre pays et ceci avec deux grands enjeux. Au
niveau mondial, est-on sûr que la balance entre concurrence stratégique et complémentarité commerciale penchera de
ce second côté ? Au niveau européen, quid de la capacité à aller de façon harmonieuse mais décidée vers davantage
d’intégration ?
Hervé GOULLETQUER
herve.goulletq[email protected]
États-Unis : part du revenu salarial dans le revenu national
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Source : Crédit Agricole CIB, Bloomberg
Europe : déficit public
-12
-9
-6
-3
0
3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% PIB
France Royaume-Uni
Italie Espagne
Allemagne
Source : CA CIB, Bloomberg

Risques
N°140 – 2e trimestre 2013 5
Ne pas rouvrir la boîte de Pandore des risques extrêmes
Le résultat des élections italiennes a ravivé les vieilles peurs quant à l’avenir de la zone euro, à un moment où la plupart des
marchés acceptaient l’idée selon laquelle la crise de la dette européenne, tout en restant un problème majeur, avait été ramenée à
une échelle régionale. Les autres problèmes sont gérables, si la boîte de Pandore des risques extrêmes n’est pas rouverte.
Tout d’abord, le risque économique a globalement baissé. La croissance sera proche de 2% à partir du deuxième
trimestre aux États-Unis, même en tenant compte des conséquences significatives des restrictions budgétaires. La stagnation
du PIB au quatrième trimestre 2012 a clairement été un accident lié à des facteurs techniques : les indices ISM et les enquêtes
suggèrent un niveau de croissance acceptable dans les mois qui viennent. Comme nous l’avons toujours soutenu, il n’y a pas
eu d’atterrissage en catastrophe en Chine et la croissance devrait être tout à fait acceptable en 2013 (près de 8%), en
grande partie grâce aux mesures de relance mises en œuvre en 2012, qui continuent de faire effet. Nous prévoyons même un
léger resserrement de la part des autorités chinoises en 2013, ces dernières cherchant une croissance plus soutenable avec
moins d’inflation. La zone euro restera en territoire quasi-récessif durant la majeure partie de l'année, avec de plus un fort
risque baissier à court terme (cf. infra), mais ne décevra pas ; puisqu’il n’y a pas d’excès d’optimisme sur cette région.
Austérité, récession, gains de compétitivité via la déflation : la situation de l’Europe est bien connue.
Le risque politique s’est également réduit, sauf en Europe. Aux États-Unis, la polarisation reste certes élevée à
Washington, mais les parties en présence ont montré qu’elles savaient ne pas aller trop loin. Le problème de la « falaise
budgétaire » a été découpé en sous-parties plus faciles à gérer, qui sont traitées (ou remises à plus tard) séparément. Les
tensions politiques sont à leur tour quelque peu retombées. La transition politique se passe sans heurt en Chine et la
stabilité semble acquise. Il y a certes des tensions avec le Japon, mais aucun signe d’impérialisme agressif à proprement parler
(pas de tensions particulières avec Taiwan, par exemple).
La principale menace reste le risque politique en Europe. L’Italie n’est actuellement pas gouvernable, le gouvernement a
été mis en péril par des affaires intérieures et les signaux lancés par la France (réforme-t-elle ou non ?) sont, au mieux, mitigés.
Avec un taux de chômage des jeunes de moins de vingt-cinq ans de près de 60% en Espagne et en Grèce et de 37% en
Italie, le risque de la tentation populiste est sérieux et durable : le marché va devoir s’y habituer. L’histoire récente
suggère que, lorsqu’un pays est au bord du précipice (comme l’était la Grèce au moment des deuxièmes élections législatives
en juin 2012), les électeurs font généralement le choix de la raison. Mais nous n’en sommes pas encore là en Italie ou en
France. À l’échelle européenne, le rythme des réformes baisse déjà, en raison de l’approche des élections en Allemagne. À cet
égard, l’Europe connaîtra une certaine faiblesse jusqu’en octobre.
En ce qui concerne les risques de marché, la menace la plus vraisemblable vient du retour possible, et même probable,
de la volatilité, retour lié au léger resserrement attendu en Chine et à un discours potentiellement moins favorable au QE
(assouplissement quantitatif) de la part de la Fed, avec la baisse graduelle du chômage. Mais cela ne tiendrait après tout que
d’une certaine normalisation : une volatilité anormalement basse pendant une période anormalement longue n’est pas
souhaitable, dans la mesure où elle encourage les opérations de portage de toute nature. Un risque plus dangereux serait alors
l’explosion de bulles sur certaines classes d’actifs surévalués, mais il nous semble que ce risque est limité, tant que la Fed
conserve une approche prudente. Les actifs les plus surévalués (cf. article Risques – Perspectives Macro de décembre 2012)
étaient l’or et le yen, qui ont tous deux continué à s’ajuster au premier trimestre. Aucune classe d’actif ne devrait subir de forte
baisse, selon nous. Nous tablons à l’inverse sur une progression graduelle, mais erratique, des actifs risqués (et une correction
des valeurs refuges), lorsque la croissance américaine retrouvera la région des 2%.
Le principal problème reste le risque politique européen. La BCE a fait ce qu’elle avait à faire, mais les règles étaient
claires : les pays de la zone euro devaient se montrer plus sérieux, en particulier en ce qui concerne les réformes structurelles
et l’exécution du budget. La BCE attendra des résultats avant de faire davantage ; tandis que les gouvernements pourraient
être tentés de jouer la montre, en attendant que les choses s’améliorent d’elles-mêmes ou grâce aux consommateurs de
dernier ressort (américains, allemands ou émergents). Ce « jeu » dans lequel chacun a intérêt à ne rien faire et à laisser l’autre
céder le premier est dangereux et pourrait amener les marchés à rouvrir la boîte de Pandore du risque systémique. Il n’est dès
lors pas étonnant que tout le monde surveille l’Italie… et la France.
Hervé GOULLETQUER Jean-François PERRIN
Croissance chinoise : pas d’atterrissage en catastrophe en vue
-5
0
5
10
15
-5
0
5
10
15
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Contributions à la croissance
demande (a/a, %)
Conso. Investissement
Commerce ext. PIB total
Prév.
Source : CEIC, Crédit Agricole CIB
Un exemple de risque politique futur : le chômage en Espagne
0
10
20
30
40
50
60
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013
Chômage des jeunes (<25 ans)
Chômage total
Source : Bloomberg,
Crédit Agricole CIB
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%