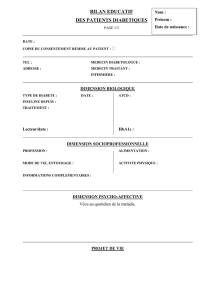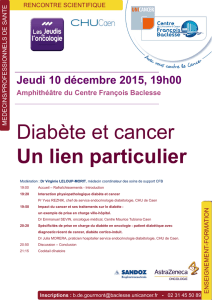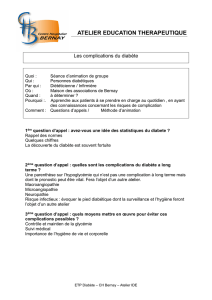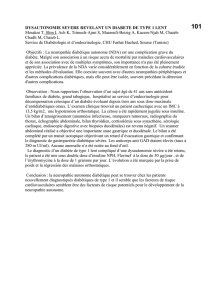item 233 : diabete sucre de type 1 et 2 de l`enfant et de l`adulte

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004
www.endocrino.net Page 1 sur 43
ITEM 233 : DIABETE SUCRE DE TYPE 1 ET 2 DE L’ENFANT
ET DE L’ADULTE
Objectifs pédagogiques terminaux : « diagnostiquer un diabète chez l’enfant et chez l’adulte », « identifier les
situations d’urgence et planifier leur prise en charge », « argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi
du patient », « décrire les principes de la prise en charge au long cours »
Définition ; diagnostic ;
Tableau I : Caractéristiques des diabètes de type 1 et 2
1. Diabète de type 1
1.a Epidémiologie
1.b Physiopathologie
1.c Signes cliniques
1.d Evolution
1.e Prise en charge thérapeutique
1.e.1 Principes généraux
1.e.2 Autosurveillance
1.e.3 Surveillance
1.e.4 Traitement insulinique
1.e.5 Traitements non insuliniques
1.f Cas particuliers
2. Diabète de type 2
2.a Epidémiologie
2b Physiopathologie
2.c Signes cliniques ; Dépistage
2.d Evolution
2.e Traitement
2.e.1 Principes généraux
2.e.2 Moyens de surveillance : HbA1c, glycémie
2.e.3. Activité physique
2.e.4 Diététique
2.e.5. Antidiabétiques oraux : biguanides, insulino-secréteurs (sulfamides, glinides), inhibiteurs
des α-glucosidases, glitazones
2.e.6. Insulinothérapie
3. Complications dégénératives du diabète
3.a Microangiopathie
3.a.1 Rétinopathie
3.a.2. Neuropathie
3.a.3. Néphropathie
3.b Macroangiopathie et facteurs de risque vasculaire
3.b.1 Artériopathie des membres inférieurs
3.b.2. Cœur et diabète
3.b.3 HTA
3.b.4 Dyslipidémies
3.c Pied diabétique
3.d Suivi des complications (ANAES)
4. Autres complications du diabète
4.a Complications cutanées
4.b Complications buccales
4.c Complications ostéo-articulaires
5. Complications métaboliques du diabète
5.a Coma céto-acidosique
5.b Coma hyperosmolaire
5.c Hypoglycémies

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004
www.endocrino.net Page 1 sur 43
DIABETE - DEFINITION ; DIAGNOSTIC
Recommandations de l’OMS:
♦ Glycémie à jeun normale < 1,10 g/l
♦ Hyperglycémie modérée à jeun si glycémie > 1,10 g/l et ≤ 1,26 g/l
= seuil d’augmentation du risque vasculaire
♦ Diabète sucré si:
- glycémie à jeun ≥ 1.26 g/l (à 2 reprises)
= seuil d’apparition de la microangiopathie diabétique (rétinopathie)
- ou glycémie aléatoire ≥ 2 g/l et signes cliniques d’hyperglycémie
Tableau I : CARACTERISTIQUES RESPECTIVES DES DIABETES DE TYPE 1 ET 2
Type 1 Type 2
Antécédents familiaux du même type souvent 0 souvent +
Age de survenue avant 35 ans après 40 ans
Début rapide ou explosif lent et insidieux
Facteur déclenchant souvent + souvent +
Symptomatologie bruyante pauvre ou absente
Poids normal ou maigre obésité ou surcharge
adipeuse abdominale
Hyperglycémie au diagnostic majeure > 3 g/l souvent < 2 g/l
Cétose souvent ++ à ++++ le plus souvent 0
Complication dégénérative absente présente dans 50 % des cas
au moment du diagnostic
Cause principale de mortalité insuffisance rénale maladie cardiovasculaire

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004
www.endocrino.net Page 2 sur 43
1. DIABETE DE TYPE 1
1.a EPIDEMIOLOGIE ; ENQUETE DE LA CNAMTS, 1999
♦ Notion de gradient nord/sud europe
♦ Prévalence en France : 200 000 (15 % des diabétiques)
♦ Incidence 7,8 pour 100 000 et par an
♦ Survient habituellement avant 35 ans (pic à l’adolescence) mais peut survenir à tous âges
♦ Age moyen de la population suivie = 37 ans
♦ Augmentation + 4% par an surtout avant 5 ans
♦ Sex ratio = 1
1.b PHYSIOPATHOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 1
Carence absolue en insuline par destruction des cellules β pancréatiques.
Synonyme : diabète insulinodépendant
Deux sous-types :
- diabète de type 1 auto-immun (le plus fréquent(>90% en Europe)) incluant le type 1 lent
- diabète de type 1 idiopathique (absence d’anticorps) :cadre nosologique mal défini
incluant diabète du sujet noir originaire d’Afrique sub-saharienne, diabète suraigu
japonais, MODY 3.
A) Prédisposition génétique (tableau II)
- présente même si dans 95 % des cas n’existent pas d’antécédents familiaux
- liaison avec HLA, DR3, DR4, DQ, B1 * 0302
- HLA protecteur : DR2, DQ, W1-2 DQB1*0602
- Beaucoup d’ autres gènes/maladie multigénique
Tableau II
Risques de diabète de type 1 en France
Risque dans la population générale
Apparenté de 1er degré
Deux parents diabétiques
Apparenté de 1er degré avec HLA identique
Apparenté de 1er degré avec HLA identique et
DR3 ou 4
Jumeaux
Jumeaux + DR3 ou 4
0.4 %
5 %
30 %
12 %
16 %
50 %
70 %

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004
www.endocrino.net Page 3 sur 43
B) Facteurs environnementaux
- expliqueraient au moins 50 % de la pathogénie puisque 50 % de paires de jumeaux sont
non concordants
- nombreux virus et toxiques suspectés, mais aucun prouvé
- à ne pas confondre avec le facteur déclenchant (grippe, stress).
C) Processus auto-immun
- insulite puis destruction des cellules β par lymphocytes cytotoxiques ( type 1 = maladie
du lymphocyte T) et cytokines
- au moins un des auto-anticorps témoins circulants détectable dans 85 % des cas :
anticorps anti-ilôts (ICA), anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline.
- Processus étalé sur plusieurs années avant et après l’apparition du diabète (cf. 1.d
Evolution)
- Fréquence des autres maladies auto-immunes associées et des anticorps spécifiques
d’organes (15 %)
- Notion de glucotoxicité surajoutée : aggravation du déficit insulaire par l’hyperglycémie
- Notions sur les modèles animaux ( souris NOD et BB)
1.c SIGNES CLINIQUES
A) Présentation clinique initiale habituelle
- Début rapide ou explosif (quelques semaines)
- Syndrome cardinal (polyuro-polydypsie, amaigrissement), polyphagie
- plus troubles visuels transitoires (réfraction)
- Examen pauvre : fonte musculaire (quadriceps) rarement hépatomégalie, rechercher
signes d’acidose
- Diagnostic par mesure de la glycémie (souvent supérieure à 3 g/l)
- Autres éléments : glycosurie massive (notion de seuil rénal), cétonurie,
hypertriglycéridémie.
- Révélation possible par une acido-cétose
B) Formes du diabète de type 1
♦ formes particulières :
- type 1 lent ou LADA. Début tardif et progressif comme le type 2 mais anticorps positifs
et insulinodépendance en 5 à 10 ans. 10 % des « types 2 » sont en fait des LADA.
- Diabète du sujet noir d’origine africaine sub-saharienne (bush diabetes). Début cétosique
puis évolution vers l’insulino-indépendance mais avec épuisement rapide des réserves
pancréatiques. Anticorps négatifs.
♦ Autres cas
- Diagnostic tardif au stade de cétose (voir plus loin)
- Diagnostic pré-clinique à l’occasion d’une analyse de fratrie, d’une glycémie fortuite :
dosage des anticorps ICA + GAD + IA2 . Prédiction positive 60 à 100 % de risque de
diabète à 5 ans si les 3 sont associés, groupe HLA peu d’intérêt (car gènes prédisposants

©Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Mise à jour décembre 2004
www.endocrino.net Page 4 sur 43
présents dans 30% de la population normale), mais prédictivité négative du gène
protecteur
C) Affirmer le type 1
- Clinique suffisante si non obèse + cétose + âge < 35 ans
- Si un des critères manque : anticorps ± groupe HLA
- Eliminer les autres formes de diabètes (tableau III), MODY 3, MIDD par la clinique et
l’interrogatoire
Tableau III
Autres formes de diabète
♦ Diabète gestationnel
♦ Diabète génétique monogénique
- MODY
- Diabète mitochondrial
♦ Atteinte anatomique du pancréas endocrine
- pancréatite chronique (calcifiée ou non)
- pancréatectomie totale
- cancer du pancréas
- hémochromatose
- mucoviscidose
♦ Inhibition fonctionnelle de l'insulinosecrétion
- hypokaliémies (diurétiques sulfamidés, laxatifs, hyperaldostéronismes…)
- diabète transitoire induit par un jeûne prolongé avec dénutrition
- phéochromocytome (rare; l'hypersécrétion de catécholamines entraîne aussi une
insulinorésistance)
- somatostatinome (rarissime)
♦ Diabète du glucagonome (rarissime). Il s'accompagne de lésions cutanées spécifiques
♦ Défauts génétiques de l’action de l’insuline : Insulinorésistance primitive profonde ±
acanthosis nigricans
- anomalie ou absence de récepteurs de l'insuline
- diabète lipoatrophique
- anomalies primitives postrécepteurs
♦ Insulinorésistance secondaire
- hypercorticisme (corticoïdes, plus rarement hypercorticisme)
- acromégalie
- hyperthyroïdie
♦ Diabètes iatrogènes
- corticoïdes (sous toutes les formes)
- diurétiques hypokaliémiants, laxatifs
- progestatifs de synthèse de type norstéroïdes
- sympathicomimétiques (Salbutamol)
- antiprotéases utilisés dans le traitement du SIDA
- Vacor, pentamidine
- interféron (discuté)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%