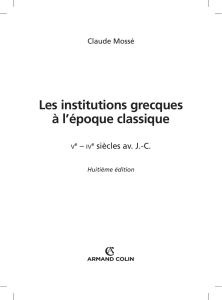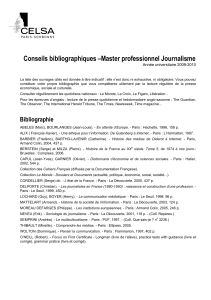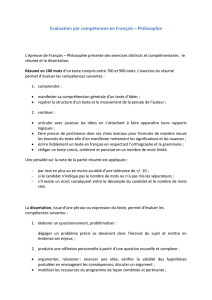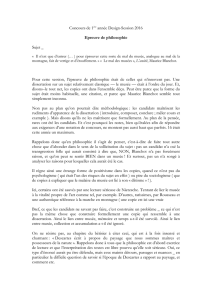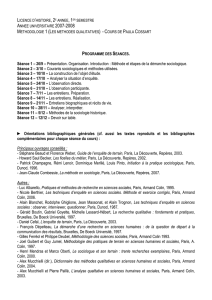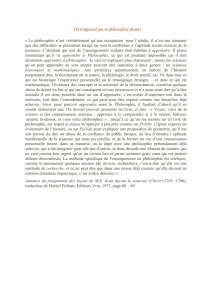Anthologie de textes philosophiques

Anthologie de textes philosophiques
- Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité – p. 13
- Emmanuel Kant, Abrégé de philosophie. Leçons sur l’encyclopédie philosophique – p. 20
- Henri Bergson, La pensée et le mouvant – p. 36
- Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger – p. 47
- Emmanuel Kant, Réflexion sur l’éducation – p. 71
- Platon, Apologie de Socrate – p. 71
- Sören Kierkegaard, Traité du désespoir – p. 72
- Montesquieu, De l’esprit des lois – p. 82
- Nicolas Machiavel, Le Prince – p. 83
- Michel de Montaigne - Essais – p. 97
- Thomas Reid, Recherches sur l’entendement humain d’après les principes du sens commun – p. 99
- John Stuart Mill, De la Liberté – p. 102
- Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique – p. 109
- Freud, Totem et tabou – p. 110
- David Hume, « De l’impudence et de la modestie » – p. 110
- Aristote, Les Politiques – p. 116
- Thomas Hobbes, Léviathan – p. 117
- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique – p. 117
- Alain, Système des beaux-arts – p. 128
- Étienne Bonnot de Condillac, Traité des sensations – p. 129
- Empiricus Sexus, Esquisses pyrrhoniennes – p. 131
- Emmanuel Kant, Critique de la raison – p. 139
- David Hume, Traité de la nature humaine – p. 142
- Pierre Duhem, La théorie physique – p. 143
- Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation – p. 152
- Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique – p. 152
- René Descartes, Les passions de l’âme – p. 158
- Aristote, Éthique à Nicomaque – p. 165
- Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion – p. 166
- Baruch Spinozza, Traité théologico-politique – p. 168
- Friedrich Nietzche, Fragments posthumes – p. 169
- Plotin, Ennéades – p. 178
- Hegel, Esthétique – p. 180
- Alain, Système des beaux-arts – p. 181
- John Stuart Mill, La Nature – p. 191
- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – p. 191
- Epictète, Manuel – p. 202
- Platon, Gorgias – p. 203
- Descartes, « Lettre au Père Mesland, 9 février 1645 » - p. 204
1 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

p. 13 Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité [1674],
Livre III, IIe partie, chapitre VII :
« Quatre manières de voir les choses.
La première, est de connaître les choses par elles-mêmes.
La seconde, de les connaître par leurs idées, c'est-à-dire, comme je l’entends ici, par
quelque chose qui soit différent d’elles.
La troisième, de les connaître par conscience, ou par sentiment intérieur.
La quatrième, de les connaître par conjecture. [...]
Il n'y a que Dieu que l’on connaisse par lui-même : car encore qu’il y ait d’autres êtres
spirituels que lui, et qui semblent être intelligibles par leur nature, il n'y a que lui seul qui
puisse agir dans l’esprit, et se découvrir à lui. Il n'y a que dieu que nous voyions d’une
vue immédiate et directe. Il n'y a que lui qui puisse éclairer l’esprit par sa propre
substance. [...]
On ne peut douter que l’on ne voie les corps avec leurs propriétés par leurs idées ; parce
que n’étant pas intelligibles par eux-mêmes, nous ne les pouvons voir que dans l’être, qui
les renferme d’une manière intelligible. Ainsi c'est en Dieu, et par leurs idées, que nous
pouvons voir les corps avec leurs propriétés ; et c'est pour cela que la connaissance que
nous en avons est très parfaite : je veux dire, que l’idée que nous avons de l’étendue
suffit pour nous faire connaître toutes les propriétés, dont l’étendue est capable [...].
Il n’en est pas de même de l’âme, nous ne la connaissons point par son idée : nous ne la
voyons point en Dieu : nous ne la connaissons que par conscience ; et c'est pour cela que
la connaissance que nous en avons est imparfaite. Nous ne savons de notre âme, que ce
que nous sentons se passer en nous. Si nous n’avions jamais senti de douleur, de chaleur,
de lumière, etc., nous ne pourrions savoir si notre âme en serait capable, parce que nous
ne la connaissons point par son idée. Mais si nous voyions en Dieu l’idée qui répond à
notre âme, nous connaîtrions en même temps, ou nous pourrions connaître toutes les
propriétés dont elle est capable : comme nous connaissons ou nous pouvons connaître
toutes les propriétés dont l’étendue est capable parce que nous connaissons l’étendue par
son idée.
Il est vrai que nous connaissons assez par notre conscience, ou par le sentiment intérieur,
que nous avons de nous-même, que notre âme est quelque chose de grand ; mais il se
peut faire que ce que nous en connaissons ne soit presque rien de ce qu’elle est en elle-
même. [...]
Encore que nous n’ayons pas une entière connaissance de notre âme, celle que nous en
avons par conscience ou sentiment intérieur suffit pour en démontrer l’immortalité, la
spiritualité, la liberté et quelques autres attributs qu’il est nécessaire que nous sachions.
[...] La connaissance que nous avons de notre âme par conscience est imparfaite, il est
vrai, mais elle n'est point fausse. »
2 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

p. 20 Emmanuel Kant, Abrégé de philosophie. Leçons sur
l’encyclopédie philosophique [cours professés dans les années qui
précèdent la Critique de la raison pure] :
« La science qui contient toutes les connaissances rationnelles par concepts est la
philosophie. [...]
Même si une connaissance est philosophique quant à sa matière, elle peut être historique
du point de vue de sa forme, par exemple lorsqu'on ne pense pas soi-même une
connaissance rationnelle, mais qu'on l'imite. Une telle connaissance philosophique peut
bien être objective, mais elle est produite historiquement par tel ou tel sujet. [...]
Aucun professeur de philosophie ne peut être parfait s'il n'a fait qu'apprendre la
philosophie par cœur. Mais en réalité aucune philosophie ne peut être apprise par cœur,
puisqu'il faut pour cela qu'un philosophe ait d'abord fourni un modèle sans défaut, et qui
soit par conséquent susceptible d'être imité. [...] Philosopher ne veut pas dire imiter la
pensée de quelqu'un, mais penser par soi-même, et même a priori. Un professeur de
philosophie ne doit pas simplement expliquer un auteur, mais instruire en même temps
de la méthode selon laquelle on doit philosopher. La philosophie a pour objets toutes les
connaissances humaines des choses, quelles qu'elles soient. Elle est en même temps le
plus haut tribunal de la raison.
p. 36 Henri Bergson, La pensée et le mouvant [1934], Introduction
(deuxième partie), extrait :
« Une idée neuve peut être claire parce qu’elle nous présente, simplement arrangées
dans un nouvel ordre, des idées élémentaires que nous possédions déjà. Notre
intelligence, ne trouvant alors dans le nouveau que de l’ancien, se sent en pays de
connaissance ; elle est à son aise ; elle « comprend ». Telle est la clarté que nous
désirons, que nous recherchons, et dont nous savons toujours gré à celui qui nous
l’apporte. Il en est une autre, que nous subissons, et qui ne s’impose d’ailleurs qu’à la
longue. C’est celle de l’idée radicalement neuve et absolument simple, qui capte plus ou
moins une intuition. Comme nous ne pouvons la reconstituer avec des éléments
préexistants, puisqu’elle n’a pas d’éléments, et comme, d’autre part, comprendre sans
effort consiste à recomposer le nouveau avec de l’ancien, notre premier mouvement est
de la dire incompréhensible. Mais acceptons-la provisoirement, promenons-nous avec
elle dans les divers départements de notre connaissance : nous la verrons, elle obscure,
dissiper des obscurités. Par elle, des problèmes que nous jugions insolubles vont se
résoudre ou plutôt se dissoudre, soit pour disparaître définitivement soit pour se poser
autrement. De ce qu’elle aura fait pour ces problèmes elle bénéficiera alors à son tour.
Chacun d’eux, intellectuel, lui communiquera quelque chose de son intellectualité. Ainsi
intellectualisée, elle pourra être braquée à nouveau sur les problèmes qui l’auront servie
après s’être servis d’elle ; elle dissipera, encore mieux, l’obscurité qui les entourait, et
elle en deviendra elle-même plus claire. Il faut donc distinguer entre les idées qui gardent
pour elles leur lumière, la faisant d’ailleurs pénétrer tout de suite dans leurs moindres
recoins, et celles dont le rayonnement est extérieur, illuminant toute une région de la
pensée. Celles-ci peuvent commencer par être intérieurement obscures ; mais la lumière
qu’elles projettent autour d’elles leur revient par réflexion, les pénètre de plus en plus
3 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

profondément ; et elles ont alors le double pouvoir d’éclairer le reste et de s’éclairer
elles-mêmes.
Encore faut-il leur en laisser le temps. Le philosophe n’a pas toujours cette patience.
Combien n’est-il pas plus simple de s’en tenir aux notions emmagasinées dans le
langage ! Ces idées ont été formées par l’intelligence au fur et à mesure de ses besoins.
Elles correspondent à un découpage de la réalité selon les lignes qu’il faut suivre pour
agir commodément sur elle. Le plus souvent, elles distribuent les objets et les faits
d’après l’avantage que nous en pouvons tirer, jetant pêle-mêle dans le même
compartiment intellectuel tout ce qui intéresse le même besoin. Quand nous réagissons
identiquement à des perceptions différentes, nous disons que nous sommes devant des
objets « du même genre ». Quand nous réagissons en deux sens contraires, nous
répartissons les objets entre deux « genres opposés ». Sera clair alors, par définition, ce
qui pourra se résoudre en généralités ainsi obtenues, obscur ce qui ne s’y ramènera pas.
Par-là s’explique l’infériorité frappante du point de vue intuitif dans la controverse
philosophique. Écoutez discuter ensemble deux philosophes dont l’un tient pour le
déterminisme et l’autre pour la liberté : c’est toujours le déterministe qui paraît avoir
raison. Il peut être novice, et son adversaire expérimenté. Il peut plaider nonchalamment
sa cause, tandis que l’autre sue sang et eau pour la sienne. On dira toujours de lui qu’il
est simple, qu’il est clair, qu’il est vrai. Il l’est aisément et naturellement, n’ayant qu’à
ramasser des pensées toutes prêtes et des phrases déjà faites : science, langage, sens
commun, l’intelligence entière est à son service. La critique d’une philosophie intuitive
est si facile, et elle est si sure d’être bien accueillie, qu’elle tentera toujours le débutant.
Plus tard pourra venir le regret, – à moins pourtant qu’il n’y ait incompréhension native
et, par dépit, ressentiment personnel à l’égard de tout ce qui n’est pas réductible à la
lettre, de tout ce qui est proprement esprit. Cela arrive, car la philosophie, elle aussi, a ses
scribes et ses pharisiens.
Nous assignons donc à la métaphysique un objet limité, principalement l’esprit, et une
méthode spéciale, avant tout l’intuition. Par là nous distinguons nettement la
métaphysique de la science. Mais par là aussi nous leur attribuons une égale valeur. Nous
croyons qu’elles peuvent, l’une et l’autre, toucher le fond de la réalité. »
p. 47 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger [1790], § 40 :
« [...] Sous l’expression de sensus communis, il faut entendre l’idée d’un sens commun à
tous, c'est-à-dire l’idée d’une faculté de juger qui dans sa réflexion tient compte,
lorsqu’elle pense (a priori), du mode de représentation de tous les autres humains afin
d’étayer son jugement pour ainsi dire de la raison humaine dans son entier, et ainsi
échapper à l’illusion qui, produite par des conditions subjectives de l’ordre du particulier,
exercerait sur le jugement une influence néfaste. [...] Voici quelles sont ces maximes [du
sens commun] : 1. penser par soi-même ; 2. penser en se mettant à la place de tout autre
être humain ; 3. penser toujours en accord avec soi-même. La première est la maxime de
la pensée sans préjugé, la deuxième celle de la pensée ouverte, la troisième celle de la
pensée conséquente. La première est la maxime de d’une raison qui n'est jamais passive.
Le préjugé est la tendance à la passivité, donc à l’hétéronomie de la raison [...].
L’Aufklärung, c'est se libérer de la superstition [...]. »
4 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017

p. 71 Emmanuel Kant, Réflexions sur l’éducation [1787] :
« Dans l’éducation, il faut donc :
1° Discipliner l’homme. Discipliner, c'est chercher à empêcher l’animalité de porter
préjudice à l’humanité, dans l’individu comme dans l’homme social. La discipline n'est
donc que l’approvisionnement de la sauvagerie.
2° Il faut cultiver l’homme. La culture comprend l’enseignement par la règle et par
l’exemple. Elle consiste à procurer l’habileté. L’habileté est possession d’une capacité
suffisant à toute fin [...].
Quelques formes de l’habileté sont bonnes en tous les cas, par exemple la lecture et
l’écriture ; d’autres ne servent qu’à un petit nombre de fins, par exemple la musique à
celle de nous rendre aimables. La multitude des fins étend en quelque sorte jusqu’à
l’illimité le domaine de l’habileté.
3° Il faut veiller à ce que l’homme devienne également prudent, qu’il soit à sa place dans
la société humaine, qu’il ait faveur et influence. Cela implique une certaine forme de
culture que l’on nomme civilisation [...].
4° Il faut veiller à sa moralisation. L’homme ne doit pas être habile à toutes sortes de
fins, il doit aussi acquérir la disposition d’esprit qui ne lui fasse choisir que de bonnes
fins. »
p. 71 Platon, Apologie de Socrate, Flammarion, 2008 :
« Mais peut-être y aura-t-il quelqu'un pour dire : ‘‘tu ne pourrais donc pas, Socrate, une
fois que tu nous auras débarrassés de ta présence, vivre en te tenant tranquille, sans
discourir ?’’ Ma réponse serait encore plus difficile à faire admettre à certains d’entre
vous. Vous ne me croirez pas et vous penserez que je pratique l’ironie si, en effet, je vous
réponds que ce serait là désobéir au dieu, et que, pour cette raison, il m'est impossible de
me tenir tranquille. Et si j’ajoute que, pour un homme, le bien le plus grand est de
s’entretenir tous les jours de la vertu et de tout ce dont vous m’entendez discuter, lorsque
je soumets les autres et moi-même à cet examen, et que je vais jusqu’à dire qu’une vie à
laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d’être vécue – je vous convaincrai
encore moins. »
p. 72 Sören Kierkegaard, Traité du désespoir [1849] :
« Le déterministe, le fataliste sont des désespérés, qui ont perdu leur moi, parce qu’il n'y
a plus pour eux que de la nécessité. [...] La personnalité est une synthèse de possible et
de nécessité. Sa durée dépend donc, comme la respiration (re-spiratio), d’une alternance
de souffle. Le moi du déterministe ne respire pas, car la nécessité pure est irrespirable et
asphyxie bel et bien le moi. Le désespoir du fataliste, c'est ayant perdu Dieu, d’avoir
perdu son moi ; manquer de Dieu, c'est manquer de moi. Le fataliste est sans un Dieu,
autrement dit, le sien, c'est la nécessité ; car à Dieu tout étant possible, Dieu c'est la
possibilité pure, l’absence de la nécessité. Par suite, le culte du fataliste est au plus une
interjection et, par essence, mutisme, soumissions muettes, impuissance de prier. Prier,
c'est encore respirer, et le possible est au moi, comme à nos poumons l’oxygène [...]. »
5 La dissertation de philosophie. Méthodes et ressources, Étienne Akamatsu, Armand Colin 2017
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%