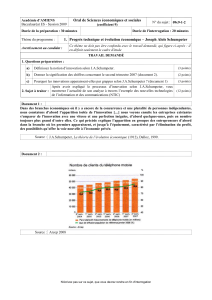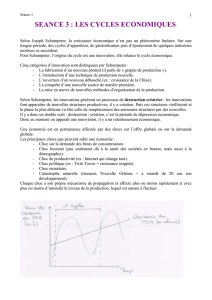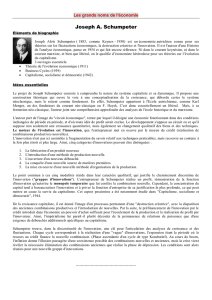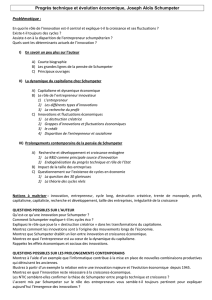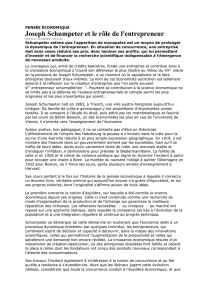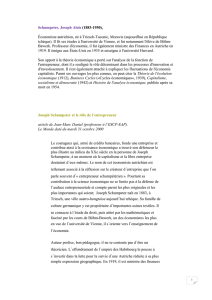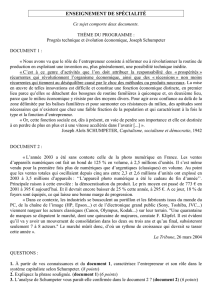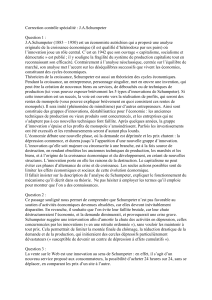Schumpeter reste-t-il d`actualité ? Recherche Académique sur l

1
Schumpeter reste-t-il d’actualité ?
Recherche Académique
sur l’Economie de l’Innovation
Réalisé Par Mr Ezzaoui Abdelkader
Doctorant au Centre de Recherche sur les Institutions, L'industrie et les
Systèmes Economiques D'Amiens.
Université de Picardie Jules Verne
France

2
es médias présentent journellement la compétition entre nations comme un problème de
compétitivité. Les exemples allemand et japonais montrent que la qualité des produits, leur aspect
novateur sont des éléments importants. Ce faisant, on introduit le rôle fondamental de la recherche
pure, donnant naissance aux inventions, et de la mise sur le marché de ces produits, c'est-à-dire l’innovation.
Ainsi, on réaffirme l’actualité de l’analyse de J.A. Schumpeter (1883-1950). Cet économiste américain
d’origine autrichienne, tout en étant libéral, emprunte à plusieurs écoles, ce qui en fait un “ inclassable ”. Sa
pensée n’est pas réductrice : il intègre l’histoire économique et sociale, ainsi que des éléments sociologiques.
Ouvrages principaux : “ théorie de l’évolution économique ” (1912), “ business cycles ” (1939), “
capitalisme, socialisme et démocratie ” (1942), “ histoire de l’analyse économique ” (1954). Par rapport au
libéralisme « standard », il s’intéresse à la croissance à long terme et réfute ainsi l’idée d’une tendance
longue vers l’état stationnaire. Comme « hétérodoxe », il n’hésite pas à faire référence à Marx, et intègre
dans ses travaux des études sociales et politiques. Dans un article de Jean-Sylvestre Mongrenier publié
dans le journal marocain le matin, l’auteur affirme que la crise économique déclenchée par la chute de
Lehman Brothers et le krach boursier du 15 septembre 2008 avait été l’occasion d’un grand happening sur la
victoire finale de Keynes et des néo-keynésiens et même le retour de Karl Marx. Les politiques de relance
alors préconisées et la vision d’un État omniscient, omnipotent et bienveillant sont venues se fracasser sur le
mur des dettes souveraines. Cette crise globale a mis en évidence le décalage entre les structures politico-
économiques européennes (l’État-providence) d’une part, le nouvel état du monde et l’affirmation des
économies émergentes d’autre part. Aussi, la relecture de Schumpeter s’impose-t-elle. Conjuguant théorie et
histoire, politique et psychologie, ses analyses vont au fond des choses ; elles peuvent féconder les situations
et imprimer une nouvelle direction.
A- Le concept de l’innovation dans la pensée schumpetérienne
Si le terme « innovation » est apparu dans la langue française dès la fin du 13ème siècle, il semble que
l’économiste Joseph Schumpeter, soit à l’origine des premiers développements à son sujet dans le domaine
des sciences sociales. Pour celui-ci, l’innovation est le seul moteur de l’évolution et de la croissance
économique. Sans innovation, l’économie serait stationnaire, elle ne connaîtrait que des transformations «
que l’on peut considérer comme plus petites que toute grandeur donnée, si petite soit-elle, et dans un cadre
toujours identique ». L’innovation représente un tout autre type de transformation, c’est une transformation «
qui modifie le cadre » (Schumpeter, 1935, p.87).
Schumpeter conçoit l’innovation comme une nouvelle combinaison des moyens de production : « Produire,
c’est combiner les choses et les forces présentes dans notre domaine. Produire autre chose ou autrement,
c’est combiner autrement ces forces et ces choses. Dans la mesure où l’on peut arriver à cette nouvelle
combinaison en partant de l’ancienne avec le temps, par de petites démarches et une adaptation continue, il
L

3
y a bien une modification, éventuellement une croissance, mais il n’y a ni un phénomène nouveau [...] ni
évolution [...]. Dans la mesure où [...] au contraire, la nouvelle combinaison ne peut apparaître et de fait
n’apparaît que d’une manière discontinue, alors prennent naissance les phénomènes caractéristiques de
l’évolution » (Schumpeter, 1935, p.94).
L’innovation consiste donc en l’exécution de nouvelles combinaisons. Pour Schumpeter, ce concept englobe
les cinq cas suivants :
1. fabrication d’un bien nouveau, c’est-à-dire encore non familier au cercle des utilisateurs ou
consommateurs, ou d’une qualité nouvelle d’un bien existant ;
2. introduction d’une méthode de production nouvelle, c’est-à-dire pratiquement inconnue de la
branche concernée de l’industrie ; il n’est nullement nécessaire qu’elle repose sur une découverte
scientifiquement nouvelle et elle peut aussi résider dans de nouveaux procédés commerciaux pour
une marchandise ;
3. ouverture d’un débouché nouveau, c’est-à-dire d’un marché où, jusqu'à présent, la branche concernée
de l’industrie du pays intéressé n’a pas encore introduit le bien, que ce marché ait préexisté ou non ;
4. conquête d’une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-ouvrés ; à nouveau, peu
importe qu’il faille créer cette source ou qu’elle ait existé antérieurement, qu’on ne l’ait pas prise en
considération ou qu’elle ait été tenue pour inaccessible ;
5. réalisation d’une nouvelle organisation, comme la création d’une situation de monopole ou
l’apparition brusque d’un monopole. (Théorie de l’évolution économique, édition Dalloz).
Les innovations sont à l’origine des périodes d’essor et donc de crise, L’enchaînement de crises et de
périodes d’essor est expliqué par Schumpeter exclusivement par le fait que l’exécution de nouvelles
combinaisons n’est pas également répartie dans le temps. Les nouvelles combinaisons, si elles apparaissent,
apparaissent par groupes et non pas une à une selon une fréquence déterminée. « Si les entreprises nouvelles
apparaissaient indépendamment les unes des autres, il n’y aurait, à notre sens, ni essor ni dépression en tant
que phénomènes particuliers, discernables, frappant, périodiques. [...] Il n’y aurait pas de perturbations
notables du circuit, par conséquent il n’y aurait pas non plus de perturbations de la croissance générale de
l’économie ». (Schumpeter, 1935, p.325).
Selon Schumpeter, trois circonstances renforcent l’action de l’apparition massive de nouvelles entreprises, de
façon interdépendante :
les nouvelles combinaisons ne sortent pas le plus souvent des anciennes mais se dressent à côté
d’elles et leur font concurrence ;
la demande massive des entrepreneurs, qui signifie avant tout l’apparition d’un nouveau pouvoir
d’achat, déclenche une vague secondaire d’essor qui s’étend à toute l’économie.
les erreurs dues à l’essor, erreurs dues au caractère incertain du succès que vont rencontrer les
nouvelles combinaisons, jouent un rôle notable dans l’apparition et le cours de la dépression.
La théorie de Schumpeter s’inscrit dans la même démarche que celle vulgarisée à partir des travaux de
l’économiste soviétique Kondratiev. Ce dernier a tenté de démontrer l’existence de cycles longs du

4
capitalisme (ondes longues / long waves). Un cycle se définit par l’enchaînement mécanique récurrent
suivant : expansion / crise / dépression / reprise. On repère une phase d’expansion à l’accroissement durable
de la production ou des prix (et inversement). La durée moyenne de tels cycles serait de 50 ans. Ils seraient
récurrents, d’où le nom de cycles. Cela donnerait au capitalisme un caractère non stationnaire (remise en
cause de la thèse libérale), et non déterminé (remise en cause de la thèse marxiste). Sous forme de schéma :
BLa dynamique du capitalisme selon Schumpeter : la « destruction créatrice »
la destruction créatrice est, selon Schumpeter, le processus par lequel des entreprises nouvelles, fondées sur
des innovations, se substituent à des entreprises vieillies et routinières, ce qui provoque une disparition des
firmes et branches anciennes, donc une « destruction », mais aussi l’apparition de nouveaux secteurs
porteurs, la « création ».Elle a des effets ambivalents :
elle a des effets dépressifs : la concurrence accrue pour les entreprises vieillies conduisant aux
restructurations, au désinvestissement, au chômage.
mais elle a également des effets expansifs : investissements forts et créations d’emplois dans les
activités nouvelles, développement économique grâce à l’élévation du niveau de vie.
Démonstration :
phase d’expansion :
en phase d’expansion, les innovations majeures permettent à ceux qui les maîtrisent de disposer d’un
monopole temporaire => superprofits dans la branche innovante => attraction d’investisseurs attirés par ces
profits => effets d’entraînement amont-aval ( plus de commandes aux autres secteurs, par exemple) => plus
d’investissements => accélération croissance économique => créations d’emplois, surchauffe (la demande
est trop forte hausse prix, hausse TXI car trop d’investissements à financer) => dégradation de la rentabilité
des activités nouvelles.
Phase de dépression:
saturation marché des innovations + destruction des activités anciennes => baisse des profits dans les
secteurs innovants, restructurations dans les secteurs vieillis => désinvestissements, licenciements,
restructurations => recul de l’activité => baisse Demande => dégradation de la conjoncture, baisse prix,

5
baisse des TXI => capitaux disponibles pour financer les prochaines innovations (on retrouve le constat
empirique du précédent, à savoir la montée des inventions durant la phase B).
B- Le rôle de l'entrepreneur et ses caractéristiques chez Schumpeter
Selon Schumpeter, l'entrepreneur est au cœur de l'analyse. Un entrepreneur est un innovateur, c'est à dire
quelqu'un qui brise la routine. Il faut donc savoir innover ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs. Une
innovation, c'est l'application industrielle et commerciale d'une invention. Un innovateur n'est donc pas
forcément un inventeur, puisqu'il peut se servir des inventions des autres. Prenons pour exemple Henri Ford
qui était un innovateur alors que Bill Gates a inventé et innové un nouveau produit.
D'après l'interprétation de J. Schumpeter, Henry Ford ne devient pas entrepreneur quand, à 43 ans, en 1906,
il est un chef d'entreprise indépendant, mais quand, en 1909, il commence à fabriquer son fameux modèle T,
très vite connu sous le nom de voiture Ford 3. Ford est encore entrepreneur quand, perfectionnant la division
du travail dans l'industrie automobile, il adopte le procédé du train d'assemblage, usant d'autre part d'une
politique basée sur le principe de la baisse progressive des prix, combinée avec l'accroissement du débit. Il
réalise alors une combinaison du second type : introduction d'une méthode de production nouvelle.
Pour Schumpeter, l'entrepreneur doit posséder des qualités exceptionnelles pour ne pas être un simple
producteur. En effet, il doit avoir le goût du risque, doit être visionnaire et donc capable d'anticiper et de
réussir ou non. Il doit être également dynamique, ambitieux, travailleur, passionné, capable de sang froid...
Mais, un entrepreneur n'est pas forcément le propriétaire d'une entreprise. En effet, il n'est pas obligé d'être
intégré à la structure organisationnelle de la firme. Il peut être salarié. Par contre, le propriétaire de
l'entreprise, que l'on appelle aussi capitaliste, doit fournir le crédit nécessaire à l'entrepreneur. C'est donc
cette personne qui risque de perdre les fonds apportés en cas d'échec. Mais reste à savoir pourquoi innove t-
il ? Il y a plusieurs raisons qui motivent l'entrepreneur. En effet, en situation de concurrence, le profit est nul,
il faut donc innover pour récupérer du profit. Par exemple, avec une innovation de produit, l'entreprise sera
pricemaker et proposera alors un prix supérieur à la concurrence pure et parfaite. Déplus, avec une
innovation de procédés, les coûts de production seront plus faibles et le profit (qui est l'écart entre les prix et
les coûts de production) va augmenter. Sauf si on décide de baisser les prix pour accéder à la situation de
monopole. L'entrepreneur veut aussi se donner dynamique aux yeux de la société et ainsi créer un empire. Il
cherche alors le succès.
C- Actualité et limites de la thèse schumpétérienne
a) - Actualité
Aujourd’hui, vingt ans après la fin de la Guerre froide et l’effondrement des socialismes, un retour sur la
démarche développée par Schumpeter s'impose moins par ses capacités de prédiction qui ont été nulles, mais
plutôt par l'ampleur même de sa vision qui nous autorise à revenir sur les liens fondamentaux qui lient le
capitalisme et la démocratie, et sur leur incompatibilité de principe dès lors qu’il s’agit d’accorder à la
démocratie un rôle actif dans la redistribution de la richesse. Plus près de nous, le livre de Schumpeter
représente encore et toujours un point de départ fort intéressant et fort pertinent à partir duquel cerner les
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%