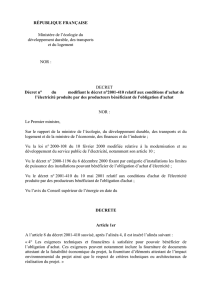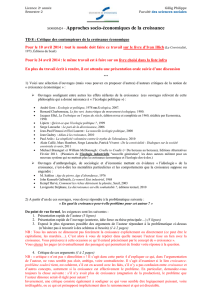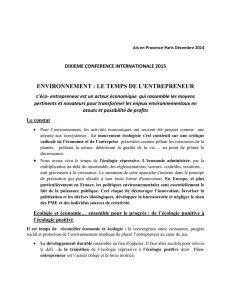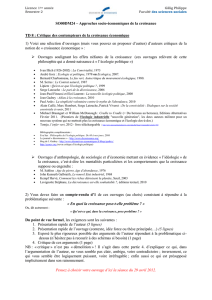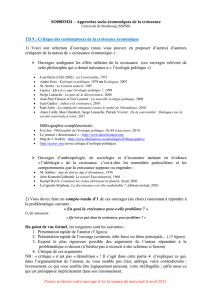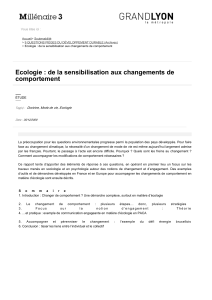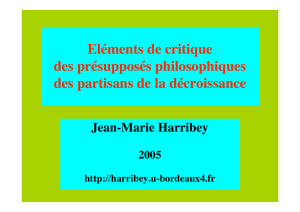L`écologie politique, de la critique de la technologie à la constitution

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris
7
1
L’écologie politique, de la critique de la technologie à
la constitution d’un véritable projet politique
Observatoire des représentations du développement durable (OR2D)
Université Blaise Pascal, ESPE Clermont-Auvergne
!"#$%&#'((
)
)#"
!* ))%#+, '
##%###+-*./
##0 #+, '1 & ' &
* 2+% #+#$##+3 /45564557
899489960: )##
## + # +) #* #
# ;Des stratégies industrielles viables< =, # ###
/45750"##,,,>###%
;dans un système industriel traditionnel, chaque opération de transformation,
indépendamment des autres, consomme des matières premières, fournit des produits que l’on
vend et des déchets que l’on stocke. On doit remplacer cette méthode simpliste par un modèle
plus intégré : un écosystème industriel< /4575 * 49?0* 2 ) #
' ) #$% @A&A ' *
# '#+, #&
$ & # : > *
# ) # @ , ,"
# /#0#@#$#%'$#
$ ;#%<"##@#$#@ *
#,,&#,)&# $
,# % #@ @# #+#$ #% /%
B 45550* 2 " # #+#$ &
%#'';#%< 2, ,C#)/455D * 8570 &
E;La prétention d’élaborer une écologie politique est, de
surcroît excessive… Elle est loin de parvenir à l’élaboration d’une nouvelle synthèse…<* #
'% %+#%#+
+##+ #%45
)#*+ #
#$#,#, ##%""
# / 45550* . %+ - %
#+ #% #+#$ #% & # #$ #

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris
7
2
,#, # #% 'A# #: # + #
!#%#+#$F
. & % % #%#
& % % % # $ #+#$
#%+ # ,&#* )
&#+#$#% ##$*+#$#%#
+'&#,%# ## ' #
+ $# ##$ #$
+#$* 2 ' # G
# $ +" # Conférence des Nations Unies sur
l’environnement Humain /45D40* ## $# $#) %
# % H# /45ID0 H% ### /45I4 45D40 ,#
2# /45?I0 2 /45D40 ##, /45DJ0 > /45DI0
,# $A$ /45D?0 . /45DD 45D50*** K
:#A #+ #+#$*") )
## ),&###*
, A! ' # , %
#$% /% 455745550*, %
%+## % # ## + #
/$A$ 45D40 # #$ %+## )# #
%/$A$45DD0*=# # /
45DI . 45D4 89440 ' # %*
) # & # ' % '
' # #+#$ #% # $ *
+#$#%#$ #%,
##$%# *#@
##,/45DJ0#,#$A$/45DI0#$
#$%@>/45540#,.,
/45540#$ 7/##
####0$,/899?0
$&#L %L ##'#
#)* %) ) #+#$ #% &
# ## #%* " #$
/89490 H /455J 89490 > /89480 #+#$ #% &
#$ +#%$ $'/
#0##:##+ *.
,, & # ) # " #+#$ #%
; <&%$ #
##D9* M-
#+ $+,#$#A*

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris
7
3
+#$#%) #
## ,#$#
$#Ainsi va le monde$$##
'3,# /45D80##%;c’est à la fin des années 1960 que le terme
environnement a pris son sens moderne, c’est à dire qu’il est apparu comme un sujet de
préoccupation et un véritable enjeu pour les pays industrialisés. La question
environnementale provenait en majeure partie des mouvements de conservation de la
nature <* /8994 * 750*2 #N $#) # #
####$##
* 2+ % # Nature Writers, ,#
2#2 , #)#+# /K#+
59##'#+0###)*
O # ,# 2 Silent Spring M 45?8* " +#
$ ;les graines d’un nouveau militantisme, qui est devenu l’une des plus
grandes forces populaires de tous les temps
1
< /8948 * 480* +% "
, % " % ' # #
K,#2 #+E##+##
! # #+ #
##$%#)E;L’une des caractéristiques les plus
fâcheuses du DDT et des produits similaires est leur façon de passer d’un organisme à l’autre,
en suivant la chaîne de l’alimentation. En voici, un exemple : un champ de luzerne est traité
au DDT ; cette luzerne est donnée à des poules ; les œufs pondus par ces poules contiennent
du DDT. Autre exemple : du foin contenant un résidu de 7 à 8 parts de DDT par million est
donné à des vaches ; le lait de ces bêtes contiendra environ 3 parts de DDT ; le beurre fait avec
ce lait en retiendra jusqu’à 65 ! Ainsi, par l’effet de ces transferts, une concentration
initialement faible peut devenir considérable </45?8P8948*6JQ0*
# 2 The Closing Circle M % & # 45D4* 2
$ $# # " R* #
#+#$ '# # # $
+#$* ) # # % ;Toutes les parties du complexe vital sont
interdépendantes</45D4P45D8*JIQ0*# #,
) %+%+A&A
#$* 8
)
# #+#$%
;la matière circule et se retrouve toujours en quelque lieu</45D4P45D8*64Q0*#
% # $, % # / > ,,
'*0%#) #$%#+ "
4
la troisième rive$,/899D*86D0%%#%+## %
#+ #: $) # # ;comme tout le monde, Les Racines du Ciel de
Romain Gary et Le Printemps Silencieux de Rachel Carlson <*

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris
7
4
$ $ & #+ * ) # ##
%;la nature en sait plus long</45D4P45D8*68Q0*,
%+# ! # *
'# %) # %%+;il n’y a pas, dans la nature, de don gratuit < /45D4
P45D8*6?Q0*2##+ ###$#'%'
%##+ "&
#%,,&#*
2+'#"%+##+#$#%*
2)+##$ ,)2#2 &
###
8
& ') #/&### # ,
# ,#$0 #+# # $# / 89440* +#$
#% D9 & # " #
J
/H######,>0S0 $# /2R
T A Blueprint of Survival0 % ) 45D8 # %
#*
Fig 1 : La longue ascension de l’écologie politique
2
#+ /45D80 # ;#$ #< >
%;l’écologie est une discipline foncièrement anticapitaliste et subversive <*
J
# # & #+"## +Ecologie & Politique ;Penser l’écologie
politique en France au XXe siècle </#6689480*

Colloque « Penser l’écologie politique : sciences sociales et interdisciplinarité », 13 – 14 janvier 2014, Université Paris
7
5
Ecologie profonde Deep
Ecology (1950 – 1965)
,#2#
/Silent Spring45?80
/45II45ID45I7
45?945?60
2
/Science and Survival45?J
2losing Circle45D40
RAPPORT
MEADOWS 1972
CONFERENCE DE
STOCKHOLM (1972)
$A$
/45D445D60Entropy Law
./45D445D50
L’économie et le vivant
##,/45D445DJ0Libérer
l’avenir, la convivialité)
, ,/45DJ0
Small is beautiful
ECODEVELOPPEMENT
(Strong, Sachs)
RAPPORT BRUNDTLAND (1987)
K
/45580
U89/89480
B..K
R
Ecologie politique
$A$455I
,899?899D8944
2##B##8944
,8949.8949
'$#
,
#
Ecologie industrielle
/=,###457503 /45570
) #
#AA''
G
RAPPORT PALEY (1952)
RAPPORT DUBOS
WARD (1972)
BLUE PRINT SURVIVAL
Goldsmith-Allen (1972)
Ecologie industrielle et territoriale
/#8944##89440
H#
/45ID45D945D?0
#$.#%
H%###/45I645DD
4577#,#$0
Projet politique
H/455J0>/89990
#$/89490E
#:#
#+
Journal of Environmental Economics
and Managment (1970)
Ecological Economics (1980)
Journal of Industrial Ecology (1990)
Le travail pionnier de Bertrand de Jouvenel (1957, 1970, 1976)
""/$455?V455?V.89480 # )#
$)#+#$#%## - #%
H# /45ID0 #+ /
89480*=3A %B/899D*?70%'#"%
" # % #*
' ' & #+# ; De l’économie politique à l’écologie politique <
H#&'##
%%+&K3$La puissance de la
civilisation/45D?0*# H# %#++
%#%E;à cette date cet exposé surprit et choqua, et cela alors que je m’adressais à des
économistes de tout premier ordre, pour lesquels j’avais et j’ai grande estime. Simplement
nous ne regardions pas les mêmes aspects des choses < /45ID P45D? * I90Q* #
)#$ H##+#
# %##A+##
##' ,#&#+%#&##
%*## #+%
## H# + # # % &
# *
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
1
/
62
100%