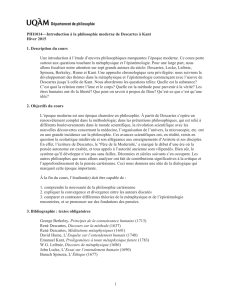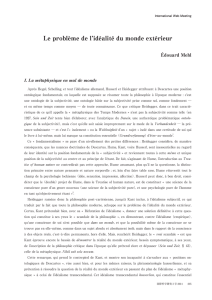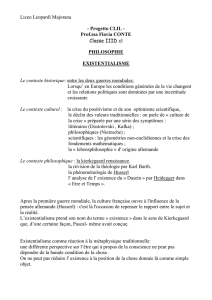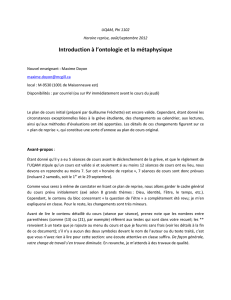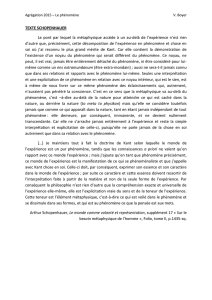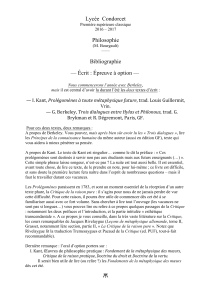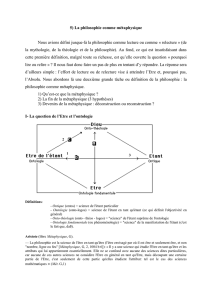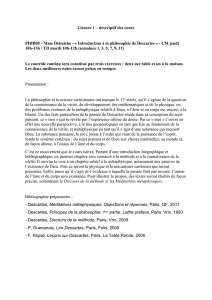Le probleme de l`idealite du monde exterieur


International Web Meeting



 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%