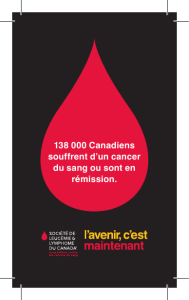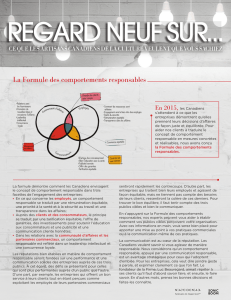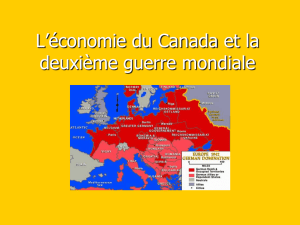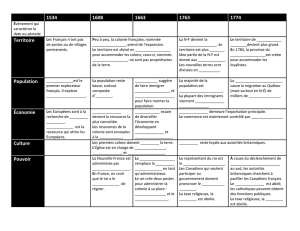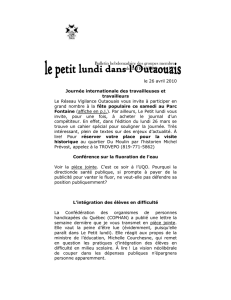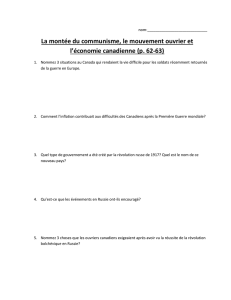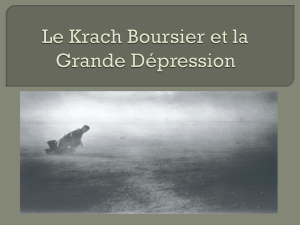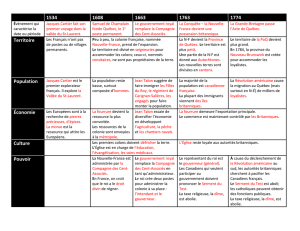La Conquête et la vie économique des Canadiens

La Conquête et la vie
économique des Canadiens
TN
bref rappel de ce qui existait avant la Conquête
^ permettra d'esquisser les données physiques et
les réalités historiques frappées par cet événement.
Les Canadiens habitaient un pays du Nord. Pelle-
teries,
pêcheries, forêts constituaient, au début, les
grandes ressources naturelles de ce territoire. La ri-
gueur du climat ne tolérait qu'une agriculture aux
produits peu recherchés. Les possibilités commer-
ciales agricoles se voyaient circonscrites car, à cette
époque, les puissances colonisatrices européennes mé-
prisaient l'agriculture non tropicale.
L'Histoire de la Nouvelle-France révèle le rôle im-
portant joué par la traite des pelleteries. II revenait
à ce commerce de déclencher l'établissement des
premiers postes, de financer l'administration, de servir
de grand moyen d'échange aux colons. L'agriculture,
essentielle parce qu'elle assurait le vivre, n'apparaissait
pas moins comme au second plan. A cause de la faible
demande extérieure, beaucoup de colons ne visaient
qu'à récolter le strict nécessaire pour nourrir
leur famille. L'opposition entre la course des bois et
le défrichement suscita une kyrielle de plaintes.
Cependant, y aurait-il eu colonisation agricole sans
commerce des pelleteries? Outre la traite et l'agri-
culture, la forêt alimentait la construction navale et
fournissait matière à l'exportation en autant que le
réclamait l'empire français. Les pêcheries, même
négligées, entraient en ligne de sompte. Et les auto-

LA CONQUETE ET LA VIE 309
rites s'employaient à diversifier les modes de vie,
encourageant l'artisanat, provoquant la fondation
d'industries manufacturières, cherchant à stimuler les
rapports commerciaux avec la France, l'Acadie, les
Antilles. Sans ignorer l'aspect paysan, il importe
donc de constater l'esprit commercial et d'entreprise
des Canadiens, adonnés à l'exploitation des différentes
ressources du pays, conformément aux données phy-
siques. Sous l'ancien régime, les Canadiens n'étaient
pas exclusivement des paysans, même si ce type
économique l'emportait en nombre. Us procédaient
à la colonisation au sens plein du mot, s'efforçant
d'implanter, en un territoire
neuf,
des activités agri-
coles,
industrielles, commerciales aussi avancées que
l'admettait, en ces temps, un pays d'Amérique.
Survint la catastrophe de 1760-1763: la Conquête
confirmée par la Cession. C'était l'introduction d'un
petit peuple qui présentait des commencements au
moins de développement dans les diverses branches
de l'économie, au sein d'un nouvel empire, c'est-à-dire,
dans un ensemble de relations politiques et écono-
miques autres que colles qui avaient contribué à mo-
deler sa vie. Un problème surgit
:
quelles forces désor-
mais vont influencer la vie économique des Cana-
diens? En quoi cette vie sera-t-elle modifiée? En
d'autres termes, quels seront les effets de la Conquête
et du maintien, par la violence, dans l'empire bri-
tannique, du peuple canadien de 1760 ? Ce problème
vaut la peine d'être scruté. Faire abstraction de
l'Histoire, c'est s'exposer à juger superficiellement
la situation économique contemporaine. Il n'est pas
oiseux de remonter à la source, d'interroger surtout
les cent premières années qui suivent la Conquête.
On a chance d'y découvrir l'explication peut-être de la
crise économique actuelle des Canadiens, en étudiant
leur vie à une époque témoin de graves boulever-
sements. •

310 L'ACTION NATIONALE
Que l'on enregistre, sans plus pour l'instant, on y
reviendra plus loin, un phénomène qu'on peut appeler:
le repliement agricole. Pour les générations qui pous-
sent après 1760, restait surtout un métier: la culture
de la terre. La vie agricole en vint à s'identifier avec
presque toute la vie économique des Canadiens pour
plus d'un siècle après la Conquête. Ctest après 1760
et non avant qu'il est bien plus juste de dire du
Canadien: paysan d'abord. Cette concentration dans
l'agriculture est à examiner à un double point de vue:
de l'intérieur de cette agriculture, dans les facteurs
internes qui la conditionnent (possibilité d'acquérir
de la terre, instruction technique, intensité de la
demande) et de l'extérieur, dans les rapports de cette
agriculture avec les autres activités économiques
(exploitations primaires, transformations manufac-
turières, commerce, finance, etc.) On s'arrêtera, en
premier lieu, à considérer l'aspect intérieur, afin de
déceler, si possible, dans les traitements mêmes
réservés aux agriculteurs après 1760, les causes histo-
riques de l'infériorité économique des Canadiens.
C'est un fait connu que l'agriculture, au premier
siècle après la Conquête, se caractérise par l'économie
paysanne, nommée aussi économie de subsistance ou
économie fermée. On peut donner comme définition
de cette autarcie à échelle réduite: une tendance vers
la production, à l'intérieur d'une même ferme et dans
le cadre familial, de tout ce qui est nécessaire à la
satisfaction des besoins fondamentaux d'ordre maté-
riel,
nourriture, vêtement, habitation, etc., dans un
esprit de contentement, de vie simple, sans idée
d'accumulation, de poursuite de la richesse pour elle-
même. Une mise au point s'impose pourtant. La
stricte économie fermée, si elle a pu exister au tout
début de l'humanité, était devenue au milieu des
XVIIle et XIXe siècles depuis bien longtemps, une
impossibilité. Le paysan ne trouvait pas tout sur sa
terre et avec le temps des besoins s'étaient créés qu'il
pouvait de moins en moins satisfaire seul. Pour la

LA CONQUETE ET LA VIE 311
paysannerie même, le marché a son importance.
O'est précisément dans le cas où les paysans ne se
« suffisent » pas, quand ils peuvent vendre une partie
de leurs produits et se procurer en retour les services
que seul autrui peut leur rendre, qu'ils forment une
classe satisfaite de son sort, indépendante et stable.
L'économie paysanne implique l'idée qu'on ne tra-
vaille pas pour le marché au point d'être dominé par
ses exigences, mais ne signifie pas qu'on affiche un
désintéressement absolu vis-à-vis du marché. Aux
facteurs, territoire et technique, que la plupart des
études sur l'agriculture des Canadiens se contentent
d'envisager, il faut joindre le facteur: marché. Quels
seront donc, à l'intérieur de l'agriculture, les effets
de la Conquête et de l'Occupation britanniques sur
chacun de ces trois facteurs: marché, technique et
territoire. ?
Durant ce premier siècle après 1760, le marché
intérieur demeure restreint. Plus des trois quarts de
la population sont agricoles et malgré des disettes
quasi périodiques, trois années sur quatre présentent
une récolte satisfaisante et la consommation inté-
rieure, les deux tiers du temps, laisse un surplus pour
l'exportation. Mais c'est surtout le rôle du marché
extérieur qu'il importe de souligner. Toute colonie,
en effet, progresse par la vente hors de son territoire
d'un ou de plusieurs grands produits naturels. Pour
le blé, principale denrée nordique exportable, la Con-
quête fut-elle un changement pour le mieux
?
En réa-
lité,
pour le commerce extérieur agricole, on dut
affronter des difficultés semblables à celles que ren-
contra la Nouvelle-France. Aux obstacles naturels,
isolement hivernal jet distances océaniques, s'ajouta
la concurrence des États-Unis. On ne put réussir à les
expulser après 1783 du commerce impérial et les
Révoltés privèrent le Nord américain resté loyal, des
marchés agricoles non satisfaits de Terreneuve, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et surtout
de l'important débouché des Indes Occidentales.

312 L'ACTION NATIONALE
La Grande-Bretagne, qui fut un temps, vers 1790 et
1800,
un excellent client à cause des guerres euro-
péennes, protégea sa propre agriculture après 1815,
en dépit des protestations de l'Amérique du Nord
britannique. Ces colonies n'obtinrent l'admission libre
de leurs grains qu'en 1843, pour voir bientôt annuler
cette faveur quand l'Angleterre adhéra au libre-
échange. Au premier siècle après la Cession, le
Québec n'est donc pas commercialement d'abord un
pava agricole, mais plutôt un pays de fourrures
(1760-1820) et de bois (1810-1850...). L'exploitation
de la colonie se trouve, par conséquent, peu favorable
à la masse de sa population, les paysans canadiens.
Si la Conquête améliore légèrement le marché, elle ne
suscite cependant pas une grande prospérité agricole.
Il y a plus. Tandis que les agriculteurs du Bas-
Canada cherchaient vers l'est un marché, se déversait
venant de l'ouest et portée par le Saint-Laurent, une
production agricole de même nature. L'invasion des
grains du centre américain eut son effet déprimant
mais c'est surtout la colonisation rapide du Haut-
( anada, colonie décuplant sa population en 35 ans
après 1815, qui introduisit dans le Québec une impo-
sante quantité de denrées, également à la recherche
d'un débouché. Une espèce de « dumping », appré-
ciable dès 1800, lourd à partir de 1830, se superpose
à la médiocrité des marchés pour former un ensemble
où règne ordinairement la surproduction agricole.
Dans le Bas-Canada, au premier siècle après la Con-
quête, il n'y avait donc pas place pour une grande
agriculture payante, capable de garder à l'aise une
population presque entièrement agricole. Il n'y avait
pas l'excitant économique voulu pour réveiller le
paysan, le transformer en un cultivateur en état
d'établir ses lils, l'encourager à persister dans son
métier, l'inciter à perfectionner sa technique, à éten-
dre son domaine.
La technique agricole des Canadiens s'attira,
durant ce même siècle, des critiques qu'on peut
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%