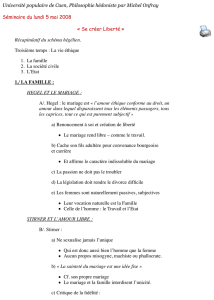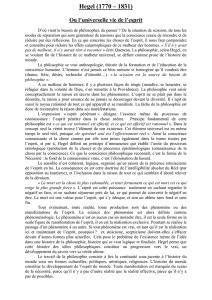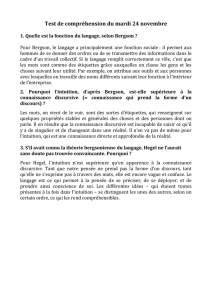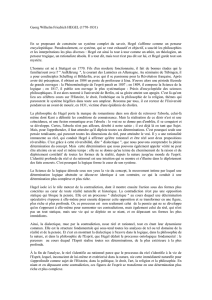Judith Butler Sentir ce qui est vivant dans l`autre. Le premier amour

1
Judith Butler
Sentir ce qui est vivant dans l’autre. Le premier amour de Hegel
Il y a peu de raisons manifestes de penser ensemble Hegel et l’amour. D’abord, pour
beaucoup Hegel lui-même n’est guère « aimable ». Et beaucoup de ses lecteurs ne voudront
pas prendre le temps de ces réflexions. En second lieu, on comprend habituellement le
langage de l’amour comme une proclamation directe ou une expression lyrique d’un certain
genre. Troisièmement, l’amour a un lien à des images et à des mouvements, à ce que nous
imaginons du temps et encore, ou plutôt, à une forme d’imagination et de mouvement qui
semble nous mener à ces répétitions et élaborations ; Le thème de l’amour semble donc une
mauvaise voie d’accès à Hegel dont le langage est dense, qui dévalorise explicitement les
formes artistiques non langagières et pour qui l’adresse directe (au lecteur) et le style lyrique
semblent également à éviter. C’est pourtant un sujet qu’il a abordé dans ses premières
œuvres ; « amour » est dans ses premiers écrits le nom de ce qui anime et mortifie ; et ce
qu’il avance a des conséquences claires pour concevoir les sens et l’esthétique en général.
Dans les années antérieures à la Phénoménologie de l’esprit (1806) par exemple, Hegel
écrivit un texte intitulé « Amour », dont il reste un fragment. Nous trouvons aussi d’autres
remarques dans un petit texte qu’on appelle actuellement « Fragment d’un système »
(1800). Ensuite, semble-t-il, l’amour disparaît ou est écarté, ou encore il est absorbé dans ses
textes sur l’Esprit.
Comment lisons-nous Hegel sur l’amour ? Y a-t-il de l’amour dans sa langue philosophique ?
Son premier art d’écrire met au premier plan des phrases déclaratives. Pas seulement parce
qu’il connait le Vrai et l’affirme avec une immense confiance, mais aussi parce qu’une phrase
déclarative est une manière de faire advenir ou de faire déchoir ce qui est dit. Une phrase
installe le sol de la suivante et une idée est éprouvée ou développée sans être établie par un
enchaînement déductif. De fait, bien que nous puissions tenter, comme beaucoup de ses
lecteurs l’ont fait, d’extraire de ses écrits des propositions, de les organiser en arguments qui
reposent sur des prémisses premières et secondes d’où découlent des conclusions logiques,
je voudrais suggérer qu’il se produit autre chose dans le mouvement de son écriture.
Lorsqu’une phrase est affirmée, qu’elle prend la forme d’une déclaration, quelque chose
devient manifeste, une manière particulière de considérer le mot est établie, une certaine
prise de position est « actée ». Nous pouvons dire qu’un point de vue est « acté » dans la
forme de la phrase. Ainsi, lorsque vient la phrase suivante, elle ne se limite pas à développer
le même point de vue. Parfois, il s’agit d’un point de vue différent qui commente de façon
critique le premier, ou qui nous montre une conséquence inattendue du premier. Cela peut
arriver parfois dans une courte séquence de phrases, ou même dans un paragraphe ou deux

2
et nous continuons à réfléchir à ce qui se joue (se passe) « entre » ces termes et au suivi de
ce qui a été « acté » (établi) dans le temps du déploiement de ces phrases. Mais alors
intervient un certain tournant – ce peut être parfois par le biais d’une clause subordonnée,
parfois aussi cela prend place par un changement dans le ton ou dans la modulation de la
voix. Nous voyons à ce moment-là que le point de vue originel, qui était affirmé avec
confiance par la proposition isolée ou dans la courte suite de propositions, a été lentement
mis en question. Cette exigence particulière de mise en question n’est pas la même chose
que d’exposer une érosion interne du sol même de la proposition ou de la séquence de
phrases. Pourtant, une part de la confiance dans la séquence initiale se trouve ébranlée par
ce qui vient ensuite. Ce qui est advenu en second semble bien suivre de ce qui venait
d’abord, ce qui veut dire que la semence de ce trouble - que Hegel nomme parfois Unruhe –
était là dès le départ. Simplement, on ne le voyait pas, ou il était mis de côté au début de
l’exposé. Cet ébranlement se produit donc, mais pas comme l’irruption soudaine du
nihilisme ni comme la renonciation violente à ce qui est venu auparavant. Au milieu du
développement de ce qui est exposé, la forme déclarative a perdu sa fiabilité. Cela peut se
produire simplement par la répétition de la forme déclarative sur un mode tout aussi
confiant, mais alors à ce moment le lecteur est confronté à deux prétentions concurrentes,
exposées avec une égale confiance. Posons la question suivante : la voix d’autorité garde-t-
elle le contrôle sur son propre matériel en ce carrefour ? Ou bien y a-t-il quelque chose dans
le matériel même qui implique un retournement ? La voix est revenue sur elle-même sans
précisément s’autodétruire et sans, à proprement parler, répudier ce qui précédait. Posons
la question : cette involution a-t-elle quelque chose à voir avec l’amour ?
En exposant ce qu’est l’amour, Hegel effectue un retournement qui concerne autant le
thème qu’il expose que son exposition. Nous comprenons, pourrions-nous dire, que quelque
chose dans la nature même de l’amour est réversible ou se retourne et nous avons à trouver
un mode d’écriture qui reconnaisse et explicite cette réversibilité. La présentation doit se
conformer à ce qu’exige ce qui est présenté. Ce qui « est » là exige sa propre présentation
dans le discours tout simplement pour « être ». En d’autres termes, la présentation de
l’amour est le développement ou l’élaboration dans le temps de l’objet de l’amour si bien
que nous ne pouvons distinguer l’amour lui-même, en tant qu’objet, thème ou problème, de
sa présentation (ce qui ne veut pas dire, pourtant, que l’objet soit réductible à son mode de
présentation mais seulement que l’objet ne devient disponible que par sa présentation).
L’amour ne peut rester un sentiment muet et intérieur, il appelle en quelque sorte une
présentation discursive. Je ne veux pas dire que tout amour doive être confessé ni déclaré
pour être qualifié d’amour, mais seulement que le mode déclaratif est autre chose qu’une
idiosyncrasie dans l’approche du problème de l’amour pour le Hegel de 1787. L’amour doit
se développer dans le temps ; il a une allure ou une forme qui ne peut être réduite à une
proposition isolée. Il doit y avoir une suite de phrases, déclaratives et interrogatives, sur

3
laquelle s’enregistre une confiance qui, tour à tour, progresse et se défait, mais aussi qui
prend l’initiative de survenir de façon inattendue; et tout cela fait de ces mouvements des
phrases une part du phénomène lui-même. En somme, qu’il soit muet ou vociférant,
intraverti ou extraverti, le phénomène de l’amour a, dans sa propre logique, quelque chose
qui rate ou qui se développe dans le temps et qui, nous allons le voir, ne s’épanouit jamais
dans l’actualité d’une forme définitive mais se définit par son ouverture indéfinie.
On attend peut-être de Hegel un système qui totalise, mais cette erreur a fait son temps.
Dans la Phénoménologie il établit cette ouverture dans l’analyse de ce que font les
déictiques. Dans la relation au « maintenant », au moment absolument immédiat, il s’avère
que le maintenant a toujours été un passé au temps où nous nous sommes référés à lui.
Nous avons perdu le « maintenant » - ou l’avons vu se défaire- au moment où nous le
montrons, ce qui veut dire que l’acte de se référer à ne parvient pas à capter son référent.
De fait, l’incidence du temps qui émerge lorsqu’on tente de montrer le « maintenant »
établit un retard qui affecte toute la fonction de référence. Le problème n’était pas que
montrer le « maintenant » l’a renversé en un « alors », mais que l’acte de montrer,
l’indication a toujours été retardé ; c’est seulement lorsque le « maintenant » devient un
« alors » qu’il se réfléchit mais aussi bien se défait en tant que « maintenant ». Un décalage
temporel sépare le langage qui cherche à indiquer le « maintenant » du moment indiqué, il y
a donc une différence entre le temps de l’indication et le temps de ce qui est indiqué. Le
langage, en ce sens, manque ce qu’il inscrit et il doit le faire pour se référer en tout cas au
temps de ce dernier. En ce sens, le « maintenant » est invariablement un « alors » au temps
où il devient disponible pour nous par le langage (ce qui est d’ailleurs la seule manière dont
il devient disponible puisqu’il n’y a pas de relation non médiatisée au « maintenant »). Hegel
n’est pas un vitaliste ; il ne pense pas que l’immédiat soit à notre disposition sans médiation,
même si, inlassablement, il s’emploie à considérer de près les expériences qui nous
semblent être « les plus immédiates » ou les plus évidemment immédiates. « Médiation » a
au moins deux significations ici : premièrement, tout ce qui nous devient disponible dans
l’expérience est revenu de l’extérieur et s’est réfléchi en nous par un moyen extérieur lui
aussi. En second lieu, tout ce qui nous devient disponible dans cette traversée et cette
réflexion en nous à partir de l’externe se trouve toujours à distance de son lieu et de son
temps d’origine. En d’autres termes, un certain déplacement dans l’espace et le temps
conditionne le connaître. Hegel rapporte souvent ce mouvement à un « retour » [sur soi] à
partir de l’objet.
Lorsque nous réfléchissons au « maintenant », il y a toujours quelque opération temporelle
qui excède ce que nous nommons le « maintenant » et sans laquelle nous serions tout
simplement incapables de nommer le « maintenant ». Il en va de même pour tout ce que
nous pouvons appeler la « fin » d’un processus – de fait, au moment où nous nommons la

4
fin, elle est déjà passée, ce qui veut dire que le temps de la nomination se produit au-delà de
cette fin (outrepasse cette fin), et entre dans un autre registre du temps. La fin, pour autant
qu’on puisse la nommer ou l’indiquer, change d’allure et se révèle moins « terminale » qu’il
n’y paraissait. Quel nom allons-nous donner à ce temps qui est en excès par rapport à la fin ?
Ce n’est pas clair. Si nous avons un moyen langagier d’indiquer ce temps, ce sera un moyen
qui agit dans l’opération d’un retard. Et si nous pensons qu’une tristesse endeuillée travaille
de l’intérieur cet acte d’indiquer, nous pourrons bien avoir raison. Comment pouvons-nous
revenir de cette perspective à la question de l’amour ? Y a-t-il une certaine persistance du
temps qui ouvre au sens de la fin ou de l’au-delà de la fin ? Ou encore, y a-t-il une fonction
poétique étrange de la fin ? Comment l’amour et la perte sont-ils impliqués dans cette
formulation? Y a-t-il un moyen d’éviter le deuil et la tristesse qu’implique la perspective de
Hegel ? Ou bien est-ce que le deuil, inversement [dans cette inversion] précèderait
l’amour ?
Le fragment de Hegel sur l’amour commence par cette question : comment les personnes
participant à une religion concilient-elles leur individualité avec leur appartenance à une
communauté ? Il est intéressant de noter qu’au départ on ne pose pas la question de savoir
si l’individu est séparé de la communauté ou si, au contraire, il ne se trouve en quelque sorte
uni à la communauté qu’en comprenant le rapport de l’individu à la propriété, à ce que
Hegel nomme « l’objet » ou encore « le monde des objets ». Si la religion implique la
propriété collective des objets ou le sacrifice des objets, les individus renoncent au droit de
les posséder. Dans les conditions où la valeur de l’individu dérive de ce qu’il possède, il perd
sa propre valeur quand il abandonne toute forme d’individualisme possessif. Et, en effet,
selon les termes mêmes de Hegel, lorsque l’individu perd tout ce qu’il possède, il en vient à
se mépriser lui-même ; et c’est bien ce qui semble se produire lorsque ce sont des objets qui
donnent sa valeur à la personne et que les objets sont possédés en tant que propriétés de la
personne.
Or, là où il s’agissait de l’existence d’une communauté, c’est plutôt la haine de soi qui
envahit soudain le tableau. La religion est d’abord définie comme forme de participation à la
communauté exigeant le sacrifice ou la négation de la propriété individuelle et,
corolairement, la négation de l’individualité même qui prend la forme de la haine de soi.
Mais alors comment la haine de soi va-t-elle se muer en amour ? Et dans cette économie
l’amour de soi ne dérive-t-il que de l’entrée en possession d’une propriété ?
Hegel introduit aussi un second problème sur un mode surprenant : il semble qu’il veuille
faire porter l’analyse sur les conditions d’une relation vivable, praticable entre l’individu et
son monde. A ce moment, la communauté et la participation à une communauté sont mises
de côté et il introduit un nouveau point de départ. Il y a un second facteur impliqué dans la
séparation de l’individu par rapport au monde des objets. Le premier, c’était la haine de soi,

5
puisque l’individu tentait de renoncer à la possession de sa propre personne mais sans y
parvenir. Le second facteur est aussi alarmant : l’objet lui-même est mort. Lorsque c’est la
propriété qui confère à l’individu sa valeur, les objets du monde sont morts et la personne
est prise dans sa propre haine d’elle-même. Hegel semble vouloir faire contrepoids à de
telles conclusions en cherchant la possibilité d’une union vivante entre les individus et les
objets : s’agit-il d’une alternative à la religion et est-ce une solution qui en appelle à l’amour
ou qui inclut l’amour de quelque façon ? Lorsqu’il écrit « l’objet est mort », nous sommes
nécessairement amenés à poser la question : comment l’objet est-il mort ? Est-ce là la forme
générale de l’objet et en ce sens, de tous les objets ? L’objet est-il mort pour toujours ?
Les objets peuvent mourir de deux manières : par le sacrifice et par la propriété. Il semble
d’abord que Hegel veuille faire en sorte que nous nous gardions de renoncer à la propriété
si cela veut dire renoncer à toutes choses matérielles, à toute matérialité. Mais ensuite, il
paraît chercher une voie qui donne un rôle positif à la matière ainsi qu’aux objets du monde
sans que ceux-ci se réduisent à la propriété. Le texte nous demande d’imaginer d’entrer
dans une configuration du monde où un individu, qui n’aurait pas complètement renoncé à
son individualité, est mis face à un monde d’objets, entouré par ce monde créé par les actes
qui ont sacrifié toute propriété personnelle au profit de la communauté. Lorsque les
individus sont privés de toute propriété, ils sont aussi privés d’une relation vivante aux
objets – les objets sont morts. Quelle possibilité de vie affective reste-t-il alors pour des
individus soumis à de telles conditions ? Ils se mettent à aimer ce qui est mort. Il ne leur
reste qu’à vivre et aimer dans une relation à un objet, à un ensemble d’objets, à un monde
d’objets qui sont morts. Et en ce sens ils demeurent dans une relation vitale à ce qui est
mort. Les objets morts constituent, en effet, le second terme de la relation d’amour. Dans
ces conditions donc, l’amour aime un matériau qui est indifférent à celui qui aime. Cette
relation n’est justement pas une relation vivante. Et lorsque Hegel entame sa réflexion sur
« l’essence de l’amour à ce niveau » (« in seiner inneren Natur »), il ne nous parle pas de
l’essence de l’amour en tout temps, il nous dit seulement comment est constituée l’essence
de l’amour dans les conditions où est requis le sacrifice, c’est-à-dire là où la religion exige
que les individus se séparent de leurs objets comme clause de participation à une
communauté.
Hegel adopte à présent le point de vue de celui qui a composé avec l’obligation de perdre ce
monde d’objets, de vivre dans un monde d’objets morts, et de vivre jusqu’au bout les
conséquences de ce mode d’amour particulier dans lequel on n’a de rapports d’amour
qu’avec des objets morts. Il est intéressant, bien sûr, que l’amour lui-même ne soit pas
annihilé par ces conditions. L’amour y prend plutôt une forme nouvelle. On pourrait même
dire que l’amour y acquiert une forme spécifiquement historique. Celui qui vit dans une telle
configuration n’a pas simplement perdu le monde des objets, il continue au contraire
d’aimer ce qui est entré pour lui dans la mort ; et, dans le même temps, il garde espoir que
cette perte sera compensée, qu’il y gagnera une certaine éternité ou infinité, et qu’ainsi il se
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%

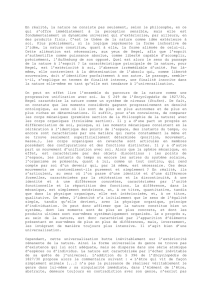

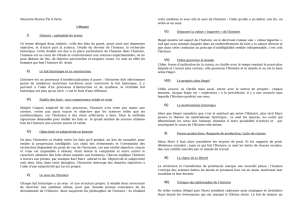
![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)